01/02/2012
Sylvie Kandé (une lecture de Georges Guillain)
Sylvie Kandé La Quête infinie de l’autre rive
Épopée en trois chants
Éditions Gallimard, Collection « Continents noirs », 2011
“IL EST TEMPS QUE LA PAROLE ACCOSTE”
Lecture de Georges Guillain
On aura peut-être trop facilement et trop longtemps considéré que l’épopée renvoyant aux enfances d’un peuple ou d’une nation, à ses origines, est incompatible avec les exigences de nos temps prétendument épuisés préférant décliner leurs insuffisances ou l’avantageuse mesquinerie de leurs supposées supériorités plutôt que de célébrer la grandeur et le courage crus de l’homme. L’ouvrage de Sylvie Kandé ne manquera donc pas de surprendre : en trois chants, il réintroduit au sein de notre langue et de notre temps la geste poétique de héros qu’une même volonté de dépassement, d’affirmation de soi, malgré les différences de conditions et de circonstances, conduit à se lancer dans la même périlleuse entreprise d’atteindre par delà les mers un monde différent.
L’histoire que nous raconte ainsi l’auteur est l’histoire d’une quête. Mais là où elle aurait pu se contenter d’évoquer, comme elle le fait dans son troisième chant, celle de ces dizaines de milliers d’africains qui dans l’espoir d’atteindre l’Europe, poussés qu’ils sont par la nécessité économique, s’entassent sur des embarcations de fortune, se livrant aux imprévisibles et meurtriers caprices de la Méditerranée, Sylvie Kandé situe son récit dans la perspective d’une autre traversée : celle de l’Atlantique, qu’aurait tentée au tout début du XIVe siècle ― soit bien avant la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb ― le grand empereur mandingue, Aboubakar II (alias Bata Manden Bori) afin de « savoir si le monde avait bien la rondeur grenue d’une gourde/ – ou si plate comme une paume de paix / une terre unique souffrait qu’à son entour / l’océan entaille de son massif estoc / ses longs doigts de sable de craie et de roc ». LIRE LA SUITE
■http://terresdefemmes.blogs.com/

Sylvie Kandé est née à Paris d’une mère française et d’un père sénégalais et réside à New York. Elle s’intéresse principalement aux nouvelles identités produites par la traite esclavagiste, les migrations et conversations entre l’Afrique et l’Occident. Ancienne élève d’hypokhâgne et khâgne au lycée Louis-le-Grand, elle est Associate Professor à SUNY Old Westbury, où elle enseigne en tant qu’Africaniste. Elle est titulaire d’une maîtrise de lettres classiques (Paris IV- Sorbonne) et d’un doctorat de troisième cycle en histoire africaine (Paris VII) écrit sous la direction de Catherine Coquery-Vidrovitch. De 1994 à 2001, elle a construit le programme d’études francophones à NYU et y a reçu une médaille d’enseignement, le Golden Dozen Teaching Award. Elle a dispensé des cours dans plusieurs autres universités américaines, notamment à Stanford University, the New School, Rutgers University et CUNY. En 2007 et 2008, elle a enseigné dans le cadre d’un séminaire d’été au Schomburg Center for Research in Black Cultures (le Mellon Humanities Summer Institute).
20:16 Publié dans Georges Guillain, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sylvie Kandé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
28/01/2012
Bernard Vargaftig
Hommage à Bernard Vargaftig
(1934-2012)

© Photo : Pierre-Emmanuel Weck
© http://www.weck.info/2010/09/19/bernard-vargaftig/
[…]
C’étaient les bruits ceux qu’on déchire les
Clés d’horloge les miroirs ceux qui tiennent
Dans leur ovale les maisons pliées
En quatre le temps à peine et les rênes
Qu’on laisse aller autour des morts autour
De l’eau avec chèvres et peupliers
Et carriole sur le vide la même
Route que nous courons comme reviennent
Rêves et paroles grand escalier
Rapace de chaque côté du jour
-------------------------
Saute sur les bêtes sur le breuil la
Mort ailleurs ce qui s’oublie les voitures
Mal englouties remplies de temps d’éclats
Eparpillés copeaux de mots sur
D’autres mots comme on croit fuir ô fracas
Château d’aiguilles déchiquetées sciure
Sur le sang au bas des marches un rat
Tel un récit et toutes ses chaussures
D’air jusqu’à se taire serrer les murs
L’eau les portes les fentes contre soi
-------------------------
J’entends la guerre
Les guêpes
Muettes
Sur le charnier
et les bombes silencieuses
Chicots d’instant
où
me suis-je tu
le soleil
l’ourlet qui file
Et l’un l’autre Bruna Zanchi
Editions Belfond, 1981
-------------------------
Les bruits sont lents ils font un paysage
D’oubli et d’eau de pentes qu’on remonte
Petites peurs frottées les unes aux autres
C’était rêver le ciel dans les bassines
Entre les noix et le bois sec le chanvre
Quelles durées fuient toujours dans la mienne
Semblants de mots d’habitudes qui cèdent
Quand on dirait qu’une à une les choses
S’étendent et se recouvrent indifférentes
Ombre enlisée enfance complaisante
Et que déjà l’herbe pousse à travers
-------------------------
Je m’étendais contre ma mort j’avais
Ses ongles et ses trous je la comblais
De mots de peurs abstraites sans issue
Rail et silence où s’effondrent les villes
Marque pliure usures dérisoires
Tout un savoir sans signification
Les noms se changent en pierre en coin en verre
Brisée platras de fuites qui s’effritent
Bouchent les murs contiennent les fontaines
Bruits de chevaux et d’anneaux sous les voûtes
Pas d’autrefois quand nous nous embrassions
Description d’une élégie
Editions Seghers Poésie 75, 1975
-------------------------
C'est quand ainsi tu me saisis
Mouvement auquel rien ne se confond
La trace du ciel
Avant qu'il n'y aura eu le ciel
Un effacement chaque roche
Soulèvement sans aucun savoir
A nouveau plus loin en moi que ne sont
Où que j'aille la clarté la grève
Vite avec puisque même éparse
La déflagration ne se tait pas
Entre aube toujours inclinée et mouettes
Dans un fragment d'appartenance
Les amandiers j'entends comme ils tremblent
Qui font espérer
Pour avoir été ce déchirement
Dont le souffle garde l'abîme
Ce n'est que l'enfance (p.53)
Editions Arfuyen, 2008
21:20 Publié dans Bernard Vargaftig | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Guillaume Allardi - Je marche
Guillaume Allardi est accompagné par Florent Manneveau (saxophone) et Karim Kasmi (percussion)
13:49 Publié dans Guillaume Allardi, LECTURE SONORE | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Terres de femmes n°86 – janvier 2012

Responsable de la rédaction : Angèle Paoli
Coordination éditoriale et mise en pages : Yves Thomas
Direction artistique et mise en images : Guidu Antonietti di Cinarca [G. AdC]
08:17 Publié dans Angèle Paoli, FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
27/01/2012
Walter Benjamin, "Ecrits autobiographiques"
Lecture Nathalie Riera
Walter Benjamin
Ecrits autobiographiques
Traduit de l'allemand par Christophe Jouanlanne et Jean-François Poirier
Editions Christian Bourgois, 2011/ http://www.christianbourgois-editeur.com/

Walter Benjamin, « … »
____________________________________________________________________________
Le but de tout commentaire artistique devrait être désormais de rendre l’œuvre d’art – et, par analogie, notre propre expérience – plus réelle à nos yeux et non pas de la déréaliser. Montrer comment l’objet est ce qu’il est ou même simplement qu’il est ce qu’il est, bien plutôt que de faire apparaître ce qu’il peut signifier, voilà le véritable rôle de la critique.
Susan Sontag, « Contre l’interprétation », 1964
Détacher la métaphore des choses, c’est découvrir leur noyau anthropologique, ce qui revient au même que représenter leur signification politique. (…) la métaphore devient finalement, à y regarder de près, la seule forme de manifestation possible de la chose. Le chemin qui permet de pénétrer jusqu’à elle : le jeu passionné avec les choses. C’est par ce même chemin que les enfants pénètrent jusqu’au cœur.
Walter Benjamin, « Notes éparses de juin à octobre 1928 »
■■■ Philosophe du langage, historien de l’art, critique, essayiste, traducteur, sensible au dadaïsme et au surréalisme, rattaché à l’Ecole de Francfort, engagé dans le mouvement des « étudiants libres », Walter Benjamin est longtemps resté inaccessible en France, jusqu’aux travaux de recherches et de traductions de Maurice de Gandillac, Philippe Jaccottet, Marc B. de Launay, Jean Lacoste, Guy Petitdemange, Michel de Valois.[1] Sa philosophie considérée à « dimension messianique » (Michael Löwy), Benjamin consacre dans ses travaux réflexions et questionnements, entre autres sur la « situation moderne » et la perte de la dimension religieuse. Sur ce propos, Eva Geulen écrit : « (…) il n’existe sans doute aucun penseur dont le dédain (…) pour tout ce qui n’est pas « spirituel » (…) soit aussi profondément ancré que chez Benjamin ».
Né à Berlin (1892-1940), victime du nazisme, Benjamin parcourt l’Europe en long et en large (Italie, France, Espagne), et voyage dans les pays scandinaves, et en Russie. Les villes nourrissent sa poétique de la description. Entre 1928 et 1931, Berlin et Marseille seront des lieux d’expériences sur les effets produits par le haschisch sur son imagination : « avec le haschisch, nous sommes des êtres de prose de la plus grande puissance ».
Proche de Theodor W. Adorno, Bertold Brecht, (« le véritable interlocuteur des écrits des années 30 » - La Quinzaine littéraire), Hugo Von Hofmannsthal (qui tenait en haute estime ses travaux), Ernst Bloch, Hannah Arendt, Karl Kraus, Gisèle Freund, Gershom Scholem, et son ami de jeunesse, le poète Fritz Heinle (qui mit fin à ses jours en 1914). Et parmi les personnalités littéraires qui auront influé sur la pensée du philosophe, « les trois grands métaphysiciens »[2] de la littérature que sont Kafka, Joyce et Proust.
Les « curriculum vitae »
Ecrits successivement pour différentes occasions : postuler au titre de docteur, obtenir une bourse de l’Université de Jérusalem, ou dans le cadre d’une demande de naturalisation (qui n’aboutira jamais), ces 6 curriculum… ouvrent le recueil des « Ecrits autobiographiques », et nous plongent dans le parcours estudiantin de Benjamin. « Je suis de confession mosaïque », précise t-il, « principalement intéressé à la philosophie, à l’histoire de la littérature allemande, ainsi qu’à l’histoire de l’art »[3]. Ses intérêts pour la théorie du langage le conduisent à un essai de traduction de Baudelaire, ainsi qu’à des lectures « sans cesse répétées de l’œuvre de Platon et de Kant »[4]. De son goût vif pour la littérature française et de son intérêt pour « la teneur philosophique, morale et théologique » de l’écriture littéraire et des formes d’art comme l’allégorie, Benjamin s’adonne à des traductions de « la grande œuvre romanesque » de Marcel Proust et des « Tableaux parisiens » de Baudelaire. Son intérêt pour l’œuvre du poète répond à la nécessité « de faire de la poésie du XIXème siècle le médium d’une connaissance critique de ce siècle » (Curriculum VI, p.45). Les traductions seront aussi l’occasion de longs séjours en France, notamment à Paris, en 1913, 1923, puis de 1927 à 1933.
En situation économique précaire, dans une Allemagne marquée par des bouleversements politiques, Benjamin exerce une activité annexe de chroniqueur littéraire (Curriculum IV).
Dans « Curriculum III » : « (…) tous mes efforts ont tendu jusqu’à maintenant à frayer un chemin vers l’œuvre d’art en ruinant la doctrine de l’art comme domaine spécifique ». Pour Benjamin, il est en effet question de reconnaître en l’œuvre d’art « une expression complète des tendances religieuses, métaphysiques, politiques et économiques d’une époque et qui ne se laisse sous aucun de ses aspects réduire à la notion de domaine (…) une telle réflexion me semble la condition de toute appréhension proprement physionomique des œuvres d’art en ceci qu’elles y apparaissent incomparables et uniques »[5].

« (…) je considère comme une matière particulièrement importante et féconde pour des séminaires et le cas échéant aussi pour des cours magistraux l’histoire des écrits anonymes, ce qui me permettrait de recourir à l’histoire des encyclopédies et des dictionnaires, des calendriers et des anthologies, des périodiques, des tracts et de la littérature de colportage, pour caractériser différentes époques de l’histoire littéraire »
(« Curriculum II », p.29)
« Journal de Wengen »
Chez Benjamin, voyager est l’occasion de sortir de son espace privé, et pour cela il importe d’endosser le meilleur costume. La leçon proustienne : « Je compose ce journal avec des évocations rétrospectives, en partie parce que je sais par expérience que je ne trouve pas le temps chaque jour d’écrire, en partie parce que l’évocation rétrospective éclaire bien des choses »[6]. Benjamin est un globe-trotter de la mémoire et de l’instant présent, ce sont ses déplacements en montagne qui lui procurent ce sentiment ; les montagnes « semblent d’éternels excursionnistes sillonnant le monde, qui avancent à pas lents et quand on est en excursion avec elles, on croit venir soi-même des lointains ».
« Pour la suite de ce pseudo-journal commencé à Wengen le 25, j’éprouve de graves doutes. Seules doivent être retenus les états d’âme, inspirés par la nature de haute montagne, qui varient constamment dans le détail mais sont au fond très semblables ; si de plus on écarte dans toute la mesure du possible les circonstances accessoires pragmatiques et insignifiantes. Et retenir les causes très subtiles des diverses impressions produites par la nature est difficile et parfois pour nombre d’entre elles impossible. Et peut-être est-ce alors, encore une fois, dans des épisodes isolés de l’expérience vécue, pragmatique, ordinaire qui nous escorte, que se trouvent la seule clé et la seule expression ».
(« Journal de Wengen », p.68/69)
Fulgurance du philosophe dans sa manière de saisir les paysages et d’en jouir pleinement. Nécessité souveraine d’imprimer sur la toile de la mémoire tout ce que ses propres yeux sont à même de voir : « … comme nous nous approchons de Genève, je suis seul devant et veux graver en moi tout le tableau, et surtout les montagnes que je vois à présent pour la dernière fois avant longtemps, les montagnes, qui ne sont pas d’une majesté tellement impérieuse, mais sont d’une couleur unie, s’élèvent à une distance rassurante, non déchiquetées – plutôt comme un mur paisible »[7].
Chaque voyage entrepris s’accompagne de lectures, d’études et d’écriture, de visites de monuments religieux, de musées et de théâtres. Ce seront les cartes postales et les livres d’aventures de l’enfance qui auront aussi exercé leur influence sur son goût des voyages.
« Voyager, n’est-ce pas triompher, se débarrasser des passions enracinées qui sont attachées à notre environnement habituel et avoir ainsi une chance d’en cultiver de nouvelles, ce qui est tout de même bien une espèce de métamorphose ».
(« Espagne 1932 », p.235)
« Mon voyage en Italie, Pentecôte 1912 »
L’environnement urbain a autant d’intérêt pour lui que le « grandiose presque architectural » de la nature. Le charme de tout voyage, passé sous le signe d’un « acte culturel international », n’est-il pas aussi de vivre quelques révélations ? comme à l’occasion de la visite du Campo Santo à Naples : « L’endroit n’est absolument pas placé sous le signe du recueillement »[8] et du cimetière milanais : « pas un cimetière à proprement parler, mais un champ de marbre, éblouissant et irritant »[9], ou encore la visite du toit du Dôme, du Brera « où abonde l’art italien de toutes les époques », jusqu’à la rencontre avec la Cène de Léonard de Vinci : « Je ne peux plus éprouver que l’espace et la conscience de voir, en face de moi si grande et si pâle, l’œuvre que j’ai si souvent admirée en reproduction»[10].
L’observation relève d’une manière de vivre l’espace et de ressentir l’espace, son harmonie, son ordonnance, son contenu ou ce qui le compose, et où « le sublime ne peut manquer d’apparaître à la fois dans la monstruosité et la clarté ». Chez Benjamin, la description des rues implique autant un travail d’écriture dans les détails qu’une description minutieuse d’ouvrages architecturaux ou qu’un examen soutenu d’une œuvre d’art. Voir, c’est alors posséder une longue-vue.
« Mai-Juin 1931 »
Dans les notes qui recouvrent cette période de l’année 1931, Benjamin fait cas de sa fatigue du combat pour avoir de l’argent, en même temps qu’un dégoût face à la situation politique et intellectuelle de l’Allemagne. Les notes de ce journal abordent pêle-mêle l’architecture moderne et la littérature, des discussions avec Brecht dont il consacre, par ailleurs, beaucoup de notes. Ces échanges passionnés portent autant sur l’art, sur Kafka, sur le théâtre épique (Calderon, Shakespeare), sur la situation de l’intelligentsia durant la révolution, que sur les modes d’habitation et la « relation de l’habitant avec le monde des choses ».
« Sanary, le 13 mai 1931 : Le plaisir donné par le monde des images ne se nourrit-il pas d’un obscur défi lancé au savoir ? Je vois le paysage au-dehors ; la mer repose dans le golfe lisse comme un miroir ; la masse immobile et muette des forêts monte vers le sommet des montagnes ; en haut, les murs en ruine d’un château, tels qu’ils étaient déjà il y a des siècles ; le ciel resplendit sans un nuage, dans un « azur éternel », comme on dit. Voici ce que veut le rêveur abîmé dans le paysage : la mer fait gonfler et retomber à chaque instant des milliards et des milliards de vagues, les forêts frémissent de nouveau à chaque instant des racines jusqu’à la plus haute feuille, en un mouvement ininterrompu les pierres du château s’effritent et tombent, dans le ciel les gaz, avant de se condenser en nuages, bouillonnent en une lutte confuse, la science poursuit ces mouvements au plus profond de la matière et la façon dont elle le fait ; elle ne veut voir dans les atomes que des tempêtes d’électrons, tout cela il lui faut l’oublier, il veut le nier : pour s’abandonner aux images auprès desquelles (il) veut trouver la paix, l’éternité, le calme, la durée. Un moustique qui bourdonne à ses oreilles, un coup de vent qui le fait frissonner, toute proximité qui l’atteint le convainc de mensonge mais tout lointain reconstruit son rêve, il se redresse à la vue d’une crête de montagne qui s’estompe, il s’embrase de nouveau à la vue d’une fenêtre illuminée. Et il semble parfois connaître l’accomplissement quand il parvient à désamorcer le mouvement même, à métamorphoser le tremblement des feuilles au-dessus de lui en cime, le passage rapide des oiseaux autour de sa tête en migration. Circonscrire ainsi la nature au nom d’images pâlies – c’est la magie noire de la sentimentalité. Mais la faire cristalliser par une nouvelle invocation, c’est le don du poète ».
(« Mai-Juin 1931 », p.189/190)
« Chronique berlinoise »
« Lorsqu’un jour en effet on me proposa de donner à une revue, sous une forme libre, subjective, une série de billets sur tout ce qui me paraissait au jour le jour digne d’intérêt à Berlin – et lorsque j’acceptai -, il apparut tout à coup que ce sujet, qui avait été habitué à rester des années durant à l’arrière-plan, ne se laissait pas si facilement convier près de la rampe ».
(« Chronique berlinoise », p.267)
Dans la postface de la première édition, Berliner Chronik, publiée en 1970 par Gershom Scholem : « Benjamin écrivit ces notes par morceaux et bien souvent d’une écriture extraordinairement rapide et difficile à lire (…) – Malgré leur caractère fragmentaire, ces notes sont précieuses non seulement pour une compréhension de la personnalité et de la biographie de Benjamin mais aussi pour une appréciation de la complexité de sa production littéraire, de sorte que leur publication devrait enrichir très sensiblement nos connaissances »[11]. Dans Chronique berlinoise, il est question de souvenirs d’enfance, mais sans ce recours à la vérité factuelle ou sans cet accent trop individuel ou familial : « Si j’écris un meilleur allemand que la plupart des écrivains de ma génération, je le dois en grande partie à une seule petite règle que j’observe depuis vingt ans. C’est la suivante : ne jamais utiliser le mot « je », sauf dans les lettres »[12]. Le souvenir d’enfance chez Benjamin se construit en référence à un lieu, il s’agit ici de Berlin et de son rapport avec cette ville. Une très juste analyse de Marie-Claude Gourde : « Cette sensibilité aux lieux qui construisent la mémoire installe un espace de figuration qui coupe le lien direct de l’écriture à l’histoire de sa personnalité et qui en fait donc un simple intermédiaire. C’est justement dans cet espace de figuration que s’installe le vrai discours réflexif de Benjamin (…) Certes, Benjamin utilise le « je » pour faire état de ses souvenirs d’enfance, mais le tout ne constitue pas en soi le récit complet de la vie de cet homme, il n’est question de sa personnalité que par l’entremise de ces lieux qui l’ont, d’une manière ou d’une autre, influencé ». Il ne s’agit non plus d’une « reconstruction synthétique de son enfance mais plutôt l’analyse du détail du souvenir, la traque de l’infime et du minuscule »[13].Les souvenirs, aussi étoffés soient-ils, nous dit Benjamin, ne constituent pas pour autant une autobiographie, car « l’autobiographie a trait au temps, au déroulement et à ce qui fait le continuel écoulement de la vie. Or il est question ici d’espace, de moments, de discontinuité »[14]. « (…) l’œuvre mystérieuse du souvenir – qui est en effet la faculté d’intercaler à l’infini dans ce qui a été – (…) »[15].
Quand bien même le caractère autobiographique ne peut être occulté, il s’ensuit que Benjamin a recours à des souvenirs d’images et d’évènements, comme il peut également arriver que « faute de souvenirs ou de notes précis, quelques inexactitudes chronologiques se glisseront peut-être dans mes notes »[16].
Exilé depuis 1933, et alors qu’il tente de regagner l’Espagne, il est arrêté à Port-Bou le 25 septembre 1940. Dans la crainte que les autorités espagnoles le livrent à la Gestapo, dans la nuit du 26 septembre 1940, Walter Benjamin se suicide en absorbant une dose mortelle de morphine.
Il faut préciser que les écrits de benjamin n’ont jamais été publiés de son vivant. Il laisse derrière lui une œuvre assez considérable. L’édition allemande de l’ensemble de ses écrits ne verra le jour que dans les années 70.
Toujours aux éditions Christian Bourgois viennent de paraître, dans la collection « Titres » : Images de pensée, 3 pièces radiophoniques, Sur le haschisch, et Lumières pour enfants.
Le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme lui consacre une exposition depuis le 12 octobre 2011 jusqu’au 5 février 2012. (Voir les différents liens ci-dessous) ■■■ Nathalie Riera, janvier 2012
■ Imprimer PDF 
Lecture Nathalie Riera_Walter Benjamin_Ecrits autobiographiques.pdf
Pour + d’infos
■ WALTER BENJAMIN ARCHIVES
Repères chronologiques http://walterbenjaminarchives.mahj.org/reperes-chronologiques.php
Le parcours de l’exposition http://walterbenjaminarchives.mahj.org/visite.php
Galerie photos http://walterbenjaminarchives.mahj.org/visite-galerie.php

D’autres sites à consulter
■ GALERIE ALAIN PAIRE
Franz Hessel / Walter Benjamin : Camp des Milles, Marseille et Sanary, derniers jours en France
■ LA QUINZAINE LITTERAIRE
http://laquinzaine.wordpress.com/2011/10/28/walter-benjamin-au-complet/
21:13 Publié dans ALLEMAGNE/AUTRICHE, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Walter Benjamin | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Andrew Wyeth

Andrew Wyeth, Nogeeshik, 1972, détrempe à l’œuf sur panneau. Collection privée
À Paris, la multiplicité et la simultanéité de grandes expositions prestigieuses font parfois oublier ou négliger fâcheusement certaines autres plus petites, moins convenues et plus intéressantes. Tel est le cas aujourd’hui de l’exposition The Wyeth. Trois générations d’artistes américains. Collection Bank of America Merrill Lynch ouverte jusqu’au 12 février prochain au Mona Bismarck – American Center for Art Culture, à quelques pas du musée d’Art moderne de la Ville de Paris (il suffit de descendre la rue de la Manutention jusqu’au quai et de tourner à droite). Dans trois salles, l’exposition présente successivement des œuvres de Newell Convers Wyeth (1882-1945), de son fils Andrew (1917-2009) et du fils de celui-ci, Jamie (né en 1946). S’il ne s’agissait que de montrer que, de ces trois peintres, le plus remarquable est Andrew, et qu’il est à juste titre le plus célèbre, l’exposition resterait d’un intérêt limité. Mais elle devient passionnante en révélant chez eux, selon des modalités différentes, une volonté plus ou moins assumée de raconter qui fait réfléchir à la relation qu’entretient la « grande peinture » telle qu’on l’entend en Occident depuis Cézanne – celle qui ne raconte presque plus rien, qui montre, forme et déforme, fait signe – avec celle qui veut dire quelque chose, suggère un récit, une histoire, et qui, figurative par nature, est aussi narrative, comme la plupart des œuvres des maîtres anciens. LIRE LA SUITE
Galerie ALAIN PAIRE
http://www.galerie-alain-paire.com/
19:42 Publié dans Alain Paire, CLINS D'OEILS (arts plastiques), GALERIES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
18/01/2012
Revue Europe, Georges Perec (Georges Perec, un regard en biais - par Nathalie Riera
Lecture Nathalie Riera
Georges Perec
Revue Europe, janvier&février 2012 – N° 993-994
Site Revue Europe/ http://www.europe-revue.net/
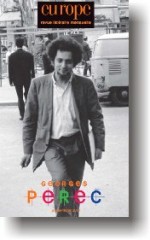
Georges Perec, « un regard en biais »
____________________________________________________________________________
■■■ Trente ans après la disparition de l’écrivain oulipien « à 97 % », quelles sont la place et l’importance de son œuvre aujourd’hui, dans le paysage littéraire ? Claude Burgelin, qui répond aux questions de Jean-Pierre Martin, se réjouit « de voir qu’il continue à incarner une image amicale, démocratique (je veux dire : non élitiste) de l’écrivain, celui qui ouvre large les portes de son atelier et laisse entendre que le langage est à tous, que regarder de tous ses yeux est à la portée de chacun, qu’une simple énumération peut mener à l’intelligence de la littérature et du monde ».[1]
Perec s’implique dans la masse du quotidien. Avec son premier livre « Les Choses » (1965), « chronique des années 60 » selon Gianni Celati, ce n’est pas l’intériorité de l’homme ou la psychologie du personnage qui charrie l’écriture, mais plutôt l’ouverture vers l’extériorité. Sur ce sujet, Celati précise : « Cette ouverture de champ est la question centrale de Perec. Il s’agit d’aller vers les choses et de les interroger, d’accumuler des descriptions de leurs caractéristiques. Dans ses textes tout devient important : les meubles, les ustensiles, les espaces, les catalogues de vente par correspondance, les emprunts faits à d’autres auteurs, une collection de cartes postales, un inventaire des aliments consommés au cours d’une année, ou des notes comme celles qui forment le cahier des charges de La Vie mode d’emploi et qui peuvent concerner tout ce qui tombe entre les mains, d’un bouquet de tubéreuses à une carte du Massachusetts, pour entrer ensuite mot pour mot dans les scènes du livre. L’idée est celle d’un magasin où même les objets immatériels, les souvenirs, les pensées et les rêves sont traités comme des choses matérielles, dans l’extériorité de tout ».[2] Citant l’écrivain et urbaniste Paul Virilio, c’est aussi « une façon de créer une mémoire du monde ».
L’extériorité et sa multitude de choses et d’objets, d’éléments sériels, invite à une manœuvre d’écriture dont le souci chez Perec est : non pas analyser, mais décrire, énumérer ce qui habite notre quotidien, ce « night-and-day de la vie de masse », « espace multiforme » qu’on ne se donne jamais vraiment la peine d’observer, la banalité étant toujours considérée comme désuète et sans intérêt. Mais de quelle quotidienneté est-il question ? si ce n’est « la quotidienneté inaperçue » qu’il s’agit de vraiment apercevoir, découvrir, voire même surprendre. Domique Rabaté rappelle ce que tout projet de livre chez Perec signifie, celui « de rompre un aveuglement », et en mémoire de l’écrivain, ce beau portrait de « l’usager de l’espace » : « un individu parmi d’autres qui changent de lieux, qui rêvent d’une impossible patrie, et voyagent de signes en signes. Lui le fait par l’écriture qui est peut-être la meilleure inscription possible, dans un espace à la fois mental et matériel ».[3]
Maryline Heck re-convoque l’origine du mot « l’infra-ordinaire » (inventé par Paul Virilio) : « description de ce bruit de fond de nos existences, habituellement passé sous silence » ; l’infra-ordinaire chez Perec : « Interroger l’habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l’interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s’il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s’il n’était porteur d’aucune information. Ce n’est même plus du conditionnement, c’est de l’anesthésie. Nous dormons notre vie d’un sommeil sans rêves. Mais où est-elle, notre vie ? Où est notre corps ? Où est notre espace ? ». [4]
Observateur des « réalités silencieuses », Georges Perec est ce peintre du quotidien, dans son ingéniosité d’inventorier et d’inventer.
« Les textes de Perec ouvrent une partie de mon inconscient (c’est pour moi le signe distinctif de la grande littérature), à l’inverse de la plupart des livres vantés par les médias et qui, eux, le bloquent, ne sachant jouer que sur l’obsession, la peur, la rage et autres rétrécissements internes ». (« La vengeance de Perec », Pierre Furlan, p.158)
(Les carnets d’eucharis, Nathalie Riera, janvier 2012)
PRESENTATION ■
http://www.europe-revue.net/presentation-janvier-fevrier.html
■ Imprimer 
Nathalie Riera_Georges Perec, _un regard en biais__Les carnets d'eucharis, 2012.pdf
21:53 Publié dans Europe, Georges Perec, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
16/01/2012
Zbigniew Herbert, Corde de lumière (une lecture de Tristan Hordé)
Zbigniew Herbert Corde de lumière
(Œuvres poétiques complètes I)
- traduites du polonais par Brigitte Gautier, édition bilingue -
Editions Le Bruit du Temps, 2011
LECTURE : Tristan Hordé
Les œuvres de Zbigniew Herbert (1924-1998) — une dizaine de livres de poèmes, des essais — restent peu connues en France(1). Le premier volume des œuvres poétiques (qui en comprendra trois) rassemble Corde de lumière (1956), Hermès, le chien et l'étoile (1957) et Étude de l'objet (1961) ; il est précédé d'une "conversation de l'auteur avec lui-même" autour du thème de l'écriture de poèmes. Parallèlement à cet ensemble, paraît un volume d'essais, Le Labyrinthe au bord de la mer (2000 en polonais, donc posthume), consacré aux voyages du poète en Grèce et en Italie et à ses réflexions sur l'Antiquité ; il sera suivi de deux autres.
On peut commencer l'exploration des poèmes, en vers et en prose, en examinant ce que Zbigniew Herbert rejette. Dans les réponses qu'il propose à ses propres questions, il marque nettement son refus du réalisme socialiste qui ne tient aucun compte de la réalité observable. Il revient sur ce point à plusieurs reprises dans ses poèmes, par prudence sans allusion directe à ce qu'imposait le pouvoir en Pologne mais sans aucune ambiguïté. Un écrivain peut sans doute présenter un monde idéal, décrire les choses quotidiennes en gommant toutes aspérités, et donc ignorer que le réel s'imposera à un moment ou à un autre ; ainsi l'image de la "La chambre meublée" [titre d'un poème] sera, pour ne pas choquer, celle d'un « monde faux » — mais « du papier peint arraché / des meubles non apprivoisés / les taies des glaces sur le mur / voilà l'intérieur réel » (p. 225). De manière analogue, il est inutile de peindre « toute la nuit en rose » les murs gris de la prison : cela n'empêchera pas l'enfermement. Donc, il faut sortir des leçons imposées, quoi qu'il en coûte — et Z. Herbert a payé le pris — et tenter de dire ce qui est en sachant que tous « nous avons des cailloux / noirs à la place des yeux » (p. 75).
Quoi écrire ? « [...] le domaine des choses, le domaine de la nature me semblait être un point de repère, et également un point de départ, permettant de créer une image du monde en accord avec notre expérience » (p. 17). Donner une "image du monde" en choisissant pour point de départ un tabouret, des chaises ou une table, c'est aller contre toute idéalisation de la réalité et, en même temps, affirmer que « nous sommes réels » (p. 113). Cette attention à ce qui passe inaperçu peut aussi être la base d'une critique d'une certaine poésie ; dans un portrait de la poule (bien différent de celui de Jules Renard dans ses Histoires naturelles), il retient la rupture entre elle et les autres oiseaux, comportement né de la vie avec les hommes, et notamment « cette parodie de chant, ces supplications brisées pour une chose incroyablement ridicule : un œuf souillé, blanc, rond. // La poule rappelle certains poètes. » (p. 343) Décrire ces choses sans relief, qui conduisent à séparer « la chose de l'apparence » (p. 167), ne signifie pas pour Zbigniew Herbert qu'il faudrait seulement s'attacher à un réel "nu" ; bien des poèmes, surtout ceux en prose, débordent ce cadre et construisent un univers de fantaisie, parfois de non-sens : ainsi, le chat « arrache les oiseaux des arbres avant qu'ils soient mûrs » (p. 321), l'ours refuse d'aller à l'école, etc. La poésie est comme le coquillage vide qui « raconte / les mers évaporées dans le sable » (p. 421)
Pour ce qui est du "domaine de la nature", il apparaît de manière récurrente sous une forme élémentaire : l'eau, la terre, le feu, l'air, puis les fleurs (seule la rose est citée, abondamment), les arbres (« un tronc de bouleau comme une corde de lumière », p. 85), les oiseaux, auxquels le Poète est associé :
que serait le monde
s'il n'était plein
de l'incessant va-et-vient du poète
parmi les pierres et les oiseaux
(p. 197)
Ce monde naturel se caractérise par le fait qu'il donne sans détour ce qu'il est. On pourrait reconnaître une forme de panthéisme dans la poésie de Zbigniew Herbert qui, l'une des rares fois où il s'adresse à un lecteur, écrit : « sans attendre de meilleure récompense / assieds-toi sous l'arbre » (p. 85). Et c'est à partir des éléments naturels que le poète peut décrire le monde des choses : « il me faut regarder les toits comme la pleine mer » (p. 219), écrit-il.
L'univers de Zbigniew Herbet est plus complexe ; y est intégré une relation active à la tradition, qu'il s'agisse de l'Antiquité — des poèmes ont pour thème Athéna, Marc-Aurèle, Néfertiti, Jonas, etc. — ou plus largement du passé. Les références ne doivent rien à une quelconque nostalgie, l'Antiquité est toujours une source vivante et, à l'occasion, se révèle un instrument critique ; si Arion, ce cheval doué de la parole, chante l'harmonie, le paradis perdu (« tout est aussi bon / qu'au commencement », p. 147), ce n'est cependant qu'un chant..., et il s'éloigne sur la mer, « seul » (p. 149). Et de la statue d'Apollon appréciée dans la jeunesse, « il ne reste qu'un socle vide » (p. 49). Quant au passé, il est doublement important : opposé aux "lendemains qui chantent" du pouvoir, c'est aussi un appui pour comprendre ce qui est vécu aujourd'hui — « la poésie est fille de mémoire / elle veille les corps dans le désert » (p. 273).
On lira, insistante dès le premier livre, une volonté d'être lisible, d'écrire sans détour — « je donnerai toutes les métaphores / pour une expression / comme une côte écalée de ma poitrine / pour un mot / qui rentre / dans les limites de ma peau » (p. 169). Une poésie donc qui s'en tient à un vocabulaire commun, à une syntaxe sans recherche, qui privilégie l'énumération plutôt que l'image : l'essentiel, toujours, est de parvenir à « décrire la simple émotion » (p. 169), de la susciter chez le lecteur non pour rejeter la réflexion mais pour qu'elle ne soit pas première. Dans un poème de circonstance, "Aux Hongrois", écrit au moment de l'insurrection en 1956 contre le pouvoir communiste, les quatre brefs quatrains ne visent pas à décrire ce qui se passait, plutôt à exprimer « d'une manière aussi pure et transparente que possible » (p. 16) la solidarité avec ceux qui luttaient pour des valeurs. Cela est peu ? C'est que les mots du poète n'ont pas le pouvoir de changer quoi que ce soit, ni d'expliquer le monde. Dans une parabole, le "Poète" relate que « deux ou trois / fois / [il a] été sûr / de toucher au fond des choses / de savoir » (p. 475) ; sa recherche a été interrompue par une intervention extérieure mais, quand il l'a reprise, il a atteint son but et a pu enfin contempler « le cœur des choses // une étoile morte // une goutte noire d'infini » (p. 477).
Alors ? Il y a sans doute dans l'affirmation de l'absence de pouvoir de la poésie un refus de l'aveuglement de ceux qui écrivaient pour vanter « le royaume de l'avenir », pour faire croire que le « paradis sera prêt / à la fin de la lutte des classes » (p. 277). C'est en même temps dire que les poèmes, comme le reste des créations humaines, disparaîtront dans l'oubli. Dans la série des éléments de la nature, le dernier cité par Zbigniew Herbert est l'herbe : « l'herbe qui survient lorsque l'histoire s'accomplit / et qui est un chapitre du silence » (p. 117). On relèvera ici la rencontre avec un poète fort différent, Jude Stéfan, qui évoque dans les Suites slaves « l'oubli des herbes » (André Dimanche, 1983, p. 81).
(Les carnets d’eucharis, Tristan Hordé, janvier 2012)
1 Trois recueils, tous épuisés, ont été traduits : Monsieur Cogito et autres poèmes (Fayard, 1990), Redresse-toi et va (Orphée/La Différence, 1995) et Élégie pour le départ suivi de Rovigo (Le Passeur, 2000). Deux essais sont disponibles, Un barbare dans le jardin (Le Rocher, 2000) et Nature morte avec bride et mors (Calmann-Lévy, 2003).
20:37 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, POLOGNE, Tristan Hordé, Zbigniew Herbert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
28/12/2011
Les carnets d'eucharis (N° spécial fin 2011)
■■■
Les carnets d’eucharis n°HORS-SERIE
Fin d’année 2011

ROI JAMES
SZILARD HUSZANK
MARIE HERCBERG
Christophe Charbonnel ■■■Jacqueline Devreux
DU CÔTÉ DE…
Alain Le Saux Crucifiction
Valérie Canat de Chizy Pieuvre
Olivier Hobé Le journal d’un haricot
Umar Timol Point Barre (revue)
Nicolas Grenier (Choix de poèmes)
■■■OSSIP MANDELSTAM
Nouveaux poèmes 1930-1934 ■■■
Zbigniew Herbert
DES LECTURES
Alda Merini, « Delirio amoroso» Oxybia Editions
■■■
Au format PDF

21:36 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
18/12/2011
Andreï Tarkovski - Zerkalo/Le Miroir - 1975
14:10 Publié dans Andreï Tarkovski, RUSSIE, VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
09/12/2011
Alda Merini - Delirio amoroso/Délire amoureux (par Nathalie Riera)

Lecture Nathalie Riera
Alda Merini,
Délire amoureux/Delirio amoroso
Collection « Debout poète, debout »
Oxybia Editions, 2011
Traduction Patricia Dao/ Préface deFlaviano Pisanelli
Quatrième de couvertureAndré Chenet
Alda Merini, « de sa fièvre amoureuse »
____________________________________________________________________________
■■■ Pour avoir été très lié à la poète Alda Merini, Angelo Guarnieri, psychiatre de la réforme Basaglia contre l’asile totalitaire soumis à une législation italienne des plus arriérées d’Europe [1], assurait la préface du recueil « Après tout même toi/Dopo tutto anche tu » [2] , dans une écriture portée par « une amitié authentique et profonde, résistante à l’usure et à l’ennui de notre temps ».[3] Il y a ceux comme Guarnieri qui auront eu la chance de rencontrer Alda Merini et de l’entendre lire ses poèmes, et il y a ceux qui s’en tiendront à cette chance de pouvoir la lire en France, deux ans après sa disparition. Si rien dans la poésie de Merini ne laisse entendre un quelconque dégoût pour la folie (« Je crois que la folie est un profond lien d’amour »), il ne peut s’agir non plus d’une idéologie de la folie, et comme l’écrit l’ami psychiatre à son propos : « Alda Merini est devenue un ruminant, qui régurgite la douleur et la reboit ».[4] Quel est donc chez elle ce rapport poésie/folie ? :
parce que le jour du poète,
si semblable à la folie,
ne trouvera pas
sa mesure
dans l’éthique moderne.
[p. 21]
Chez Merini, il y a surtout « l’enfer/des sens/qu’est la vie », « les enfers de la grande pensée », mais sans que ceux-ci ne viennent supplanter son profond humour et la gravité de sa fantaisie. Et que dire du sens de la poésie chez un être frappé par ces enfers irrémissibles ? Dans sa « Lettre à Angelo G. » [5] : « La poésie n’est-elle pas une sorte de méchanceté adressée à soi-même ou une sorte de bénédiction ? ».[6]
« La folie est un artisanat ».
[p. 71]
Et à la question sur la « loi Basaglia », Alda Merini répond [7] : « Voyez-vous, l’hôpital psychiatrique n’a pas pour moi la même fonction que pour les autres, pour moi ce fut… je ne sais pas, je n’en ferais pas un cas national… je l’ai bien vécu ; mais j’aurais bien vécu n’importe quoi, la guerre… la poésie aussi… est un traumatisme, vous le savez vous aussi. C’est une espèce d’asile psychiatrique personnel… ».
Deux ans après Dopo tutto anche tu, Les éditions Oxybia poursuivent un hommage à la poète milanaise avec l’édition bilingue de Délire amoureux/Delirio amoroso, lumineusement traduit par Patricia Dao, passionnément préfacé par Flaviano Pisanelli, ce bel ensemble rejoint par une quatrième de couverture du poète et passeur André Chenet.
Comme le précise F. Pisanelli, à chaque recueil de Merini, la notion même de « folie » « ne se limite à aucune définition conventionnelle ni médicale ».[8] C’est dans l’Italie du Sud (Milan, Taranto) que Merini fera l’expérience de l’incarcération psychiatrique :
« Elle ne cesse de vouloir comprendre les raisons de l’univers déshumanisé et déshumanisant de l’asile psychiatrique. Cette attitude de révolte et de résistance amène l’écrivain à défendre son rôle d’individu et de femme : elle continue à vivre sa condition d’épouse et de mère, en essayant de ne jamais perdre le contact avec la réalité qui semble toutefois s’arrêter au-delà des barreaux des fenêtres de sa chambre et de son lit de contention, des électrochocs et de la stérilisation qu’elle subit et qui privent l’individu de son identité et de sa dignité ».
[p. 14]
« Dans Délire amoureux… la folie s’exprime tout d’abord comme une force ‘dissidente’ ».
[p. 16]
Mais comment est-il possible d’écrire dans l’enfer de l’internement ? Patricia Dao me confiera qu’il fut impossible pour Alda Merini d’écrire « dans ce lieu tourmenté et infâme qu’est l’asile psychiatrique ».[9] Ce ne sont pas les fous qui font l’asile psychiatrique. Dans « La neo-mediocrità », Patrick Faugeras relate :
C’est en 1988, dix ans plus tôt donc, qu’avait éclaté le scandale concernant la ville d’Agrigente, lorsqu’un parlementaire, Franco Corleone, avait poussé, de façon impromptue, les portes de l’asile, et avait découvert avec stupeur une situation catastrophique : « … des malades errants, nus, glissant sur un sol inondé d’urine, demandant l’aumône aux visiteurs, mangeant avec les mains… dormant nus dans des draps tachés de jaune, de marron, de pus, rongés par les rats… des malades enfermés dans des cellules, d’autres ne pouvant franchir l’enceinte de l’hôpital… » Ces faits, rapportés par le journal L’Espresso, soulevèrent en Italie une indignation générale. L’opinion publique, les politiques se mobilisèrent. Le 3 octobre 1991, un malade est retrouvé mort au pied du mur d’enceinte de l’hôpital, le visage dévoré par les rats et par les chiens. L’enquête s’élargissant, seize médecins et administrateurs sont accusés d’« abandon aggravé de personnes en difficulté », d’« homicide par imprudence », d’« incurie par imprudence ». Il faut préciser qu’entre 1977 et 1988, cent quatre-vingt-dix personnes ont trouvé la mort, la moitié de ces décès étant dus à une épidémie de tuberculose non enrayée, non soignée. [10]
« Je fus déchargée à l’entrée de l’hôpital psychiatrique Paolo Pini, mais je ne comprenais pas encore. Les âmes bénies ne croient pas qu’il puisse y avoir de la violence dans le monde ».
[p. 31]
La psychiatrie de Taranto ne cesse d’être une insulte : « Incroyables sont les malversations, les intrigues, les compromis auxquels recourt le personnel des Centres Psychiatriques pour piéger le malade qui parle, discute, dénonce. Le malade est coupable : tout ça pour eux est savoir psychiatrique. Tout ça pour moi est crime».[11]
Alors reconnue par les critiques et les plus grands poètes du XXème siècle (Montale, Pasolini…), le premier internement d’Alda Merini aura lieu dans la jeunesse de ses 16 ans, suivi d’un autre internement, de plusieurs années (de 1955 à 1972), et c’est en 1979 qu’elle recommencera à écrire.
« Je suis devenue poète peut-être parce que la poésie m’importait guère. Même si j’ai dévoré les livres, même si en moi était le chant (mais c’était le chant de la vie, et ça ils ne l’ont pas compris)
[…]
J’ai vécu ma première société poétique Via del Torchio. Par société, je veux dire que j’étais sur le divan coude-à-coude avec les grands de la poésie, avec la classe du renouveau littéraire. J’étais trop petite pour comprendre ce que faisaient ces grands hommes.
Erba, toujours joyeux et éparpillé. Pasolini, taciturne et plein de résistance physique. Turoldo, à la voix tonnante et belle qui semblait la réincarnation de la « scapigliatura » affranchie.
Nous étions pauvres, mais pleins de patience et avec une grande capacité d’absorption. Plus qu’un écrivain, j’étais leur mascotte : jeune, taciturne, peut-être belle, avec deux flancs dont j’avais honte et que j’essayais de cacher.
Manganelli était un brave homme. Il lançait des miettes dans mon décolleté en riant, mais il avait aussi un sourire tendre. Erba semblait toujours à la recherche d’un cerf-volant qui lui échappait des mains ».[12]
Dans cette vie constellée de malédictions, Alda Merini parle souvent de la peur, la peur est au centre de sa vie, de sa chair, comme elle évoque souvent ces deux années d’isolement total, chaque jour marqué par « un douloureux calvaire de solitude », sans « aucune solution de mémoire ni de chant ».[13] Et même si « la psychiatrie et la littérature n’ont rien en commun » : « Avec ‘Delirio amoroso’ Alda Merini décrit précisément cette ‘folie d’amour’ qui lui valut de sortir des ornières de la pensée admise. Un chant halluciné remontant des grandes profondeurs de l’être sous-tend ce récit d’une tragédie qui se dénoue, comme une prière muette, dans la divinité de l’amour universel ».[14] ■■■
Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Nathalie Riera

Régis Daubin - 12, rue des Roumègons – 06520 MAGAGNOSC
Tél. : 09 53 61 72 31 ou 06 76 96 96 67
Extraits
____________________________________________________________________________
J’ai été trahie : je ne sais pas par qui. Un jour, un nuage gris tomba sur mon existence. Un nuage sans couleur. Difficile que les hommes puissent remuer le ciel, mais parfois ils se servent des devins pour cela. Par le biais de chaudrons, de serpents et de sorcières je fus envoyée loin de ma vieille patrie, où je ne connus plus rien. Je fus enterrée en psychiatrie. Pour l’honneur, par le pouvoir. Le « diario » fut mon passeport pour une folie dense d’amour et de pauvreté. Je suis pauvre, seule l’obole de mes amis me permet de vivre. Il y a en cela un certain romantisme, mais je reste fondamentalement pauvre, alors que je voudrais avoir mon domaine secret. Si on me trahit, je me cache dans l’enchevêtrement des mots et les mots sont des haies vertes et hautes où se tapissent de nobles faons.
L’homme est un cannibale qui veut à tout prix manger ses semblables, après quoi il exhibe avec clameur ses appareils électroniques, ses machines à laver dernier cri, les ordinateurs et tout ce qu’il appelle progrès (et que j’appelle carnage).
[p. 42/43]
Ça fait maintenant deux ans que je suis malade, exactement deux ans, et c’est moi qui l’ait voulu. Encore une fois j’ai fermé le lourd temple de ma vie. J’ai reculé en me plongeant dans un indéchiffrable inconscient. L’inconscient est riche comme le fond des mers, plein de coraux et d’éponges, de sirènes et de personnages de rêves. Plein de fleurs carnivores. J’habite ici depuis deux ans comme quand j’étais à l’asile psychiatrique. L’asile psychiatrique est une grande caisse de résonance où le délire devient écho. J’ai vécu en asile psychiatrique parfois volontairement. D’autres fois sans le savoir.
[p. 83]
[1] Lire l’article de Patrick Faugeras « La neo-mediocrità » - Sud/Nord 1/2004 (no 19), p. 31-39.
[8] Le feu de la folie : Délire amoureux d’Alda Merini (Préface de Flaviano Pisanelli), Délire amoureux/Delirio amoroso, Oxybia Editions, 2011, p. 13
22:04 Publié dans Alda Merini, ITALIE, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Zbigniew Herbert, Corde de lumière
Zbigniew Herbert Corde de lumière
(Œuvres poétiques complètes I)
Editions Le Bruit du Temps, 2011
LECTURE : (Nathalie Riera)
« … un poème qui sonne comme un disque de vieux tango ne m’attire pas », [1] mais ce n’est pas pour autant que le grand poète polonais Zbigniew Herbert(1924-1998) soumettra sa passion de penser à « ce malheureux intellectualisme de la poésie contemporaine », refusant pour cela l’épithète de « poète intellectuel ». Pour Herbert, entre le poète et son lecteur, la complicité est plus que jamais primordiale : « Je fais confiance à mon lecteur pour être mon complice, travailler avec moi. Ceux qui dispensent une distraction facile méprisent leur public. Moi, je le traite comme un partenaire, en respectant sa différence, sa capacité de juger et de critiquer ».[2]
« Une flamme qui pense », en titre d’un article de Claude Mouchard dans La Quinzaine Littéraire,[3] le poème chez Herbert n’est pas un moyen d’expression mais le moment d’une expérience intérieure, le lieu d’une autre connaissance. Pour faire un parallèle avec le réalisateur russe Andreï Tarkovski : « … mes films ne sont pas une expression personnelle mais une prière. Quand je fais un film, c’est comme un jour de fête. Comme si je posais devant une icône une bougie allumée ou un bouquet de fleurs. Le spectateur finit toujours par comprendre lorsqu’on lui parle avec sincérité (…) Le manque d’honnêteté détruirait le dialogue ». [4]
Que peut offrir la poésie dans un monde trahi ? La poésie, antithèse du concept et de la puissance négatrice, chaque poème est une ligne du cœur sans mélodie artificielle, la volonté d’une union du rêve et de la mémoire. « (…) les poètes n’ont pas de pouvoir sur le monde. La langue est leur unique royaume. Ce n’est que dans ce domaine qu’ils peuvent gouverner et légiférer ».[5]
Corde de lumière est le premier volume des Œuvres poétiques complètes, publié aux éditions Le Bruit du Temps, et traduit du polonais par Brigitte Gautier.
(Les carnets d’eucharis, Nathalie Riera, décembre 2011)
EXTRAITS
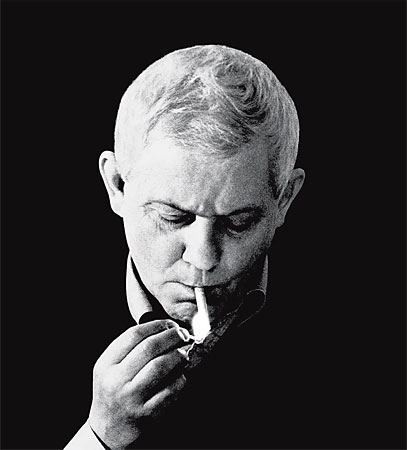
La forêt d’Ardenne
Joins les mains pour puiser du rêve
comme on puise eau ou graine
et apparaît une forêt : nuée verte
et un tronc de bouleau comme une corde de lumière
et mille paupières vont battre
une langue feuillue oubliée
tu te remémoreras alors le matin blanc
où tu attendais que les portes s’ouvrent
tu sais l’oiseau entrouvre cette contrée
il dort dans l’arbre et l’arbre dans la terre
source ici de nouvelles questions
sous les pas les courants des mauvaises racines
vois le dessin de l’écorce où
s’imprime une corde de musique
le luthiste tournant les chevilles
afin que résonne ce qui se tait
écarte les feuilles : des fraises des bois
la rosée d’une feuille l’arête d’une herbe
plus loin l’aile d’une libellule jaune
une fourmi enterre sa sœur
plus haut au-dessus de la belladone traîtresse
mûrit doucement un poirier sauvage
sans attendre de meilleure récompense
assieds-toi sous l’arbre
joins les mains pour puiser de la mémoire
des morts les prénoms la graine flétrie
une autre forêt : nuée calcinée
le font marqué d’une lumière noire
et mille paupières serrées
fort sur des globes immobiles
l’arbre et l’air brisés
la foi trahie des abris vides
et cette forêt-là est pour nous pour vous
les morts réclament aussi des fables
une poignée d’herbes l’eau des souvenirs
alors sur les aiguilles de pin sur les murmures
et des odeurs les fils fragiles
peu importe que la branche t’arrête
que l’ombre te mène par des chemins sinueux
car tu retrouveras et tu entrouvriras
notre forêt d’Ardenne
(p.85/87)
Le sel de la terre
Une femme passe
son foulard tacheté comme un champ
elle serre contre sa poitrine
un petit sac en papier
cela se passe
en plein midi
au plus bel endroit de la ville
c’est ici qu’on montre aux excursions
le parc et son cygne
les villas dans les jardins
la perspective et la rose
Une femme avance
avec la bosse d’un baluchon
- que serrez-vous donc ainsi grand-mère
elle vient de trébucher
et du sac
sont tombés des cristaux de sucre
la femme se penche
et son expression
n’est rendue
par aucun peintre de cruches brisées
elle ramasse de sa main sombre
sa richesse dissipée
et remet dans le sac
les gouttes claires et la poussière
Elle
reste
si
longtemps
à genoux
comme si elle voulait ramasser
la douceur de la terre
jusqu’au dernier grain
(p.144/145)
01:52 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Zbigniew Herbert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Jude Stéfan, Ménippées (P(r)o(so)ésies)
Lecture Tristan Hordé
Jude Stéfan, Ménippées (P(r)o(so)ésies)
Editions Argol, 2011
■■■Le titre et le sous-titre apparaissent, comme la plupart du temps chez Jude Stéfan comme un programme. Ménippées ne s’inscrit pas dans la tradition de la Staire Ménippée, texte essentiellement satirique, mais, ce que suggère le pluriel, évoque sans doute possible les Ménippées de Varron, c’est-à-dire des écrits qui mêlent vers et proses et abordent tous les sujets sans établir de hiérarchie entre eux, passant de remarques sur la vie quotidienne à des considérations sur la philosophie ou la littérature. C’est bien de cela qu’il s’agit dans les cinq ensembles, datés de 2006 à 2010 du livre de Stéfan ; s’y succèdent les fragments d’un journal, des "litanies du Muséomane" (parallèles aux Litanies d’un scribe), des ajouts à Pandectes (Pandectes (ou le neveu de Bayle), 2008), la traduction d’un poème de Rubén Darío, des poèmes, des remarques sur la littérature, d’autres sur une lecture, des propos entendus au café, des citations (parfois non traduites), des idées de titres, des notations de rêves, des jeux phoniques à partir du grec et du latin ; etc. Le sous-titre, P(r)o(so)ésies, qui, littéralement, ne peut être lu, dit autrement le refus de distinguer entre des genres, de séparer prose et vers. C’est là une constante dans l’œuvre de Stéfan, affirmée dès le premier livre (Cyprès (poèmes de prose), 1968) et régulièrement répétée dans les textes critiques, dans des titres, par exemple La Muse Province (ou 76 proses en poèmes), et dans les poèmes : le sous-titre apparaît dans Épodes (1999), ouvrant le premier ensemble, "Des vers" :
78 : Arthur affiché sur les portes d'acier
aux Transformateurs
la poésie en la prose
la poésie en le PO M
ou la prose en prosoésies les
proêmes en prosies proésies
le poèmenprose en la prosenpoème
[etc. ; p. 11]
La radicalité de ce choix déconcerte certains lecteurs pour qui les genres existent toujours, partage ancré par les habitudes de lecture scolaire figées. Si la plupart des lecteurs admet qu’un coucher de soleil ou une déclaration d’amour ne sont pas "poétiques" par nature ( ?), il faut encore redire que la poésie ne se définit pas plus par la présence du vers — le passage à la ligne — que par le sens dénoté : « En lisant Zanzotto (Phosphènes) ; enfin des textes dépourvus de sens, du sens appris de lecture scolaire ou conformiste, enfin pouvoir lire les mots tels quels en leur indépendance syntaxique. » (p. 80) Le sens n’est pas absent, certes, ou l’émotion, la présence du sujet, mais rien du « ça veut dire », ni dans Zanzotto ni dans des œuvres en cours fort différentes comme celles de Philippe Beck, Caroline Sagot-Duvauroux ou Jean-Louis Giovannoni.
Dans Ménippées, les lignes de force de l’œuvre sont bien présentes si l’on met en valeur celles qui organisent presque tous les livres : l’amour, le temps, la mort. Non pour classer des éléments du texte mais, ici et là, sous diverses formes. Ainsi le motif du temps clôt le premier ensemble daté (I, 2006) avec l’évocation d’une maison dont les éléments progressivement se défont, allant vers la ruine
Anti-poème
à l’arrière-cour
fenêtre murée
verrous, gouttières, auvents
barreaux, grille rouillée
rideaux pendants
en muet abandon
tenons et chenil
dans une aire sans accent
que des cadenas
Ainsi le motif de la mort se lit dans un rappel des noms perdus ou dans la proposition d’un récit où reviendrait à intervalles réguliers la phrase : « X… est mort ». Quant au motif de l’amour, c’est un solide fil conducteur, au début du livre avec le souvenir d’un film d’amour « bouleversant », ensuite avec le récit d’anecdotes — un adieu dans une gare —, la notation d’un « cri de Fille », de conseils pour séduire une femme, d’affirmations lapidaires (« Amour. Le moins aimé souffre le plus ») ou, pour conclure un rêve, avec une équivalence, « L’amour : inquiétude/apaisement ».
Le lecteur retrouve les formules qui se veulent sans réplique (« Il n’est de plaisir pur que dans l’égoïsme »), les remarques sur la difficulté à vivre la solitude et, nombreuses, les assertions provocatrices : à l’ouverture de Ménippées, la lumière et la naissance (la venue au jour) sont associées à la défécation (la disparition) : « Confession d’Optimiste. Il s’avèrera moins lugubre d’allumer, dans les lieux d’aisances, afin d’honorer ce rite quotidien, en remerciant d’être né. ». À la page suivante, c’est l’art d’être grand-père qui est parodié : « Lorsque l’enfant paraît traînant son pot [etc.] » ; ajoutons un éloge du port de la burka et de la masturbation en public (puisqu’elle est « naturelle »…), et le rejet de Mozart, Beethoven et quelques autres, seulement capables de « flatter l’oreille », « art mélodique […] qui longtemps retarda la Musique ».
Ce regard peu amène sur ses contemporains et leurs choix n’est pas nouveau mais, parallèlement, Stéfan considère avec peu de complaisance son personnage. Le commentaire de l’exposition qui lui était consacrée en 2010 — « Une vie d’ombre, une œuvre de non-vie » — est symboliquement noté le 1/7, jour de la naissance de qui signe de ce nom ; le thème de la "non-vie", comme celui du "vide", est récurrent dans l'œuvre. Symboliquement encore, Ménippées s'achève sur une sortie avec une note du 31/12 : « Excipit. Le dégoût d’avoir écrit l’emporte sur le plaisir d’écrire », qui répond au dernier vers de Que ne suis-je Catulle (2010), « Ne Plus Écrire ». ■■■
Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Tristan Hordé
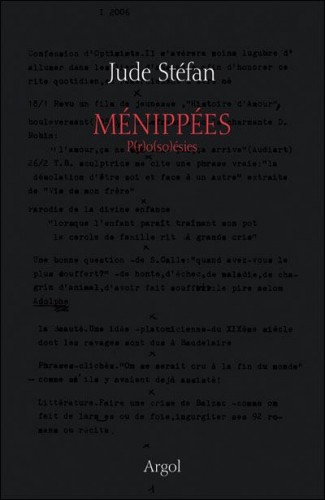
01:36 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Claude Royet-Journoud et Alain Cressan (une lecture de Tristan Hordé)
Lecture Tristan Hordé
TABOURET
Claude Royet-Journoud et Alain Cressan
Editions Lnk, 2011
■■■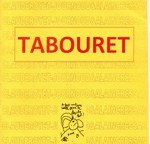 Il faudrait un jour écrire l'histoire de ces éditeurs qui, depuis des années, travaillent en marge, diffusant leurs livres vaille que vaille, grâce au bouche à oreille, sans souci premier d'être "rentables". Pascal Quignard a évoqué, dans une lettre à Bénédicte Gorillot qui ouvre Inter (Argol, 2010) comment Emmanuel Hocquard, l'hiver 1978, tirait « à la main sur la presse d'Orange Export Ltd » ses livres, « dans l'atelier de Raquel, à Malakoff, sur un plancher de bois exhaussé, le chien hurlant de ne pouvoir monter les échelons ». Quelques passionnés, sans beaucoup plus de moyens, poursuivent cette tâche patiente, obscure, donnant à lire quelques titres chaque année — je cite, au hasard des livres sur la table, L'arrière-pays (Josette Ségura et Éric Dazzan), Poliphile (François Lallier et Géraldine Toutain), Ficelles (Vincent Rougier), Contrat Main (Pascal Poyet et Françoise Goria).
Il faudrait un jour écrire l'histoire de ces éditeurs qui, depuis des années, travaillent en marge, diffusant leurs livres vaille que vaille, grâce au bouche à oreille, sans souci premier d'être "rentables". Pascal Quignard a évoqué, dans une lettre à Bénédicte Gorillot qui ouvre Inter (Argol, 2010) comment Emmanuel Hocquard, l'hiver 1978, tirait « à la main sur la presse d'Orange Export Ltd » ses livres, « dans l'atelier de Raquel, à Malakoff, sur un plancher de bois exhaussé, le chien hurlant de ne pouvoir monter les échelons ». Quelques passionnés, sans beaucoup plus de moyens, poursuivent cette tâche patiente, obscure, donnant à lire quelques titres chaque année — je cite, au hasard des livres sur la table, L'arrière-pays (Josette Ségura et Éric Dazzan), Poliphile (François Lallier et Géraldine Toutain), Ficelles (Vincent Rougier), Contrat Main (Pascal Poyet et Françoise Goria).
Je n'oublie pas les livres fabriqués "à la maison" avec un ordinateur, un scanner et une imprimante, mais qui n'entrent pas dans le circuit commercial ; les textes sont publiés autour d'une centaine d'exemplaires et distribués à des amis. Ce type d'édition, confidentiel, propose poèmes et dessins que leur éditeur, ici Alain Cressan, a sollicités auprès d'écrivains et d'artistes qu'il apprécie, sans souci de la notoriété des uns et des autres — pas seulement français : la part des travaux venus des États-Unis est importante (Peter Gizzi, Rosmarie Waldrop, Jill Magi, etc.). L'un des deniers titres, Tabouret, donne à voir des "peintures numériques" de Claude Royet-Journoud accompagnées en légende d'un récit d'Alain Cressan. La première page pose deux éléments à partir desquels se construit l'histoire : un personnage, Igor, et un tabouret, liés par une phrase écrite avec maladresse (comme celle d'un enfant qui apprend ses lettres)1, « Igor dessine son tabouret et il se couche tout content » ; le récit double partiellement ce dispositif : « Igor pense à un tabouret. Le dessine. Dort. Action faite. »
Seront introduits au fil des pages des éléments variés ; quelques-uns appartiennent à la vie d'aujourd'hui (le plan d'un appartement et ses W.C., un écran de cinéma, une porte où s'inscrit "DRH" quand « Igor cherche un travail »), certains sont rêvés ( une plante dans un pot, un âne), d'autres évoquent le loisir ou la sortie dans l'imaginaire (un livre, une bibliothèque, la mer, des bateaux, la nuit). Igor, absent une seule fois (remplacé par le plan de son appartement), devient double ou sextuple, une autre fois quatre Igor « regardent les bateaux », plus loin trois « observent le ciel ». De manière analogue, les tabourets se multiplient — il suffit de les dessiner —, et les livres, et le récit se développe à partir de jeux sur les nombres et de la répétition de l'absence (motifs privilégiés de conte) : c'est un tabouret, ou un livre, qui a disparu, c'est une tête perdue, une plante rêvée, une hypothétique « île aux tabourets » qu'il faut chercher, et même le travail manque.
 Le personnage d'Igor, malléable, change sans cesse de vêtements : pantalon jaune rayé, bleu, rose, rouge, grenat, gris, blanc, jaune, et le fond de l'image varie en même temps. Les dessins se veulent naïfs pour la mise en scène de cette figure toujours souriante, d'une naïveté très contrôlée cependant : Igor, pour une fois sur une chaise, lit de la poésie..., et sur la dernière image abandonne le tabouret pour un fauteuil ; c'est qu'alors, comme "l'Étranger" de Baudelaire (« J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages ! »), il « observe les formes des nuages à travers les fenêtres, voit des formes d'idées. Quelles idées ? » Oui, quelles idées dans ces insaisissables mouvements ? ■■■
Le personnage d'Igor, malléable, change sans cesse de vêtements : pantalon jaune rayé, bleu, rose, rouge, grenat, gris, blanc, jaune, et le fond de l'image varie en même temps. Les dessins se veulent naïfs pour la mise en scène de cette figure toujours souriante, d'une naïveté très contrôlée cependant : Igor, pour une fois sur une chaise, lit de la poésie..., et sur la dernière image abandonne le tabouret pour un fauteuil ; c'est qu'alors, comme "l'Étranger" de Baudelaire (« J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages ! »), il « observe les formes des nuages à travers les fenêtres, voit des formes d'idées. Quelles idées ? » Oui, quelles idées dans ces insaisissables mouvements ? ■■■
Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Tristan Hordé
01:14 Publié dans Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Arséni Tarkovski

Enfant, je fus malade
De faim comme d’effroi. J’ôte la peau des lèvres,
Les lèvres, je les lèche ; et je me rappelais
Cette fraîche saveur à peine un peu salée.
Arseni Tarkovski
00:38 Publié dans Arséni Tarkovski, RUSSIE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
30/11/2011
Note(s) - Eric Bourret (photographie) Henri Maldiney (philosophie)

[…]
Que voit le peintre dans un paysage ?
« Nous disons « quel paysage merveilleux ! », nous le disons parce qu’on voit l’horizon dans la profondeur du lointain, couvert d’un bleu au travers duquel apparaissent des montagnes, des forêts, des lointains, qu’en bas, au milieu des prairies, court une rivière, que sur elle glissent des barques, que dans un pré s’avancent des gens qui s’épanouissent en habits de couleurs… » Mais que voit le peintre dans un tel paysage ?
« Il voit le mouvement et le repos des masses picturales, il voit la composition de la nature, l’unité des formes picturales variées, il voit la symétrie et l’accord des contradictions dans l’unité du tableau de la nature. Il reste immobile et est transporté par le courant des forces et leur entente. C’est ainsi que la nature a construit son paysage, son grand tableau multilatéral de la technique, contradictoire avec la forme de l’homme – elle a lié les champs, les rivières et les mers et grâce à la forme humaine elle a pulvérisé le lien entre les animaux et les insectes, elle a formé ainsi une gradation de formes sur sa surface créatrice. C’est une telle surface créatrice qui est apparue devant l’artiste créateur : sa toile, le lieu où son intuition construit le monde… ».
Art et existence
In Dialectique du « Moi » et morphologie du style dans l’art, (p.103)
 format pdf
format pdf
LES CARNETS D’EUCHARIS
Nathalie Riera© décembre 2011
http://lescarnetsdeucharis.hautetfort.com
21:03 Publié dans Eric Bourret, Henri Maldiney, PHOTOGRAPHES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
27/11/2011
Café poétique avec Nathalie Riera au Château de Mouans-Sartoux
VENDREDI 2 DECEMBRE 2011 —
NATHALIE RIERA – JULIANA PLANÇon – fabienne pujalte
CafÉ-POÉSIE “Les Mots d’Azur”

il se fait tard trop loin
et parfois lents sont les mots à venir
qu’on les voudrait guêpes galops
et vent dans la nuque
Nathalie Riera
L'hiver avance. Nos demeures et nos esprits se préparent à recevoir le souffle de ce qu'il reste du sourire des beaux jours. Encore un peu de patience, et aux premières lueurs de l'aube l'espoir d'une poésie la vie entière renaîtra. Je vous invite à venir partager les mots de l'amitié en écoutant Nathalie Riera, poétesse qui nous vient du Var. Fondatrice et directrice depuis 2008 de la revue numérique" les carnets d'Eucharis", sa voix est de celles qui portent. C'est un viatique qui nous emmène vers de nouveaux horizons.
Au violon, la jeunesse et les cordes vibrantes de Juliana Plançon viendront compléter ce moment de poésie pure que vous ne pouvez manquer.
En seconde partie, Fabienne Pujalte nous ouvrira les portes de ses nouvelles créations, avec plusieurs textes inédits qui sauront vous toucher.
Soyez des nôtres le vendredi 2 décembre 2011, à partir de 18h30, dans la salle des conférences du valeureux château de Mouans-Sartoux.
Je pense pouvoir dire que vous ne le regretterez pas !
Pierre-Jean Blazy
*******************************************************************************
Nos prochains rendez-vous :
3 février 2012: Claude Artès
13 avril 2012: André Chenet
8 juin 2012: Yves Ughes
*******************************************************************************

Contacts: 06 07 53 00 42 - 06 07 05 78 05.
14:56 Publié dans LECTURES PUBLIQUES, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
24/11/2011
Paul Blackburn
— eDITIONS JOSE CORTI, 2011 —
Paul Blackburn
Villes suivi de Journaux
. B L A C K A N G E L .
par angele paoli
Blackburn, Paul Blackburn. Américain et poète. Quelque chose du feu et de noir dans son nom. « An angel », ― black angel un peu voyou un peu voyeur ? ― qui bat le pavé de la ville. Et un poète « accro » aux « magnétos » dont il se sert pour enregistrer les voix qui hantent l’atmosphère, la traversent et l’habitent. Bribes de conversation saisies au hasard des rues, onomatopées et rumeurs, claquements et cliquètements, grincements, roulements et rythmes.
Peu connu en France, si ce n’est de quelques lecteurs aficionados de la poésie d’outre-Atlantique, Paul Blackburn a fait cet automne son apparition dans le paysage poétique de l’Hexagone. Traduit dans son intégralité par Stéphane Bouquet, le recueil de Cities/Villes vient d’être publié dans la Série américaine des éditions José Corti, accompagné et complété d’extraits de Journals/Journaux. Ainsi composé, du « premier livre de taille » de Paul Blackburn d’une part, et, de l’autre, des Journaux des dernières années de sa vie, l’ouvrage proposé par l’éditeur offre un parcours poétique dense et envoutant. Et du personnage du poète, une vision profondément humaine et profondément attachante.LIRE LA SUITE (sur le site Terres de femmes)

Paul Blackburn
Poète américain
(1926-1971)
■ LIEN :http://www.jose-corti.fr/
LES PATURAGES DE L’ŒIL
Des floculations de cirrus suspendus
précipitent
dans le tube du ciel au-dessus de la rue,
couvrent d’un toit l’œil vieillissant dans sa flaque
enfermant ses
reflets sous une croûte de glace
Crac
Sourd, mais
L’œil regarde dehors
et des rangées de moutons aléatoires paissant au-dessus du parc
se nourrissent
de la seule herbe qu’il y a en ce matin d’hiver
/
dans l’esprit
L’œil, oui
vieillissant dans sa flaque,
mais ouvert .
O U V E R T
-------------------------
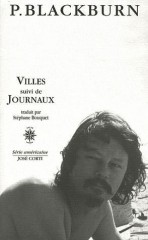
VILLES, SUIVI DE JOURNAL
Paul BLACKBURN
éditions José Corti, 3 novembre 2011
Traduit de l'anglais par Stéphane Bouquet
22:53 Publié dans ETATS-UNIS, José Corti, Paul Blackburn | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Le temps du coeur - Paul Celan & Ingeborg Bachmann
Ingeborg Bachmann, Paul Celan Le temps du coeur : Correspondance (1948-1967)
Editions Seuil, 2011
Collection : La Librairie du XXe siècle

PRESENTATION :
Les deux êtres qui se rencontrent dans la Vienne de 1948 encore occupée par les troupes alliées, sont issus de cultures et d’horizons différents, voire opposés : Ingeborg Bachmann est la fille d’un instituteur, protestant, ayant adhéré au parti nazi autrichien avant même l’accession de Hitler à la chancellerie du Reich (1932) ; Paul Celan, né dans une famille juive de langue allemande de Czernowitz, au nord de la Roumanie, a perdu ses deux parents dans un camp allemand et a connu l’internement en camp de travail roumain pendant deux ans. Cette différence, le désir et la volonté de renouer sans cesse le dialogue par delà les malentendus et les conflits déterminent leur relation et la correspondance qu’ils échangent du premier jour, en mai 1948, où Paul Celan fait cadeau d’un poème à Ingeborg Bachmann jusqu’à la dernière lettre adressée en 1967. L’écriture est au centre de la vie de chacun des correspondants, dont les noms apparaissent dans les comptes rendus critiques, dès le début des années 1950, souvent au sein d’une même phrase, comme étant ceux des représentants les plus importants de la poésie lyrique allemande de l’après-guerre. Mais écrire n’est pas chose simple, ni pour l’un ni pour l’autre et écrire des lettres n’est pas moins difficile. L’imperfection du dire, la lutte avec les mots, la révolte contre le mutisme, occupent une place centrale dans cet échange épistolaire.
Correspondance augmentée des lettres échangées par Paul Celan et Max Frisch ainsi que par Ingeborg Bachmann et Gisèle Celan-Lestrange. Édition de Bertrand Badiou, Hans Höller, Andrea Stoll et Barbara Wiedemann.
Ingeborg Bachmann est née à Klagenfurt en Autriche, le 25 juin 1926 et morte à Rome, le 17octobre 1973. Poétesse et nouvelliste, elle a participé au Groupe 1947 et a reçu, en 1964, leprestigieux prix Georg Büchner.
Paul Antschel est né en 1920 en Bucovine. Persécuté par les nazis, il est interné dans un camp de travail en Roumanie ; ses parents sont déportés, sans retour. Toute son oeuvre de poète est publiée sous le nom de Celan (anagramme de son patronyme : Ancel). Il meurt à Paris en 1970.
■ ŒUVRES OUVERTES (Laurent Margantin)
"Inventer une lecture du dialogue Celan-Bachmann"
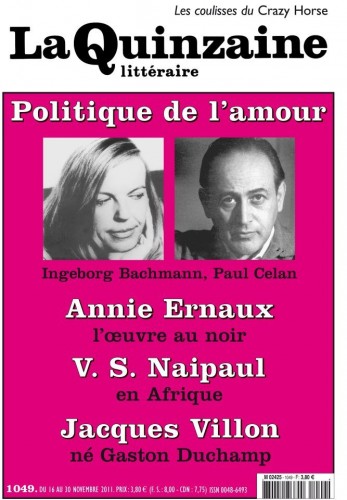
■ LA QUINZAINE LITTERAIRE :
21:40 Publié dans 4EMES DE COUVERTURE, ALLEMAGNE/AUTRICHE, Ingeborg Bachmann, Paul Celan | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Ingeborg Bachmann - Journal de guerre
lngeborg Bachmann Journal de guerre
suivi des
Lettres de Jack Hamesh à Ingeborg Bachmann
Editions Actes Sud, 2011
Collection « Lettres allemandes »
Traduction de l'allemand et préface de Françoise Rétif

Quatrième de couverture
Dans ce journal tenu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ingeborg Bachmann relate non seulement la vie dans sa ville natale meurtrie mais aussi son amour pour un soldat anglais, Jack Hamesh, émigrant juif au service de la force d'occupation. La grande poétesse et romancière dira plus tard que ce fut le plus bel été de sa vie. Son journal est suivi des lettres que lui adressa Jack Hamesh, ayant décidé de rejoindre la Palestine.
Découvertes vingt-cinq ans après sa mort, les quelques pages de ce journal suffisent à témoigner de la lucidité, du courage et de l'esprit de résistance de l'écrivain singulier qu'est Ingeborg Bachmann
20:51 Publié dans ALLEMAGNE/AUTRICHE, Ingeborg Bachmann | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook

































































