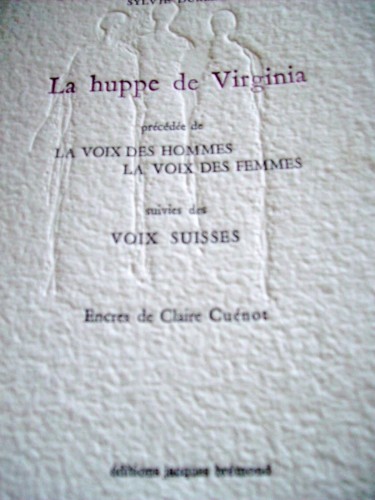24/07/2011
Annie Le Brun (Du jour au lendemain par Alain Veinstein)

Alain Veinstein reçoit Annie Le Brun pour ses essais Les châteaux de la subversion (Gallimard) et Vagit-prop (Editions du Sandre) 
ICI
23:28 Publié dans Annie Le Brun | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
22/07/2011
Annie Le Brun, Ailleurs et autrement (une lecture de Nathalie Riera)
AILLEURS ET AUTREMENT – Annie Le Brun
(Editions Gallimard, “Arcades”, 2011)
Bien sûr, il s’agit toujours de trouver « le lieu et la formule » dont parle Rimbaud. Mais que savons-nous encore de cette quête, aujourd’hui que l’émiettement de nos désirs à travers une multitude de satisfactions immédiates nous dissuade autant de voir au loin que de prendre de la hauteur ? Que pourrions-nous en savoir, depuis que la presque totalité de ce qui prétend penser se fait rabatteur du réel pour accélérer l’écrasement de toute perspective imaginaire ?
Annie Le Brun n’aime pas se tenir tranquille. Dans son dernier ouvrage, Ailleurs et autrement, au-delà même d’y entendre sa verve redoutable contre toutes les bouffonneries des instances poético-littéraires en place – ces finalement « paradis culturels peu différents des paradis fiscaux » (p.34) – faut-il y reconnaître sa toujours plus grande complicité avec Alfred Jarry, grand chantre du grotesque et de l’absurde ; ainsi qu’avec Sade, Raymond Roussel, Hans Bellmer… comme autant de voix subversives, mais dont la langue sans auditeur, sans public, nous révèle à quel point la société technicienne s’emploie délibérément à nous rendre chaque jour plus triomphants dans nos cécités et nos surdités.
Ailleurs et autrement compte une vingtaine de chroniques – publiées entre 2001 et 2002 dans La Quinzaine Littéraire – et autres textes rassemblés comme autant de détonateurs prompts à desservir tout ce qui tend vers toujours plus d’incarcération, d’artificialisation, d’angélisme, d’idéologisme, et surtout ne faut-il pas entendre chez Annie Le Brun son seuil de tolérance décroître, tant ne cesse de se profiler à nos horizons communs le toujours plus sombre ghetto du « nouvel esprit du capitalisme ». Force étant de constater les réelles intentions du néolibéralisme, à savoir : absolument rien de ce à quoi l’être humain peut prétendre, mais plutôt tout pour qu’il y ait « mort du sujet », ou alors « sujet flottant, sans attache, qui se définit par son indétermination sexuelle, affective ou intellectuelle, telle que rien ne l’empêche d’être traversé par le flux d’une marchandisation généralisée ». Qu’en est-il en effet de ce monde qui nous donnerait notre chance de vivre, de nous rapprocher du monde naturel et du monde sensible, si ce n’est rien de tout cela, mais de précisément nous enfermer dans la médiocrité et l’indigence, et nous en gaver jusqu’à l’horreur. Et dans pareil monde, qui brille des falsifications de tous genres, comment entendre un Novalis, un Lautréamont, et plus proche de nous, des figures combatives comme René Riesel…
Annie Le Brun s’insurge contre « la langue stretch », contre le « langage de synthèse » qui participe à notre formatage, contre « la technicité qui vise à liquider ce qui nous reste de singularité », contre le « réalisme sexuel », contre l’idéologie du néoféminisme ou de l’actuel « féminisme pragmatique », contre le terrorisme et l’hégémonie « Du trop de théorie » incarné sous le label « French Theory », s’imposant « comme le dernier chic culturel – en ce que, pour la première fois, la théorie y proposait la possibilité d’innombrables jeux de rôles pour amateurs de subversion verbale » (p.164). Annie Le Brun décortique, décharne, répond à l’urgence d’un « Ailleurs et autrement ». Car pour elle, notre « immense chance qui ouvre toutes les autres » est de commencer par dire non. « Car si la servitude est contagieuse, la liberté l’est plus encore » (p.187). Citant Georg Grosz : « Ne cessez jamais d’être un critique féroce de la société », Annie Le Brun s’y emploie le plus férocement, non sans cesser de nous poser la question : de quelle sorte de résistance est-il encore possible ? dans un monde où règne ce qu’elle-même qualifie de « rationalité de l’incohérence ».
Ne nous contentons pas de croire que notre société atrocement anesthésiée puisse se vanter de sa capacité à la profondeur et au sérieux d’une véritable critique sur l’état des choses actuel. Lire Annie Le Brun c’est se rallier à une observation sociale réellement pertinente, sans feinte et sans épate. Car au même titre qu’un Jaime Semprun, l’art de la réflexion n’est-il pas de « déceler les approximations, les coups de bluff et réflexes conditionnés théoriques qui, depuis des années, se substituent à toute réflexion véritable » (p.276) ? Retrouver la « cohérence passionnelle », opter pour la « contrebande de la mémoire » (Jacques Hassoun), cela ne doit pas nous faire porter le masque de l’indigné (tel qu’il se porte actuellement à quelques endroits de l’Europe), mais de garder la plus haute vigilance quand on sait « l’ampleur des grandes épidémies de servitude volontaire, dont l’humanité est périodiquement affectée » (p. 244)
Nathalie Riera, Les carnets d’eucharis
Juillet 2011
 Annie Le Brun a publié aux éditions Gallimard « Les châteaux de la subversion », « Soudain, un bloc d’abîme, Sade », « Du trop de réalité », « Ombre pour ombre », « De l’éperdu », « On n’enchaîne pas les volcans », « Si rien avait une forme, ce serait cela ».
Annie Le Brun a publié aux éditions Gallimard « Les châteaux de la subversion », « Soudain, un bloc d’abîme, Sade », « Du trop de réalité », « Ombre pour ombre », « De l’éperdu », « On n’enchaîne pas les volcans », « Si rien avait une forme, ce serait cela ».
Entretien accordé au Magazine Littéraire
Propos recueilli par Benoît Legemble
Annie Le Brun : « L'actuelle bonne conscience se veut à la fois subversive et normative »
Poétesse aux accents surréalistes, figure intellectuelle à l’esprit incisif et polémique, exégète notamment de Sade, Alfred Jarry et Raymond Roussel, Annie Le Brun n’a de cesse d’explorer les marges comme d’autres sondent les lignes de faille. Son dernier livre, Ailleurs et autrement (paru récemment chez Gallimard), revient, au fil de chroniques publiées dans La Quinzaine littéraire durant la dernière décennie, sur ses engagements littéraires et idéologiques. L’occasion d’une rencontre avec l’auteur des Châteaux de la subversion.
Bon nombre des textes d’Ailleurs et autrement s’inscrivent dans la dénonciation d’une époque de la «fausse conscience» à la «subversion subventionnée», une période où la poésie même paraît menacée. Dans ce contexte, faut-il selon vous repenser le lien historique qui l’unit à la Résistance ?
Annie Le Brun.Dans ce livre, il n’y a rien de délibéré concernant l’articulation dont vous parlez puisqu’il s’agit de la réunion d’articles portant sur les sujets les plus divers mais dont la succession chronologique sur une dizaine d’années n’en rend pas moins compte d’une critique se développant à l’encontre d’une sorte de simulation critique qui est désormais une posture comme une autre. Ainsi me paraît-il insupportable qu’à tout propos on parle de «Résistance», en se référant implicitement ou non à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. C’est encore une de ces approximations, au bout du compte monstrueuses, qui en dit long sur la fausse conscience devenue norme. Et, à l’évidence, la littérature en participe, sans parler de la mômerie intitulée «Printemps des poètes», dès lors qu’elle ne se propose pas d’abord d’échapper à la confusion, mieux de la combattre en se tournant vers de tout autres horizons.LIRE LA SUITE
Annie Le Brun publie Ailleurs et autrement, et lit De l’Érotisme de Robert Desnos
Dans La Quinzaine littéraire du 16 au 30 juin dernier, Maurice Nadeau s’incline devant Annie Le Brun (ainsi est-ce annoncé en couverture [4] :
« Annie Le Brun, écrit-il, réunit les chroniques mensuelles qu’elles a tenues à La Quinzaine littéraire en 2001-2003 [5]. Elle y joint d’autres textes, préfaces et conférences [6], sous le titre général qui n’étonnera pas ceux qui la connaissent : Ailleurs et autrement [7]. Déjà, les chroniques de La Quinzaine littéraire paraissaient sous la rubrique : A distance. [...] On connaît son intérêt pour quelques grandes figures du passé, fort mal à l’aise, elles aussi, dans le monde où elles vécurent : Jarry, Sade, Roussel [8]. Pour chacun elle a étudié « l’écart » qui nous les rend contemporains. De ce que le Surréalisme a laissé de vivant elle est l’ultime représentante. [9] »
Le lecteur, ancien ou nouveau, mesurera en effet une fidélité intacte à un mouvement qui s’était attaché à repenser l’homme dans sa globalité, à son énergie, à sa révolte, comme s’y était essayé le premier romantisme allemand. L’un de ces textes pourra peut-être en donner plus particulièrement la mesure, tant il reflète les intérêts de l’auteure, sa manière, tant l’écriture que la forme de la pensée. Je n’en livrerai que quelques éléments significatifs, alors que grande serait la tentation de le reproduire in extenso !LIRE LA SUITE (La Lettre de la Magdelaine/Ronald Klapka)
21:38 Publié dans Annie Le Brun, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
18/07/2011
YANNIS RITSOS
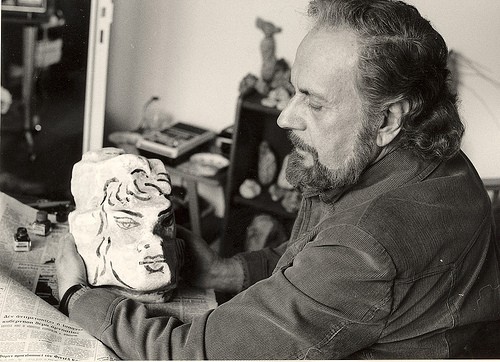
Yannis RITSOS
Poète grec
(1909-1990)
■ LIEN : Ypsilon éditeur
Il est né en Grèce, à Monemvasia, le 1er mai 1909 et mort le 11 novembre 1990 à Athènes.
Cadet d’une famille de grands propriétaires terriens, sa vie est marquée par la mort de la mère et du frère aîné, la folie de la sœur et du père qui provoquera leur ruine économique, et la maladie personnelle qui lui vaudra de fréquents séjours en sanatorium. Il adhère au Parti Communiste Grec à la fin des années 1920.
De 1948 à 1952, époque de guerre civile, Ritsos est déporté pour ses convictions politiques dans les îles de Limnos, Makronissos et Aï-Stratis, en même temps que toute une génération qui y fut emprisonnée, battue, torturée, exécutée. Mais il écrit toujours, tant bien que mal, secrètement, des poèmes tels que ceux du Journal de déportation, de 1948 à 1950, interrompu en 1949 par l’écriture de Temps pierreux. Les poèmes sont enfermés dans des bouteilles et enfouis dans la terre.
En avril 1967, c’est le coup d’État des Colonels. Ses amis conseillent à Ritsos, de retour d’un voyage à Cuba, de se cacher mais il ne quitte pas sa maison d’Athènes. Il est arrêté le matin même et envoyé à la fin du mois sur l’île de Yaros, un grand rocher sans arbre et sans eau, infesté de rats. Il sera ensuite transféré sur l’île de Léros puis placé en résidence surveillée à Samos. Pendant tout ce temps, il continue d’écrire plusieurs séries de poèmes, toujours en cachette, regroupés sous le titre Pierres Répétitions Grilles. (Ypsilon éditeur)
PIERRES REPETITIONS GRILLES (extrait)
http://ypsilonediteur.com/fiche.php?id=81
ÉPILOGUE
La vie, – une blessure à l’inexistence.
Yaros, 27.07.68
NUIT
Grand eucalyptus sous une large lune.
Une étoile tremble dans l’eau.
Ciel blanchâtre, argenté.
Pierres, pierres écorchées jusqu’en haut.
On entendit tout près dans les eaux basses
le deuxième, le troisième saut d’un poisson.
Extatique, vaste orphelinage – liberté.
Léros, 21.10.68
Camp de déportés politiques de Parthéni, île de Léros.
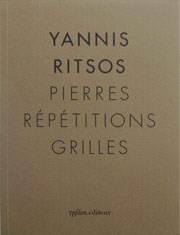
Yannis Ritsos
Pierres Répétitions Grilles
Editions Ypsilon, 2009
Traduit du grec par Pascal Neveu
Préface de Bernard Nöel
-------------------------
Temps pierreux
Makronissiotiques (extrait)
RECONNAISSANCE
Un soleil de pierre a voyagé à nos côtés
brûlant l’air et les ronces de la solitude.
L’après-midi, il s’est tenu à la lisière de la mer
comme un globe jaune sur une vaste forêt de mémoire.
Nous n’avions pas de temps pour ces choses-là – malgré tout,
nous jetions un œil de ci de là – et sur nos couvertures
entre les taches d’huile, la poussière et les noyaux d’olives,
restaient quelques épines de pin, quelques feuilles de saule.
Ces choses-là aussi avaient leur poids – rien d’important
l’ombre d’une fourche dans un enclos, lente au crépuscule,
le passage d’un cheval à minuit,
un reflet rosé qui meurt dans l’eau
laissant derrière lui le silence plus seul encore,
les feuilles mortes de la lune parmi les roseaux et les canards sauvages.
Nous n’avons pas de temps – nous n’en avons pas,
quand les portes sont comme des bras croisés
quand la route est comme celui qui dit « Je ne sais rien ».
Pourtant, nous le savions, nous, que plus loin, au grand croisement
il y a une ville et ses lumières colorées,
des hommes se saluent là-bas d’un seul mouvement du front –
nous les reconnaissons à la position des mains,
à la façon dont ils coupent le pain,
à leur ombre sur la table du dîner,
à l’heure où s’endorment toutes les voix dans leurs yeux
et qu’une étoile unique les signe sur l’oreiller.
Nous les reconnaissons à la ride du combat entre les sourcils
et plus que tout – le soir, quand le ciel grandit au-dessus d’eux –
nous les reconnaissons à ce geste mesuré du partisan
lorsqu’ils jettent leur cœur comme un tract illégal
sous la porte close du monde.
22:55 Publié dans GRECE, Yannis Ritsos | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Yannis RITSOS : "Poème, n'abandonne pas mon corps aux loups"
Yannis RITSOS

Sur une corde
(poèmes traduits du grec
et présentés par Dominique Grandmont)
Solin Editions, 1989
331
Son de tambours, voix lointaines, fumées. Et les statues dans les couloirs des hôpitaux.
332
Dans cette transparence infinie se balance une tenaille de fer.
333
Voyelles et consonnes, leurs voix sonnent, tombent d’accord et se taisent dans une profonde impartialité.
334
Et maintenant qu’on lui a retiré le bâillon, comment va-t-il faire pour parler ?
335
Toi, Grèce, qui me crucifies mon pain et mes papiers.
336
Sache-le, - ces mélodies sur une corde, ce sont mes clés. Prends-les.
20:21 Publié dans Yannis Ritsos | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
14/07/2011
Sanford Roth
00:10 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
La Galerie Le Réalgar - Mon journal de ton voyage
« Mon journal de ton voyage »
Photographies de Thierry Michau et Texte d’Eric Perrot
Vous pouvez participer à la souscription lancée à cette occasion
(19€ au lieu de 24€ jusqu’au 31 Aout 2011)
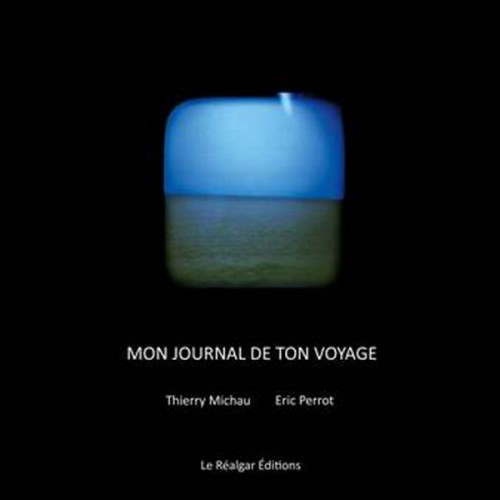
Les autres livres disponibles édités par la Galerie :
Talus : poème de Michel Butor et reproduction des gravures de François Mourotte, 16€
Vue du train : texte de Frédéric Pont et reproduction des peintures de Jean Luc Brignola, 4€
La nuit Obscure : poème de Jean de la Croix et reproduction des dessins de Sandra Sanseverino, 4€
Contacts : Le Réalgar
23 rue Blanqui
42000 Saint Etienne
Tel : 0687602234
00:05 Publié dans Le Réalgar | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
13/07/2011
Sereine Berlottier, "Attente, partition" (une lecture de Tristan Hordé)
ATTENTE, PARTITION – Sereine Berlottier
(éditions Argol, 2011)
(Editions
Une lecture de Tristan Hordé
Le poème récit qu’est Attente, partition a adopté la forme du journal, propice pour noter les mouvements intimes. Genre qui permet également au récit de s’insérer dans un ensemble : ici, un nouveau carnet est commencé, dont la narratrice précise les dimensions (14 sur 9), et placé dans une série, manière de dire que ce qui est à écrire — les jours de la vie — est inachevable ; le dernier vers sans ponctuation finale (« et qui est une main levée ») laisse explicitement suspendu le récit.
Comme c’est souvent le cas, le journal ne mentionne pas les années : 2 avril, 8 avril, etc. (1). Deux dates précises seulement apparaissent, mais à l’intérieur d’une notation. La première (« Je crois que c’était le 13 février 2004. / J’ai le souvenir d’une page », p. 102) renvoie à l’ouverture du carnet : « Tu te demandes comment ça commence, ce qui commence au juste pour toi […] » (p. 11) (2), liée à l’écriture dont la nécessité est évoquée à plusieurs moments par la suite, soit en marquant qu’écrire exige un travail continu, peut-être sans fin (« Il faut écrire longtemps pour écrire », p. 45), soit parce qu’écrire n’est pas à dire vrai inventer un récit mais a sa propre fin (« L’illusion d’avoir à écrire une histoire qui serait arrivée alors que l’écriture est tout ce qui peut m’arriver écrivant », p. 146). Le journal n’est pas tenu chaque jour — mais parfois la narratrice le reprend plusieurs fois le même jour — et il peut se passer un long temps entre deux notations : par exemple, rien n’est inscrit entre le 27/4 et le 20/6, entre le 5/7 et le 7/8, etc., et ces lacunes sont d’ailleurs relevées une fois : « 16 août / Ici même le lieu délaissé [= le carnet]. Quand il faudrait nourrir le temps chaque jour. Creuser chaque jour sur la page un geste net comme la tranchée d’une pelle menée sous le pied. (p. 75) »
La seconde mention d’une date précise se rapporte explicitement à ce qui construit aussi le récit, l’enfant à venir : « 15 déc. / L’enfant n’est pas la question du 15 décembre 2005. Seul le livre. Charnel. Givré de secrets. // Le tenir. Ne pas le lâcher quand il sera, oiseau faible, l’habitant de tes paumes nues. » (p. 46) La liaison entre "enfant" et "livre (écriture)", si forte ici, organise d’une certaine manière tout le livre ; non pas qu’un parallèle soit présenté entre l’un et l’autre — on est très loin de la métaphore de l’"accouchement" d’un livre — , les deux motifs existent, chacun évoqué à sa place ou parfois dans la même phrase comme on l’a vu ; citons encore : « dans le ventre du bruit qui n’est pas du langage » (p. 71).
Attente, partition peut s’entendre en effet de deux manières ; "attente" renvoie aussi bien à l’espoir qu’au fait que l’on demeure quelque part jusqu’à ce que quelque chose se produise, et "partition" s’entend au sens de « séparation » (« tenir et pourtant / se quitter », p. 22) et de « composition musicale » ; les différents emplois s’associent, que l’on pense à la part(ur)ition ou au livre, l’attente de l’enfant étant elle-même un récit : « On colle l’oreille à ce ventre / comme si on cherchait pour de bon // si on a mal / on fait comme / si c’était une façon d’avoir une histoire encore. » (p. 99)
Composition musicale, si l’on accepte la métaphore, avec son alternance de très courts récits (« Elle est debout sous la douche [etc.] ») et d’ellipses, de mots comme jetés dont la référence au réel n’est pas ce qui importe (« Tandis que / (Ça bouge.)/ Dessus, dessous. / Son front de miel. / Un cil d’or. », p. 17) ; avec le mouvement subtil des moments de prose-poésie et de vers ; avec le jeu très réglé des pronoms : à côté de "je", un "tu" et un "elle" qui peuvent être aussi la narratrice, également un "on" quand se vit une distance avec soi (p. 127-128). Seul "il" n’est pas ambigu, et l’on note l’écart entre le "je" et le "il" dans l’attente quand la diariste n’emploie pas le possessif attendu ("son visage, le mien"), mais le pronom personnel : « Quelque chose est dans le silence entre le visage de lui et de soi » (p. 61). On peut encore ajouter les récits récurrents des rêves de chute, la relation à la série des Alien, le retour des motifs de la perte, de la disparition, de la déception, de la solitude aussi (« On est sans force et seule au milieu de la nuit, comme quelqu’un dont la maison brûle et dont le troupeau a fui sans retour », p. 63).
Attente, partition… On a peu dit de ce récit complexe (mais la lecture est-elle achevable ?) qui travaille sans cesse le dedans-le dehors du corps, les mouvements de retournement y compris dans la langue avec, par exemple, l’anagramme « du sien au sein » — et le très beau motif de l’attente(3) :
9 février
l’attente — et si
l’attente ne meurt pas
et qu’il faille
l’ensevelir de force
vivante
son cri dans loin
ne pas se préparer
ne pas consentir
À lire et relire…
Tristan Hordé
Les carnets d'eucharis
Juillet 2011
1 Une seule fois mention est faite du jour de la semaine : « Dans le soir du vendredi 1er juin » (p. 136) — il s’agit donc de l’année 2007 si l’on se reporte aux autres indications.
2 On pourrait rapprocher ce début de L’innommable de Samuel Beckett où, par une série de questions, est amorcée la question du récit : « Où maintenant ? Quand maintenant ? Qui maintenant ? sans me le demander. Dire je. […] » Quant à la dernière phrase, elle annonce que l’écriture ne peut être interrompue : « […] il faut continuer, je vais continuer. »
23:38 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sereine Berlottier, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Sereine Berlottier - Attente, partition
Editions Argol
40, rue Godefroy-Cavaignac
75011 Paris
http://www.argol-editions.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=69

« Tu ne sais pas si tu sauras garder longtemps vivante cette question en toi, ou s’il te faudra un jour la prendre, l’atteindre, la décrocher, la bercer, lui fermer les yeux doucement et l’enterrer au pied d’un arbre, noisetier ou prunier, près d’une vieille ruine aux pierres épaisses, aux caves noires. » S. B.
On dit que quelque chose commence. On écrit dans des carnets noirs, péripéties, silence, ou bien la neige. Ce qu'on attend est sans évidence, ne se laisse pas atteindre d'un seul jet de mots. On tourne la tête, le corps en sourdine, l'enfant s'écarte. Ça dure longtemps. Ça dure plus longtemps qu’on ne l’aurait cru, espéré. De ce voyage, ce qu’il en reste, ce qu’on en sauve, vient par éclats, brisures, chuchotements. Une main posée sur le ventre, l’autre sur le stylo, pour l’équilibre.
23:33 Publié dans 4EMES DE COUVERTURE, Sereine Berlottier | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Dominique Quélen, Finir ses restes
Editions Rehauts
105, rue Mouffetard - 75005 Paris
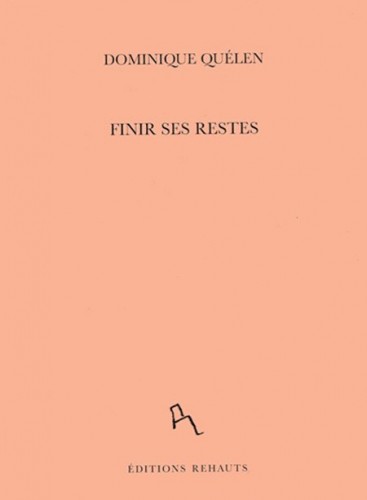
tu regardes le bras qui suinte
tu penses que ton bras est le bras qui suinte
le regard de l’oeil est ici sur le suintement
l’oeil droit fixé sur le bras gauche
23:21 Publié dans 4EMES DE COUVERTURE, Dominique Quélen | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
05/07/2011
Sylvie Durbec, La huppe de Virginia, éditions Jacques Brémond, 2011
Une lecture de Nathalie Riera
©
LA HUPPE DE VIRGINIA – Sylvie Durbec
(Editions Jacques Brémond, 2011)
I could not bear to live – aloud –
The Racket shamed be so –
Je ne pouvais supporter de vivre – à voix haute –
Le Tapage me gênait tant –
Emily Dickinson, Poème 473 (Poésies complètes, 1862) édition bilingue Flammarion, 2009, p.447)
il y aurait une femme
il y aurait un homme
ce seraient leurs voix qui diraient
et il n’y aurait plus pour traduire
que les oiseaux la terre et le pain
De belles singularités de voix et d’images parcourent La huppe de Virginia, le dernier recueil de Sylvie Durbec, aux éditions Jacques Brémond.
Tout poème ne surgit pas d’un monde intact mais de l’imparfait du monde, qui donne l’impulsion à nos voix ou qui les laisse à jamais se tarir, « puits englouti/à sec ». Il faut des fontaines à nos voix, ces fontaines qui sont les berceaux des mots pour « nous faciliter l’élan du verbe et nous permettre de nous exclamer ». Dans la première section du recueil, Sylvie Durbec nous offre un « poème bilingue » que sont « la voix des hommes/la voix des femmes ». Ils sont des voix que l’on regarde, des portraits de voix. Et d’où vient la voix des hommes ? Elle « vient d’un centre/leurs mères l’ont creusé dans leur ventre/et pour s’élever la voix des hommes doit/enjamber la prairie déserte de l’enfance ».
Nous en passons par la langue héritée, mais il est également une autre voix à placer, comme celle de « l’enfant trop grandi ne sait où glisser son corps ses fesses et surtout les mots dont il a l’usage mais dont il sait l’inconvenance c’est-à-dire qu’ils ne pourraient venir s’asseoir au sein de la famille et toujours ouvrant avec violence mâchoire à broyer la voix lui luttant pour tout de même installer sa présence invisible comme moi le fais sans en connaître vraiment l’enjeu si ce n’est que j’ai besoin de la voix sans corde ni fil/ juste ».
La voix de la poète s’essaye à « la voix de silence », « la voix du sourd », « la voix écrite », « la voix qui se tait », « la voix qui se perd ». Cependant, la voix ne se réduit pas à seulement un organe sonore ou insonore, mais c’est aussi « les yeux aveuglés comme la voix ».
« Regard, le mien, collé aux grincements des choses », écrivait Pizarnik dans son « Journal, 1962 ». « Monde de silence. Besoin de m’inventer dans la nuit, avec des mots qui me coûtent tellement ». Tenter d’habiter ce monde en poésie, mais pour quelle fin, si ce n’est comme, selon encore Pizarnik : « je sais, d’une façon visionnaire, que je mourrai de poésie ».
Sylvie Durbec nous dit que en soi la voix a un corps, « inconnu continent », ou alors évoquant la voix du chef de gare : « la bête dans sa voix celle qui fut la première à dire/ECCE HOMO/ECCE VOX ». Inversement, le corps et son trop plein de voix, un étouffement.
Ecrire est inscrire une voix, est chanter « une éternité de voix ». J’aime alors à entendre « La voix matinale », « La voix des images », des voix à lire :
LA VOIX MATINALE
la voix c’est aussi cette feuille trouvée
sur la table au petit déjeuner alors que
tristesse s’était assise à la table inquiète
et puis feuille rousse dépliée un baiser
allège de son poids petit l’ajournée
devenue le temps de l’action et de dire
un jour à construire dans le désir
La voix a pour géographie ce qui est vie ce qui est mort. Paysages de voix déterminés par le vent, sa langue brutale, par le vert qui dans la voix s’enchante, par l’encre coulée noire, par le mot monde, moi qui ne sais pas l’écrire, par le mot mort :
« la vieille Virginia déclare : quand ça vient entre
c’est une vilaine affaire quand ça vient
entre les familles ça les coupe ce serait mieux
de ne pas
ou d’avoir simplement un an ou deux de différence
entre les mères et leurs filles les pères et les fils
ce serait plus facile que la mort n’entre pas ».
Capture de pensées et d’images saisies au passage : « cornes aigües des mots », « esquissant la parole/esquissant encore le geste de la vie », « cette bouche jeune s’essayant à dire/est la fenêtre d’un monde ancien prêt à finir ».
***
Venons-en à la deuxième section de ce recueil, une fugue : La huppe de Virginia. On y croise des noms d’insignes poètes : Leopardi, Thierry Metz, Fernando Pessoa, Celan, Bonnefoy, James Sacré…, des noms qui nous disent que « c’est d’une voix pauvre que la présence en nous s’exercera ».
D’un vers de Leopardi, tentant de lui faire
traverser le détroit usé de la gorge,
avec seulement un peu de sable en guise de ponctuation
Nathalie Riera, Les carnets d’eucharis
Juillet 2011
Sylvie Durbec a récemment publié « Marseille/éclats&quartiers » (Jacques Brémond, 2009) suivi de « PRENDRE place, une écriture de Brenne » (Collodion, 2010)
00:17 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sylvie Durbec | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Sylvie Durbec, Apparitions/disparitions

Roberto Bolano, au Chili, 1970
l’enfant a petite taille et grandes enjambées
petit géant des livres disent les grands
le savant-savant si sage enrage :
voler si vite avec jambes si petites
alors que lui si pressé en pensée
rien plus jamais ne le délivre
Pourquoi commencer de cette manière en invoquant un enfant dans un poème plus ou moins raté si ce n’est à cause de l’écrivain chilien Bolano ?
Je n’écris pas. Je lis. Bolano. Et de Bolano à d’autres, il n’y a qu’un pas.
En le lisant/relisant, je découvre qu’il avait lu Daudet enfant et regrettait que cet auteur qu’il avait aimé soit tombé dans un total oubli, parlant de Tartarin de Tarascon comme d’une sorte de traité du plaisir de vivre qu’il avait justement apprécié et dont il dit certaines choses qui me paraissent d’une lucidité telle que nous n’en avons jamais eu conscience, nous, le lisant enfants ou adultes, à part peut-être le texte éclairant de la Doulou dans lequel Daudet évoque la maladie qui finit par le tuer. Dans cet oubli qui frappe bon nombre d’auteurs, hispaniques ou étrangers, Bolano range évidemment Daudet, mais aussi parmi ces auteurs qui s’éloignent, Artaud le géant, Sophie Podolski que nous avons tant aimée, Henry Miller, Macedonio Fernandez. Demandant à des amis libraires ce que les gens lisaient (ou achetaient), j’ai su qu’on ne lisait plus (ou très peu) Walser, Faulkner, Sarraute et tellement d’autres, auteurs aimés et figurant sur les étagères de nos maisons comme autant d’amis aux paroles bruissantes et vivantes mais que le monde éphémère dans lequel nous vivons oblige au silence.Invendables. Souvenirs pour étudiants. Littérature morte.
Bolano est un compagnon actif.
Il ne désarme jamais.
Se moque des jeunes écrivains qui se vantent de ne pas lire.
Fait l’éloge de Swift.
Ne décolère pas.
Même mort.
La preuve ? Il me fait courir au premier étage et ressortir de la bibliothèque du palier (celle qui attend toujours une vitre) le roman de Javier Cercas dans lequel justement, outre Rafael Sanzas, figure la ville de Blanès. Donc également Bolano lui-même mais aussi un personnage, sorte de héros républicain, dont le nom, Mirallès, est le même que celui du poète Yann Mirallès.
Le personnage du roman de Cercas (Les soldats de Salamine) disparaît. Le poète Yann Mirallès apparaît.
Le livre de Cercas est maintenant sur la table de la cuisine, là où on écrit comme on mange, bien.
Il n’y a pas encore le livre de Yann Mirallès. Mais il sera là, bientôt.
Pour l’instant, deux livres qui ouvrent à eux seuls une bibliothèque : Entre parenthèses et Les soldats de Salamine.
Entre eux, rien.
La cafetière, la voiture qui passe sur la route, la grisaille, le chant du coq.
Cette immense fatigue devant la tâche de mettre en mots la colère.
Et même plus simplement la ville de Blanès où Bolano et Cercas mangent une paëlla.
Et qui n’existe plus et n’existera plus jamais.
Plus loin, à Mexico, dort Karla Olvera, autre poète.
Vivant cette fois, ce qui est une joie à cause de tous ses livres à venir.
Comme elle est en train d’écrire, j’espère que ce livre qui n’existe pas encore et donc ne peut disparaitre, un jour sera dans la bibliothèque du palier, celle à qui il manque une vitre, et rejoindra ainsi non seulement Cercas et Bolano, mais aussi Vila-Matas qu’elle admire tant, sans oublier Mirallès.
Ce que j’aime, dit Bolano, ce sont les raisons que l’on n’exprime pas vraiment et qui font qu’on s’installe à Gerona ou à Blanès, loin de Barcelone ou Madrid, et qu’on y écrit. Des livres qui ne disparaissent pas, puisqu’ils parlent la langue des vivants.
C’est tout.
A Boulbon, 4 juillet,
SD
00:05 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sylvie Durbec | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
04/07/2011
Thierry Valencin
Atelier Valencin Photographie
46, rue Saint-Sébastien - 75 011 Paris
06 03 01 45 62 / 01 43 38 09 27

TV 9
tirage argentique sur papier baryté
23:28 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques), CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Pascal Boulanger, le lierre la foudre (une lecture de Brigitte Donat)
Comment la poésie rencontre-t-elle l’histoire et permet-elle à la littérature de dévoiler l’envers d’un monde que ronge le nihilisme ? Pascal Boulanger poursuivait déjà cette question dans un précédent recueil poétique, Tacite (Flammarion, 2001) : il révélait l’histoire comme une reconduction de l’enfer. Cette vision s’approfondit avec le Lierre la foudre ; elle met à nu le fondement anthropologique de toute société selon lequel chaque communauté se fonde sur un crime commis en commun, dresse la généalogie d’un effondrement qu’inaugure le siècle des Lumières, met en abîme le déclin du père symbolique que creuse une insondable absence. Le dévoilement est accablant, notre modernité n’en finit pas de s’enliser au sein d’un mécénat maternel qu’accompagne un retour au paganisme et à sa violence généralisée.
« Mollesse / débordement / Quand le monde offert à la prise / à la consommation / efface les limites / qui paie sa dette / qui paie le prix d’être soumis au langage ? »
S’il est impossible d’échapper à la comédie sociale, l’aliénation cesse pourtant dès qu’un être s’éveille au jeu désintéressé de l’amour quand il est sans négoce et sans ressentiment. La vie de chaque homme peut alors s’opposer à la totalité hégélienne et, dans ce retrait, annoncer : je suis l’esprit qui toujours affirme. Son langage alors souverain, dans l’écart et la solitude, s’arrache à la fatalité du malheur et renverse la malédiction en exultation. Quand le poème se pense et s’écrit, l’existence d’un être n’est plus saturée ni close, puisque le langage excède le monde. Le vers apparaît comme un trait, chaque parole se détache, fait saillie dans l’art de la notation sèche. Composé comme une fresque, ce recueil n’en n’est pas moins diffracté afin que chaque poème, avec son titre et souvent sa dédicace, s’impose comme un îlot. Pascal Boulanger, de cette manière, rend hommage, de personne à personne, de livre en livre, dans et par le langage, à de nombreux noms – Marcelin Pleynet, Pierre Legendre, Jacques Henric, Claude Minière, Philippe Muray – qui, dans leurs singularités, sont autant d’expériences incomparables et de vérités pratiques qui permettent d’accéder à la connaissance du pire sans exclure le chant de l’affirmation. C’est dans ce continuum du poétique comme du politique que le poème déploie un dispositif chant/critique. À l’horizontalité de la série et du nombre se dresse la verticalité de l’oeuvre, qui s’ouvre au deuil fécond de l’héritage. En effet, la bibliothèque s’oppose au dressage social et permet au poète d’être écrit par ce qu’il lit. Les visions de l’écriture appellent une exigence éthique où la poésie est envisagée comme l’essence même d’un langage qui prophétise, rayonne et résonne.
Dans un contexte de relectures théologiques et en prenant appui sur les pensées de Chestov et de Kierkegaard, Pascal Boulanger rétablit la suprématie d’une pérennité christique à contre-courant du contexte poétique, qui, l’ayant refoulé, s’est attaché essentiellement au monde grec et à la pensée heideggérienne. Ce n’est donc pas anodin si les éditions Corlevour, dont les travaux tournent autour du christianisme, publient ce livre. À notre temps qui, sous prétexte de « lumière », s’est engagé dans l’ignorance, Dieu apparaît comme l’unique signifiant capable d’opposer sa transcendance à l’immanence de la barbarie communautaire.
« Le Nom au centre de tout / qui assume tout / porte tout / souffre tout… croit encore à l’échec des échecs. »
L’expérience du défaut de Dieu n’est pas celle de sa radicale absence. Soutenir son deuil, au contraire, renforce son attrait, et du Dieu sans visage, de son regard invisible, s’impose un éloignement qui trace un chemin. Le retrait de Dieu ne signifie pas que l’amour passe hors-jeu, mais indique le visage actuel de son insistance, de sa fidélité à travers son refoulement même. L’histoire, parce qu’elle est endurée, sera ainsi traversée, soutenue par l’espérance qui croit dans la promesse de l’impossible.
« Qui frappe là où il n’y a pas de porte… pour nous faire entendre / que l’impossible devient possible / quand Isaac est rendu à Abraham… »
Puisque la foi ne repose sur rien, sur l’insensé, elle est le levier qui suspend un instant les fracas de l’histoire, la violence de son mouvement. À l’interruption momentanée de l’histoire, à l’histoire devenue un instant l’impossibilité de l’histoire, se produit le vide où la catastrophe hésite à se renverser en salut, où, dans la chute, s’opère la remontée et le retour.
« Quand tout est impossible, alors la parole prophétique affirmant l’avenir impossible, dit aussi le “pourtant” qui brise l’impossible et restaure le temps » (Maurice Blanchot).
Le Lierre la foudre recompose un monde dans son ultime poème qui a pour titre emblématique Prophétie. « Des chants monteront des voûtes / des rebelles vivront cachés et goûteront l’esprit d’un monde jamais perdu / des bibles vivront dans des échoppes / des soleils éblouis d’herbes et de fleurs renverseront le paysage. » Brigitte Donat
Cette recension vient de paraître dans la revue art press n°380
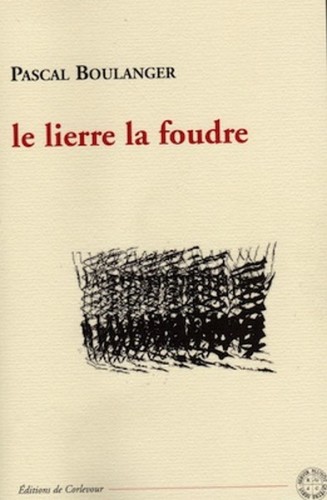
le lierre la foudre - éditions Corlevour, 2011
22:50 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Oleg Batrakov
Galerie Roy Sfeir
6 rue de Seine - 75006 Paris
Tel : +33 (0)1 43 26 08 96
art@galerie-du-fleuve.com/www.galerieroysfeir.com

"Jardin des Tuileries"
Huile sur toile -Oil on canvas
61 x 46 cm
22:42 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Hommage à Bernard Noël
Deux expositions + une rencontre
cet été en Provence (Forcalquier et St-Étienne-les-Orgues)

Par ses poèmes, ses récits, ses pièces de théâtre, ses livres historiques ou politiques, ses textes sur la peinture, Bernard Noël (1930, en Aveyron) est un écrivain de première importance dont le nombre de lecteurs, en France mais aussi à l'étranger, ne cesse de croître.
1. Exposition à Forcalquier LES YEUX DANS LA COULEUR
Vernissage samedi 9 juillet à partir de 11h30.
Peintures de Robert Brandy, Jean-Jacques Cecarelli, Olivier Debré, Bernard Moninot, Jean-Marc Scanreigh, Hervé Télémaque, Jan Voss, Zao Wou Ki,
À Forcalquier, quelques artistes qui ont été l’objet de textes de Bernard Noël lui rendront hommage au Centre d’art contemporain Boris Bojnev, du 2 juillet au 15 août. Tous les jours sauf le mardi de 11 à 13 et de 16 à 19 h.
Livres d’artistes de Bernard Noël réalisés avec : Jean-Jacques Ceccarelli, François Deck, Colette Deblé, Olivier Debré, Fred Deux, Magali Latil, Jean-Michel Marchetti, Henri Michaux, Gilbert Pastor, Serge Plagnol, Cécile Reims, Jan Voss, Youl, Zao Wou Ki…
2. Exposition à St-Étienne-les-Orgues des DESSINS DE BERNARD NOËL
Vernissage samedi 9 juillet à partir de 18h.
Au Coin de la rue de l’Enfer, du 2 juillet au 15 août les samedis, dimanches et jours fériés de 15 à 19H. Les autres jours sur rendez-vous.
RENCONTRE AVEC BERNARD NOËL
dimanche 10 juillet de 9 à 19 h. dans le jardin du Couvent des Cordeliers à Forcalquier, où se réuniront écrivains, philosophes et artistes autour de Bernard Noël pour une journée de conversation et de plaisir à propos de son oeuvre, avec Édith Azam, Jean-Luc Bayard, Robert Brandy, Jean-Jacques Ceccarelli,Yves Charnet, Jean Daive, Monique Dorsel, Jean-Marie Gleize, Bernard Moninot,Jean-Marc Scanreigh, Jean-Pierre Sintive, Jacques Sojcher, Christian Tarting…
Tous renseignements, dossiers, ou photographies au 04 92 73 06 75 - Cristine Debras ou yves.bical@orange.fr
AU COIN DE LA RUE DE L’ENFER
Pl ace Pas t eu r 04 2 3 0 Sa in t -Ét i e n ne - l es -Or g ues
22:23 Publié dans Bernard Noël | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
17/06/2011
Revue Triages N°23, juin 2011 (avis de parution)

Copyright © Revue Triages, N°23, 2011
« Vie ne veut pas dire
que vivre est absence.
Mais si vie exige
des brassées de fleurs,
et que fleurs disparaissent,
tu peux partir. »
Jacques Izoard « Le bleu et la poussière » (1999)
La revue littéraire et artistique Triages, des Editions Tarabuste, ouvre sa 23ème édition avec un dossier d’hommage à Jacques Izoard, une figure marquante de la poésie contemporaine (1936-2008). Dans « Merci aux poèmes de Jacques Izoard », James Sacré écrit : « Aucune œuvre ne vient de nulle part sans doute – et celle de Jacques Izoard, je suppose, pas moins que les autres. On peut penser en la lisant à des fatrasies du XIIIe siècle, à des façons de faire briller les associations de mots de Tristan L’Hermite, ou à des éclats de poèmes de Rimbaud. N’y a-t-il pas chez Izoard quelque chose de fortement rimbaldien (…). Peut-être aussi quelque chose du surréalisme, mais sans que l’image et la métaphore empoissent le poème.
Françoise Favretto, éditrice de L'atelier de l'agneau : « (…) on sait qu’il ne choisira pas la littérature « engagée » mais tendra plutôt vers l’Esthétisme. Il voit cependant les limites de l’écriture et souhaiterait davantage d’elle ». Izoard publiera sous cette enseigne : Plaisirs solitaires (avec Eugène Savitzkaya), Axe de l'œil, Petits crapauds du temps qui passe (avec Michel Valprémy), Bègue, bogue, borgne.
Les deux premiers tomes de ses « Œuvres poétiques » complètes sont disponibles aux Editions de La Différence ; un troisième volume paraîtra en 2011, consacré aux années 2000-2008.
« Langue happe libellules
Langue d’insecte,
Ou de saint sec !
Le mot « langue » bouge
Sans cesse en un étui
De fraîche salive…
(p. 29)
***
Cette 23ème édition est aussi une rencontre incontournable avec le poète Claude Minière dans un entretien avec Pascal Boulanger intitulé « Courage cœur, poussière dorée à propos de Claude Minière ». Rappelons-nous de Pascal Boulanger Une action poétique de 1950 à aujourd’hui (éd. Flammarion, 1998), Suspendu au récit... la question du nihilisme (éd. Comp’Act, 2006), et puis Fusées et paperoles (L'Act Mem, 2008), sans oublier l’ensemble de ses articles consacrés à la littérature contemporaine et publiés dans des revues comme Art Press, Europe, Action Poétique… tout le travail d’analyse de Pascal Boulanger s’établit sur le terrain non pas des clivages scolaires sur la poésie, mais sur celui de la demeure du poète dans sa relation à l’Histoire. D’un livre à un autre, ce qui s’affirme sans relâche est la question du nihilisme et des diverses intimidations de notre époque. Au cœur de ce passionnant entretien, les réponses de Claude Minière témoignent d’une profonde et réelle attention pour la poésie, et plus que jamais pour le « courage poétique ». L’enjeu d’un recueil de poésie, nous dit Claude Minière « est d’abord du rapport du poète à lui-même. Les hommes sont parés de mérites et pourtant c’est en poète qu’il faudrait habiter cette Terre. /La conviction de tout véritable poète est qu’à travers l’Histoire – à travers l’histoire de l’humanité, à travers l’histoire sociale et l’histoire de la métaphysique – un très long débat se poursuit, « visiblement » ou secrètement. Débat du poète avec lui-même (« La poésie doit avoir pour but la vérité pratique »), avec les logiques de discours qui formatent les corps et les esprits, et avec la culture. Ainsi même, le poème peut parfois avoir pour « embrayeur » la haine de la poésie quand celle-ci n’est pas à la hauteur de ses ressources mais les galvaude. Ne pas contourner la haine qui anime le poème est un premier trait du « courage poétique ». Trait de dégagement (contre le « chantage », d’exercice de la nécessité et de la liberté intime, et, comme en passant, salut adressé aux compagnons de route, de joie, de combat et de questionnement. ».
Grand lecteur d’Ezra Pound et auteur de Pound caractère chinois, paru dans la collection L’Infini chez Gallimard en 2006, un prochain essai de Claude Minière va paraître aux éditions Tristam : La méthode moderne (consacré au poète Pound).
Pour ma part, je suis heureuse de retrouver, parmi les recensions de Pierre Drogi et Brigitte Donat autour de l’œuvre de Claude Minière, ma lecture, en 2009, de Pall-Mall, Journal 2000-2003 (éd. Comp’act, 2005), sous le titre Claude Minière... et le monde dans son ordre par la justesse d'un trait. Que Pascal Boulanger, Djamel Meskache et Tatiana Lévy en soient remerciés.
Nathalie Riera, juin 2011
■ Sur Claude Minière, consulter Les Carnets d'eucharis
Pour commander la revue
Editions TARABUSTE
Rue du Fort
36170 SAINT-BENOIT-DU-SAULT
Tél. 02 5447 66 60
Fax 02 5447 67 65
23:50 Publié dans Claude Minière, Jacques Izoard, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
16/06/2011
Hilde Domin (sur le site Littérature de partout proposé par Tristan Hordé)

Jamais encore, semble-t-il, la réalité n’a été aussi perfide que celle qui nous entoure aujourd’hui. Elle menace de détruire la réciprocité entre elle et nous, elle menace, d’une manière ou d’une autre, de nous anéantir. C’est le danger le plus subtil qui semble presque le plus inquiétant : il existe sans exister. Tout le monde en parle. Personne ne le rapporte à soi. Ce danger s’appelle la « chosification », c’est notre métamorphose en une chose, en un objet manipulable : la perte de nous-mêmes.
La poésie peut-elle encore nous aider à affronter une telle réalité ?
[…]
Hilde Domin (1909-2006), "À quoi bon la poésie aujourd’hui", Lire la suite sur le site LITTERATURE DE PARTOUT(Tristan Hordé)
23:00 Publié dans Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Georges Guillain, Avec la terre, au bout - éd. Atelier La Feugraie, 2011
|
Là simplement là parmi le blanc des linges l’été haute chimie de l’air des nerfs et la circulation partout du doute et des promesses à quoi toujours distincts se mélanger mais comme on brasse un jeu de cartes ou les figures sans bien jamais s’y retrouver – perplexes – on est ainsi dans la brouille incertaine des choses marchant solidement pourtant sur des herbes des pailles admirant les jardins où tremble avec aplomb sur des fils l’énergique lessive des hommes |
Après Compris dans le paysage (Editions Potentille, 2010) où l’auteur s’efforçait de rendre compte du sentiment complexe né de la rencontre, sur le site du camp de concentration du Struthof, entre le sentiment merveilleux d’être vivant dans le cadre idyllique d’une nature apparemment offerte et le malaise provoqué par la connaissance des atrocités autrefois commises dans ce même décor, Avec la terre, au bout (Atelier La Feugraie, 2011) continue de creuser la question de notre difficile présence au monde. Et du juste usage des mots nécessaires à la dire.
Les cinq parties qui composent le livre dessinent comme un itinéraire partant du sentiment premier d’une sorte de dispersion ou de réinvention perpétuelle de soi dans l’écriture, pour s’accomplir dans l’affirmation d’une unité retrouvée dans le présent d’un monde accepté comme il est, non plus hostile et froid, mais d’une force égale, ne réclamant rien de nous. Qu’une approche impalpable sans mots.
Traversé par l’expérience de la perte mais aussi de la rencontre infatigable avec le monde, ses saisons, ses paysages, jamais décrits mais toujours éprouvés, en mouvement, Avec la terre, au bout est un livre constamment incarné, pénétrant, se tenant au plus près de l’expérience unique et à jamais indécidée de vivre.

105 rue Mouffetard, 75005 Paris
Fax 01 43 37 90 31
Tel. 01 43 36 81 03
« Depuis 1984, L’Atelier La Feugraie, à travers sa collection L’Allure du chemin, publie des textes de poètes français et étrangers qui témoignent (au-delà de leurs «allures» différentes : poèmes, notes de journal, aphorismes, proses poétiques…) d’un cheminement, d’une expérience intérieure, d’une quête : tenter de mieux saisir le rapport de l’homme au monde à travers la poésie conçue, ainsi que le voulait Rilke, comme «manière de vivre», «mode de vie».
22:28 Publié dans Georges Guillain | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Revue EUROPE n° 986-987 Juin-Juillet 2011 - André du Bouchet
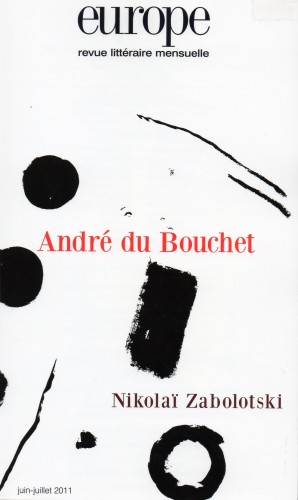
ANDRÉ DU BOUCHET(1924-2001) compte parmi les poètes les plus marquants de la deuxième moitié du XXe siècle. Il a vécu son enfance sur « fond de rumeur de langues étrangères ». Son père, Américain d’origine française, avait passé sa jeunesse en Russie. Sa mère, française, était la fille d’émigrés juifs russes qui avaient choisi « le pays de la lumière et de la liberté ». En juin 1940, la guerre et l’exode furent ressentis par André du Bouchetcomme une déchirure, avec le sentiment d’une perte irrémédiable dans l’écroulement d’un monde qu’il commençait tout juste à découvrir du haut de ses quinze ans. « J’écris pour retrouver une relation perdue », dira-t-il plus tard. L’écriture sera le seul viatique pour endosser sa condition précaire : « pour ne pas rester les mains nues, pour que mon poème serve de route à ce que je ne connais pas ». André du Bouchet produit son premier livre en 1946. Si son cheminement ne va pas sans rencontres marquantes avec des poètes de sa génération, des amitiés avec des peintres, il poursuit cependant sa route singulière. Outre ses poèmes, ses traductions — de Mandelstam et de Celan,entre autres —, pendant des années du Bouchet consigne sa recherche dans des carnets qu’il emporte toujours avec lui lorsqu’il marche dans la campagne du Vexin et de la Drôme. S’il noircit des milliers de pages c’est dans l’espoir de prendre langue avec le monde. Son expérience devient celle d’un réel qui ne se laisse pas saisir mais sur lequel il est possible de prendre appui. André du Bouchet débarrasse la langue de ses oripeaux et s’avance vers la nudité. Il voudrait « peser sur chaque mot jusqu’à ce qu’il livre son ciel ». Sa poésie agit en aérant la parole : « ce qui aère la parole oblige à en sortir aussi vite qu’on y sera entré », dit-il. Dans un équilibre toujours instable entre dispersion et cohésion, son œuvre accorde une grande place à la force motrice du vide, à l’espacement qui sépare et relie. Pour André du Bouchet, tout doit rester ouvert : « Je ne voudrais pas que le langage se referme sur moi. Je ne voudrais pas que le langage se referme sur soi. »
89e année / n° 986-987 Juin-Juillet 2011
22:01 Publié dans Europe, REVUES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
13/06/2011
Nadja Einzmann (traduction inédite de Chantal Tanet)

© photo sur le site d'ÉCLA-Aquitaine
Alors non je ne peux pas dire non
Mon bien-aimé est de ceux qui méritent qu’on les attende. Il m’aime, et ça me suffit. Alors je me plais à être sa maison et son foyer et j’en vérifie le toit et huile la porte, jour après jour, et j’attends. Une nuit, mon bien-aimé viendra ainsi vers moi, à travers la campagne, et les étoiles se feront carillon et la lune tam-tam et pulsation pour lui souhaiter la bienvenue. Il vit encore sous d’autres cieux et fouille et cherche ardemment et feuillette des livres à s’en écorcher le bout de la langue. Il me l’a souvent écrit. Alors non je ne peux pas dire non ni prendre mes distances ni le laisser passer : dans une autre ville une autre femme. Alors non je ne peux pas dire non. Et puis tout le monde voudrait un pareil bien-aimé et ne l’ayant pas, le rêve. Je regarde par la fenêtre et le vois venir, une ombre sur le chemin. Et le gravier crissera sous ses pas, et ma main, appuyée sur le rebord de la fenêtre, se fera lourde, ma main en attente.
Certains jours
Certains jours, j’attends que quelque chose se passe. Un appel ; que la maison s’écroule ; ou que le médecin me dise que je n’ai plus que quelques semaines à vivre. Je suis assise dans mon lit et j’attends, et ma mère frappe à la porte. Elle n’a rien à raconter. Sois gentille, dit-elle, descends la poubelle, ou bien : que dirais-tu d’une promenade, c’est une journée magnifique, ensoleillée, et les moineaux le sifflent sur tous les toits. Non, lui crié-je à travers la porte fermée, je n’en ai pas envie, je n’ai pas envie du monde. Et je suis assise dans mon lit, le ciel bleu perce à travers ma fenêtre ou s’assombrit, ou un orage approche. Mon lit est mon navire, mon lit est mon radeau, je flotte là, des requins et autres animaux marins au-dessous de moi et les étoiles et le ciel au-dessus.
Que dois-je faire de toi, dit ma mère en mettant le dîner devant ma porte. Aucun de mes enfants, aucun de mes enfants, tous sont normaux et vont travailler, ils sortent le matin de la maison et reviennent le soir, sauf toi. Que vas-tu devenir ?
Il fut un temps où j’étais différente. Il y a eu un temps. J’étais vraiment pleine de vie. Aucune tâche ne me résistait, et en plus je dessinais simplement pour passer le temps et je faisais de la voltige et de l’escrime et dansais toute la nuit. Mes frères et sœurs avaient l’air fatigués quand ils revenaient du travail. Ils avaient tâché de sang le blanc de leurs yeux au fil de la journée et leurs mains, elles aussi, étaient écorchées et douloureuses. Chez moi on ne voyait aucune peine. Jamais. Je planais sur le sol où les autres marchaient, et il est très rarement arrivé que je me penche. Oui, il y a eu un temps où j’étais différente, et je ne le regrette pas. Mettez vos cœurs dans du papier d’aluminium pour qu’ils soient protégés quand vous sortez de la maison et ne les faites pas passer librement !
Il y a eu un temps où j’étais différente, et ma mère le regrette. Ma fille, dit-elle, ne veux-tu pas te lever pour que ton père puisse aller à la pêche avec toi et que tes frères et sœurs te racontent leur journée ? Non, dis-je, je n’ai pas envie du monde. Je suis assise dans mon lit, qui est mon navire, et la houle est forte. Le vent salé traverse ma chevelure et les vagues se déchaînent.
Jeux
Je porte mon cœur sur le bout de la langue : là, venez et attrapez-le ! dis-je en le tenant haut dans l’air en équilibre. Il brille et suinte dans la lumière crue du soleil. Un jeu amusant qui réjouit autant les femmes que les hommes. Ils inclinent la tête en arrière et affûtent les lèvres, lissent leur jupe ou les pinces de leurs pantalons. Et ensuite on joue à la balle avec mon cœur qui fait la galipette dans l’air.
Ce qu’il voit
Je change, c’est ça ce qu’il voit. Mes articulations craquent et claquent comme au printemps et mes cheveux luisent. C’est comme ça qu’il me voit et me réclame comme un événement imprévu. Et comme si je n’avais pas eu à ses côtés toute l’année la main sur son genou et le regard sur ses lèvres, suivant avec gravité la naissance de chaque mot, comme si je n’avais jamais été assise à ses côtés toute l’année.
J’ai provoqué un incendie en lui, me dit-il. Un incendie, et je le vois écumer dans ses yeux et s’embraser. Pas assez pour qu’il me fasse des demandes en mariage, il s’accroche à moi. Je suis devenue forte, et sur son front les veines saillent.
Soleil, je peux te voir à travers lui, de légers nuages bordent le ciel, et son souffle ne met plus mes cheveux en désordre. Ma mâchoire s’avancecomme chez tous les animaux en bonne santé, les dents blanches comme de la neige fraîchement tombée. Et mon cœur palpite et palpite et respire le sang frais.
Nadja Einzmann, Da kann ich nicht nein sagen, Geschichten von der Liebe, S. Fischer Verlag, 2001, p. 18, 41, 60, 99. Traduction inédite de Chantal Tanet.
Da kann ich nicht nein sagen
Mein Liebster ist einer, auf den zu warten sich lohnt. Er mag mich, und das genügt mir. Da bin ich gerne sein Haus und sein Hof und prüfe das Dach und öle die Tür, tagein, tagaus, und warte. Es ist eine Nacht, in der er so zu mir kommen wird, übers Feld, und die Sterne werden dröhnen und der Mond pubbern und pulsen, meinem Liebsten zur Begrüßung. Noch lebt er unter anderem Himmel und forscht und strebt und leckt sich die Zungenspitze wund zwischen den Büchern, er hat es mir oft geschrieben. Da kann ich nicht nein sagen und beiseite treten und lasse ihn nicht vorbei: in einer anderen Stadt einer anderen Frau. Da kann ich nicht nein sagen. Und so einen Liebsten hätte ein jeder gern und hat er ihn nicht, erträumt er ihn. Ich sehe zum Fenster hinaus und sehe ihn kommen, ein Schatten auf dem Weg. Und der Kies wird knirschen unter seinen Füßen, und meine Hand, gestützt auf die Fensterbank, wird schwer werden, meine wartende Hand.
An manchen Tagen
An manchen Tagen warte ich, daß etwas passiert. Auf einen Anruf ; daß das Haus einstürzt ; oder der Arzt mir sagt, daß ich nur noch wenige Wochen zu leben habe. Ich sitze im Bett und warte, und meine Mutter klopft an die Türe. Zu berichten hat sie nichts. Sei so gut, sagt sie, bring den Müll hinunter, oder : Wie wäre es mit einem Spaziergang, es ist ein wunderbarer Tag, sonnig, und die Spatzen pfeifen es von allen Dächern. Nein, rufe ich ihr zu, durch die geschlossene Tür, mir ist nicht danach, mir ist nicht nach Welt. Und ich sitze im Bett, der Himmel schaut blau durch mein Fenster oder umwölkt sich, oder ein Gewitter zieht auf. Mein Bett ist mein Schiff, mein Bett ist mein Floß, ich treibe dahin, Haie und andere Meerestiere unter mir und Sterne und Himmel über mir.
Was soll ich unternehmen mit dir, sagt meine Mutter, und stellt mir das Abendessen vor die Tür. Keines meiner Kinder, keines meiner Kinder, alle sind sie normal und gehen zur Arbeit, gehen morgens aus dem Haus und kehren abends zurück, nur du nicht. Was soll nur werden mit dir ?
Es gab Zeiten, da ich anders war, solche Zeiten hat es gegeben. Ausgesprochen lebhaft war ich. Keine Aufgabe war sicher vor mir, und dann noch zum bloßen Zeitvertreib zeichnete ich und voltigierte und focht und tanzte die Nächte durch. Meine Geschwister sahen müde aus, wenn sie von der Arbeit kamen. Sie hatten sich das Weiß in ihren Augen blutig gesehen über den Tag, und auch ihre Hände waren wund und schmerzten. Mir sah man keine Mühen an. Nie. Ich schwebte über den Boden, wo andere gingen, und daß ich mich bückte, kam nur sehr selten vor. Ja, es hat Zeiten gegeben, da ich anders war, und ich trauere ihnen nicht nach. Packt eure Herzen in Alufolie, daß sie geschützt sind, wenn ihr aus dem Haus geht, und reicht sie nicht frei herum!
Er hat Zeiten gegeben, da ich anders war, und meine Mutter trauert ihnen nach. Kind, sagt sie, willst du nicht aufstehen, daß dein Vater mit dir fischen gehen kann und deine Geschwister dir berichten von ihrem Tag? Nein, sage ich, mir ist nicht nach Welt. In meinem Bett sitze ich, das mein Floß ist, und der Seegang ist hoch. Salziger Wind fährt mir durchs Haar und die Wellen überschlagen sich.
Spiele
Ich trage mein Herz auf der Zungenspitze: Da, kommt und fangt es! sage ich und balanciere es hoch in der Luft. Es glänzt und schwitzt im grellen Sonnenlicht. Ein lustiges Spiel und erfreut Frauen und Männer gleichermaßen. Sie legen die Köpfe in den Nacken und wetzen die Lippen, sie streichen die Röcke glatt und die Bundfalten ihrer Hosen. Und dann spielen wir Ball mit meinem Herzen, daß es Purzelbäume schlägt in der Luft.
Was er sieht
Ich verändere mich, das ist es, was er sieht. Meine Gelenke krachen und knacken wie im Frühling und mein Haar schimmert. So sieht er mich und verlangt nach mir, als sei ich ein unvorhergesehenes Ereignis. Und als hätte ich nicht neben ihm all die Jahre, die Hand auf seinem Knie und den Blick auf seinen Lippen, die Geburt jedes Wortes mit Ernst verfolgend, als hätte ich nicht neben ihm gesessen all die Jahre.
Ein Feuer habe ich in ihm angerichtet, sagt er mir. Ein Feuer, und ich sehe es schäumen in seinen Augen und bluten. Nicht genug, daß er mir Anträge macht, er hält sich fest an mir. Stark bin ich geworden, und auf seiner Stirn schwellen die Adern.
Sonne, ich kann über ihn hinwegsehen, leichte Wölkchen säumen den Himmel, und sein Atem bringt mein Haar nicht mehr durcheinander. Mein Kiefer schiebt sich vor, wie bei allen gesunden Tieren, Zähne weiß wie frischgefallener Schnee. Und mein Herz pocht und pocht und atmet frisches Blut.
Nadja Einzmann, Da kann ich nicht nein sagen, Geschichten von der Liebe, S. Fischer Verlag, 2001, p. 18, 41, 60, 99.
Nadja Einzmann, écrivaine allemande née en 1974, vit à Francfort où elle a fait des études d’allemand et d’histoire de l’art. Elle a publié des récits et des poèmes dans des revues et anthologies, ainsi que deux livres chez S. Fisher-Verlag : Da kann ich nicht nein sagen. Geschichten von der Liebe (2001) et Dies und das und das. Porträts (2006). Elle a obtenu plusieurs prix littéraires, notamment pour Da kann ich nicht nein sagen en 2002 et le prix d’encouragement Hölderlin de la ville de Bad Homburg en 2007.
21:04 Publié dans ALLEMAGNE/AUTRICHE, Chantal Tanet, Nadja Einzmann, TRADUCTEURS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook