09/04/2011
Gerard Manley Hopkins

Gerard Manley Hopkins © Source visuelle : internet
Havre de grâce
Une religieuse prend le voile
J’ai désiré aller
Où ne tarit l’eau vive,
Aux champs que nulle grêle acérée ne fustige,
Où s’ouvrent quelques lys.
J’ai quêté d’habiter
Où nul vent ne fait rage
Là où la houle glauque est muette dans les havres,
A l’abri du roulis des mers
Heaven-Haven
A nun takes the veil
I have desired to go
Where springs not fail,
To fields where flies no sharp and sided hail
And a few lilies blow.
And I have asked to be
Where no storms come,
Where the green swell is in the havens dumb,
And out of the swing of the sea.
Gerard Manley Hopkins, « Poèmes et proses », éd. du Seuil
(traduit par Pierre Leyris)
23:44 Publié dans Gerard Manley Hopkins, GRANDE-BRETAGNE/IRLANDE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Bernard Manciet (1923-2005)

Bernard Manciet © Photo : Pascal Fellonneau
Sanctus, LXIII (extrait)
Chaudière de pâleur et sureau en fleur grand ouvert
et rose d’âme patène
maintenant hautaine puis effondrée et enflammée
en secret rayonnante angélique répandue – bouche
comme une prairie de vent
qui se mire longuement dans son épaule
dans son ourlet fuyant lune et talon
peuple : une rose d’insomnie
où se fait l’ombre et plus ombre que l’ombre
jour maintenant et plus que jour semences
soit le monde pétri au songe
soit enseveli dans notre vue intérieure
ou songe de toute notre chair pétrie silencieuse
ou songe enseveli au songe des grandes choses
le songe monte des bas-fonds
sauvage
d’itinéraires étoilés anges et dieux
tombés dans la toupie – beaux enfers nécessaires –
chute éclair architecte
et l’Homme fait homme
par l’arbre
de braises qui descendent
insurrection candide
rose par colonne et colonne d’ailes
ordre vivant
d’où vivants nous sommes ciel vif
comme procède rose de la rose
Tu es couvert de pétales
pour l’exclamation de tes essieux
qui t’inondent et de lustre nous sommes
comme d’ombres couverts
toutes formes hâtées
tous muscles raisonnables
pour enfin cet Archet
feu dévêtu de flamme
feu dépouillé des pétales du feu
sans risquer Dieu si Dieu n’est que le risque
et langue et lune-archet
corps toute langue et lune
lucidité de hasard
Bernard Manciet, « L’enterrement à Sabres », éd. Poésie/Gallimard, 2010, (pp. 235/237)
Mensa Tremenda (extrait)
Mais frêle
comme de la glace en avril
ou de la neige sur l’étang
elle s’y pose sans rien dire
comme un peu de lumière
haleine sur la nuit
ce narcisse sans fard
sur les eaux-mères
des sept sources scellées
l’agneau dans le Lion
une vivante paupière
dans le feu d’étoile comme un soleil fragile
- ne tremble pas comme ça –
au creux du bruit de soleil
un agneau de regard
un dieu de pressentiment
un dieu qui se murmure
un matin un agneau dans le soir de force
ourlet d’aube sans fin
fragile puissance
midi de givre
quadruple sans nombre
pétale antérieur
à la rosée
les péchés neigent en saisons
source de la mer elle sort titubante
Juda sort de sa proie
et du tremblement de la treille
quelque fragile éclair
du péché un feu prince
du vin lourd laine et lin
le Lion rieur a rassasié l’agneau
à sept cornes l’agneau
et des yeux pour en rassasier la nuit
et des yeux nous brisons cette paix
en neuve fragilité tremblante
en orient de l’eau
en émoi dans la bogue
membrane
de paix l’éclair entre les mains
Ibid., (pp.347/349)
23:21 Publié dans Bernard Manciet | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Ikko Narahara

23:00 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
04/04/2011
Nasser Al-Aswadi (par Claude Darras)
Portrait de Claude Darras
Nasser Al-Aswadi, le fabuliste de Saba
Nasser Al Aswadi : L’acrylique, les encres, la gravure associée à la photographie et accessoirement la terre cuite attestent de la multiplicité de ses curiosités (Photo Daniel Lemaire).
L’univers de Nasser Al-Aswadi a mûri en grande partie dans l’inconscient, vraisemblablement pendant les deux premières décennies d’une vie constellée de découvertes. La société yéménite et tribale ne connaissant pas le cloisonnement plus ou moins étanche des classes d’âge, il a été graduellement initié aux activités et aux comportements des adultes. Ainsi la révélation précoce de l’architecture du Yémen, l’écoute passionnée des diseurs de bonne aventure et le lent déchiffrage de la calligraphie arabe sur les manuscrits coraniques et les monuments antiques ont peu à peu sédimenté un terreau fertile de références savantes et de curiosités pastorales sur lequel a fleuri une exubérante invention. Études simplifiées mais encore reconnaissables où vibrent des lignes simples et des coloris sobres : l’académisme des premières gouaches se nourrit des minarets et des dômes peints des mosquées de Taez et emprunte aux blasons enluminés des façades chaulées de Sanaa. Sur des papiers grenus, il interprète l’harmonie glacée de la maçonnerie et les cassures tranchées au couteau entre les ombres et les lumières des édifices domestiques et des lieux saints…

Sans titre, technique mixte sur toile, 147 x 130 cm. 2010
À Maussane, au seuil des Alpilles calcaires, dans la quiétude du mas du Soleil, son esprit semble se concentrer, l’espace de quelques secondes, sur un tableautin qui l’absorbe tout entier, obscurcissant son regard : des briques d’ocre rouge bien appareillées emprisonnent des vitraux aux couleurs criardes. C’est un exercice d’école où il transcende déjà la géométrie polychrome des citadelles de basalte et d’argile perchées sur les hauts plateaux d’altitude. Tandis qu’il parle, quelque chose de spectaculaire se produit. Une lueur ironique, pleine d’appétit, ressurgit au fond de ses yeux noirs, prête à faire un sort à tous les obstacles jetés en travers de notre dialogue par les chausse-trapes de la langue française.
« Désormais, je colporte au cœur de ma peinture les histoires que m’ont racontées les bergers de mon village, justifie-t-il simplement. Ce sont de vieilles légendes ou des contes animaliers, tirés du Coran parfois, auxquels je mêle les dernières volontés des legs testamentaires. »
Sans titre, technique mixte sur toile, 120 x 60 cm. 2008
Dans la petite cité d’Al Hujr (où il est né le mercredi 4 octobre 1978), à une vingtaine de kilomètres de Taez, accroché à l’herbe tendre des massifs abrupts de la Hugariyya, l’adolescent ne se lasse pas de réécouter les mille et une versions du fabuleux voyage de la huppe, habile messagère de Bilqîs, la reine de Saba, auprès du roi Salomon, à Jérusalem. Aux heures de classe buissonnière, les pâtres l’ont persuadé que l’oiseau sacré protégeait du mauvais œil, exorcisait les sortilèges et éloignait les djinns de néfaste augure. Aussi suivra-t-il longtemps dans le ciel le flamboiement du plumage fauve orangé à pointes noires qui fait ressembler le passereau à un grand papillon noir et blanc des tropiques. Il ne goûte que modérément les enseignements de la scolastique par les maîtres égyptiens de la madrasa du village. Et le cercle de famille pourtant très moderniste lui paraît trop resserré autour d’une fratrie de douze frères et sœurs dont il est le sixième enfant. Il étouffe. Et il se rebelle. « À seize ans, j’ai osé dire non à mon père… », lâche-t-il en baissant la voix. On dirait qu’il n’en revient toujours pas ! Au milieu du visage glissent l’ocre et la nuit, et les émotions passent par un sourire fugace et une pesante concentration.
« J’ai quitté le nid parental pour la ville de Taez, débite-t-il soudain loquace. J’y ai appris le dessin industriel au sein d’un établissement d’enseignement technique. J’ai prolongé ma formation à Sanaa en alternant les cours avec des petits boulots de tailleur et de marchand de quatre-saisons. »

Sans titre, technique mixte sur toile, 136 x 97 cm. 2010
À Sanaa, l’architecte Yassin Ghaleb, son mentor, et le peintre soudanais Taïeb Al Hajj, un camarade d’atelier, l’incitent à se déprendre du badinage conventionnel inséparable des années d’apprentissage. La rencontre simultanée du langage universel des formes - avec Chagall et Picasso - et de la France des Lumières, au moyen du livre et de la télévision, de même que l’exploration assidue des terrains de fouille archéologique de la péninsule Arabique, sous le tutorat de prestigieux épigraphistes et historiens de l’art, dessinent déjà, de 1997 à 2001, les linéaments de l’œuvre futur. La bibliothèque du Centre culturel français à Sanaa et les programmes audiovisuels de Canal France International ont charpenté sa connaissance du pays de Molière et de Rimbaud. Commencés en 2004, des séjours en Touraine et en Provence ont aiguisé sa détermination à y établir un second atelier : des amis collectionneurs le persuaderont de planter son chevalet à Marseille.

Sans titre, technique mixte sur toile, 144 x 110 cm. 2010.
Le versant occidental de son activité l’introduit dans un système d’échos, de miroirs, de résonances, de métissages qui a pour effet d’élargir la conception de sa création et d’en étendre les registres. L’acrylique, les encres, la gravure associée à la photographie et accessoirement la terre cuite attestent de la multiplicité de ses curiosités. La mémoire et le lignage, l’homme et la femme, les travaux des champs et le labeur des villes, les fables et l’écriture, les graffiti rupestres et la magie des songes, autrement dit les racines immémoriales de sa parentèle, continuent de sous-tendre sa démonstration. Un peu comme la basse continue du oud cadence les chants psalmodiés au dernier étage des demeures yéménites, le mafraj, où les hommes mâchent du qat (plante aux vertus stimulantes) au gré du glougloutement des pipes à eau tout en déclamant les grands textes de mystiques soufis et de philosophes bédouins. Le pastoureau d’Al Hujr est resté fidèle aux rêves de sa jeunesse. Parmi les grands formats des acryliques et les photographies « lithiques », le bestiaire du Jebel Saber ramène au large de la Méditerranée les fragrances de l’Arabie heureuse, vapeurs d’encens et arômes épicés, odeur de menthe et de rose trémière, fumet de la shurba et du ragoût d’agneau. Des prédictions naïves enluminent la toile où la huppe symbolise la piété familiale et l’attachement aux ancêtres. Sur le vélin gaufré, l’âne agrandit les prunelles étonnées et vitreuses d’un solitaire, d’un ascète du désert. Le merveilleux qui est le cœur et le moteur de ces fables peintes et gravées laisse entrevoir l’âme du fabuliste et de ses personnages.
© Claude Darras, avril 2011

NASSER AL-ASWADI_Portrait de Claude Darras.pdf
Nasser Al Aswadi, la Citerne, Les Baux de Provence, du mardi 19 avril au lundi 2 mai 2011, tous les jours de 10 à 13 h et de 14 à 18 h. Vernissage le samedi 23 avril à 18 heures.
Renseignements : Office de tourisme des Baux 04 90 54 34 39.
18:21 Publié dans Claude Darras, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Marie Etienne, Haute Lice (une lecture de Tristan Hordé)
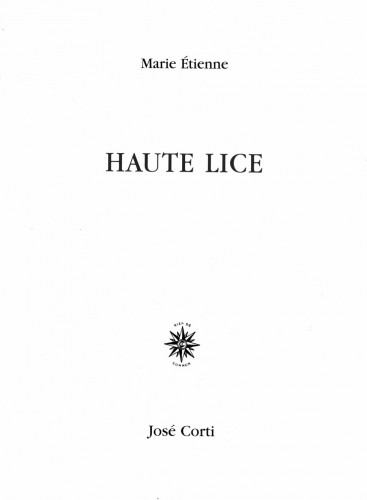
Marie Étienne, Haute Lice, éditons José Corti, 2011, 18 €.
Une lecture de Tristan Hordé
Rien de plus efficace que l’exergue tiré de Rimbaud, « Moi, j’ai toujours été stupéfait ! Quoi savoir ? » ("Remembrances du vieillard idiot") pour lire ce livre singulier ; c’est dire d’entrée de jeu que le lecteur aura à construire quelque chose — donc à lire ; « Faut-il tout dire afin qu’un jour il ne reste plus rien que la lucidité ? » (p. 124) : certes non. Haute Lice est partagé en sept ensembles de courtes séquences et se ferme sur une postface bien en relation avec l’exergue, sorte de "mode d’emploi" où l’auteur esquisse une poétique : « À proprement parler, le sens ne compte pas vraiment, ou bien ni plus, ni moins, que la sonorité, le rythme et le suspens, c’est ainsi que les choses se passent. » (p. 171) De quoi s’agit-il pour que le lecteur n’ait pas à se préoccuper du sens ?
Les ensembles sont liés grâce à la présence du début à la fin d’un personnage, Ava, c’est-à-dire Ève, narratrice des brefs récits dans lesquels elle a un rôle ; ajoutons qu’elle-même devient à l’occasion auteur : « Pour vaincre la tristesse, je m’inventais des fables troubles, dont j’ignorais la signification. » (p.20) Autrement dit, dans cet emboîtement les histoires ne se distinguent pas les unes des autres. Elles mettent en scène Ava, de l’enfance à l’âge adulte, et de nombreux personnages qui n’apparaissent qu’une fois, comme Joachim l’Italien ou Seringa le chimpanzé, ou reviennent à intervalles réguliers, comme Stone (mari d’Ava) ou Nel. Tous font n’importe quoi, le n’importe quoi ne pouvant être toujours défini, et leur apparence même n’est pas fixe. Ainsi, Ava, dans un récit est exhibée au bout d’une laisse, serait-ce dans un cirque ?, et le lecteur retrouve cette laisse bien plus loin, cette fois Ava peut-être sous une forme animale : « La laisse de ma mère, de mauvaise qualité, va céder sous mes crocs. » (p. 117)
Tout peut arriver : les oiseaux ont des dents, des fillettes sont dans des cages suspendues pour le plaisir des curieux, Ava perd sa mère dans un train ou reçoit devant sa porte « face cachée, nuque exposée, une tête sans corps » (p. 94). On multiplierait les exemples, mais ce serait recopier Haute Lice…Si une partie du livre évoque un lieu désigné par Lajenès (à lire "la jeunesse", en créole haïtien), la narratrice se trouve aussi à Paris, monte dans un étrange autobus aux vitres aveugles qui l’emporte nulle part, « dans le milieu d’une étendue d’eau grise, crêtée de loin en loin par une touffe d’herbe. » (p.166) Le lecteur renonce vite à la tentation d’organiser le tourbillon des changements d’apparence, de chercher quelque équilibre dans des récits qui, si minuscules soient-ils, le conduisent dans l’inexploré. On verrait aisément un monde à la Lewis Carroll, une Alice dans Ava, et l’auteur semblerait nous engager dans cette voie, mais il l’exclut immédiatement :
Petite sœur me conduit au miroir.
—Passe derrière, me dit-elle.
—Eh, quoi, ne me conduiras-tu ?
Elle rit, fleur goyave. (p. 124)
Le monde de Lewis Carroll a ses lois, qui relèvent somme toute d’une certaine logique, celui de Marie Étienne, qu’on pourrait lire comme relevant uniquement du rêve, est pour beaucoup un univers de mots, j’y reviendrai.
Cependant Le monde de Lewis Carroll a ses lois, qui relèvent somme toute d’une certaine logique, celui de Marie Étienne, qu’on pourrait lire comme relevant uniquement du rêve, est pour beaucoup un univers de mots, j’y reviendrai.
Cet univers n’est pas totalement coupé de l’Histoire ; on y croise par exemple un maçon « admonesté et sous-payé comme c’était la coutume » (p. 39), et les femmes, qui savent distinguer la satisfaction du désir sexuel et l’amour, peuvent surtout être elles-mêmes par le rêve ou l’écriture ; « Je commençais d’écrire c’est-à-dire de migrer vers mes terres intérieures « (p. 75) indique Ava. Mais quand elle entend bien refuser d’être dans le temps (« Je refuse de survivre à l’instant annulé en m’accrochant avide aux basques du suivant »), sa sœur se moque d’elle : « Allons, allons, tu racontes des histoires ! » L’Histoire est présente aussi par les allusions littéraires ; par exemple, "La Ravaudeuse" évoque Margot la Ravaudeuse de Fougeret de Monbron et "Nel" peut-être un personnage de Fin de partie de Beckett, "Marigda" est sans doute une allusion au livre de Viviane Forrester Le corps entier de Marigda, etc. Quant au premier récit, "La dictée", dans lequel Ava se laisse aller à uriner en classe au point que le liquide forme une grande mare, sans d’ailleurs que l’institutrice s’étonne outre mesure, il renvoie directement à "Remembrances du vieillard idiot" et donc à l’exergue :
[…] Quand ma petite sœur, au retour de la classe,
[…] Pissait, et regardait s’échapper de sa lèvre
D’en bas, serrée et rose, un fil d’urine mièvre… !
La postface introduit un jeu entre lice et lisse, d’où les termes techniques de peausserie lisser et chagriner ; dans les deux cas, le travail de l’artisan — la tapisserie, montage complexe de fils, la préparation des peaux — permet de passer d’une apparence à une autre : impossible de reconnaître dans l’œuvre achevée les matériaux travaillés. Et c’est heureux. De même, les mots sont associés non pas comme dans une fatrasie mais pour construire des ensembles pas encore vus, pas encore imaginés, pas du tout impossibles … puisqu’ils sont décrits. Voici par exemple le début d’une scène dans la loge d’une maison d’Ava :
« La femme est belle, moi je sucre, elle a les doigts qu’il faut, on lui en mangerait son cratère de plaisir, d’autant qu’elle sait ce qui convient : détecter en dansant mais sans colle ni buée les écrans de fumée qui séparent du bleu, et lire dans les yeux le tintamarre des culs. » (p. 97)
Le seul changement de position des mots (qui entraine modification du statut grammatical) produit des effets, ainsi dans ce passage : « or voilà que la terre se bombe, or voilà que les bombes se terrent » (p. 30) ; on notera les nombreux jeux avec les sons, minuscules (« je suis en pantalons, pantoise ») ou non : Ava aime une femme qu’elle nomme "Missive" ou "Mélisse" ou "Réglisse", noms qui portent le sens « de délice (ou supplice ?) », et il n’est pas surprenant que la rivale de cette femme ait pour nom "Céline" — la finale ne peut entrer dans la série….Au jeu des sons s’allie le rythme ; on prendra plaisir à entendre le mouvement de la voix dans ce passage :
« Musique en fête, en tête, en crête, en kiosque, en dents calquées sur les montagnes, en tournevis, en tour de roue, musique saoule sur les terrains poudreux, éclatée à dessein, flûtes en verve. Musique verte. (p. 80)
Il y a dans Haute Lice un amour de la langue (comment dire autrement ?) que l’on voudrait plus répandu, une jubilation que l’on partage sans peine, un humour constant — et une manière malicieuse de l’auteur d’être présente : "Marie" et "Ava/Ève" sont deux origines culturelles, et ne reconnaît-on pas "Marie" dans les noms de personnages "Mariquido" et "Marigdar" ?
© Tristan Hordé, avril 2011
■ Sur le site TERRES DE FEMMES
Dans le chagrin ouvragé de la page (une lecture d’Angèle Paoli)
18:10 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
John Muir, Célébrations de la nature (une lecture de Nathalie Riera)
JOHN MUIR
Célébrations de la nature
(traduction d’André Fayot)
Ed. José Corti, 2011
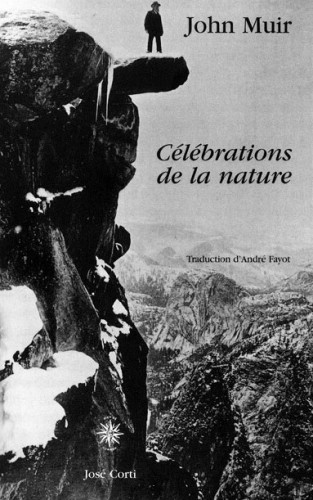
Aucun des dogmes que professe la civilisation actuelle ne forme, semble-t-il, un obstacle plus insurmontable à la saine compréhension des relations que la culture entretient avec l’état sauvage, que celui qui considère que le monde a été fabriqué spécialement à l’usage de l’homme. Tout animal, toute plante ou cristal le contredit de la manière la plus formelle. Or il est enseigné de siècle en siècle comme quelque chose de précieux et de toujours nouveau, et dans les ténèbres qui en résultent cette prétention monstrueuse peut aller librement son chemin.
[...]
Célébrations de la nature de John Muir (José Corti, 2011) rassemble plusieurs textes, dont la plupart ont paru dans diverses revues : Mountains of California (1894), Our National Parks (1901) et Steep Trails (1918).
Traverser les paysages les plus grandioses, afin de recevoir « d’utiles leçons sur la sculpture terrestre », être un habitant de la Nature, en saisir la musicalité, la radicalité, la grammaire de ses herbes et rochers : les mots de la Nature sont « là pour nous rencontrer », là pour nous revigorer, et chez Muir le préparer à de nouvelles journées « de notes, de croquis et de toutes espèces d’escalades » ; journées « qui vous agrandissent la vie ». Dans la Nature, telle que célébrée par John Muir, tout est « stricte beauté », tout mérite la plus vive attention, et nous engage à accueillir la Nature dans ses formes multiples :
On trouve ici aussi des collines de cristaux étincelants, des collines de soufre, des collines de verre, des collines de cendre, des montagnes de tous styles architecturaux, boisées ou glacées, des montagnes couvertes de nectar à l’instar de l’Hymette des Grecs, des montagnes cuites à l’eau comme des pommes de terre et colorées comme un coucher de soleil.
Chez Muir, il n’est pas vraiment question d’une Nature romantique, plus juste serait de souligner sa profonde dévotion. Chez lui, la célébration est un haut lieu sans artefact, montagnes et collines de l’esprit, dès lors qu’il peut encore entendre toute chose se transmuer en amour. La Nature revêt plusieurs figures, plusieurs statuts, et parmi ses virtuosités décelées :
On peut considérer les vallées supérieures des rivières importantes comme des laboratoires et des cuisines, où, parmi des milliers de marmites et de cornues, il est possible de voir la Nature à l’œuvre dans ses fonctions de chimiste et maître queux – composant adroitement une variété infinie de ragoûts minéraux, rôtissant des montagnes entières, cuisant les roches les plus dures dans l’eau ou la vapeur jusqu’à en faire une pâte molle, une bouillie (jaune, brune, rouge, rose, mauve, gris ou blanc crème) ou la plus jolie boue du monde, et distillant les essences les plus subtiles.
La Nature-Maçon : « les pierres de cette maçonnerie divine », et puis aussi la Nature qui travaille
avec enthousiasme, comme ferait un homme – attiser ses forges volcaniques comme un forgeron ses charbons ; pousser les glaciers sur le paysage comme un charpentier ses guillaumes ; nettoyer, labourer, herser, irriguer, planter et semer comme un paysan ou un jardinier ; faire aussi bien le gros travail que l’ouvrage plus minutieux ; planter les séquoias, les pins, les églantiers, les marguerites ; s’intéresser aux pierres précieuses dont il remplit la plus petite fissure, la moindre cavité ; distiller des essences fines ; peindre comme un artiste les plantes, les coquillages, les nuages, les montagnes, la terre et le ciel tout entiers – œuvrant et agissant pour toujours plus de beauté. (chapitre 4, Le parc national de Yellowstone)
Lire John Muir c’est apprendre que la Connaissance participe à la survie de l’homme. De par sa fonction d’échanges, elle garantit le dialogue. Curiosités, observations, découvertes, autant de façons d’être et de se sentir habitant de la Nature. Tout au long de ce livre formé de 17 sections, comme autant d’excursions et « d’années d’étude parmi ces terres vierges et splendides », la Nature apparaît dans son unicité : « Sur toute cette étendue d’architecture démente – la capitale de la nature – il semble n’y avoir aucune habitation ordinaire ». (chapitre 9, Le Grand Canyon du Colorado)
Nulle part ailleurs sur ce continent, les merveilles de la géologie, archives du passé du monde, ne sont étalées plus ouvertement ni empilées à ce point. Le Canyon tout entier est une mine de fossiles, dans laquelle mille cinq cents mètres de strates horizontales sont offerts à la vue sur plus de deux mille cinq cents kilomètres carrés de parois ; mais sur le plateau adjacent, c’est une autre série de couches, deux fois plus épaisse, qui constitue une énorme bibliothèque géologique – une collection de livres de pierre couvrant mille cinq cents kilomètres d’étagères sur plusieurs niveaux, classés de façon très commode pour l’étudiant. Et quelles merveilles que les documents qui couvrent les pages – formes innombrables des flores et des faunes successives, magnifiquement illustrées de dessins en couleur, qui nous transportent au cœur de la vie d’un passé infiniment lointain ! Et à mesure que nous progressons dans l’étude de cette vie tellement ancienne, à la lumière de la vie chaude qui palpite autour de nous, nous enrichissons et nous grandissons la nôtre.
Après les splendeurs de la Yellowstone, Muir explore les glaciers et nous amène vers une « Vue rapprochée de la Grande Sierra ». Parmi les espèces animales que Muir aura rencontré, et dont il consacre plusieurs pages tout en louanges, quelle jubilation que le pétillant écureuil de Douglas (chapitre 7) : « C’est l’animal, sans exception, le plus sauvage que j’aie jamais vu – petit brandon crépitant de vie, qui se grise d’oxygène et des meilleures essences de la forêt ». Et parmi les oiseaux de montagne, qui feront la réjouissance de Muir, de belles pages consacrées au précieux et prodigieux Cincle d’Amérique, qui ne chante en chœur qu’avec les rivières, « amoureux des pentes rocheuses », et qui « vocalise en toute saison, même dans la tempête (…), et dont la particularité est que « Jamais rien de glacé ne sort de son gosier ardent ».
Au cours de ses multiples expéditions, Muir se fera témoin de tempêtes de neige, de violents orages, d’avalanches – « Ce vol dans une voie lactée de fleurs de neige fut le plus spirituel de tous les miens, et après bien des années, son souvenir suffit à me mettre en joie » – Depuis sa cabane proche de Sentinel Rock, il assiste à un tremblement de terre : « Les roulements issus des profondeurs étaient suivis généralement de subites poussées antagonistes horizontales venues du nord, auxquelles succédaient à la fois des mouvements de torsion et des chocs verticaux. A en juger par ses effets, ce séisme de Yosemite – ou d’Inyo, comme on l’appelle parfois – était faible, comparé à celui qui a donné naissance au système de grands éboulis du massif et qui a tant fait pour le paysage ». (chapitre 15, Les cours d’eau de Yosemite)
Parmi les chefs-d’œuvre des conifères, gros plan sur le vénérable séquoia géant de la Sierra Nevada, venu « de l’ancien temps des arbres », et dont la taille colossale peut atteindre quelques 100 m de haut : « l’arbre entier a la forme d’un fer de lance, et, (…) se montre aussi sensible au vent qu’une queue d’écureuil ». Leurs troncs, pouvant aller jusqu’à 3 m de diamètre, « ressemblent plus à des colonnes d’architecture artistement sculptés qu’à des troncs d’arbre ». Le séquoia « vous maintient à distance, ne fait nul cas de vous, ne s’adresse qu’aux vents, ne pense qu’au ciel et parait aussi insolite d’allure et de comportement au milieu des arbres du voisinage que le serait un mastodonte ou un mamouth laineux parmi de vulgaires ours et des loups ordinaires ». John Muir nous apprend que la mort d’un séquoia « résulte d’accidents et non pas, comme celle des animaux, de l’usure des organes (…) Rien (…) ne préjudicie au séquoia ». (chapitre 16, Les séquoias de Californie)
Dans notre actualité du 21ème siècle naissant, tandis que les forêts du monde sont soumises à la hache et au feu, que la menace des écosystèmes les plus divers se fait grandissante (déforestation de la forêt amazonienne pour la culture du soja), des recensements inquiétants indiquent, d’année en année, les méfaits d’une destruction programmée, dont on peut mesurer les déséquilibres climatiques de par le monde. A l’époque de J. Muir, gâchis et saccages sont perpétrés sous l’indifférence du gouvernement et le mépris des tueurs « qui répandent la mort et le chaos dans les jardins sauvages et les bois les plus magnifiques ». Les forêts sont loin d’être considérées comme dispensatrices de vie. Contre autant de destruction et de pillage, qui « s’étendent chaque jour plus vite et plus loin », Muir préconisait l’alternative de laisser la forêt à l’état naturel, ou alors que celle-ci soit « objet d’une judicieuse administration ». Mais comment protéger les arbres des imbéciles ? Le monde ne cesse de tourner « sous le couvert d’or et de fables », mais le monde ne peut revenir en arrière.
Il y aura une période d’indifférence de la part des riches, endormis par leur opulence, et des millions de laborieux, endormis par la pauvreté, dont la plupart n’ont jamais vu une forêt ; une période de protestation véhémente et d’objection de la part des pillards, qui ont autant d’audace et aussi peu de honte que Satan lui-même.
Une telle lecture nous soumet à nos résignations, ainsi qu’à la fragilité de ce qui n’est plus capable de dispenser la bonne joie ou d’assurer des façons enthousiastes d’être. Un tel livre nous invite à plus d’égards pour nos survies personnelles, au sein d’une humanité coupable d’aucune autocritique et d’aucune action massive face aux saccages consentis. Dégradations répétitives, quand la Nature s’offre à nous sans concept et sans profit. Lire John Muir, c’est aussi s’encourager à ne plus douter que ce qui doit être sauvé, doit l’être rapidement.
Dans Walden, H.D. Thoreau s’interroge : Ne suis-je pas en intelligence avec la terre ? Ne suis-je pas moi-même en partie feuilles et terreau végétal ?
Nathalie Riera Les Carnets d’eucharis
25 mars 2011
Quelques autres extraits :
(…) il ne m’était jamais venu à l’esprit que les arbres sont des voyageurs, au sens courant du terme. Leurs voyages sont nombreux quoique peu étendus, mais nos petits voyages à nous, en avant, en arrière, ne sont guère plus que les oscillations d’un arbre (…) (chapitre 12, Tempête dans la forêt)
Il n’y aurait donc pas lieu de s’étonner que ceux qui aiment leur pays et qui déplorent sa nudité hurlent aujourd’hui : « Sauvez ce qu’il reste encore des forêts ! » Aujourd’hui le défrichement est sûrement allé bien assez loin : le bois d’œuvre ne va pas tarder à se faire rare et il ne restera plus un bouquet d’arbres pour se reposer ou prier. Sans nouvelle réduction de sa superficie, le reliquat, protégé, fournira quantité de bois – une récolte pérenne pour tous ses usagers légitimes – et continuera à abriter les sources des rivières qui jaillissent des montagnes, à dispenser de l’eau d’irrigation aux vallées sèches du piémont, à empêcher les crues dévastatrices et à être à jamais et pour le monde entier une bénédiction. (chapitre 17, Les forêts américaines)
18:03 Publié dans ETATS-UNIS, John Muir, José Corti, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
27/03/2011
E. E. Cummings - Font 5 - Editions NOUS
Traduction et postface de Jacques Demarcq
Collection Now

puisque sentir est premier
qui prête la moindre attention
à la syntaxe des choses
ne t’embrassera jamais entière;
tout entier être un idiot
quand le printemps est de ce monde
mon sang approuve,
et les baisers sont un meilleur sort
que la sagesse
ma dame je le jure sur toutes les fleurs. Ne pleure pas
—le plus beau geste de mon cerveau ne vaut
ce battement de tes paupières qui dit
nous sommes l’un à l’autre:alors
ris donc,à la renverse dans mes bras
car la vie n’est pas un paragraphe
Et la mort je pense n’est pas une parenthèse
E. E. Cummings
(1894-1962), son cinquième livre,
le plus parisien, d’une vitalité infatigable,
toutes griffes et caresses dehors.
Autre extrait sur le site
Littérature de partout (Tristan Hordé)
XXVII – MEMORABILIA sur le site Terres de femmes

Source photo : http://www.gvsu.edu/english/cummings/Index.htm
E. E. Cummings (1894-1962) :
Poète, écrivain et peintre américain. Son œuvre est composée de plus de neuf cents poèmes, quelques pièces, des essais. Il fut l'un des grands novateurs de la poésie XXe siècle, notamment par son usage de la typographie et de la syntaxe.
Ont été traduits en français, par Jacques Demarcq : je:six inconférences, Contes de fées, 16 Poèmes enfantins (Clémence Hiver), 95 Poèmes (Points/Seuil) ainsi que No thanks à paraître prochainement aux éditions Nous.
éditions NOUS
4 chemin de Fleury
14000 Caen
Site : www.editions-nous.com
Blog : http://editions-nous.tumblr.com/
22:21 Publié dans E.E. Cummings, ETATS-UNIS, Nous | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e e cummings, éditions nous, littérature de partout, les carnets d'eucharis, terres de femmes |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
ANTHOLOGIE NUMERIQUE : Quels infinis paysages ? – Ici Poésie, éd. Publie.net (collectif dirigé par François Rannou)

OLIVIER APERT, THOMAS AUGAIS, JEAN-LOUIS AVEN, PATRICK BEURARD-VALDOYE, MICHEL BUTOR, FRANÇOIS CHENG, MICHEL COLLOT, HUNG RANNOU, BENOÎT CONORT, FABIENNE COURTADE, RENÉ DEPESTRE, PIERRE DHAINAUT, YVES PICQUET, HENRI DROGUET, MICHÈLE DUJARDIN, CHANTAL DUPUY-DUNIER, MYRIAM ECK, ANTOINE EMAZ, FRED GRIOT, GEORGES GUILLAIN, DENIS HEUDRÉ, LUDOVIC JANVIER, JACQUES JOSSE, THIERRY LE SAËC, PAOL KEINEG, VÉNUS KHOURY-GHATA, ABDELLATIF LAÂBI, FRANÇOIS LALLIER, DENISE LE DANTEC, MARC LE GROS, HENRI GIRARD, CHRISTOPHE MARCHAND-KISS, VICTOR MARTINEZ, OLIVIER MATUSZEWSKI, DOMINIQUE QUÉLEN, FRANÇOIS RANNOU, NATHALIE RIERA, ROLAND REUTENAUER, HÉLÈNE SANGUINETTI, PIERRE-YVES SOUCY, ANNE DE STAËL, JEAN-LUC STEINMETZ, JEAN-CHARLES VEGLIANTE, ANDRÉ VELTER, KENNETH WHITE.
Description
Cette anthologie est d’abord une manière d’interroger, aujourd’hui, le paysage et ses infinies variations – celles du regard singulier grâce auquel chacun construit son paysage, au fil du temps ; celles qu’il subit sous l’effet des transformations liées à l’action de l’homme, ou des éléments. Paysage précaire, donc, mouvant, qui se constitue pourtant dans l’arrêt qu’il impose : une pause est nécessaire pour admirer, décrire, peindre, cadrer ce qui est là sous les yeux. Chaque texte, ici, écrit un rapport au monde, tente d’en percevoir un rythme, d’en traduire une leçon, d’en soulever un questionnement. Il y a bien un enjeu qui fait du paysage autre chose qu’un thème décoratif. Notre « terre habitable » (François Cheng), c’est la chute d’Iguazú (Michel Collot) et la ville (Michèle Dujardin, Denis Heudré, Fred Griot) autant que le poème comme espace (Fabienne Courtade) ou les noms qui le désignent (Patrick Beurard-Valdoye). C’est toujours un départ vers l’inconnu (Michel Butor, Kenneth White), un angle de vue (Antoine Emaz) qui, parfois, remet en cause avec ironie (Paol Keineg). Les peintres, qui nous ont appris à voir le paysage, sont présents dans cet ouvrage et c’est somme toute d’une logique irréductible.
Voici le lien de l’anthologie Publie.net/ Printemps des poètes consacrée au paysage… C’est la première anthologie de poésie réalisée sur ce support… une première en somme, à goûter !
Vous pouvez le télécharger au prix modique de 0,99 € au format pdf, epub ou mobipocket
en cliquant ici http://www.publie.net/fr/ebook/9782814504462/quels-i...nfinis-paysages
21:56 Publié dans Nathalie Riera, PUBLIE.NET | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathalie riera, publie net, françois rannou, anthologie numérique |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
13/03/2011
Carnet d'eucharis n°27 - mars/avril 2011
[SOMMAIRE………]

Les carnets d’eucharis n°27
Mars/Avril 2011
Aleksander Rodchenko
Artiste russe
Eric Bourret
Photographe
DU CÔTÉ DE…
Caroline Sagot-Duvauroux
Kenneth White
EDITIONS NOUS DOMINIQUE BUISSET Quadratures
AUPASDULAVOIR
DOMINIQUE GRANDMONT Soleil de pluie
ALAIN HELISSEN ARNACHIST COOKBOOK – sur fond de friches industrielles
NATHALIE RIERA là où fleurs où flèches
Georges Oppen … Robert Creeley
SITESPOESIE
Ingeborg Bachmann sur le site ŒUVRES OUVERTES
Andreï Biély sur le site ESPRITS NOMADES
REVUE
3ème SECOUSSE sur la toile Editions Obsidiane
Au format PDF
Les Carnets d'eucharis n°27_mars&avril 2011.pdf

Au format livre numérique/CALAMEO
http://fr.calameo.com/read/000037071f68b31ec93b0
15:56 Publié dans Eric Bourret, LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, PHOTOGRAPHES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
10/03/2011
Nathalie Riera est invitée le samedi 19 mars dans le cadre du « printemps des poètes », à la bibliothèque Desnos, à une rencontre et lecture de ses poèmes.
COMMUNIQUÉ…………………………
PRINTEMPS DES POETES 2011 ----------------------
D’infinis paysages
Paysages naturels, paysages urbains, paysages rêvés, paysages intérieurs… Quand la poésie ose tout dire, on assiste bien aux noces du ciel et de la terre, de la ville et des vallées et de tous les espaces traversés et vécus.
Chacun de nous habite les paysages du monde. Et les paysages, sans nous, ne prendraient plus la peine de se faire une beauté. L’infini tient aussi dans tous ces visages – fragiles, vulnérables – que les poètes savent nommer et chanter.
Atteindre des paysages nouveaux, c’est s’ouvrir au mystère de l’autre, c’est tendre l’oreille à l’espace infini des paroles humaines. (Pascal Boulanger, bibliothécaire)

Samedi 19 mars 2011
Bibliothèque Robert-Desnos
14 Boulevard Rouget de Lisle
93100 Montreuil
01 48 70 64 55
Métro : Mairie de Montreuil

A 16h
Rencontre et lecture de Nathalie Riera et de Mathieu Brosseau
Nathalie Riera est née en 1966. Elle vit en Provence. Elle est responsable du site « Les carnets d’Eucharis ». Elle a publié un essai « La parole derrière les verrous » (Editions de l’Amandier) et trois livres de prose et de poésie parmi lesquels : « Puisque beauté il y a » (Lanskine). Sa poésie, lyrique, est avant tout sensible aux paysages de la Provence et au sentiment amoureux.
Né à Lannion en 1977, Mathieu Brosseau est bibliothécaire à Paris. Il publie des poèmes dans de nombreuses revues. Il est l’auteur de plusieurs livres de poésie, parmi lesquels : « L’Aquatone » (La Bartavelle), « La nuit d’un seul » (La rivière échappée) et « UNS-Pantin » (Le Castor astral). Il travaille le vers dans sa tension et dans son exigence pour mieux arpenter les scènes de l’histoire et de l’intime.
A 17h
Lecture spectacle d’une anthologie de textes poétiques (Jean Giono, Paul Verlaine, Georg Trakl, Marcel Proust notamment) et de textes d’Anne Savelli (auteur en résidence à la bibliothèque de Montreuil) par Valérie Bousquet, comédienne, et Anne Savelli.

Les poèmes de Nathalie Riera sont le couronnement du jour qui passe. Ils savent jouer tout cela ensemble : saisons, terre et ciel, joie et accablement, défaite et espoir. Toute une habitation se tisse dans les poèmes de ce recueil, à travers les fils invisibles qui relient chaque chose vivante sous un ciel de contrastes.
L’écriture retient les sensations traversées afin qu’elles ne basculent pas dans l’oubli et l’indifférence. Il faut alors remonter jusqu’à la source des choses qui nous entourent. Leur énergie, leur abondance s’inscrivent sous les pluies et sous les soleils pour former un tableau de grande beauté.
Pascal Boulanger (extrait de la préface "Puisque Beauté il y a", éditions Lanskine, 2010).
22:46 Publié dans LECTURES PUBLIQUES, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
03/03/2011
Mon soutien à la revue "La Pensée de Midi"
Très peu de revues, intégrant littératures et débats d’idées, encouragent le lecteur à une vision moins synthétique, mais réellement plus rassemblée sur son propre motif, soucieuse du détail et de la réflexion, en même temps que très attachée à la Méditerranée, et non sans cette ultime obstination – comme le rappelle son rédacteur en chef Thierry Fabre, et en référence à son ami Emile Temime : « donner au rêve méditerranéen un peu plus que l’étoffe du songe ».
Il y a l’irréparable, mais il y a aussi l’impardonnable ! L’arrêt de La Pensée de Midi n’est autre que le mauvais signe d’une époque résolue à démolir, réduire, soustraire, jusqu’à l’extinction totale ! Procédé monstrueux qui finit, hélas, par se répéter, et réduire ainsi le paysage des arts et de la culture à l’inculture.
A toute l’équipe de La Pensée de Midi, j’adresse mon chaleureux soutien et ma certitude que votre décision sera la meilleure et apportera à vos projets futurs toute l’envergure nécessaire.
Les chiens peuvent continuer à aboyer, rien ne sert de perdre son temps à lancer des pierres ! (un vieux proverbe turc remanié à ma façon).
Nathalie Riera
23:05 Publié dans La Pensée de Midi, Nathalie Riera, REVUES | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Lettre ouverte de La pensée de midi à la Région PACA*
Il fut un temps où cette Région était fière de défendre une revue littéraire et de débats d'idées. C'était, il est vrai, il y a un peu plus de dix ans, lorsque Toulon, Vitrolles, Marignane, Orange, étaient aux mains du Front National...
Il fut un temps où cette Région se préoccupait de culture, de réflexion, où elle encourageait les débats, comme ce fut par exemple le cas durant au moins cinq ans avec le Festival d'Avignon où elle demandait à La pensée de midi de les concevoir et de les animer...
Il fut un temps où cette Région défendait une réelle ambition en Méditerranée, où elle ne se contentait pas de vagues incantations. Manifestement cette époque est révolue...
Alors que penser de ce retrait brutal de subventions ? Etonnant, non, de vouloir faire disparaître une revue telle que La pensée de midi à un moment où survient le printemps arabe et alors que cette revue a construit durant les dix dernières années des relations privilégiées avec les écrivains, les artistes et les penseurs de cette région du monde. Saviez-vous, par exemple, que l'auteur de L'immeuble Yacoubian, Alaa al Aswany, succès mondial, qui vient de passer ses dernières semaines au Caire sur la place Tahrir, a été publié pour la première fois en France dans La pensée de midi ?
Manifestement, les responsables de cette Région ne le savent pas ou ils n'en ont cure !
Quelle bonne idée de couper entièrement les crédits accordés à cette revue, sans l'ombre d'une discussion ou d'une concertation, alors que depuis huit mois les courriers de l'association éditrice sont restés sans réponse.
Après dix ans de travail, 31 numéros publiés, qui le plus souvent font référence, des centaines de rencontres littéraires et de débats d'idées, nous avons appris, oralement, que le dossier était tout simplement retiré, sans aucune autre forme d'explication. Le fait du prince, circulez, il n'y a plus rien à voir !
Etonnant, non, comme manière de faire... Il est vrai que des conseillers mal avisés et des élus peu inspirés étaient depuis un moment déjà à la manœuvre. Ils auraient bien aimé que la revue soit "un instrument de la politique de communication de la Région". Oui, oui, vous avez bien lu !
Une revue littéraire et de débats d'idées telle que La pensée de midi, qui s'est inspirée du grand et bel exemple des Cahiers du Sud, transformée en organe de communication, ou en "média", ce qu'elle n'a jamais été et ne sera jamais...
Curieuse façon de penser, au XXIe siècle, surtout à un moment où gronde la révolte et où s'exprime avec force l'indignation.
Ces dix dernières années de chemin commun n'ont-elles été qu'un grand malentendu ? Une collectivité locale a-t-elle vocation à retrouver le programme de ses activités dans une publication qu'elle finance au titre d'une forme de narcissisme institutionnel ? Mais financer, par exemple, les Rencontres photographiques d'Arles ne lui donne pas, pour autant, le pouvoir de choisir les photographes exposés... Au nom de quoi devrait-elle intervenir dans le contenu éditorial d'une revue littéraire et de débats d'idées telle que La pensée de midi ?
Parce qu'elle en est le partenaire principal, il faudrait parler dans la revue de ses initiatives institutionnelles de coopération décentralisée ? Curieuse confusion des genres et bien inquiétante tentation !
Le projet éditorial de La pensée de midi n'a jamais été négocié et il n'a aucune vocation à l'être. La liberté de penser, de publier, d'écrire n'a pas de prix, n'en déplaise à ceux qui au sein de cette Région aimeraient la contrôler. Jean-Claude Izzo, Emile Temime et Bruno Etienne, personnalités culturelles éminentes de notre comité de rédaction ne sont malheureusement plus là pour tempêter contre de tels égarements. Ils avaient dû, il est vrai, déjà intervenir à plusieurs reprises auprès de la Région, par le passé, pour préserver l'autonomie de notre espace éditorial face à de pseudo-intellectuels institutionnels qui ne supportent guère qu'une telle revue puisse exister en dehors de leur magistère.
Grâce soit rendue à la Région et à son président d'avoir soutenu cette revue durant dix ans. L'effort financier est réel, près de 700 000 euros. Cet argent public a été employé avec un grand discernement et en toute rigueur. La pensée de midi a fait ce à quoi elle s'était engagée par convention : publier trois numéros par an, soit 31 numéros en un peu plus de dix ans, organiser des rencontres littéraires et de débats d'idées [1], diffuser largement la revue sur le web (plus de 210 000 consultations de textes de la revue sur le site CAIRN en 2010). La diffusion papier a toujours été, il est vrai, relativement limitée, autour de 1000 exemplaires, abonnés compris. C'est certes insuffisant mais cela correspond, et même un peu au-delà, à la diffusion d'une revue de ce type, qui justement ne relève pas du champ commercial. C'est d'ailleurs pourquoi elle a besoin de mécénat et de financements publics.
En 2009, le budget de La pensée de midi était d'un montant de 169 000 euros, la Région apportant un peu moins de la moitié du financement. Est-ce trop demander pour une revue qui a acquis une réelle reconnaissance, à l'échelle nationale et internationale et qui a ouvert un espace éditorial qui compte ?
Il fut un temps où cette Région le pensait. Ce n'est manifestement plus le cas aujourd'hui.
Face à la grave crise de financement des collectivités locales et territoriales, la revue avait anticipé les restrictions budgétaires en cours et avait déposé, pour 2011, une demande de financement de 40 % de moins que les financements précédents.
Ce n'est manifestement pas la question budgétaire qui a compté dans la décision prise par la Région. C'est un choix arbitraire et infondé, inspiré par des conseillers à la courte-vue, surtout à un moment où s'annonce Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, et où il aurait fallu renforcer les liens avec les acteurs culturels et intellectuels de l'autre côté de la Méditerranée. Un tel aveuglement est confondant !
Sur le fond comme sur la forme, le comportement de la Région PACA est indigne. Il aurait été tout à fait possible d'en parler et non de retirer brutalement une subvention à une revue qui existe depuis plus de dix ans !
La revue La pensée de midi n'a pas changé de cap. Elle reste fidèlement orientée vers le monde méditerranéen. Elle n'a pas non plus changé de rédacteur en chef. Elle a juste proposé de changer de formule. Publier une revue annuelle, sous une forme singulière, en renforçant la dimension artistique et en étoffant la pagination, tout en développant, grâce aux financements demandés, sa version numérique et sa présence sur le web, ce qui est le nouvel horizon des revues aujourd'hui.
La Région PACA a décidé de ne plus nous suivre. C'est sa liberté et son choix. Les voyages, le protocole et autres réceptions, qui doivent s'élever, en une année, au financement de dix ans d'une revue telle que La pensée de midi, ont été privilégiés. Ce n'est manifestement pas un choix culturel. La Région n'est certes en aucun cas prisonnière des engagements du passé. Attribuer ou non une subvention, renouveler ou non une aide, demeure entièrement de sa responsabilité politique. Avec La pensée de midi, elle a fait un choix clair... tout en se justifiant de manière obscure. Car c'est bien la question du contenu qui pose problème, c'est bien la fonction occupée par la revue dans la sphère culturelle et intellectuelle qui est en question, c'est bien la confusion entre culture et communication qui est au cœur de cette décision.
Il est vrai qu'il est toujours plus simple de démolir plutôt que de construire, surtout pour de mauvaises raisons, ou de calamiteux règlements de compte.
La pensée de midi a ouvert un espace éditorial qui ne va cependant pas se refermer de si tôt. La Région se retire, unilatéralement, nous inventerons donc autre chose sans elle. Elle met certes en péril une structure, supprime un emploi et fragilise un lieu de pensée critique, mais nous saurons rebondir.
A l'heure du printemps arabe, au moment où s'accomplit sous nos yeux une véritable reconfiguration du monde méditerranéen qui a tant besoin d'être pensé, nous pouvons déjà annoncer à la Région le titre du prochain numéro de La pensée de midi qui devrait paraître à l'automne 2011 : Le temps des utopies concrètes...
Qui sait, cela pourra peut-être l'inspirer !
L'association éditrice de La pensée de midi
* En réponse au communiqué de presse publié par la Région du 23/02/2011
[1] Rappelons notamment qu'une convention triennale établie entre notre association éditrice et la Région, pour la période de 2008 à 2010, portait sur deux axes, notifiés ainsi dans cette convention :
"Axe 1 : publication de "La pensée de midi", revue littéraire et de débats d'idées qui apporte des éclairages sur les grands débats contemporains et donne la parole aux acteurs des deux rives de la Méditerranée.
Axe 2 : conception et organisation régulière de manifestations littéraires et de débats d'idées (rencontres, animations littéraires, conférences, émissions radiophoniques...) avec des acteurs culturels, artistes, chercheurs, écrivains... de la Méditerranée. Ces manifestations auront lieu dans l'ensemble de la région PACA, en partenariat avec des librairies ou d'autres professions du livre."
La pensée de midi
Tél. + 33 (0)4 96 12 43 19
courrier@lapenseedemidi.org
www.lapenseedemidi.org
23:03 Publié dans La Pensée de Midi | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
26/02/2011
Henri Cole, Terre médiane (à paraître)
Terre médiane
Henri Cole

© Star Black
Occupé à nettoyer les géraniums, je me vois
comme je suis, presque nu dans la chaleur,
essayant de faire vivre un microcosme
de tons roses noircis, fanés par le soleil et la pluie,
qui ploient et frémissent sous mes sécateurs
tandis que je sépare les fleurs pourries des vivantes,
comme un homme seul emplit un vide de paroles,
non pour consoler ou indiquer où est le bien,
mais pour dire quelque chose de vrai qui a du corps,
parce que c’est la preuve qu’il existe.
21:57 Publié dans Henri Cole, Le Bruit du Temps | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
James Sacré, Mobile de camions couleurs (par Tristan Hordé)
Une lecture de Tristan Hordé
MOBILE DE CAMIONS COULEURS
Photographie de Michel Butor
James Sacré
(Editions Virgile, 2011)
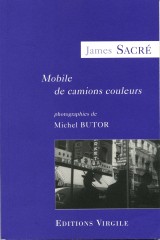 Les camions étaient présents dans un livre récent de James Sacré, America solitudes1, ils occupent toute la place dans ce livre de poèmes, accompagné de 9 photographies. Le titre rappelle sans ambiguïté le Mobile (Gallimard, 1962) de Michel Butor, construit à partir de ses séjours aux Etats-Unis où il enseignait la littérature ; les images remontent à la même époque (une dixième, Michel Butor à sa table de travail, est plus récente). Mais le titre évoque aussi le mouvement sans cesse changeant des camions et, en même temps, leur déplacement les uns par rapport aux autres comme s’ils étaient les énormes pièces d’une sculpture de Calder liées par les invisibles fils des routes. Enfin, comme le livre de Butor, Mobile de camions couleurs, est une construction complexe « où divers éléments de prosodie et de figurations bougent en lents mouvements de l’ensemble ».
Les camions étaient présents dans un livre récent de James Sacré, America solitudes1, ils occupent toute la place dans ce livre de poèmes, accompagné de 9 photographies. Le titre rappelle sans ambiguïté le Mobile (Gallimard, 1962) de Michel Butor, construit à partir de ses séjours aux Etats-Unis où il enseignait la littérature ; les images remontent à la même époque (une dixième, Michel Butor à sa table de travail, est plus récente). Mais le titre évoque aussi le mouvement sans cesse changeant des camions et, en même temps, leur déplacement les uns par rapport aux autres comme s’ils étaient les énormes pièces d’une sculpture de Calder liées par les invisibles fils des routes. Enfin, comme le livre de Butor, Mobile de camions couleurs, est une construction complexe « où divers éléments de prosodie et de figurations bougent en lents mouvements de l’ensemble ».
Les camions sont liés à l’histoire des Etats-Unis et leurs formes, leurs couleurs ont évolué, les machines anciennes abandonnées ou reléguées dans les régions les plus pauvres. Seul l’écrit garde trace (pour combien de temps ?) des temps enfouis de cet aspect de l’industrialisation de l’Amérique, « la voilà maintenant qui s’en va dans le souvenir qu’en garde ce livre [Mobile] de Michel Butor / Avec son histoire, un peu grandiloquente et vaguement ridicule ; / Pays qui oublie, qui oublie longtemps souvent ». Ce motif de l’oubli et, lié, celui des jours qui se ressemblent à se confondre, sont récurrents ; les camions passent sans cesse, comme à la fraîcheur du matin succède la chaleur du jour, comme « demain est un autre jour, le même ». Nous vivons dans un monde de la répétition, du même — avec des machines identiques à Kayenta, en Arizona, et à Cougou, en Vendée.
Ces camions très divers ressemblent à des êtres vivant hybrides, mi-ferrailles mi-animaux, chevaux de fer ou monstres bruyants mais bonasses d’une mythologie contemporaine, l’un « carré sous le coupe-vent bombé et les deux oreilles dégagées », l’autre « le museau jaune (barres rouges des pièces métalliques) comme pris dans un harnais ». Ce caractère subsiste quand ils sont immobiles, « au repos » dans des parkings « derrière un grillage haut », tout comme les bêtes d’un zoo. Ils paraissent parcourir le pays de manière autonome, tant les conducteurs sont invisibles dans leurs cabines. En outre, on ne sait pas vraiment, à les regarder passer ou quand on les croise, vers quel lieu ils se dirigent dans l’ « immense toile de parcours routiers », et peut-être roulent-ils sans fin, dans leur « vigueur aveugle », « pour que tiennent ensemble les villes du pays ».
Comment restituer quelque chose du mouvement incessant, de la profusion de formes et de couleurs ? James Sacré alterne une amorce de description des camions à l’arrêt, qu’il photographie (immobiles alors à jamais), et la saisie de leur extrême variété quand il les voit sur la route. Sur le parking, c’est surtout l’animalité, parfois un peu inquiétante, qui est mise en valeur ; la phrase alors peut s’étendre sur plusieurs vers (« Soit le long museau […], soit / Le groin carré […] / Quand […] / Où […] », ce qui est exclu quand il s’agit d’écrire à propos du passage des camions. Plus de verbes, de clausules, pas d’autres qualifications que celles relatives à la forme ou à la couleur :
Camions gris à double caisse blanche — rouge terne à caisse blanche — noir, caisse bleu clair — noir renfrogné, la caisse blanche — jaune cru à caisse blanche — blanc à caisse blanche — gris-vert à caisse blanche et lettres vert clair — noir à caisse blanche —gris-bleu costaud, caisse blanche — bleu-vert, caisse blanche ligne et lettres rouges — bleu clair, la caisse blanche et des lettres rouges — rouge à caisse blanche, lettres rouges —blanc à caisse blanche — etc.
Une autre alternance est lisible. Parmi les pages consacrées aux camions s’insèrent des poèmes autour de la vie quotidienne du narrateur, ou des chauffeurs : ces derniers non pas comme conducteurs des machines mais « comme autant d’artisans ou de pêcheurs du dimanche », parfois sans plus de lien avec leur travail, comme celui-ci endormi sur une pelouse. C’est aussi le monde du travail qui apparaît, avec la figure de l’Indien qui pourrait être contraint de quitter sa terre pour devenir routier, ou avec un lieu, Gallup, « Où le commerce et la misère, et le simple travail quotidien / Font se rencontrer […] toutes sortes de gens. » Ce qui est également visibles sur la caisse des camions, ce sont les noms des compagnies qui les possèdent ; c’est là une autre variation notée, « une troisième ligne rythmique » à côté de celle des couleurs et du mouvement bruyant. Un autre rythme encore est donné par le silence et la quasi immobilité du paysage.
Une nouvelle pièce du mobile oppose la course des camions aux États-Unis, dont on ne sait trop jusqu’où ils vont — à l’instar des pionniers du XIXe siècle construisant continûment une nouvelle frontière — à celle de camions de taille plus modeste, « gros jouets propres », sur une autoroute en France, qui font « le tour d’un petit pays ». La dernière pièce, à mes yeux, de ces constructions de rythmes est le jeu entre les photographies de Michel Butor et les poèmes : deux d’entre elles (l’entrée d’un parking souterrain, un homme endormi sur une pelouse) peuvent être associés aux camions, les autres sont relatives à la vie citadine quotidienne : la proportion est inversée dans le texte. Il est sans doute d’autres à lire ; il est certain que l’on ne quitte pas volontiers ce "mobile", singulier non par certains motifs récurrents dans l’œuvre mais par sa construction.
Tristan Hordé
(pour les Carnets d’eucharis)
21:54 Publié dans James Sacré, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
19/02/2011
Charles Olson, Les Poèmes de Maximus

je vivais à Washington la
capitale de cette grande pauvre Nation
j’avais du temps avant – les Muses ? où étaient les Muses ? – sont-elles, les
Muses toujours sous le déguisement d’
oiseaux sur la terre,
là un rossignol, ici un rossignol, à Cressy-plage un rossignol
oh des rossignols, ici ?
dans l’air de la nuit je suis seul
pas les perdrix qui flaquent des ailes en s’envolant, elles roucoulent et ne parlent pas, ici ?
en tous cas de toute façon toujours je n’ai jamais cherché qu’au son
des seuls rossignols, dans ces Etats-Unis d’ici (cette portion d’Amérique
- & c’est du fond des puits que vient notre parole
nous parlons avec l’eau
sur nos langues lorsque
la Terre
nous a rendus au Monde, nous Poètes, & que les Airs qui appartiennent aux Oiseaux ont
conduit nos vies à être ces choses-là au lieu de Rois
(Extrait Les Poèmes de Maximus, Volume trois, éditions La Nerthe, p.510)
La migration en fait (qui est sans doute une
constante de l’histoire, chose courante : la migration
est la recherche par les animaux, les plantes & les hommes d’un
environnement – et par les Dieux aussi – qui leur soit convenable
& préférable ; elle mène toujours vers un centre nouveau. Et pour dire
le vrai je parlerais ici du bi-pôle Ases-Vanes, car là
est l’impetus (la fureur qui s’ajoute à
l’Animus : ainsi l’Ame, la Volonté toujours
avec succès s’oppose au temps d’Avant & l’investit, Et là
est la rose est la rose est la rose du Monde
lundi 8 août, dans la nuit
(Ibid., p.565)
00:10 Publié dans Charles Olson, La Nerthe | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
18/02/2011
Eric Bourret, Dans la montagne de Lure (par François Bazzoli)

Au Prieuré de Salagon (juillet-novembre 2010)
Dans la montagne de Lure
D’abord, il y a la montagne de Lure, masse rocheuse à l’intersection des Alpes et de la Provence, située, comme on peut s’en douter, au sud-ouest des Alpes-de-Haute-Provence, et qui culmine à 1 826 mètres. Ce n’est qu’une montagne parmi toutes celles qu’Éric Bourret a parcouru, non pour les figer définitivement mais, au contraire, pour les mettre en mouvement. Le contraire du truisme photographique, en somme. C’est sans doute pour cela qu’il affirme faire de l’art, contemporain si possible, avant que de faire de la photographie. Affirmation paradoxale puisque son travail ne peut exister que par le médium photographique, sa vision borgne, ses imperfections, la chimie de son tirage.
Son travail de décalage de l’image, de superpositions, de recherche pédestre du point de vue comme objet unique, n’est sans doute pas la photographie. Peut-être seulement une photographie qui serait toujours complexe, aux confins de plusieurs zones, de plusieurs idées, et de certaines facultés de comportement ou de création. Pour entrer dans le vif du sujet, quelle donc est cette démarche proche de l'art contemporain et totalement ancrée dans la photo, qu'on pourrait définir comme (à cause de ses côtés ludiques, manipulatoires et surtout analytiques) l'antichambre de la perception ? Cette démarche où se superposent une image première lisible a priori et une image seconde suffisamment surprenante et énigmatique pour obliger le spectateur à analyser la proposition qui lui est faite et à en chercher les sources et les aboutissants.
On pourrait imaginer cette photographie comme un immense memento mori, un lacis inextricable de traces fragiles vouées à l'oubli, un massif de mémoires tremblantes, de lignes bougées, un cénotaphe vide consacré à l'infime durée des choses de ce monde. En auquel cas, toute photographie (et surtout celles d’Éric Bourret) serait une vanité, cette horreur de l'éphémère, le point de basculement entre l'existence et l'effacement, presque la frontière métaphysique de toutes choses. Pouvoir saisir l'apparence de l'objet réel, sa peau seule, son enveloppe matérielle, aurait été l'offre d'un démon nommé Daguerre à l'humanité inconsciente. Il n’était plus besoin de la lenteur du dessin et du recouvrement laborieux de la peinture pour fixer tout ce qui est digne de rester, à l'aune de l'individu et non de l'histoire. Un simple clic et le tour est joué. Car il s'agit bien d'un tour, de magie ou de passe-passe. L'intangible prend corps, l'anodin devient image. Cette vision aurait des liens serrés et quasi généalogiques avec l'art éphémère de l’extrême fin du XXe siècle et du début encor vagissant du suivant, une causalité sans faille avec le presque rien et le je-ne-sais-quoi. Dans cette proposition, l’œuvre d’Éric Bourret aurait une place de choix, ses liens avec la concrétion, l’effacement programmé, mais aussi avec le monument tumulaire, tutélaire, étant très fortement marqués, insistants même. Avec la capacité de transformer l’image lisible en son contraire, de faire du paysage une œuvre de Land Art transformable à sa volonté. Et cela en redoublant le clic initial afin qu’une partie de l’image se désintègre sur la pellicule avant de se concrétiser.
On pourrait également imaginer la photographie telle que la pratique Éric Bourret comme la somme totale de toutes les mémoires de l’œil, car il ne peut exister de mémoires sans oubli. Une plaque sensible sans limites, qui serait le réceptacle de chaque couche de forme et de sens. Une superposition sans fin de toutes les réalités pour parvenir à une seule image. Peut-être serait-elle blanche, peut-être serait-elle noire, c'est selon. Elle entretiendrait avec les superposeurs de tout acabit, avec les voileurs de pellicules et les bougeurs de caméras, les photographes sans appareil et les bricoleurs de chambres, des relations troubles et attirantes qui sonneraient le glas des formes réelles, des contours identifiables et des masses reconnaissables. Un feuilletage de la réalité imagée qui tiendrait peu de place et pourrait se glisser dans la mince couche de gélatine de la photographie. Or les images d’Éric Bourret sont toutes remplies de ces superpositions infimes, semblables à un brouillage mais nourrissant abondamment le regard de leur complexité. Une complexité de construction qui n’exclut pas une grande simplicité de lecture, où l’émotion affleure comme un souvenir qui peine à réapparaître tout en laissant deviner qu’il est là, latent, prêt à émerger. Mais cette superposition ne doit rien au hasard ou au bougé, elle s’engendre par la mise en place d’une procédure qui peut se répéter d’image en image, qui se réédite de procédure en procédure afin de comprendre (pour le spectateur comme pour l’artiste) ce qu’il peut advenir de différent au sein du même. Il n’est pas besoin de chercher bien loin dans l’histoire de la photographie pour retrouver des images de montagnes. Elles font même partie d’un genre extrêmement prisé au XIXe siècle. Parce qu’elles sont une sorte de climax du paysage romantique. Ce n’est pas la préoccupation d’Éric Bourret, pas plus que celle d’un Richard Long ou d’un Hamish Fulton, par exemple. La montagne est là pour sa morphologie plus que pour sa symbolique, pour la raréfaction (de présences, de formes, de nuances) qu’elle entraîne plus que pour sa photogénie. On remarquera d’ailleurs que dans la série ici présentée, quelques présences humaines identifiables apparaissent en petit nombre, en contradiction légère avec les règles tacites édictées il y a longtemps.

Lure 2010 (142.3) - 110 x 130 cm
On nous dit depuis déjà longtemps que la photographie n'est plus fiable, en tant que technique et en tant que représentation. Loin de l'inébranlable des solutions chimiques du XIXe siècle, les procédés commerciaux de notre temps s'effaceraient, s'effaceront, en dix ans, en trois ans, voire moins en ce qui concerne le Polaroïd ou l’imprimante de salon (bien que nous arrivent des processus faramineux et des durées d’un siècle à tout le moins). La boulimie d'images des amateurs et des professionnels est comme remise en cause avant que la photo ne soit faite. Cette précarité inscrite comme un destin inéluctable donne à la prise de réalité photographique une instabilité tragique. Un destin la marque qui est celui de la révélation. L'instant d'avant, il n'y avait rien, l'instant d'après ne reste que la marque brûlante d'un fait dont on ne jurerait pas de l'existence. C'est aussi ce qui entache de fragilité la photo de reportage et le scoop. Ne jamais savoir si cela représente le bon moment, celui que décrit le texte et que le photogramme tente de cerner tant que faire ce peut, sans jamais indiquer si le point culminant est celui qui se lit. Chez Éric Bourret, ce tragique est à l’œuvre mais dans une autre figuration. Dans son obstination à construire du transitoire, du peu ou du presque, à relier les gestes qui sont ceux du bricoleur (mais au sens où le développe Claude Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, celui de l’invention et de la survie, celui du faire avec l’entourage immédiat pour trouver une solution viable) à ceux du sculpteur, les gestes de l’artisan d’autrefois à ceux de l’artiste d’aujourd’hui. Ce tragique-là gît dans la profondeur de l’image obtenue, nourrie de ses contradictions et de sa polyvalence. Si une représentation est polysémique, c’est bien celle-là, qui ne se laisse pas réduire à son sujet. D’ailleurs qui sait si le sujet est la montagne de Lure ou le redoublement de l’image ?
On a assez dit, jusqu’à en faire un stéréotype, que l’objectif photographique était un piège à image. L’immatérialité de l’image est aussi rattrapée, ici, par l’immatérialité des choses de la cosmologie et de la météorologie, le vent, les nuages, le brouillard, les reflets, le mutable. Par la présence, et l’interaction sur l’image, de plusieurs clichés identiques légèrement décalés, même la roche peut devenir liquide, comme l’eau peut se durcir et se fossiliser. Quelles manœuvres de coercition, quelles tactiques d’approche doivent-elles êtres développées devant tant d’insaisissable ? Les procédures mises en jeu par ces pérégrinations argentiques permettent de voir le contraire de ce qui se montre en même temps que celui-ci. Certains photographes, comme Georges Rousse, se disent essentiellement peintres, et d’autres pourraient prétendre à la fonction de sculpteurs. Dans le travail d’Éric Bourret, chaque œuvre superpose, en même temps que des prises de vue, le photographe, le peintre et le sculpteur, sans que l’un soit plus présent que ses alter ego : si un jour l’un se met à prédominer, il n’y aura plus d’image.
Sans entrer dans le monde infini des paradoxes, le parcours d’Éric Bourret se veut une « démarche ». Mais comprise entre ce qui se fait intentionnellement et toutes les barbes du temps et de l’à-peu-près. Entre ce qui construit l’image et ce qui s’insinue en elle sans que l’appareil y prenne garde. Entre la conscience du photographe et l’inconscient de la photographie. Alors, autant que d’une démarche, qui le situe d’autorité dans le camp des plasticiens, il pourrait bien s’agir aussi de l’élaboration d’une méthode, si l’on en croit le Petit Larousse : « Méthode n. f. (latin Methodus) manière de dire, de faire, d’enseigner une chose, suivant certains principes et avec un certain ordre : procéder avec méthode. // Démarche ordonnée, raisonnée ; technique employée pour obtenir un résultat : procéder avec méthode, une méthode de lecture. // Ouvrage groupant logiquement les éléments d’une science, d’un enseignement. // Philos. Ensemble des règles et des procédés permettant de parvenir à la vérité. Méthode expérimentale, procédure qui consiste à observer les phénomènes, à en tirer des hypothèses et à vérifier les conséquences de ces hypothèses dans une expérimentation scientifique. » Une vérité scientifique malaxée par le hasard, l’instant fatidique et la poésie.
La citation est un peu longue, mais éclaire comment et pourquoi une méthode en art ou en photographie, et aussi comment y parvenir. Les sentiers qu’emprunte notre photographe sont en effet méthodiques, obsessionnels, prudents mais inventifs. Quelque chose du dernier moment possible pour saisir un réel en dilution oblige aux grands moyens : employer autant de rigueur que de souplesse, autant de « méthode » que de « démarche ».
Ayant défini l’œuvre et la méthode comme se démarquant volontairement de celles qui sont admises par le genre et le médium, il est difficile de dresser un arbre généalogique construit, logique et évident. Comme pour ses sources ou ses matériaux, le cadre de ses pères ou de ses pairs est composite et multiple. Non pas qu’il s’agisse d’autant d’objets trouvés que dans les autres domaines édifiant son œuvre, mais il n’est pas possible de ranger Éric Bourret dans un groupe cohérent qui le définirait autant qu’il en ferait partie. Sa position est trop flottante, son comportement trop sensible, son parcours trop individualisé pour le nommer d’une seule étiquette, d’une seule définition. Le fait que l’époque soit au refus, dans les faits plutôt que dans les mots, des mouvements revendiqués, surligne cette position. Sans doute par peur de sombrer dans la masse des conformismes, les avant-gardes (les historiques comme celles des années 1960) et les archipels de groupes qui en étaient issus, avaient tablé sur une lisibilité faite de déclarations, de manifestations et de proclamations écrites. Depuis vingt ans, il n’est plus question de regroupements idéologiques ou formalistes. Chaque œuvre est une aventure qui ne tente pas de surpasser ou de défaire les aventures qui précèdent ou coexistent. On n’inscrira donc pas Éric Bourret dans un arbre, serait-il généalogique. Mais sa proximité avec les artistes nomades de tout profil qui se sont mis en quête de l’immensité du monde ses dernières années n’est sans doute pas pour lui déplaire.
Pour en finir, il y a encore la montagne de Lure. C’est là qu’il voit pour la première fois ses semblables dans son viseur. C’est là que les valeurs de ses images s’inversent. Lourdes, noires et minérales, elles deviennent blanches, légères et gazeuses. Elles succèdent à des formats panoramiques, elles seront donc rectangulaires. Leur poids venait de leurs représentations, c’est dans le cadre que, maintenant, il se niche. Elles n’hésitent plus à se confronter à elles-mêmes, elles peuvent être grandes et petites en même temps. Et leur exposition peut réserver des surprises qu’on ne dévoilera pas. Sacrée montagne de Lure.
François Bazzoli, printemps 2010

PHOTOGRAPHIES & MARCHES
Eric Bourret est né à Paris le 10 mars 1964.
Il vit à Marseille, la Ciotat, dans les Alpes, en Himalaya.
19:26 Publié dans Eric Bourret, PHOTOGRAPHES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
15/02/2011
REVUE GPU n°6 - Février 2011 - (au sommaire)
A l’occasion de la sortie de GPU #6, jeudi 17 février 2011 à 19H00, à l’AtelieRnaTional : La présentation de la revue sera suivie d’une lecture par Brian Mura Affiches et livres à découvrir

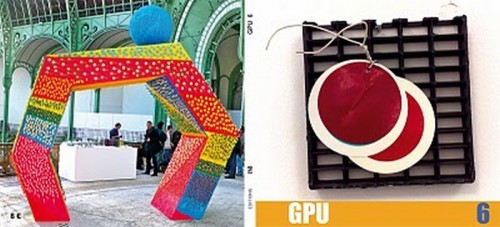
SOMMAIRE N°6
STEPHEN HITCHINS
MARTINE LE CORNEC-DRUCKER
JEAN-YVES BOSSEUR
FRANÇOIS POIVRET
RICHARD SKRYZAK
JEAN-LUC POIVRET
NATHALIE RIERA
PIERRE PETIT
JEAN-LUC STEINMETZ
ARNO CALLEJA
HELMUT STALLAERTS
LOUIS SCUTENAIRE
MATHIAS PÉREZ
AURELIE NEMOURS
DIDIER CAHEN
PAUL-ARMAND GETTE
HUBERT LUCOT
Avec les contributions de Veerle Van Durme, Eric Harasym, la bibliothèque de l'Ecole Supérieure d'Art du Nord-pas-de-Calais, Tourcoing, la collection CNAP, Paris.
Pourquoi une revue ?
Parce que le livre n’est pas un produit comme les autres, parce qu’une revue n’est pas un livre comme les autres(…)Fondée en 2005 la revue GPU a publié, dans un format pas tout à fait carré sur un papier bien net, des oeuvres inédites et originales d’une centaine d’artistes et auteurs tels que : Valérie Favre, John Giorno, Norbert Hillaire, Paul-Armand Gette, Nathalie Riera, Louis Jou, Jacques Villeglé, Charles Bukowski, Jean-Luc Steinmetz, Fabrice Gigy et Pierre Petit.
Avec le concours du Centre National du Livre le n°6 vient de paraître. Le directeur de publication est Brian Mura avec Jean-Luc Poivret comme conseiller à la rédaction.
Parallèlement en 2010 naissait Courtesy, une extension éditoriale de la revue avec à ce jour deux titres disponibles (Mnémosyne et Sans Titre).
La page de l’évènement sur Facebook
AtelieRnaTional - Patricia BOUCHARLAT, Vincent DELAROQUE, Franck LESBROS, Brian MURA, yujeong PYEON, Jean-François RAGARU, Jean-François ROUX, Marta RUEDA, Ran SERI
21:18 Publié dans Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
14/02/2011
Quadratures, Dominique Buisset - (par Tristan Hordé)
Une lecture de Tristan Hordé
QUADRATURES
Postface de Jacques Roubaud
Dominique Buisset
(Editions NOUS, 2010)
 Il faut répéter que la poésie n’est pas une, que « La poésie naît de ce qui, sans elle, demeurerait à jamais sans nom. »1 Elle peut donc encore être en vers comptés et rimés aujourd’hui, sauf à éliminer des œuvres aussi différentes que celles de Jacques Réda et Christian Prigent. Comme eux, Dominique Buisset choisit des formes dites traditionnelles et prouve avec une allégresse communicative qu’elles n’ont pas fini d’être explorées. Rien de contourné dans ces poèmes courts, écrits dans des mètres (7, 8, 9, 10, 11 syllabes) et des formes (septain, huitain, neuvain, dizain, onzain) classiques. Cependant, une fois que le lecteur a reconnu le cadre, il comprend vite que l’auteur en joue en tous sens : développant un art d’écrire — une poétique — et, dans le même temps, revisitant les motifs du lyrisme — le temps, la mort, l’oubli —, Dominique Buisset parcourt tous les schémas de rime, multiplie les combinaisons phoniques et fait partager le plaisir de manipuler des structures numériques.
Il faut répéter que la poésie n’est pas une, que « La poésie naît de ce qui, sans elle, demeurerait à jamais sans nom. »1 Elle peut donc encore être en vers comptés et rimés aujourd’hui, sauf à éliminer des œuvres aussi différentes que celles de Jacques Réda et Christian Prigent. Comme eux, Dominique Buisset choisit des formes dites traditionnelles et prouve avec une allégresse communicative qu’elles n’ont pas fini d’être explorées. Rien de contourné dans ces poèmes courts, écrits dans des mètres (7, 8, 9, 10, 11 syllabes) et des formes (septain, huitain, neuvain, dizain, onzain) classiques. Cependant, une fois que le lecteur a reconnu le cadre, il comprend vite que l’auteur en joue en tous sens : développant un art d’écrire — une poétique — et, dans le même temps, revisitant les motifs du lyrisme — le temps, la mort, l’oubli —, Dominique Buisset parcourt tous les schémas de rime, multiplie les combinaisons phoniques et fait partager le plaisir de manipuler des structures numériques.
Comment débuter un livre ? En disant qu’il commence et qu’il vient après d’autres. Le premier vers du livre, « Il est temps de reprendre le chant », ouvre un huitain mais, comme s’il fallait s’échauffer, le système de rimes est défaillant (a b c d e e e a) — ensuite, quand un poème ne sera pas régulièrement rimé, le lecteur inclinera à en chercher la raison. Quel parti est pris ? « la parole a besoin d’ordre », et cet ordre s’établit, par exemple, par le retour du même — nombre de vers égal au nombre de syllabes, rimes ; par extension, c’est le réel qui perd quelque peu son opacité :
[…] le poème est un rêve du nombre,
dans le désordre qui met la césure,
nomme et compte et divise le réel
pour éviter qu’il soit un chaos sombre
Sans doute ne prête-t-on pas attention à cette mise en ordre de la langue, du réel, « poussée des pages s’amoncelle / dans tous les sens apparemment ». Apparemment : bien des indices ralentissent ou interrompent le lecteur, notamment les rimes. Ici, un dizain à rime unique (an, en), là des rimes riches (consentement / contentement ; l’éclosion des mots / les cloisons d’émaux ; etc.), qui couvrent tout un hémistiche : et nous par le dedans / et nous parle de dents ; néant toussa / nez en tout ça ; rêve d’une ombre / rêve d’une ombre ; etc. L’attention se porte sur tous les jeux avec les sons et les repère ailleurs que dans les rimes : « le vent violent voyeur à l’œil / violet » ; adieu mers vaches merveilles ; apeurés tels des lapereaux ; etc. Comme le montrent des exemples ci-dessus, Dominique Buisset utilise pour les transformations phoniques un procédé cher à Raymond Roussel, jusqu’à agir sur un vers entier : dans un dizain, au vers 1 « Tout doit disparaître ! En mille, en cent ans… » répond le dernier vers, « tout dix doit paraître, cela s’entend. »
Jacques Roubaud relève dans la postface que « Quadratures suppose des tonnes de lecture, des années de travail ». Il est bon d’y insister : aucune poésie n’existe sans travail dans la langue : « Le faux n’est pas rien, l’imaginaire / est une vieille astuce et la ruse /du réel, en quoi rien ne se crée /mais tout se produit. Et la matière / est première » (souligné par moi). On le voit dans la variété des schémas de rimes, dans la reprise de rimes de la Délie de Scève (hommage annoncé par l’auteur) ou d’un thème né à la même époque (la "belle matineuse"), avec son vocabulaire. La mise en ordre, toujours rigoureuse, n’est pas à tout coup exhibée. Dans la première partie du livre (qui en compte six), 21 poèmes sont organisés en deux groupes de 10, le onzième poème, onzain de 11 syllabes, sert de pivot et suggère la règle choisie. En effet, il n’est pas rimé mais deux fins de vers (le rend / rends-le), la construction du vers 9 (nous, et sa piqûre dont s’ourlent de nous) (souligné par moi), la relation entre les premier et dernier vers (Universelle maison de l’équivoque / dans l’équivoque biais de l’universel) orientent vers une structure en palindrome. En effet, aux dix premiers poèmes (8-7-8-7-8-9-8-10-9-10) répondent en miroir les dix après le onzième (10-9-10-8-9-8-7-8-7-8) ; on peut d’ailleurs voir que la construction est plus complexe. Pour le bonheur du lecteur, la règle d’organisation peut être dite ; la quatrième partie est titrée "Six cents syllabes à circonscrire Une ballade pour rire" et propose la suite 3 dizains (300 syllabes) - une ballade - 3 dizains (à nouveau 300 syllabes). Le lecteur découvre d’autres règles de construction non explicitées et peut établir des liens avec, notamment, les poètes désignés (souvent péjorativement) par "Grands Rhétoriqueurs" et ceux de la Renaissance.2
Mais à quoi bon cette vertigineuse mise en ordre ? Dominique Buisset répond à sa manière :
Couronnant le vide souverain
Le poème est le mètre de rien
De son compte il enchante les leurres
Du silence sans fin qu’il emplit
En son lieu il arpente le champ
Des lois propres de sa gravité
Il est de nature sans objet
Car sa course exactement réglée
N’a ni sens ni centre ni sujet.
Ce qui est dit ici, on n’en sera pas surpris, est inscrit dans la forme : l’absence de rimes des vers 3, 4 et 5 attirent l’attention (a a b c d e f e f), comme les rimes souverain / rien, gravité / réglée, objet/ sujet. Forme et fond inséparables. Cependant, on laisserait beaucoup de côté si l’on ne s’attachait qu’à la très savante virtuosité, qu’à la connaissance approfondie de la poésie du passé — ce qui ne serait pas si mal ! Mais ce serait dire aussi que les "quadratures" ne sont que des ornements. Il faut relire Dominique Buisset sur ces points et réfléchir à une affirmation sur ce qu’est le poème : « l’inutile est là / seul qui donne au temps la tenue / sans laquelle il n’a pas de cesse ». Organiser strictement le flux des mots, construire un ensemble de poèmes (et non pas les juxtaposer), c’est refuser la "fuite" du temps, ou plutôt inscrire quelque chose qui peut résister un peu dans le temps, laisser une empreinte — sans l’illusion d’une fausse éternité :
envolés drames, comédies, renoms,
iambe ou trochée, poésie trépassée !
Satire, épopée, travaux de Romains,
œuvres, formes, tout a suivi les mains…
tout repose au fond du temps, in pace.
Il y a aussi dans Quadratures le sentiment fort de la solitude de chacun (De personne rien ne nous délivre / Sinon mourir) et du vide des jours, quoi qu’on fasse, sans autre perspective que la mort (Quelle mort parle en nous plus haut /que le désir). Ces motifs sont des lieux communs du lyrisme, certes. La poésie de Dominique Buisset, cependant, leur donne de la fraicheur grâce au travail minutieux et savant sur la forme : l’élégie existe, mais l’auteur introduit une distance vis-à-vis du discours, ne serait-ce que pour rappeler que le temps, la mort ne sont pas que des mots :
Non il n’y a rien à dire
L’écriture c’est la règle
Elle fait taire le pire
À coup d’arbitraire espiègle.
© Tristan Hordé, Carnets d’eucharis (février 2011)
■ AUTRES SITES A CONSULTER :
Recension d’Angèle Paoli
Extraits de Quadrature
Fiche de l’auteur sur le site CipMarseille
13:49 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Erich Fried
Erich FRIED
Ecrivain et poète de langue allemande
(1921 - 1988)
L A P A U S E P O E S I E

© Photo : internet
Biographie
Né à Vienne en 1921 de parents juifs, Erich Fried quitte l’Autriche après l’Anschluss en 1938 et s’exile à Londres, collaborant notamment au service allemand de la BBC. Profondément marqué par le spectre du nazisme et la condition juive – son père est mort lors d’un interrogatoire par la Gestapo – Fried incarne en Allemagne, à partir des années 1950, la figure de l’écrivain engagé, au service d’une conscience politique toujours tenue en éveil (guerre du Vietmam, Israël).
Aux côtés d’écrivains comme Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll, Peter Weiss, Martin Walser ou Paul Celan, il a fait partie du Groupe 47, initié par Hans Werner Richter en 1947 dans le but de nettoyer la langue allemande des séquelles du nazisme, en prônant une écriture dépouillée.
L’oeuvre d’Erich Fried porte la marque claire de cette démarche et se caractérise par la dimension ludique du travail d’écriture. Il est l’auteur de quelques romans (Les Enfants et les Fous, Le Soldat et la Fille) mais surtout d’un nombre considérable de recueils de poèmes. Ce sont eux qui lui ont assuré une grande popularité en Allemagne, notamment Cent poèmes sans frontière, lauréat du Prix International des Éditeurs en 1977, et plus encore ses Liebesgedichte (Poèmes d’amour) en 1979. Certains poèmes comme Was es ist (Ce que c’est) sont devenus des "classiques" de la littérature allemande des années 1980. Erich Fried est aussi un grand traducteur de l’anglais, en particulier de Shakespeare, Dylan Thomas, T.S Eliot, Sylvia Plath.
Le prix Georg Büchner lui a été décerné pour l’ensemble de son oeuvre en 1987, un an avant sa mort à Baden-Baden.
Bibliographie en français
Le Soldat et la fille, traduit par Robert Rovoni, Gallimard, 1962 (réédition, 1992).
Les Enfants et les fous, traduit par Jean-Claude Schneider, Gallimard, 1968.
Cent poèmes sans frontière, traduit par Dagmar et Georges Daillant, Christian Bourgois, 1978.
La Démesure de toutes choses, traduit par Pierre Furlan, Actes Sud, 1984.
Bibliographie sélective en allemand
1944, Deutschland.
1945, Österreich
1960, Ein Soldat und ein Mädchen
1965, Kinder und Narren
1966, und Vietnam und
1967, Anfechtungen
1968, Zeitfragen
1972, Die Freiheit den Mund aufzumachen
1974, Höre, Israel !
1978, 100 Gedichte ohne Vaterland
1979, Liebesgedichte
1981, Zur Zeit und zur Unzeit
1982, Das Unmaß aller Dinge
1983, Es ist was es ist
1985, Von Bis nach Seit
1987, Gegen das Vergessen
1988, Unverwundenes
D’autres sites :
10:11 Publié dans ALLEMAGNE/AUTRICHE, Chantal Tanet, Erich Fried, TRADUCTEURS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Erich Fried -I- (traduction Chantal Tanet & Michael Hohmann)
Liebe ?
in memoriam Hans Arp
Sackhüpfen
im verschlagenen Wind
ohne Segel
Strohsack- und Plumpsackvögel
im eigenen Hosensack
Hodensackhüpfen
Schwalbenhodensackhüpfen
Schwalbenhodensarglüpfen
Schwalbenhodenhosensargnestelknüpfen
Schwalbennestelknüpfen
Aus dem Nest fallen:
Lustrestlinge
Hineinschlüpfen
Wo hinein?
Sich festkrallen
Gefallene Nestlinge
zu klein
Vögel sein wollen
noch ein zweimal flattern
sterben
Amour ?
in memoriam Hans Arp
Sautiller en sac
dans le vent malin
sans voile
Oiseaux sacs de paille et sacs grossiers
en poche-sac de pantalon
Sautiller en sacs à testicules
Sautiller en sacs à testicules d’hirondelles
Soulever tombeau de testicules d’hirondelles
Nouer rubans de tombeau de pantalon de testicules d’hirondelles
Nouer rubans d’hirondelles
Tomber du nid :
Rescapés du plaisir
Glisser
Où donc ?
Se cramponner
Occupants du nid tombés
trop petits
Vouloir être oiseaux
encore une deux fois battre des ailes
mourir
09:44 Publié dans ALLEMAGNE/AUTRICHE, Chantal Tanet, Erich Fried, TRADUCTEURS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook


































































