26/09/2015
Enrique Vila-Matas, "Marienbad électrique ... Dominique Gonzalez-Foerster"

Enrique Vila-Matas en 1997
Dominique Gonzalez-Foerster

Lecture
Marienbad électrique
« littérature et scénographie de l’évasion »
__________________________________________________________________________________________
■■■ Marienbad électrique, publié à l’occasion de l’exposition de Dominique Gonzalez-Foerster au Centre Pompidou (du 23 septembre 2015 au 1er février 2016), est un livre curieux, à commencer par son titre qui nous invite à la ville d’eaux et au film L’année dernière à Marienbad du réalisateur Alain Resnais, Marienbad entendu comme « la ville du film le plus incompréhensible de l’histoire ». Bien qu’aucune scène n’ait été tournée à Mariánské Lázně,le rapprochement est inévitable. Pour Enrique Vila-Matas, le choix de cette ville n’est pas un hasard. Parce que de cette ville se dégage une atmosphère particulière et que pour l’écrivain « tout y était immortel et moribond », le projet d’y séjourner sera pour lui une manière de mieux comprendre les contraintes de l’artiste – et c’est de DGF dont il est question – à savoir : « me mettre dans sa peau, savoir ce qu’on ressentait quand il fallait transformer un espace apparemment condamné à ne jamais changer ». [1]
À l’occasion de M.2062 (la partie de l’opéra), qui est présenté à la Fondation Louis Vuitton, on peut lire en présentation de cet autre évènement : « DGF explore les relations entre réalité et fiction sous forme d’environnements, de performances, de photos et de films ». En effet, cinéma, littérature et musique s’interpénètrent, Vila-Matas n’hésitant pas à trouver des points communs entre DGF[2] et Duchamp dans leur manière de procéder, notamment sur leur façon d’utiliser « des techniques de recyclage de matériaux existants », de transporter « des pièces dans des endroits inattendus » et de mettre en relation des éléments très différents.[3]
Les scénographies de DGF, sous-tendues par la thématique de l’« évasion », inspirent Vila-Matas, non sans un parallèle direct avec les récits de Robert Walser. Sa référence à « Promenade » permet de mieux saisir ce qui peut lier l’artiste à l’écrivain dans leurs œuvres respectives : « les intrigues finissent par construire un récit qui, en général, donne toujours l’impression de parler de quelque chose de différent de ce que nous y voyons. C’est comme si elle cherchait par le biais de l’art la vivacité que Walser savait perdue… ».[4]
Dire de DGF qu’elle est « une romancière très active », c’est aussi pour Vila-Matas l’occasion de se dévoiler en tant que « cinéaste secret » : « j’imagine des séquences, je crée des scènes pour une future anthologie du cinéma invisible ».[5] La méthode de travail de DGF passe pour Vila-Matas comme singulière. Il cite d’ailleurs Ana Pato[6] en rapport à cette méthode qui « donne lieu à une nouvelle forme de littérature, non pas circonscrite dans les mots ou la communication linguistique mais multidimensionnelle… ».[7] Pour DGF les livres sont des créateurs d’espaces ; ils sont son « matériau de construction ». Vila-Matas précise que « pour elle tout commence par les livres. Puis, à partir d’eux, elle enquête, voit des films, voyage, prend des photos, des tas de notes, interroge, écoute, tout aura à un moment donné la possibilité d’entrer dans le monde de sa prochaine installation ».[8] Le paradoxe chez Vila-Matas n’est-il pas aussi celui de « chercher mon originalité d’écrivain dans l’assimilation d’autres voix. Les idées ou les phrases prennent un autre sens quand elles sont glosées, légèrement retouchées, replacées dans un contexte insolite… ».[9]
Entre DGF et Vila-Matas, un dialogue se poursuit depuis des années, par des courriels échangés et par des rendez-vous « intenses, chargés de mots et d’idées » au Café Bonaparte. Rivalité et compétition sont exclues du champ de leur relation. Leurs conversations, autant sur l’art que sur « l’état des choses », n’entendent pas mettre à l’épreuve l’envergure intellectuelle de chacun. Même si l’art est « l’une des formes les plus hautes de l’existence », ni l’un ni l’autre ne s’entichent de « l’horrible masque de l’artiste ».
Lorsque Vila-Matas demande à Gonzalez-Foerster quelles années couvriraient la rétrospective, celle-ci répond : « de 1887, année de la naissance de Marchel Duchamp, à 2666, date qu’il est très difficile de séparer du roman de Bolaňo »[10].
Nathalie Riera, septembre 2015
Les carnets d'eucharis
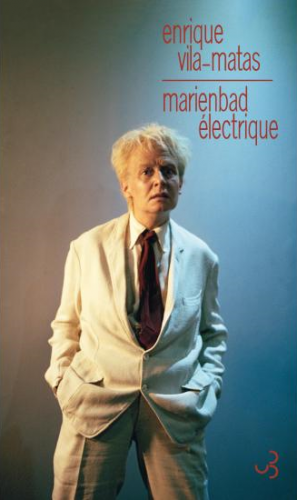
CHRISTIAN BOURGOIS – 2015
Traduit de l΄espagnol par André Gabastou
CONSULTER Site de l’éditeur
Editions Christian Bourgois
| © http://www.christianbourgois-editeur.com/une-nouvelle.php?Id=243
[1] p.90
[2] DGF est lauréate du Prix Marcel Duchamp en 2002.
[3] p.82
[4] p.53
[5] p.45
[6] « (…) comme l’a dit l’essayiste Ana Pato, elle a trouvé « d’autres manières d’écrire des romans » et pratique depuis déjà un bon bout de temps l’art de la Littérature en expansion » (cité par E. Vila-Matas, p.37)
[7] p.110
[8] p.59
[9] p.72
[10] p.101
10:56 Publié dans Enrique Vila-Matas, LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enrique vila-matas; dominique gonzalez-foerster |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
04/01/2014
Enrique Vila-Matas, Dublinesca
●●●
UNE LECTURE DE NATHALIE RIERA
…
Enrique Vila-Matas

« Dublinesca »
Christian Bourgois Editeur, 2010
(Traduit de l’espagnol par André Gabastou)
_________________________________________________
■■■
L’écriture et le voyage, confie Nicolas Bouvier, sont des entraînements à notre propre disparition. Dans « Dublinesca », le dernier roman de l’écrivain Barcelonnais Enrique Vila-Matas, nous assistons à la disparition non pas d’un écrivain mais d’un éditeur qui se promet une étrange odyssée, à dessein de retrouver l’enthousiasme originel. Pour Samuel Riba, figure centrale du roman, rédiger « une théorie générale du roman » ou entreprendre « un léger saut anglais » ne sont-ils pas d’étranges voyages, qui n’auraient pour autre but que : « ce qu’il ya de mieux au monde, c’est de voyager et de perdre des théories, de les perdre toutes » (17)
Ancien éditeur revenu de tout, qu’une crise aigue finit par étreindre, accusant tristesse de n’avoir entre autres pas « découvert un auteur inconnu qui aurait fini par se révéler un écrivain génial » (18), « quelle poisse que d’avoir à aller à la chasse de ces écrivains et de ne jamais tomber sur un vrai génie ! » (106), ce qui lui a d’ailleurs valu de renoncer « à sa jeunesse pour constituer honnêtement un catalogue imparfait » (72). Imparfaite également sa vie qui n’a lieu que « dans la plus pure orthodoxie du voyage circulaire », ainsi que dans l’isolement d’un hikikomori (terme japonais pour signifier un accroc à Internet). Et puis, quelle déveine que de vivre cet étrange passage entre deux époques – celles de l’ère Gutenberg et de la révolution numérique – mutation qui participe à cette circularité désœuvrante.
Mais bien que l’heure du bilan se passe sans enthousiasme ni quelconque réjouissance, Samuel Riba n’est pas sans être dépourvu d’affection pour ce qui incarne « une vie simple, en contact permanent avec la rassurante banalité du quotidien » (73). En effet, ne faut-il pas entendre de sa propre voix cette fascination pour « le charme de la vie ordinaire ». Se laisser ainsi porter par le rythme de l’accoutumé, qui peut se transformer en exceptionnel. Riba se refuse de vivre dans un roman. Comme dans les peintures de Vilhelm Hammeshoi : « pas de place pour la fiction, le romanesque » (165). N’est-ce pas au cœur de la vie ordinaire et des saturations qu’elle engendre qu’il nous est au mieux donné « de franchir le pas, de traverser le pont » qui « mènera vers d’autres voix, d’autres atmosphères ».
Samuel Riba n’a pas quitté son métier d’éditeur, il l’a plutôt fui, ou alors a-t-il mis simplement un terme à ses pâlottes aventures dans la géographie de la littérature ; la littérature qui n’est pas épiphanie, pas plus qu’elle n’est ce « centre du monde » avec cette « fabuleuse sensation d’être ailleurs ». La littérature est coupable d’avoir fait disparaître le lecteur talentueux : « si l’on exige d’un éditeur de littérature ou d’un écrivain qu’ils aient du talent, on doit aussi en exiger du lecteur » (74).
Faire un léger saut anglais, tomber de l’autre côté, « entonner un requiem pour la galaxie Gutenberg », nous dit Riba, enterrement « en l’honneur du monde détruit de l’édition littéraire, mais aussi de celui des vrais écrivains et des lecteurs talentueux », tout cela comme un moyen d’enterrer tout ce qui a participé au refus d’un grand destin.
Pour Riba qui semble avoir mené une vie de catalogue :
Traverser le pont c’est sortir d’un monde et entrer dans un autre monde, s’y sentir le maître du monde. Lorsque l’éditeur se souvient de sa traversée à pied de Manhattan à Brooklyn aux côtés de son jeune auteur Nietzky : « marcher vers Brooklyn signifiait pour lui repartir en quête des anciennes forces occultes » (115)
Tomber de l’autre côté, serait-ce pour retrouver la personne qu’il aurait réellement pu être avant même qu’il ne commence sa vie d’éditeur ; retrouver ce Je unique, original, « la première personne qui était en lui et a si vite disparu » (219)
Le désir d’un saut anglais vient faire réplique au saut français de l’écrivain américain Saul Bellow, ou encore au saut italien du poète florentin Guido Cavalcanti : « le saut agile et inattendu (…) qui se hisse au-dessus de la pesanteur du monde, montrant que sa gravité contient le secret de la légèreté » (133)
Mais pourquoi également ce grand saut de Riba dans l’Ulysse de Joyce ? Outre qu’il est bon connaisseur de l’œuvre du poète et romancier irlandais, « la plus grande trouvaille de Joyce dans Ulysse est d’avoir compris que la vie est faite de choses triviales. La glorieuse astuce mise en pratique par Joyce fut de prendre ce qui se passe au ras des pâquerettes pour en faire un soubassement héroïque aux accents homériques » (159)
Requiem pour un monde où la splendeur est encore récupérable, où Riba peut enfin se sentir libéré « de la chaîne criminelle de l’édition de fictions » (197), où tomber de l’autre côté c’est se trouver enfin dans une géographie du monde où pouvoir se réinventer, n’être plus qu’ « une allégorie, un témoin de son temps, le notaire d’un changement d’époque » (217)
Alors « … que l’enterrement soit une œuvre d’art » !
Nathalie Riera, décembre 2010
Revue « Europe », N° 984, avril 2011
© Les Carnets d’Eucharis
____________________________________________________________________________
SITE À CONSULTER
dublinesca
Sur le site : Enrique Vila-Matas
| © Cliquer ICI
Quatrième de couverture Samuel Riba est l'éditeur talentueux d'un catalogue exigeant. Néanmoins, incapable de faire face à l'émergence des nouveaux médias et de concurrencer la vogue du roman gothique, il vient de faire faillite. Il sombre alors dans la déprime et le désœuvrement. Pour y remédier, il entreprend un voyage à Dublin. L'accompagnent quelques amis écrivains avec qui il entend créer une sorte de confrérie littéraire. Cette visite de la capitale irlandaise se double d'un voyage dans l'œuvre de Joyce.
En explorant toutes les facettes de ce personnage complexe, qui est en partie son alter ego de lui-même, Enrique Vila-Matas interroge la notion d'identité, de sujet, et décrit le cheminement parcours qui a mené la littérature contemporaine d'une épiphanie (Joyce) vers l'aphasie (Beckett).
19:59 Publié dans Christian Bourgois Editeur, Enrique Vila-Matas, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
































































