04/06/2015
Bruno Fern, Le petit test (une lecture de Tristan Hordé)
●●●
UNE LECTURE DE TRISTAN HORDÉ
…

© Bruno Fern │
Bruno Fern
Le petit test
Éditions Sitaudis, 2014
■■■
En quatrième de couverture, Bruno Fern renvoie explicitement au Testament, invitation modeste à lire Le petit test comme un prolongement de ceux de Villon ; il repose sur une lecture approfondie du poète du Moyen Âge, non pour imiter, à quelque point de vue que ce soit, mais pour en conserver l’esprit : l’humour, une certaine paillardise, le plaisir de parler des choses de la vie quotidienne et d’être dans une « matière pleine d’érudition et de bon savoir ».
« Voici un livre fait de greffes et d’excroissances », précise Bruno Fern. L’une des greffes consiste à retenir le huitain du Testament — il y en a cent — et à y introduire d’autres éléments, non des ballades mais trois envois, le livre s’achevant par un « renvoi ». Les vers ne sont ni comptés ni rimés, mais il faut tout de suite indiquer les exceptions. Un huitain est en vers de 3 syllabes et rimé, aaaabcbc (93)1, le suivant en vers mêlés, 44544544, avec rimes, abbcbcac (94), et sa seconde version en vers de 4 syllabes, non rimé (94). Le lecteur relèvera ici et là des rimes : elles ont toujours une fonction qui déborde le rôle habituel ; ainsi reprenant « le trou Perrette », qui rimait chez Villon avec « cornette », Bruno Fern développe autrement le thème burlesque (ou paillard, si l’on veut) (59) :
préférant (et de loin) le trou Perrette
qui sent pas que la violette
mais le rose nuancé bat
ant jusqu’au sang [..]
On trouvera des variations d’un autre genre. Un poème est uniquement formé de questions prélevées dans Villon ; le premier vers d’un autre, « celer mes amours », vient aussi du Testament (« Je pense celer mes amours, xcv), dans les vers suivants seul le complément est conservé (« mes amours »), le premier mot retenu est homophone du verbe ou en conserve la première syllabe :
celer mes amours
seul et " "
semer " "
seller " "
serer " "
céder " "
cesser " "
c.v. " "
Une autre greffe, comme on l’a vu ci-dessus, consiste à introduire dans chaque poème un fragment emprunté à Villon, signalé en caractères gras. On situe sans trop de difficulté des vers ou des parties de vers (« Dieu sait quelle sueur », « Les vers n’y trouveront pas graisse »), mais Bruno Fern introduit des grains de sable : par exemple, reprenant le vers de Villon « En petits bains de femmes amoureuses », il remplace "femmes" par "filles" ; par ailleurs, « en », « plus aigu », « des flûtes », etc., présents dans le Testament, pourraient évidemment se trouver ailleurs... Un mot repris dans le Testament est commenté, non pour sa place juste dans le vers original mais en tant qu’élément grammatical adéquat : « rondement / c’est l’adverbe qui convient ».
Comme le faisait Villon, Bruno Fern mêle les registres et le vocabulaire dit populaire, ou familier, est bien représenté : kif kif, fastoche, cool, triquer, tire-larigot, rien à branler, accro, à donf, etc. Mais surtout, il introduit dans presque tous les poèmes des lieux communs, des slogans publicitaires, des formules de mode d’emploi, des syntagmes propres à l’administration, toutes manières complètement usées d’être dans la langue qui, mises ici en évidence, apparaissent pour ce qu’elles sont, marques d’une totale absence d’inventivité : y a pas photo, ça le fait pas, y a comme un défaut, [Pince-mi et Pince-moi] sont sur un bateau, sonnerie personnalisée, intégralement recyclables, etc. — ajoutons ce qui est en relation directe avec l’actualité, par exemple renforcer la lutte contre la délinquance, made in China, vive émotion dans la communauté internationale. Des expressions rebattues sont détournées, ainsi : tombe au champ d’odeurs, la ligne bleue des cours, en mourant par la Lorraine, mais aussi un chant révolutionnaire : c’est la lutte finale grouillons-nous et deux mains ; etc.
Viennent s’ajouter des citations en italique, presque toutes littéraires et dont l’auteur est signalé en note — Kafka, Mallarmé, Nathalie Quintane, Soupault, Beckett, Malherbe —, mais il y a aussi Lacan et le compositeur Steve Reich ; d’autres, non signalées comme telles, passent inaperçues, parfaitement intégrées : on lit « bijoux sonores » et l’on se souvient de Baudelaire ("Les bijoux"), et de Mallarmé dans « la nue à câbles » : avec "accable" on retrouve "À la nue accablante". Entrent aussi dans des poèmes des figures d’écrivains contemporains ; « à J. S. l’ardeur des mots » (62) évoque Jude Stéfan, dont le prénom en toutes lettres et l’allusion à une nouvelle viennent un peu plus tard (69) ; « à Jean-Pierre V. une bouteille » (75) débute un récit à propos de Verheggen, « à Ch.P. cette vigueur qu’il prouve » est l’entrée d’un portrait de Prigent lisant : deux écrivains dont Bruno Fern est proche par certains aspects de son écriture. La "géographie" littéraire est toujours complexe ; sont également présents Petr K.[ral] et ses cigares, Philippe Boutibonnes à qui un poème est dédié.
Parmi les moyens d’ « essayer [...] tous les sens possibles », Bruno Fern emploie abondamment le chevauchement : un mot2 appartient à deux séries syntaxiques différentes ; par cette épargne des mots, la lecture est freinée et, surtout, la polysémie permet des effets comiques. Des exemples : « tendance à sous estimer [le monde] / roule pour lui-même » ; avec bilinguisme : « à tue / [tête] bêche dans le raidillon n° 69 / of [course] au cotillon (page 62) ; en jouant sur l’homophonie : « ténue [= t’es nue] jusqu’aux sourcils / à donf tombe en un comme en / [sans] attendre » (page 63) ; le mot commun est verbe dans le premier ensemble, adjectif dans le second : « se [grise] de préférence dans l’entrejambe / toutes les chattes le sont la nuit » (73) ; c’est un article et un mot-une syllabe qui sont communs : « présents les pieds posés sur [le sol] / stice d’hiver stigmate à son échelle », et remarquons qu’ici p est repris dans le premier vers, sti[c,g] dans le second.
La répétition d’un son est régulièrement un des éléments du burlesque dans Le petit test, comme dans les deux premiers vers du "Renvoi" final : « ainsi se clôt s’exclut s’excla / s’achève la période d’essais [...] » (page 61). On a pour ce registre burlesque une liste d’homophonies, de par mon et par vos et le classique neiges – que n’ai-je à en pur don de soie et toute en R – s’envoyer en l’air, des séries d’à-peu-près comme des mouvements divers et avariés et d’un pas décédé, des anagrammes parfois signalées (parties-patries). À chaque lecture, on découvre de nouvelles pistes dans l’usage plein de jubilation de la langue et, comme chez Villon, s’expriment des « préoccupations diverses » (4ème de couverture), tragique et burlesque liés : dans le huitain 99 adressé à un "tu" (« tu branles carcasse... »), si l’on réunit mots et syllabes en gras, on obtient : « car en amours mourut martyr ».
Tristan Hordé | © Les Carnets d'Eucharis, N°45 - Printemps 2015
À CONSULTER Sitaudis
Terres de Femmes
———————————
1. sauf indication contraire, le nombre entre parenthèses renvoie au numéro d’un poème.
2. noté ici entre crochets.
18:07 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sitaudis, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
20/02/2015
Jean-Richard Bloch & Jean Paulhan, par Tristan Hordé
●●●
UNE LECTURE DE TRISTAN HORDÉ
…


© Jean-Richard Bloch & Jean Paulhan │ http://www.librarything.com/author/aikenconrad
Jean-Richard Bloch & Jean Paulhan, Correspondance 1920-1946
édition établie, préfacée et annotée par
Bernard Leuilliot
Éditions Claire Paulhan, 2014
Site éditeur | © http://www.clairepaulhan.com/auteurs/bloch_paulhan.html
■■■
La publication de la correspondance de Paulhan se poursuit, aux éditions Claire Paulhan, parallèlement à celle des œuvres complètes chez Gallimard (après celle du Cercle du Livre Précieux, il y aura bientôt 50 ans), dont on espère qu’elles trouveront un jour leur place dans la Pléiade. Ce volume permet de mettre en lumière la personne de Jean-Richard Bloch, né en 1884 comme Paulhan : romancier, essayiste, il a fait partie du comité de rédaction de la revue Europe à sa création, en 1923, et il y a tenu dans les années 1930 une chronique régulière ; il a dirigé ensuite avec Aragon le quotidien Ce soir, jusqu’à l’interdiction de la presse communiste en octobre 1939. On suivra précisément son parcours, en particulier pendant la guerre, jusqu’à sa mort brutale, d’épuisement, en 1947, dans la présentation de Bernard Leuilliot.
Les deux hommes commencent leurs échanges épistolaires en 1920, un peu par hasard : Bloch avait envoyé des haïkaïs à Jacques Rivière, directeur de La Nouvelle Revue française, et c’est Paulhan qui lui répond, lui signalant que, par ailleurs, il connaît ses livres. Toujours ouvert et attentif, Paulhan passe de « Je vous serre les mains » (mars 1921) à « votre ami » (février 1922), puis à « affectueusement à vous » (1926). La sympathie mutuelle de ces deux écrivains et hommes de revues n’empêche pas Paulhan de n’être jamais complaisant quand il devient lecteur ; à propos de La Nuit kurde et de Sur un cargo, il écrit en 1925 : ces deux livres « décidément, me déçoivent (...). Je vous en veux de votre laisser aller et d’appuyer même dans le sens de votre laisser-aller » ; en 1931 il remercie Bloch de l’envoi d’un poème, tout en le jugeant « chargé d’une poésie aussi froide, aussi plaquée, aussi contrainte que le préface à La Nuit kurde. » Une dernière fois, le 1er janvier 1940, il répond à l’envoi d’une nouvelle : « votre récit me paraît manqué ». Cependant, il manifeste son admiration pour d’autres textes, suscite régulièrement la collaboration de Bloch à La NRF et lui envoie fin 1931 et début 1932 de longues lettres autour du "pouvoir des mots", question qu’il développe dans Les Fleurs de Tarbes publiés en 1936.
Bloch vit de sa plume et est souvent préoccupé par l’accueil fait à son œuvre ; mais quand il s’étonne que La NRF ne rende pas compte de tel de tel de ses livres, Paulhan lui répond : « nous ne parlons pas dans la nrf de tous les livres que nous aimons ». À la parution de Sybilla dans La NRF en 1932, il demande à Paulhan de lui rapporter les réactions des lecteurs — ce qu’il obtient. Mais s’il ne néglige pas l’approbation du public, ce qui lui importe est son combat d’idées. Un roman doit selon lui porter l’engagement de son auteur et, opposant Sybilla à d’autres romans, il définit exactement en juin 1932 ce qu’il a prétendu faire : « Ceci est le roman de mœurs, le roman des conditions sociales, de l’individu dans la Société, des milieux, des aspirations, des familles, des maisons, des morales, le roman de Dieu et de la foi dans l’homme, le roman de l’impérialisme passionnel, de l’impérialisme spirituel. »
Les liens se distendent, et les lettres s’espacent, à partir du moment où Bloch se rapproche des communistes. Quand il co-dirige Ce soir, il reproche à Paulhan le silence de La NRF à son égard, ce qui lui vaut une réponse qui équivaut à une rupture : Ce soir est présenté comme « ce célèbre journal du soir où l’on trouve plus de sexe-appel, d’histoires de basse police et de bobards (...) que dans tous les autres journaux réunis ». Ils renouent un an plus tard et, surtout, à partir de 1940 ; la situation de Bloch est alors plus que difficile et il s’interroge, « De quoi vivre demain ? » et « (...) si, Juif, je ne vais pas devenir momentanément (un moment qui peut durer plus longtemps que la fin de ma vie) un citoyen de seconde zone ou même pas du tout un citoyen. »
Chacun à sa manière est résistant. Paulhan fait notamment partie d’un réseau et participera à la création des Lettres françaises clandestines. Bloch est obligé de partir à Moscou en 1941 et, jusqu’en 1944, il y parle à la radio ; son retour en France ne peut être que difficile : à la suite d’un bombardement, la totalité de ses travaux, le journal de toute une vie ont été détruits, « tout a brûlé, en juin 41, consumé jusqu’au dernier fragment ». Mais beaucoup plus lourd pour lui, il s’épuise en recherches pour « retrouver la trace de [ses] disparues » — traces de l’horreur : sa fille France, résistante, a été décapitée à Hambourg, sa mère gazée à Auschwitz et son gendre fusillé.
C’est le chemin de l’intellectuel, d’abord éloigné de la politique, puis engagé, qu’a été Jean-Richard Bloch qui est restitué dans cette correspondance ; Paulhan, sans ambiguïté, exprime son estime pour l’écrivain et pour l’homme, mais n’hésite pas à dire ses désaccords. On suit d’autant mieux leur relation que les notes qui accompagnent chaque lettre, abondantes et précises, restituent le contexte politique et culturel, complexe, de la période de 1920 à 1945.
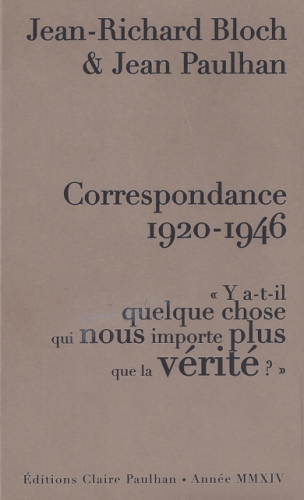
21:34 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
01/07/2014
Jean-Luc Sarré, Ainsi les jours, Le Bruit du Temps - Une lecture de Tristan Hordé
●●●
UNE LECTURE DE TRISTAN HORDÉ
…
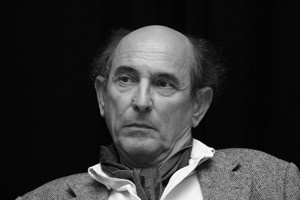
© J. Luc Sarré photographié par Jean-Marc de Samie │ http://www.franceculture.fr/
Ainsi les jours
JEAN-LUC SARRÉ
Le Bruit du Temps, 2014
______________________________________________________________
■■■Ainsi les jours, ce sont quelques poèmes et de « modestes petites proses », notes souvent brèves, dépassant rarement la douzaine de lignes, « ni sentences, ni aphorismes, ni maximes mais simples remarques » (174). On pense très vite à Jules Renard, et Sarré indique qu'il fut en effet le « principal instigateur de [s]es carnets » (99). Donc des remarques, et celles qui le concernent le décrivent avec bien peu de complaisance : « tout en moi est discordant » (22), affirme-t-il et il regrette ici et là de n'avoir rien fait d'autre qu'écrire quelques lignes ; l'âge venant, il n'apprécie guère « le visage d'un étranger » (183) qu'il voit le matin dans le miroir. Mais est-ce misanthropie de ne plus supporter au fil des ans, la bêtise (bruyante) des voisins, plus largement de ses contemporains ? Inapte à toute discipline, non pas sceptique, mais « douteur », il s'ennuie vite, constatant, désabusé, « je ne suis pas d'ici » (80). Comment vivre ? Les notes quasi quotidiennes sur les carnets sont nécessaires, écriture de minuscules moments de vie saisis et restitués : « j'écris parce qu'il me faut bien respirer » (114).
Qu'est-ce qui est retenu, hors les propos, le plus souvent acerbes, le concernant ? Sédentaire, Sarré observe les choses de son balcon du quatrième étage, et d'abord le ciel qu'il apprécie plutôt nuageux — quand le soleil s'installe, on entend « l'odieux chant des cigales ». Il peste contre le bruit des engins de terrassement et le bavardage au téléphone portable qui l'oblige à fermer la fenêtre. Il suit des yeux l'enfant qui, sur son petit vélo, pédale et se dirige vers le bout du monde... Il suit également le mouvement des oiseaux, d'un arbre devant son logement aux graines de tournesol qu'il leur prépare. Il vérifie que le poisson rouge a eu sa ration journalière. Les notations sur la nature, ou plutôt sur la relation que l'on peut entretenir avec elle, sont nombreuses ; se définissant piètre cavalier, il s'attendrit de savoir sa fille être plus à l'aise qu'il l'avait été et il se désole, un cheval s'avançant vers lui, de n'avoir pas toujours un sucre dans sa poche. Il est attentif aux pies qui construisent un nid au sommet d'un arbre et comment ne pas l'approuver quand il note que « le cri de l'effraie légitime l'insomnie » (137) ?
Ce sont toutes les choses du monde qui requièrent son attention et vouloir relever ce qui le retient conduirait (presque) à citer tout le livre. Il recopie un jour une petite annonce concernant la vente d'un cor de chasse, il s'amuse de la laideur des genoux — trop gros — de jeunes femmes en mini-jupe, il écoute une conversation dans un bus à propos des tatouages et des piercings ( "qui habillent"), il relate un fait-divers, il constate la disparition accélérée des petits magasins, il apprécie à Genève des maisons « aux couleurs audacieuses », il s'irrite qu'une place de parking puisse susciter une violente querelle, il suit des yeux le rouge-gorge qui mange les baies de la vigne vierge. La multiplication des motifs est compensée, d'abord, par le fait que certains sont développés ; ainsi, plusieurs pages sont consacrées à Barcelone, toujours sous la forme de remarques. Un motif en entraîne parfois d'autres ; évoquant Breton, par qui il découvrit la poésie, Sarré rappelle les insupportables ukases du poète et, de là, cite Cioran qui fustigeait le « ton prophétique ». À partir du rire « étranglé » (130) d'une petite fille qui semble rejetée d'un groupe, un récit s'esquisse. S'indignant de la morgue des « coquins » de l'ENA, il passe des urnes électorales aux urnes funéraires — les seules dignes — et termine avec une citation de Reverdy sur le spectacle des manifestations politiques (111-112).
Une autre manière d'introduire des variations consiste à rapporter ses visites d'expositions, signalant au passage que l'abandon de son activité de peintre a été « un bon choix dans la vie », à commenter aussi, brièvement, les disques écoutés, de Schubert à Charlie Parker, de Brahms à Kathleen Ferrier — celle-ci point de départ d'une minuscule digression. En relation ou non avec une remarque viennent aussi des citations, de moralistes qu'il affectionne — Chamfort, Joubert —, d'écrivains qu'il fréquente : Flaubert, Kafka, Jules Renard, Thomas Bernhard, Eudora Welty, Limbour, Perros, Faulkner... Enfin, ennemi de la "merdonité", il n'hésite pas à marquer sa distance vis-à-vis des goûts et activités dominants. Il rejette les pratiques empruntées aux États-Unis des ateliers d'écriture et de la lecture publique, relevant une note de Leopardi pour qui il y avait un « vice qui consiste à lire et à réciter aux autres ses propres productions » ; sont alors sur le même plan "l'atelier cuisine" et "l'atelier poésie"... À propos des colonnes de Buren, Sarré constate qu'elle « continuent de saloper la cour d'honneur du Palais Royal, d'en altérer l'harmonie » (84).
Lire Ainsi les jours, c'est comme reprendre une conversation passionnée, interrompue pour une mauvaise raison. J'y retrouve une sobriété dans l'écriture propre aux moralistes, un regard sans illusion sur le monde et sur lui-même, une vraie tendresse aussi pour les choses de la nature. Ce sont là de bonnes raisons de le lire et relire.
Tristan Hordé, juin 2014 © Les Carnets d’Eucharis

SITE À CONSULTER
Sur le site : Le Bruit du Temps | © Cliquer ICI
23:33 Publié dans Jean-Luc Sarré, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
21/05/2014
Edward Estlin Cummings, Paris, Seghers, 2014 (Une lecture de Tristan Hordé)
●●●
UNE LECTURE DE TRISTAN HORDÉ
…

© The Famous People │ http://www.thefamouspeople.com/profiles/e-e-cummings-160.php
Paris
Edition bilingue
traduit de l'anglais et présenté par Jacques Demarcq
Edward Estlin Cummings
Seghers, Poésie d’abord, 2014
Site éditeur | © http://www.editions-seghers.tm.fr/site/paris_&100&9782232123849.html
______________________________________________________________
■■■
Nombre d'artistes américains, après Gertrude Stein installée dès le début du XXe siècle, sont venus à Paris au cours des années 1920, et certains y ont vécu plus ou moins longtemps, d'Hemingway à Alexander Calder, qui s'installa ensuite en Touraine. Cummings (1894-1962) y est venu en 1917 quelques semaines, pendant la Première Guerre mondiale, y a vécu deux ans à partir de 1921 et y est retourné régulièrement ensuite. La quarantaine de textes (proses, poèmes — parfois partiellement en français —, article pour Vanity Fair et lettres) écrits à propos de la ville, de 1918 à 1957, dispersés dans plusieurs recueils, sont réunis dans ce livre et présentés de manière précise dans la postface de Jacques Demarcq. Ils sont accompagnés de neuf dessins (crayon ou encre), tracés entre 1917 et 1933.
Cummings distingue nettement, en 1926, un Paris pour touristes (qu'il désigne par "Paree", prononcé à l'anglaise) avec ses lieux obligés (Montmartre : « machine totalement dénuée d'intérêt servant à débarrasser les Anglo-Saxons de leur papier monnaie »), de la ville authentique ("Paname"), avec ses bistrots, la Foire aux pains d'épices (nommée ensuite Foire du Trône), les courses, le Cirque d'hiver, le Jardin du Luxembourg, les péniches et les bateaux-mouches, bref : « le profond, l'extraordinaire, le lumineux triomphe de la Vie même et d'une ville fondée sur la Vie ». En 1953, revenant sur ce qu'avait été Paris dans sa jeunesse, il y reconnaît le lieu de « la miraculeuse présence [...] d'êtres vivants [...] et où la beauté fleurissait dans ma vie comme une étoile. » C'est ce Paris qui est exploré dans sept chapitres regroupant des textes en ensembles : "Les Halles, le Marais", Montparnasse", Grands Boulevards, Pigalle", etc.
C'est surtout ce qui se passe quotidiennement dans la rue qui est retenu, mais certaines scènes singulières sont décrites. Par exemple, dans une lettre à sa mère, il rend compte avec humour des funérailles officielles de Joffre, regardant avec détachement ce qui se voulait solennel et, ainsi, tournant en dérision ce qui appartient à l'institution : « Tout le monde prenant le spectacle pour un pique-nique désordonné doublé d'un music-hall universel. » Il s'attache aux éléments d'une vie passée, totalement disparus aux États-Unis, comme les joueurs d'orgue de barbarie, ou « à / denfert l'hercule gras [qui] a étalé son tapis », ailleurs les enfants acrobates pour les passants ou ceux qui vendent des fleurs — « sautez dansez gamins hop suivez du doigt le rouge bleu blanc violet orange verd- /oyant ». Ce qu'il rejette fortement de son pays natal, l'argent édifié en unique valeur et le vide de la pensée, se lit dans une saynète, dialogue entre deux touristes américaines, riches et prétentieuses, dans un restaurant des Halles, avec mise en place du décor (« La scène se passe la nuit au Père Tranquille, dans le quartier des Halles. Des putains endormies. (etc.) » ; s'ajoute l'esquisse d'une américaine qui dépense « un fric incroyable ».
Cummings fréquente les expositions et un poème daté de 1920 évoque les peintres Picabia, Picasso, Matisse, Kandinsky, Cézanne ; mais il ne néglige pas les spectacle comme ceux des Folies-Bergères et il écrit, en 1926, pour la revue Vanity Fair un long éloge de Joséphine Baker dansant, en se moquant du moralisme des spectateurs. Il rapporte aussi des scènes plus intimes, avec Marie-Louise « aux jambes de reine » dont il dessine le visage ; il ne cache pas sa nostalgie de l'enfance, du temps aussi de la "Grande époque", celle du dadaïsme déjà dans le passé en 1923 ou de poètes selon son cœur comme Swinburne.
Regrouper des poèmes écrits au cours d'une quarantaine d'années aboutit à donner à lire des manières différentes d'écrire. À côté de proses et de poèmes de facture classique, le lecteur retrouvera au fil des pages les ruptures introduites par Cummings dans son écriture. Par exemple, il introduit ici un complément de lieu dans une parenthèse entre un pronom ("je") et le verbe, mais là, outre ce procédé qui contraint à revenir sur sa lecture, il introduit des coupes à l'intérieur même des mots — ce qui pose de redoutables difficultés au traducteur :
(the;mselve;s a:nd scr;a;tch-ing lousy full. of rain
beggars yaw:nstretchy:awn)
devient :
(le;s s;e gr,att-ant poux pleins.de.pluie mendiants
b:âillents'étirentb:âillent
Non pas seulement jeu, puisque le poème construit sur les articulations "quand... quand... alors", s'achève sur l'union, dans les mots, du couple : « nous / toi-avec-moi / autour de (moi)toi / d'un seul JeTu ».
Cette mise en pièces des règles morphologiques peut être plus forte, et les frontières de mots disparaissant dans :
and, b etw ee nch air st ott et er a thresillyold
WomanSellingBalloonS
traduit par
et, e ntr el esc ha ise sc lop in e lavieille idiote
QuiVendDesBallonS
Jacques Demarcq, traducteur déjà de plusieurs œuvres de Cummings(1), met en relation dans la postface des épisodes de la vie du poète avec les textes c'est apporter un éclairage utile pour comprendre ce qui peut être allusif dans les poèmes. En même temps, cela constitue une introduction à une écriture encore déconcertante pour bien des lecteurs. Ce Paris est un livre à lire et relire.
______________________
1. Récemment, Érotiques (Seghers, 2012) et 1x1 (La Nerthe, 2013)
Tristan Hordé, mai 2014 © Les Carnets d’Eucharis
■■■Edward Estlin Cummings
Néen 1894 à Cambridge (Massachusetts). Étudiant à l'université Harvard, il vient en France comme ambulancier en 1917. Ses convictions pacifistes lui valent trois mois de détention à La Ferté-Macé (Orne). Cette expérience lui inspire L'Énorme Chambrée, un récit enjoué et moqueur, remarqué dès sa sortie par la critique et figurant depuis parmi les classiques. Toute sa vie, Cummings écrira des poèmes, sur l'actualité parfois et sur la vie sociale, mais plus souvent sur les thèmes éternels de la nature et de l'amour, dans un style de plus en plus novateur, bousculant les formes et repoussant les frontières du langage. Très populaire auprès des jeunes après la Seconde Guerre mondiale, Cummings est mort en 1962.
SITES À CONSULTER

Sur le site : Seghers | Paris
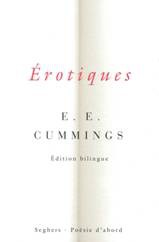
Sur le site : Seghers | Erotiques

Sur le site : La Nerthe | 1 x 1 [une fois un]
| © Cliquer ICI
22:36 Publié dans E.E. Cummings, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
19/02/2014
Jean-Louis Giovannoni - Voyages à Saint-Maur, Champ Vallon 2014 (une lecture de Tristan Hordé)
●●●
UNE LECTURE DE TRISTAN HORDÉ
…
Voyages à Saint-Maur
JEAN-LOUIS GIOVANNONI
Editions CHAMP VALLON, 2014
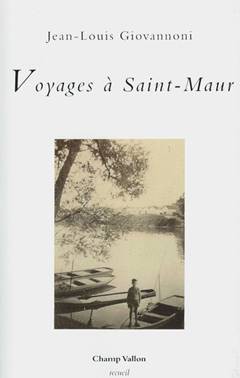
Site officiel | © http://www.champ-vallon.com/Pages/Pagesrecueil/Giovannoni1.html
____________________________________________________________________________
■■■ Le pluriel du titre oriente vers des relations anciennes qui conduisaient le lecteur vers les Amériques ou le Moyen Orient (Voyages à Athènes, Constantinople et Jérusalem, 1602-1605), ou l'on peut penser à ces explorations des ressources et du patrimoine d'une région (Louis Jouve, Voyages anciens et modernes dans les Vosges, 1838), mais Saint-Maur n'est pas en Martinique ou dans l'Océan Indien, c'est une ville du Val-de-Marne. Il ne s'agit donc pas de voyages dans l'espace, mais dans le temps, le récit débuté au printemps 1981 s'achève le 21 décembre 2012. Sont mêlés les parcours réels dans la ville (seulement les cinq premiers voyages) et les souvenirs reconstruits ou imaginés, notamment à partir de photographies, l'une achetée aux Puces et quatre prises par la mère du narrateur. Le récit est précédé d'un croquis avec la légende « La commune de Saint-Maur-des-Fossés est quasiment encerclée par la Marne... », le dernier "voyage" rappelle, grâce à la vue aérienne, « La Marne entoure Saint-Maur » : fin des voyages comme si rien n'avait bougé.
On sait, par le poème Mère1, l'importance qu'a eue pour Giovannoni sa mère, morte en 1974, dans sa décision d'écrire, et ce n'est pas hasard si le premier chapitre est introduit au présent par l'annonce de son décès et l'indication de son adresse, but du voyage : « Ma mère est morte. Elle habite au 23, avenue Jean-Jaurès », et l'ensemble du récit est organisé autour de ce lieu qui semble pourtant ne pouvoir être atteint. Le narrateur ne s'y rend pas au cours du premier voyage, non plus lors du second : « Impossible d'aller au 23 », « Je saute le 23 ». Pour le troisième, les choses sont plus simples, le narrateur ne sort pas de chez lui et un poème titré "Le corps immobile", précède une plongée dans les souvenirs. Ce n'est que pendant le quatrième voyage qu'il pousse le portail du "23", ce qui déclenche (« C'est parti" ») un flot de souvenirs d'enfance. Le "23" ne réapparaît que dans le dernier chapitre où le narrateur retourne dans un Saint-Maur virtuel à l'aide de Google Maps ; alors : « Le 23. / Je monte le curseur. / Impossible d'entrer. L'image se brouille. »
Ces retours à Saint-Maur ne sont que très partiellement dans un présent et encore se limitent-ils à quelques endroits, énumérés dans le dernier chapitre, notamment le cimetière, la place Galilée, l'avenue Jean-Jaurès, la Marne et la passerelle — et le bus 111. Les quatre premiers parcours sont effectués en 1981 au rythme des saisons, du printemps à l'hiver, le cinquième en septembre 1982 ; ensuite, les repères temporels sont absents : tout se passe dans le passé des souvenirs, partiellement étayés par des photos. Parmi les images fortes se détache une figure féminine dont le portrait est à peine esquissé, celle de la grainetière chez qui le narrateur enfant, amoureux silencieux, venait acheter des pommes de terre ; elle lui a donné une brochure sur les nuisibles du jardin, ce qui a entraîné toute une série d'observations. Cette figure revient, présente absente dans un retour rêvé à Saint-Maur : la nuit, le narrateur voit dans la boutique des vêtements de la femme sur une chaise.
Le narrateur observe, sans cesse, dans ses journées à Saint-Maur les modifications du paysage urbain. Mais le réel disparaît régulièrement et surviennent des faits étranges. Par exemple, une femme et un enfant le fixent dans le bus 111, se lèvent quand il se lève et le suivent quand il descend, mais il remonte très vite juste avant la fermeture des portes — s'agit-il du narrateur enfant et de sa mère dans un autre temps ? Auparavant, au cours du premier retour à Saint-Maur, quand il est sur les bords de la Marne, il note : « Tout le monde me regarde » ; plus loin dans le temps, il relève encore, « On me regarde ». L'enfant lui-même est guetté par le propriétaire du petit immeuble ou, d'une autre manière, par une voisine très âgée, Mme Yvette, dont le fils Dédé sort périodiquement de l'asile. D'autres éléments sont à la frontière du réel et de l'imaginaire, ainsi la masse d'écrevisses remontées de la Marne, la barque noyée..., et quand l'enfant se réfugie dans un appentis à l'abri des regards, c'est pour voir le monde à travers une vitre déformante qui, comme un kaléidoscope, transforme l'aspect des choses. Par ce biais, il réinvente à son gré l'univers : « je ne me lasse pas de faire et de défaire. Un monde en un clin d'œil. »
Les lieux nommés existent — on peut aisément le vérifier —, l'espace est donc précisément délimité mais, ici et là, des énoncés, parfois très brefs, sans lien avec le contexte, accroissent le sentiment que la frontière entre réalité et imaginaire est très poreuse, ce que renforce l'absence de repères chronologiques et la construction même du récit, formé de courtes séquences souvent indépendantes les unes des autres. Le lecteur passe d'un jardin la nuit, où « Les objets articulent de petits cris », auxquels le narrateur répond, à une scène dans une chambre d'hôpital dans la séquence suivante et l'on peut imaginer qu'il s'agit des derniers moments de la mère. Le douzième et dernier voyage, entrepris en 2012 à partir de Google maps, ferme le récit. L'image sur l'écran de l'ordinateur ne suscite plus les souvenirs et puisque la ville ne peut plus être un mélange de réalité et de rêve, elle n'a plus à être : « Zoom arrière. / Saint-Maur s'enfonce. / Fermeture de session / en cours... »
Tristan Hordé, février 2014
© Les Carnets d’Eucharis
____________________________________________________________________________
SITE À CONSULTER
[Huitième voyage à Saint-Maur]
Sur le site : Terres de Femmes
| © Cliquer ICI
■■■JEAN-LOUIS GIOVANNONI
Ecrivain et poète français, né à Paris en 1950. Il a exercé le métier d'assistant social, pendant plus de trente cinq ans, dans un hôpital psychiatrique parisien. Il effectue aussi des lectures de poésie dans les prisons. Il fonde en 1977, avec Raphaële George, la revue Les Cahiers du doublequ'il codirige jusqu'en 1981. De 2005 à 2007, il est membre du comité de rédaction de Nouveau Recueil.

Juste pour situer
Voyages à Saint-Maur tourne autour du 23, avenue Jean-Jaurès, à Saint-Maur-des-Fossés où ma mère vivait dans un studio (fin des années 50, début des années 60) avec son chat Pompon et deux poissons rouges.
Un autre axe détermine l’avancée de ce livre : les photos d’un petit garçon de huit ans, retrouvées dans une boîte à chaussures. Cinq d’entre elles ont pour décor les bords de Marne (passerelle de la Pie, quai de Bonneuil), les deux autres ont été prises dans le jardin du 23, avenue Jean-Jaurès. Les dates sont précisées à l’arrière de chacune d’entre elles. Le photographe est ma mère. Une dernière photo représente un enfant inconnu ayant à peu près le même âge que le premier et faisant du surplace sur un vélo. Ce document a été acheté aux puces de Saint-Ouen dans les années 1980. Aucun prénom ou nom ne figure à l’arrière, si ce n’est la marque Kodak imprimée et la référence : B 546.
(EXTRAIT)
|
|
|
1 dans Jean-Louis Giovannoni, Garder le mort, suivi de Mère, préface de Bernard Noël, Fissile, 2009.
21:47 Publié dans Jean-Louis Giovannoni, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
09/01/2014
Edith Azam, Décembre m'a cigüe (une lecture de Tristan Hordé)
●●●
■■■
le corps n'est pas facile : à être
(Décembre m'a ciguë, p. 150)
« (...) téléphone. Surtout qu'il ne sonne pas. Veux pas que ça t'arrive, veux pas que tu me quittes. » S'il sonne, ce ne peut être que pour annoncer la disparition de la grand-mère de la narratrice. Décembre m'a ciguë, où "ciguë" connote sans équivoque la mort, est un long soliloque tenu dans l'attente de ce qui viendra clore le récit : une sonnerie, « et ton nom qui s'écrit... / mais ce n'était pas toi, / non, / ce n'était pas : / ta Voix ». Quoi, avant l'inéluctable ? La narratrice, dans son enfermement, tente de rassembler ce qui fut heureux dans le passé avec Mamie, moments que seule l'écriture pourra fixer, figer pour les « vivre à nouveau ». Elle cherche un refuge dans l'oubli du présent, et à « fuir ce que l'avenir a... d'insupportable », en retrouvant les images de la continuité, de l'innocence, celles de l'enfance, « du début de la lumière ». Elle se remémore toutes les petites actions accomplies, tous ces petits gestes qui emplissent la vie (« la cueillette, les myrtilles, les longues marches, la météo... le ciel qui change de couleur [...] », et elle se souvient des mots de sa grand-mère, comme : « À mon avis tu te compliques la vie pour rien. » Cependant, elle ne peut penser vivre seule les jours à venir, dépourvue devant les problèmes les plus simples de la vie quotidienne : au fur et à mesure que les jours passent, la narratrice perd de plus en plus contact avec la réalité, ses repères disparaissent — « l'avenir me fait froid, l'avenir me fait peur ». Quoi que l'on fasse pour échapper aux choses du monde, « c'est le vide, toujours, toujours : toujours le vide recommencé [... sans pouvoir] sauver un bout d'imaginaire. »
Dans ce long monologue sont introduits, énigmatiques, de très courts extraits (qui ouvrent parfois un chapitre) d'une légende, en partie variante de l'histoire de Tristan et Iseut. Le chevalier breton Bran a vaincu des troupes anglaises mais, blessé et fait prisonnier, il est emmené en Angleterre ; sa mère, prévenue, vient payer la rançon et le délivrer, malheureusement un valet le trompe et lui annonce que la voile du bateau qui approche des côtes est noire : persuadé d'être abandonné, le chevalier meurt. Les fragments, réunis, forment le dernier chapitre — comme si la mort donnait son sens à l'histoire maintenant d'un seul tenant, de même que la mort de la grand-mère interrompt le monologue.
Décembre m'a ciguë est plus qu'un étrange récit autour de la difficulté de vivre : on y lit aussi parallèlement une méditation continue sur la difficulté d'écrire, et elle ne concerne pas seulement la mort proche, attendue, refusée : « Écrire ne signifie rien, rien d'autre que le manque ». On reconnaît là un des motifs de la poésie d'Édith Azam et l'on retrouve dans sa prose le souci de faire entendre ce qui presque toujours est tu, « ce gouffre où sont nés les langages, parce que s'y parlent encore l'Oubli et la Mémoire. » Comme dans la poésie, elle dérange l'ordre de la phrase, obligeant le lecteur à construire autrement le sens ; parmi tous les moyens en œuvre (phrases interrompues, désarticulation de l'ordre sacré sujet-verbe-complément, jeu minuscule/majuscule, etc.), je retiens l'usage qui lui est propre des deux points (:) ; ainsi, « la nuit, je rêve au-delà : de toute expression », « Je craque : une allumette, recommence jusqu'à finir : la boîte. », etc.
Tristan Hordé, janvier 2014
© Les Carnets d’Eucharis
18:16 Publié dans Edith Azam, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
01/06/2013
Cole Swensen, Le nôtre (Ed. José Corti, 2013) par Tristan Hordé
Une lecture de
Tristan Hordé
Cole Swensen

■ Cole Swensen © Photo : Carl Sokolow
Source : https://jacket2.org/podcasts/where-real-exceeds-ideal-poemtalk-52
Le nôtre
Editions Corti, 2013
Traduit de l'américain par Maïtryi et Nicolas Pesquès
Après L'Âge de verre en 2010 et Si riche heure en 2007, Maïtryi et Nicolas Pesquès proposent la traduction d'un troisième ensemble de Cole Swensen sur la "matière" française. Le plus ancien prenait pour prétexte Les très riches heures du duc de Berry, livre d'heures achevé à la fin du XIVe siècle, et le second livre s'attachait aux tableaux de Pierre Bonnard ; Le nôtre — jeu sur le nom pour le titre en anglais Ours — est construit à partir de la création par André Le Nôtre de nombreux jardins au XVIIe siècle. Le livre s'apparente à un livre d'histoire, avec ses divisions ("Histoire", "Principes", "Vaux-le-Vicomte", etc.) ; on suivrait donc l'invention du jardin à la française avec d'abord la création de Vaux-le-Vicomte en 1666 — « les femmes jaillissaient des carrosses, en plumes d'autruche et en rivalités / chatoiements / inclinaisons » — qui entraîna la disgrâce du surintendant Fouquet. Il y aurait ensuite Versailles, sommet de l'art de Le Nôtre, mais aussi Saint-Cloud, Chantilly, Les Tuileries, Saint-Germain-en-Laye, d'autres encore. À côté de la figure de Louis XIV, d'autres personnages apparaissent, comme Charles Le Brun, et, en remontant le temps, Marie de Médicis, Colbert. Ajoutons, quand sont évoquées les orangeries construites au XVIIe siècle, des réflexions sur l'évolution générale des sociétés (« L'histoire des fruits exotiques est parallèle à celle de l'ascension des classes moyennes »).
Cependant, même si les faits rapportés sont exacts, ils ne constituent qu'un matériau et, très rapidement, ce n'est pas la partie historique, volontairement lacunaire, qui retient le lecteur : il s'aperçoit que dans Le nôtre le temps est comme déréglé, qu'il y a glissement dans une phrase d'une époque à une autre. Tout se passe comme si, ouvrant une porte, un personnage traversait les siècles ; ainsi pour Marie de Médicis au Palais du Luxembourg :
Sortant au premier jour de l'été 2007, Marie
voit des centaines de gens jouer sur les pelouses et dans les allées
qui ont été entièrement redessinées, et les chaises métalliques vertes,
leur bruit particulier quand on les traîne sur le gravier [...]
Marie hurle, sans que les gens se soucient d'elle — mais s'agit-il bien de Marie de Médicis, puisque « [c]hacun a un geste ou une expression qui le montre hors du temps » ? Et pourquoi ne pas croire ces deux anglaises qui, au début du XXe siècle, s'égarant dans les allées des jardins de Versailles, se retrouvèrent vivre pendant quelques moments au lendemain de la Révolution de 1789 ?
L'art du jardin consisterait à reconstruire le monde, ou peut-être même à le contenir : le jardinier doit parvenir à « ouvrir l'espace » pour que le jardin n'ait plus de limite et procure une « illusion d'infini ». L'espace est totalement transformé, de manière bien plus vive que « peint sur une tasse de porcelaine » : on reconnaîtra toujours la tasse pour ce qu'elle est, alors que le jardin de Le Nôtre avec ses multiples allées, pièces d'eau, bosquets, plans lointains, est un monde en lui-même ; les sous-titres le suggèrent, "Un jardin est un visage", "une marée", "une approche infinie", etc, c'est-à-dire « tout un jeu / dans lequel les pièces s'ajustent ».
Les temps et les espaces se mêlent, et s'engouffrent dans la fiction d'autres jardins éloignés du jardin à la française, ceux vus par Montaigne en Italie et celui lié, après la Passion, à la mort et à la renaissance — qui pourraient définir le jardin —, quand une autre Marie s'approche du jardinier :
On nous avait promis
et Marie tend les bras au jardinier
que par l'humilité du toucher
qui recule d'un pas
Cole Swensen parle d'anamorphose, et le mot rend compte des jeux d'illusion qu'elle propose, y compris dans le poème titré "Paradis" : l'homme et le jardin n'existeraient pas l'un sans l'autre et ils disparaîtraient sitôt séparés, mais leur liaison ne serait-elle pas aussi une perte de soi, ce que suggèrent les derniers vers : « On appelait oubliettes les premiers jardins publics de l'histoire. Sitôt entré, on ne vous distinguait plus des animaux ».
Ce ne sont pas seulement les repères spatio-temporels qui, ici et là, sont atteints et mis à mal. Le dessin que forme souvent le poème sur la page s'éloigne de l'image toute faite du jardin à la française transparent, sans mystère : les vers peuvent être alignés en milieu de page, les blancs tronçonnent la syntaxe, les enjambements désarticulent le vers, la phrase qui s'est développée, reste inachevée, seul le début d'un nom est écrit, des phrases s'interpénètrent, "nous" renvoie aussi bien à des contemporains de Le Nôtre qu'à des personnages du XXIe siècle, etc. On suit dans le livre la confusion des temps et des espaces, le passage parfois inattendu d'une réalité reconstruite à un monde imaginé, le jeu du continu et du discontinu, on reconnaît le passé comme énigme autant que le présent... Le dernier poème a pour titre "Garder la trace de la distance" : si le lecteur y consent, il prendra au mot ce que proposent les deux derniers vers : « Tu pourrais revenir / le long d'une voie inconnue. »
Il faudrait s'attarder sur les réflexions croisées de Nicolas Pesquès et de Cole Swensen à propos de ce qu'est traduire, ce serait un autre article — je retiens de l'auteur : « Si écrire, c'est présager sa propre mort, et dépasser l'horizon de cette limite, alors traduire c'est entrer dans la mort d'un autre, et devenir deux fois étranger. »
© Tristan Hordé
■ LES CARNETS D’EUCHARIS N°37, 2013
■ JOSE CORTI : http://www.jose-corti.fr/titresetrangers/le_notre_cole_swensen.html
© Droits réservés. Reproduction Interdite
■
Les carnets d’eucharis sont un espace numérique sans but lucratif, à vocation de circulation et de valorisation de la poésie, la photographie & des arts plastiques.
12:12 Publié dans Cole Swensen, José Corti, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
02/03/2013
Ariane Dreyfus, La lampe allumée si souvent dans l'ombre (une lecture de Tristan Hordé)
Une lecture de
Tristan Hordé
Ariane Dreyfus

La lampe allumée si souvent dans l'ombre
« en lisant en écrivant »
Editions José Corti, 2013
320 p., 19 €
Le livre s'ouvre sur une lecture, toujours reprise, jamais achevée, de Colette, et sans doute y a-t-il des points communs entre Ariane Dreyfus et l'auteure de La Naissance du jour, ne serait-ce que la place que toutes deux donnent au corps et à la voix — le chapitre est titré "Le cri chanté". Ce n'est pas cela qu'Ariane Dreyfus retient, mais une leçon pour vivre : « c'est avec elle que j'ai appris, et réapprends, qu'on ne meurt pas de perdre. » C'est peut-être ce qui domine dans les analyses et réflexions, publiées de 1986 à 2011 (hors quelques inédits) et retravaillées ; l'écriture, toujours étroitement liée au vécu — ce qui n'implique en rien d'ailleurs l'épanchement, un moi abondant dans les poèmes —, rejette toute négativité comme tout souci strictement formel. On découvre cette position aussi bien dans les lectures réunies dans le premier chapitre (Nabokov, Degroote, Dostoïevski, Kaye Gibbons, Rouzeau), dans les essais de l'avant-dernière partie (J. Lèbre, C. Lamiot, Giovannoni, Pesquès), dans ceux consacrés à deux proches (Éric Sautou, Stéphane Bouquet) qui occupent le tiers du livre et le ferment, dans l'hommage à James Sacré, sous le titre "Celui qui m'a montré", et dans le chapitre "La poésie quand nous la faisons", plus directement consacré à la fabrique du poème.
C'est à quelques aspects de cette question du "faire" (« Je vis dans le faire »), si présente dans l'ensemble des essais, que je m'attacherai. Il y a eu, d'abord, les découvertes dans l'enfance, notamment le plaisir que procure l'assemblage des mots, et tout autant l'analyse des phrases, leur démontage et remontage, en un mot la grammaire ; ce qu'écrit Ariane Dreyfus à ce sujet se dirait sans peine de sa poésie : « Toute phrase était un pays où les mots apprenaient à vivre ensemble » — c'est ce "vivre ensemble" des mots qu'elle cherche toujours à obtenir. L'enfance, ce sont aussi les contes : le premier chapitre d'essais débute par un bref conte en vers "Les trois soeurs", et "Le Petit Poucet" offre encore un modèle de vie par sa ténacité : le personnage est par excellence celui qui « ne renonce jamais ». Cependant, les oeuvres « fondatrices », ce sont L'enfant et Poil deCarotte, qui lui apprirent ce qu'était une « douleur contenue », et c'est dans ces deux livres une « sorte de peine sur le qui-vive » qui l'a « réellement formée pour écrire ». L'écriture est liée à l'enfance d'une autre façon : comme pour d'autres qui n'éprouvent pas ensuite la nécessité de poursuivre, elle a été pour elle un refuge, un « espace de projection » qui l'a aidée à « sortir de la peur et de la honte qui ont dominé [son] enfance, [son] adolescence », un moyen donc de se construire contre ce qui l'en empêchait. L'enfance, « ce moment de l'attente sans bords », est toujours là, surtout par ce qu'elle représente, ce qui est clairement analysé : comme elle est « à la fois l'irréparable et l'espoir », note Ariane Dreyfus, « je ne vois pas comment j'écrirai dans un esprit qui ne serait pas d'enfance ».
Après les oeuvres qui ont donné l'élan, ce sont surtout Lewiw Carroll, Brontë, Denis Roche et le cinéma qui lui ont permis d'être « traversée par d'autres vies : des voix intérieures, [ses] fées consolatrices ». De longs développements à propos des films vus et revus explicitent le rôle qu'ont pour elle les images et les voix — s'il fallait choisir, écrit-elle, mieux vaudrait écouter les voix que regarder les images. Les visages de femmes la fascinent en ce qu'ils sont un « miroir magique » qui la délivre « de [son] propre visage », mais plus largement, notamment dans les westerns, les images magnifient les gestes quotidiens, ce qui n'est pas sans lien avec les choix dans le poème, qui doit proposer des « pensées communicables », et non s'éloigner de tout réel : on lira les pages consacrées de manière détaillée à l'élaboration du poème "Iris", qui s'achèvent par une mise au point de ce qu'est le "motif" (et non le "sujet"), à l'origine d'un poème, « fragment inentamable du monde, (...], aussi (...) tout éclat, de quelque nature qu'il soit, attaché à la vie humaine pour l'incarner, y compris dans ses manifestations les plus courantes ».
C'est là un des points essentiels de la poétique d'Ariane Dreyfus, il s'agit à chaque fois dans un poème de parvenir à « l'évidence du vivant », restituer quelque chose de sa dynamique, pour qu'écrire puisse « construire, d'une façon ou d'une autre, un lien », faire partager au lecteur une émotion. De cette manière, le poème « réveille » autant qui le lit que celle qui l'écrit. Quand on parle d'émotion, ce n'est pas le "moi" et ses sentiments qui apparaissent dans le poème ; Ariane Dreyfus écrit très justement que l'amour, quoi qu'on dise, n'est pas un thème poétique, que c'est le fait d'écrire qui « devient de l'amour », « le poème [étant] ce lieu où ni [le lecteur] ni moi ne sommes, mais où nous sommes ensemble ».
Le poème est aussi un lieu de construction du présent, un « présent multiplié », un lieu qui donne le moyen d'éloigner un moment le réel, non pour l'oublier mais « pour ne pas constamment le subir », pour l'interpréter, le réinventer. C'est dire encore que ces essais sont pour son auteure et visent à être pour le lecteur, une manière de penser ce qu'est vivre autant qu'une poétique — les deux ne se distinguent pas toujours. Il y a d'ailleurs, tout au long du livre, avec le refus aussi bien de la poésie-sentiment que de l'"avant-garde", l'affirmation que le poème vivifie et « n'a de sens que par le souffle moral qu'il nous donne, et non par une accumulation de belles trouvailles ».
© Tristan Hordé
■ LES CARNETS D’EUCHARIS, Hiver 2013, N°36
19:21 Publié dans Ariane Dreyfus, José Corti, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
30/01/2013
Lorine Niedecker, "Louange du lieu" par Tristan Hordé
Une lecture de
Tristan Hordé
LORINE NIEDECKER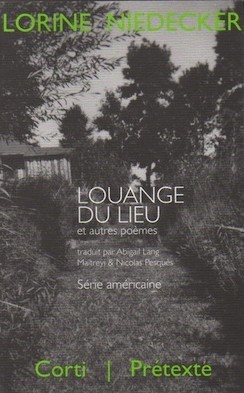
Louange du lieu
« Série américaine »
Editions José Corti, 2012
Après Poésie complète de George Oppen et en même temps que L'Ouverture du champ de Robert Duncan, les éditions Corti publient dans leur "Série américaine" une partie importante de l'œuvre poétique de Lorine Niedecker (1903-1970) — les poèmes de sa dernière période (1957-1970) et une sélection d'un recueil précédent. Elle était jusqu'à aujourd'hui quasiment inconnue en France (comme l'ont été longtemps beaucoup de poètes américains), présente seulement par quelques traductions en revues, par Abigail Lang, notamment dans Vacarme en 2006 et 2008, et Sarah Kéryna dans Action poétique en 2001. Les traductions d'Abigail Lang, Maïtreyi et Nicolas Pesquès, qui donnent une idée très juste de la poésie de Lorine Niedecker, sont précédées d'une préface mêlant biographie et étude précise de l'œuvre.
Découvrant en 1931 dans la revue "Poetry" Louis Zukofsky, Lorine Niedecker a adopté ensuite dans son écriture quelques principes de ceux qui furent réunis sous le nom de poètes objectivistes : le refus de la métaphore, l'attention aux choses quotidiennes de la vie, le choix de l'ellipse (jusqu'à aboutir parfois à des poèmes difficiles à déchiffrer). Elle a rencontré les poètes (George Oppen, Charles Reznikoff, Carl Rakosi) qui se réclamaient peu ou prou de l'objectivisme théorisé par Zukofsky, mais c'est avec ce dernier qu'elle s'est surtout liée et qui sera jusqu'au bout un interlocuteur privilégié.
Le titre Louange du lieu a été retenu pour l'ensemble traduit parce que ce recueil, « synthèse de précision et de fluidité », « hymne et flux et autobiographie poétique », est bien, soulignent les traducteurs, la « somme de son œuvre ». La louange, c'est celle de la région natale, le Wisconsin, où Lorine Nediecker est restée l'essentiel de sa vie, sans pour autant vivre en recluse. Elle présente ainsi son environnement : « Poisson / plume / palus / Vase de nénuphar / Ma vie » et, dans un autre poème, elle évoque de manière un peu moins lapidaire sa vie dans ce pays de marécages et d'eau : « Je suis sortie de la vase des marais / algues, prêles, saules, /vert chéri, grenouilles / et oiseaux criards ». L'émotion est toujours retenue, mais présente cependant dans de nombreux poèmes à propos des saisons, notamment de l'automne (« Brisures et membranes d'herbes / sèches cliquetis aux petits / rubans du vent »), de l'hiver avec ses crues (« Assise chez moi / à l'abri / j'observe la débâcle de l'hiver / à travers la vitre ».
Les poèmes à propos de son environnement laissent percevoir une tendresse pour ces terres souvent couvertes d'eau, et l'on relève de multiples noms de plantes et de fleurs, une attention vraie aux mouvements et aux bruits de la nature :
Écoute donc
en avril
le fabuleux
fracas des grenouilles
(Get a load / of April's / fabulous // frog rattle)
Ce sont aussi des moments plus intimes qui sont donnés, sans pathos, dans des poèmes à propos de ses parents ou de son propre mariage ; il y a alors en arrière-plan, sinon quelque chose de douloureux l'expression d'une mélancolie : « Je me suis mariée / dans la nuit noire du monde / pour la chaleur / sinon la paix ». Cette mélancolie, toujours dite mezzo voce, est bien présente quand Lorine Niedecker définit la vie comme un « couloir migratoire » ou quand, faisant de manière contrastée le bilan de ses jours, elle écrit : « J'ai passé ma vie à rien ».
Dans des poèmes "objectifs", elle note de ces événements de la vie quotidienne qui ne laissent pas de trace dans la mémoire : « Le garçon a lancé le journal / raté ! : / on l'a trouvé / sur le buisson ». Cependant, il n'est pas indifférent qu'elle soit attentive à de tels petits moments de la vie ; elle est, certes, proche de la nature, mais cela ne l'empêche pas d'être préoccupée par la vie de ses contemporains, par le monde du travail. À la mort de son père, dont elle hérite, elle constate : « les taxes payées / je possèderai un livre / de vieux poètes chinois // et des jumelles / pour scruter les arbres / de la rivière ». On lira dans ces vers quelque humour, il faut aussi y reconnaître son indifférence à l'égard des "biens" (« Ne me dis pas que la propriété est sacrée ! Ce qui bouge, oui »), qu'elle exprime à de nombreuses reprises sans ambiguïté : « Ô ma vie flottante / Ne garde pas d'amour pour les choses / Jette les choses / dans le flot ». Sans être formellement engagée dans la vie politique, elle écrit à propos de la guerre d'Espagne, du régime nazi, sur la suite de la crise économique de 1929 (« j'avais un emploi qualifié / de ratisseuse de feuilles ») ou sur Cap Canaveral et sur diverses personnalités (Churchill, Kennedy). Elle se sait aussi à l'écart de son milieu de vie, sans illusion sur la manière dont elle serait perçue si l'on connaissait l'activité poétique qu'elle a en marge de son travail salarié : « Que diraient-ils s'ils savaient / qu'il me faut deux mois pour six vers de poésie ?».
C'est justement une des qualités de la préface de reproduire des documents qui mettent en lumière la lente élaboration des poèmes, depuis la prise de notes jusqu'au poème achevé. Il s'agit toujours pour Lorine Niedecker de réduire, de condenser encore et encore : elle désignait par "condenserie" (condensery) son activité. Son souci de la « matérialité des mots » l'a conduite à privilégier des strophes brèves (de 3 ou 5 vers) qui ne sont pas sans rappeler les formes de la poésie japonaise — Lorine Niedecker rend d'ailleurs plusieurs fois hommage à Bashô. Il faut suivre le cheminement des premiers poèmes proposés dans ce recueil (le premier livre publié, New Goose, 1946) n'a pas été repris) aux derniers, à la forme maîtrisée : c'est une heureuse découverte.
Un poème :
Jeune en automne je disais : les oiseaux
sont dans l'imminente pensée
du départ
À mi-vie n'ai rien dit —
asservie
au gagne pain
Grand âge — grand baragouin
avant l'adieu
de tout ce que l'on sait
© Tristan Hordé
■ LES CARNETS D’EUCHARIS, Automne 2012, N°35
22:44 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
23/06/2012
Isabelle Ménival, "Khôl" par Tristan Hordé
Isabelle Ménival
Editions Argol, 2012
■ Site Les éditions Argol/ http://www.argol-editions.fr/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=155

(…)
____________________________________________________________________________
■■■ La publication d'un premier livre de poèmes, surtout quand son auteur est très jeune, est un pari : on le souhaite gagné. La quatrième de couverture explicite les raisons du choix de l'éditeur : « Khôl, c'est la singularité et la violence d'un monde qu'elle [Isabelle Ménival] vit et éprouve, c'est déjà une maturité de la langue exceptionnelle. » C'est bien là, un regard particulier sur le monde et l'inventivité de la langue, ce que l'on attend de la poésie.
Pour lire l'ensemble, on partira du titre et de la citation en exergue. "Khôl", qui apparaît également dans le titre d'un poème et à l'ouverture d'un autre, évoque non pas l'Orient nervalien, mais la transformation du visage, le masque, l'indécision entre la figure et son reflet. Ce motif est présent à plusieurs reprises à propos de l'apparence du visage, présenté comme « masque aux yeux cernés » ; le maquillage, ce « papier carbone sur le visage », fabrique une manière de double, « métamorphose écarquillée dans l'absence », et dissimule quelque chose : il signale la difficulté à entrer dans le monde sans apprêt et peut-être oriente-t-il également vers une indétermination généralisée, annule-t-il de façon provisoire la séparation hommes-femmes — « il y a des années / j'habitais les corps / de femmes et d'hommes » (on sait la force qu'a le verbe "habiter"). L'absence de délimitation atteint régulièrement l'expression du lien amoureux, par le questionnement des frontières ( « ton corps c'est le mien ? »), et sans qu'il y ait fusion du masculin et du féminin par la tentative de ne pas choisir, d'accueillir « l'autre inconnu(e) indéterminé(e) ».
Il y a l'idée d'une séparation impossible à surmonter, d'une nécessité du masque pour qu'un passage soit possible entre le sujet et l'autre par les mots :
[...] je rêve que tu rêves à ce que je t'apprenne à foncer nos deux peaux ;
Les voix de la rue comme de petites cendres jetées de moi à toi à toi et sans retour.
Ce jeu des reflets est présent dans la composition même du livre : le second ensemble est titré "recto verso" ; il est encore dans la récurrence des quasi homophones, des anagrammes, des allitérations et des rimes répétées, qui introduisent de multiples échos ; voir par exemple : « de ces corps [...] décor ; tu plaides les plaies que tu planques sous pull ; floues / foule ; si proches tes propres premiers sons . hésitant / tant [...] », etc. — jeu jusqu'à l'ironie vis-à-vis de ce jeu : « perdues perverses perchées perturbées ».
Le trouble de l'identité a pour corollaire une relation malaisée au corps et un questionnement continu sur le temps, ce qu'annonce la citation de Proust mise en exergue : « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre ! » (Du côté de chez Swann) Ce gâchis apparaît aussi dans Khôl, lié à une position du corps défait : « elle avachie par terre / avait perdu vingt ans ». Le temps, rien d'exceptionnel, modifie les corps « au fil des rides », pâlit la couleur des choses, et le désir de quitter « l'enfance interminable » n'aboutit pas à une plénitude rêvée, comme si rien ne tenait et que la menace de disparition obligeait à se saisir de l'instant dans l'instant même (« toutes les secondes qu'on a passées / même pas un jour entier »), parce que l'on sait « que tout s'échappe » et que cette disparition elle même doit être vécue : « c'était beau cette fois / l'amour qui se délite / emmêlé à ta voix ». On pourrait voir quelque complaisance dans cette visite d'un motif lyrique classique, où l'amour semble bien vaincre le temps : « quatre mêmes mains qui ne se tordent plus ne se lèsent plus / se foulent se découvrent », ce serait ne pas lire la lucidité d'Isabelle Ménival, qui prend ses distances avec la convention : « errer se perdre et jouir cf romantisme ». On ne peut être plus clair.
Cette distance se manifeste aussi dans la pratique du vers, précisément dans l'essai des formes. Le second ensemble débute par des vers courts placés au milieu des pages : on peut dire que c'est là reprendre un poncif de la poésie "moderne", et j'ajoute qu'Isabelle Ménival utilise allègrement tout ce qui signale aujourd'hui la poésie : absence de ponctuation (sauf deux fois un point dans le dernier poème), absence de majuscule en début de vers (sauf dans deux poèmes), petits groupes de vers "libres" séparés par des blancs, décalage des vers les uns par rapport aux autres. Mais elle introduit aussi les vers rimés et comptés, des heptasyllabes — « on rimait quelquefois / saoulés d'impairs » — ou des alexandrins, ou des vers comptés mêlés ; elle n'hésite pas à jouer avec la rime et le sens, associant "doliprane" à "cyclohexane" et "nymphomanes", "versatiles" à "virils" et "stériles"... La poésie n'a pas besoin de mots "poétiques" (d'où l'introduction de "jouable", "grave"), elle est dans cette redécouverte du lyrisme et du vers dans son histoire ; aussi dans le questionnement jamais apaisé de ce lyrisme, ouvert dans le dernier poème avec la répétition de "Regarde" et les deux derniers vers du livre :
Regarde
depuis toujours nos nuits blanches et noires portent ce songe
Il faut espérer qu'Isabelle Ménival continue à « briser la glace des normes », puisqu'elle sait déjà qu'« on peut casser / la norme sur papier ».
©Tristan Hordé LES CARNETS D’EUCHARIS
Juin 2012
23:51 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
20/05/2012
Jean-Pascal Dubost
Tristan Hordé
Jean-Pascal Dubost
et leçons et coutures
Editions Isabelle Sauvage, 2012
136 pages, 20 €
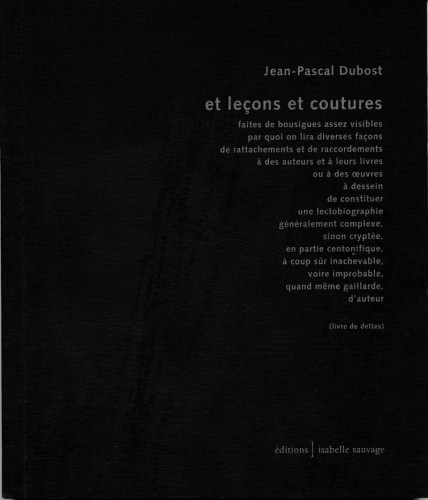
___________________________________________________________________________
■■■Le titre est suivi, comme on le faisait par exemple au XVIe siècle, d'un long sous-titre qu'on peut lire comme un poème, avec un jeu facétieux de rimes et assonances (inachevable /improbable /gaillarde) ; repris page 75, il convient tout à fait pour dire ce que sont les poèmes de Michel Leiris. Titre et sous-titre se prêtent à de multiples interprétations, ce qui correspond au contenu du livre ; leçons cumule ici nombre de significations, dont celle courante au Moyen Âge et toujours en usage de "lecture" : lecture des 99 auteurs convoqués ; quant à coutures, qui se rattache à "coudre", il avait en ancien français pour homonyme couture (que l'on retrouve aujourd'hui en toponymie), doublet de culture, lié à cultiver ; les deux mots du titres sont d'ailleurs réunis dans le mot valise "lec[ons/cou]tures". Les coutures, affirme d'emblée le sous-titre, sont faites de « bousigues assez visibles » ; cette indication présentée comme une explication déroute : ne peut être visible que l'observable, or "bousigues" est absent des dictionnaires que le lecteur consultera et le contexte n'est pas éclairant — son sens, "coutures grossières", n'est donné, en note, que plus tard, dans les "Notes préambulaires" (p. 7). D'autres surprises attendent le lecteur quand il entre dans la broussaille du sous-titre trompeur, qui semble ne rien dissimuler quand il définit le livre comme une "lectobiographie", mais il est précisé qu'elle est « complexe », « cryptée », « inachevable »... Les derniers mots, entre parenthèses, « (livre de dettes) », pourraient accompagner toute publication, si l'on accorde que rien ne s'écrit sans la mémoire, vive ou non, de ce qui a été lu.
Comment Jean-Pascal Dubost règle-t-il ses dettes ? D'abord en donnant en exergue trois citations qui, de manière différentes, répètent que toute écriture se construit à partir de lectures : Montaigne (très présent ensuite), Valérie Rouzeau et Haroldo de Campos. Aucun hasard dans ce choix : un écrivain du XVIe siècle, qui reporte à un passé que Jean-Pascal Dubost affectionne, une écrivaine contemporaine dont on sait qu'elle intègre (comme Montaigne) dans sa poésie ce qu'elle lit et voit, un écrivain hors de nos frontières qui a su relire la tradition poétique. Une courte introduction précise en quoi le plagiat est « un des fondements de la littérature » (p. 7), donnée comme une « longue chaîne citationnelle et re-citationnelle ad infinitum, aux transformations personnalisées au gré des époques traversées » (p. 8).
Ces transformations, Jean-Pascal Dubost les pratique « en une autre langue, assavoir dans la langue naturelle de l'auteur : hors du commun ; cryptée » (p. 9), « une langue tout à la fois populaire, vulgaire, verte, littéraire et documentée » (p. 12). Cette langue comporte de nombreux mots et tours du Moyen Âge et de la Renaissance, mais aussi des créations verbales — qui peuvent être dites telles : « le mot "babouineur" est une invention », p. 19 —, des énumérations (voir Rabelais), le goût de la fatrasie, l'emploi parodique d'allitérations : « Qui veut connaître [...] s'enfoncera dans une forêt fabuleuse fichu d'un foutu fonds de forces fidèles pour lutter [...] » (p. 93), etc. Ajoutons encore dans cette introduction le recours aux notes ; elles seront abondantes ensuite, pour préciser un point, définir un mot ou une expression, proposer au lecteur d'aller lire autre chose — ou l'égarer.
Viennent ensuite les poèmes, puis une table des auteurs et le livre se ferme sur "Le complexe Dubost (phrases lares)", formé d'un ensemble de citations sur l'écriture et la lecture, sur la complexité, dont la dernière, isolée, avec le nom de son auteur (James Sacré) en tête, suggère que la composition du livre n'est pas aussi préparée qu'on la souhaitait : quel que soit le plan prévu, « le livre quand même / Se continue / Autrement qu'on l'avait prévu » (James Sacré, cité p. 131).
Quels auteurs sont présents ? 99, nombre qui donne plus l'idée de l'inachevable, à mes yeux, que 100. Il s'agit pour un bon tiers d'écrivains français du XXe siècle, pas toujours "poètes" (Pierre Michon), pas toujours reconnus (Henri Simon Faure), parfois essayiste (Paul Zumthor) ; le Moyen Âge (8) et la Renaissance (10) ont une belle part ainsi que les écrivains de langue anglaise (19), plus que le XIXe siècle (9, dont un gastronome écrivain, Grimod de la Reynière) ou le XVIIe siècle (5) français. On ne peut dans un court article lire et chiffrer ce qui est écrit pour chaque écrivain retenu. Lisons la prose poème consacrée à James Sacré puisque lui sont prêtés les derniers mots du livre ; on peut y repérer quelques aspects du travail de Jean-Pascal Dubost.
James Sacré Comme tout le monde se plaint
de la cruelle envie que la nature porte aux longueurs
de nos jours et comme tut rien turne en declin,
quoiqu'on vous jure sur la tête d'un God
qu'on va moraliser les banques et les patrons
voyous, il était acquis d'avance que ce poème
sué, soufflé, rendu, raterait la couche du moche
et serait raté ni d'aucune aide, et du coup, n'en
est pas un —
On sait que James Sacré progresse parfois dans un poème en s'interrogeant sur ce qu'il écrit et, ce faisant, doute de la nécessité du poème : c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Par ailleurs, James Sacré a publié un choix de poèmes de Jean de Sponde, d'où la citation de deux vers tirés d'un sonnet. Le vers de Wace qui suit (tiré de la fin du prologue du Roman de Rou) renvoie, lui, aux textes qu'apprécie Jean-Pascal Dubost, et le contrepet ("la couche du moche") est une des manières qu'il a de bousculer les bonnes manières dans l'usage de la langue, tout comme l'inexistence d'un lien entre les deux propositions [quoiqu'on vous jure...] et [il était acquis...].
Il est, évidemment, exclu de découvrir la source de toutes les citations, et je soupçonne quelques inventions dans ce domaine. Pour les textes, on se réjouit par exemple de lire un pastiche de Pascal Quignard (un autre amateur du passé) dans les premières lignes qui lui sont consacrées, et l'on ne peut qu'approuver un passage de la longue note accompagnant le poème "Jehan de Bretteville" — dont le nom est absent du catalogue de la Bibliothèque nationale...—, à propos de la « déambulation hasardeuse et meneuse de trouvailles inattendues », que l'on applique sans peine à ce livre qu'il faut lire et relire.
On peut s'attarder aux proses-poèmes d'ouverture et de fermeture : la première, pour William Carlos Williams, affirme une absence, « Aucune idée pour ce poème — », et la dernière, en image inversée, l'infinité des lectures avec Pierre Michon, « J'écris sous la tutelle d'un vieux Pan de bibliothèque ». On peut lire aussi une manière d'art poétique dans le second poème consacré à un écrivain imaginé, Tortore1 ; est répété à deux endroits, huit fois de suite, « travailler la langue » et sont énumérés des substituts à "poésie" et "poème" (comme on pourrait les lire, par exemple, chez Ponge ou Stéfan) : pohésie, pouème, pohérésie, proème. S'ajoute l'emploi d'un mot dialectal et d'un mot de l'époque médiévale (avec note explicative pour chacun), une construction syntaxique pour le moins inhabituelle (« or qu'ici non donc, ») et un renvoi, avec « en façon bien estrange », à la naissance de Gargantua (chapitre 6). Un programme loin de tout lyrisme : on comprend qu'Alphonse de Lamartine soit rejeté :
Voici par ailleurs une fondamentale détestation
qui ne peut se taire ores car, j'ai tué le temps
longtemps souvent, j'ai tué Dieu dans l'œuf et
Pieu le der, j'ai tué les muses au berceau, j'ai
tué le génie dla langue, j'ai tué mon père, ma mère,
mes frères et mes sœurs, et c'était le bonheur,
j'ai tué le bonheur, j'ai tué ma langue de bœuf rude,
j'ai tué la beauté, trop assise, j'ai tué l'âme en faisant
l'âne, du moins je crois, [...] j'ai tué Alphonse
et Lamartine et tant bien d'autres encore jusques
y compris des toujours vivants, mais récatonpilu2, ne
me pardonnez pas, car je savais ce que je faisais,
j'ai tant et tellement tué, que je suis bien vivant —
(p. 107)
Jean-Pascal Dubost est bien vivant, en effet, et ses leçons et coutures (pas si visibles que ça) sont une lecture des plus revigorantes. ■■■
Tristan Hordé
Les carnetsd'eucharis (mai 2012)
14:57 Publié dans Jean-Pascal Dubost, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
13/04/2012
Revue Place de la Sorbonne, par Tristan Hordé
REVUE PLACE DE LA SORBONNE
revue annuelle, éditions du Relief, 15 €

Annuel n°2 – Mars 2012
On ne dit rien de remarquable quand on insiste sur le rôle essentiel des revues, quel que soit leur tirage (souvent modeste) et leur fréquence, pour la diffusion de la poésie : à côté d'auteurs bien connus, qui attirent l'acheteur, bien des auteurs nouveaux trouvent là un support indispensable. Leur diversité reflète la variété du paysage poétique en France, qu'elles soient pour l'essentiel consacrées à la poésie — Action poétique, Dans la lune, N4728, Nu(e), Rehauts, Triages, etc. — ou accordent une part plus ou moins importantes à d'autres formes de littérature, aux arts et à la lecture des œuvres — Conférence, L'Étrangère, Europe, Friches, Fusées, Il Particolare, Thauma, etc.1 Il faudrait ajouter la riche floraison de sites et blogs qui, sans les remplacer, complètent le rôle des revues papier.
En tout cas, l'arrivée d'une nouvelle revue ne peut que réjouir. Le second numéro de Place de la Sorbone, qui a pour sous-titre "Revue internationale de poésie de Paris Sorbonne", a vu le jour en mars. Son rédacteur en chef, Laurent Fourcaut, poète, est aussi un universitaire fin connaisseur de la poésie contemporaine, à laquelle une large pace est donnée (le 1/3 de la livraison), avec des poètes reconnus — de Marie-Claire Bancquart, Charles Dobzynsky à Jean-Pierre Verheggen —, d'autres beaucoup moins. Une large place est réservée à la poésie d'autres langues : Erich Fried pour l'allemand, Diane Glacy pour l'anglais des États-Unis, Rachel pour l'hébreu, David Rosenman-Taub pour l'espagnol du Chili ; les traductions, de qualité, sont toujours précédées du texte original, ce que ne font guère la plupart des revues.
Plusieurs rubriques prolongent ces deux ensembles. Dans cette livraison, Michel Collot, dont on connaît les travaux sur la poésie, donne des pistes pour s'y retrouver dans "le paysage brouillé de la poésie française contemporaine" ; d'une manière fort différente, Lionel Ray éclaire lui aussi dans un entretien la situation de la poésie vivante, tout comme le font les réflexions sur la question du sens de Jean-Claude Pinson.
Il faut ajouter "Contrepoins" avec les picto-clichés de Roxane Maurer et leur lecture, "Vis-à-vis" où un poème (de Claude Ber) est commenté, et des notes de lecture qui ne privilégient pas des ouvrages récents mais s'apparentent, un peu trop, plus à de mini monographies qu'à des notes. La revue (372 pages) est éditée sur un beau papier, avec une mise en pages aérée, une typographie bien lisible, et son prix (15 €) est modique. Longue vie à cette Place de la Sorbonne !
© Tristan Hordé
© Nathalie Riera, avril 2012
21:48 Publié dans Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
28/02/2012
Peter Huchel, Jours comptés (une lecture de Tristan Hordé)
Une lecture de
Tristan Hordé
Peter Huchel

Jours comptés, [Gezählte Tage]
Edition bilingue
Traduit de l'allemand par Maryse Jacob & Arnaud Villani
Atelier la Feugraie, 2011
 L'Atelier La Feugraie contribue avec son "Domaine étranger" à faire connaître, notamment, la poésie contemporaine de langue allemande peu connue en France, Johannes Bobrowski, Alfred Kolleritsch, Peter Nim, Ernst Meister, Joachim Sartorius, De Peter Hucher (1903-1981), Chaussées chaussées (2009) et Jours comptés (2011) ont été traduits, avec une présentation, par Maryse Jacob et Arnaud Villani : quand on se reporte à l'original en regard du texte français, on comprend combien la restitution est heureuse.
L'Atelier La Feugraie contribue avec son "Domaine étranger" à faire connaître, notamment, la poésie contemporaine de langue allemande peu connue en France, Johannes Bobrowski, Alfred Kolleritsch, Peter Nim, Ernst Meister, Joachim Sartorius, De Peter Hucher (1903-1981), Chaussées chaussées (2009) et Jours comptés (2011) ont été traduits, avec une présentation, par Maryse Jacob et Arnaud Villani : quand on se reporte à l'original en regard du texte français, on comprend combien la restitution est heureuse.
Il est peu de pages, dans les cinq ensembles du livre (le second s'ouvre sur un poème qui donne le titre, "Jours comptés"), sans la présence de la nature, qu'il s'agisse d'animaux ou de ce qui constitue les paysages. Quand on dresse une liste, on compte des animaux domestiques, avec une prédominance du cheval — qui permet de partir —, beaucoup d'oiseaux (merle, corneille, hirondelle, choucas, etc.), des mammifères, des poissons, et même des araignées. Il ne s'agit pas de poésie animalière, chacun est là pour le rôle qui lui est attribué, grues qui vont "ailleurs", merle ou coqs morts, coquillage silencieux, etc. De manière analogue les éléments naturels, comme la végétation, très abondante, s'ils caractérisent une région sont aussi un support pour évoquer des sentiments, des émotions. Ce sont les arbres des régions continentales, plutôt froides, qui prédominent, notamment l'aulne et le saule, arbres de rivières et d'étangs qu'accompagnent joncs et roseaux, brouillard et pluie, nuit et neige avec les « pinces » du gel. Ils occupent beaucoup de place, s'opposant à l'olivier et à son feuillage d'« argent gris » (p. 47) ; à la lumière méridionale répondent le brouillard, la brume et :
les Mères saules du pays wende
les vieilles verruqueuses
à la poitrine béante
au bord des eaux fermées
ces étangs à l'œil sombre (p. 47)
L'opposition n'est pourtant pas au bénéfice des pays du Sud — l'Italie napolitaine, Venise — qui seraient préférés aux régions à l'apparence hostile qui, elles, portent le passé du narrateur ; des "Mères saules" symbolisant le pays entier, Huchel écrit : « leurs pieds s'enfoncent dans la terre / qui est ma mémoire » (p. 47). Quant à la relation à l'Italie, elle est ambiguë ; ce peut être un heureux lieu d'échanges où « les couleurs / [...] rappellent / une conversation » ; mais ici on regarde les « bateaux rouillés », là, à midi, « tout pâlit dans la lumière et la chaleur » (p. 38), et l'on voit alors « l'ocre grossier des murs / la mousse desséchée [...] / la verdure clairsemée », etc. (p. 38). Au delà de la différence ombre - lumière, il y a partout un monde qui se défait, dans le silence et la violence, violence de la guerre qui laisse partout des traces. C'est l'hiver et le froid pour des prisonniers « dans leurs manteaux de drap mince effilochés » (p. 65) — Huchel a été prisonnier en Russie ; c'est l'évocation « des morts dans leurs capotes durcies par le froid », (p. 67), de leur « peau bleuie » (p. 69) ; ce sont les caves grises, les gravats partout, le sombre envahissant, le froid du ghetto de Varsovie, et « nul ne vient » (p. 41). Ce sont les bottes et « la nasse de barbelés » (p. 13) avec la figure d'Ophélie dans le poème d'ouverture du livre ; le récit commencé ailleurs s'achève ici dans la boue, « plus tard, au matin » comme l'indique le premier vers.
Plus largement, la présence quotidienne de la mort s'impose ; c'est le merle mort, la poule d'eau, ou les coqs « tête en bas » que le narrateur refuse d'acheter au marché mais il retrouve un peu plus loin « la dentelure des rochers à crête de coq » (p. 43). Les allusions à l'Ancien Testament — l'égorgement du bélier — ou les souvenirs littéraires peuvent eux aussi se rapporter à la mort, ainsi "La vipère" renvoie à un poème de Pouchkine sur le cheval d'Oleg. Ajoutons la fréquence de mots qui, dans le contexte, connotent la mort, sombre, ombre, nuit, noir, vide, froid — jusqu'au bel oxymore « les ténèbres blanches du ciel » (p. 133).
À ce motif insistant sont liés dans Jours comptés ceux de la perte et de la solitude. Mais l'accent mis sur ces seules thématiques donnerait seulement l'idée d'un univers poétique fort sombre alors qu'un autre aspect pourtant retient : cet univers semble souvent à côté de celui où nous vivons, avec des questions sans réponse (« Qui a installé les ténèbres ? », p. 55), des saltimbanques frères de ceux d'Apollinaire qui laissent un masque accroché à des buissons et disparaissent, des personnages venus de nulle part (« d'un trou de la route », p. 71) qui portent des poissons et des rats morts et partent on ne sait où, un autre s'enfonce dans la terre... Le glissement du réel à l'imaginaire, le mélange entre rêve et mythologie ou faits de l'antiquité, l'évocation des temps de la Syrie ancienne, etc., créent un monde proche du fantastique. Il y a, certes, à vivre la solitude et il faut savoir que l'empreinte que chacun laisse sera vite « comblée par la glace de l'hiver » (p. 57). Cependant, il ne faut pas oublier non plus qu' « au creux glacé des [nos] années », au « bois dur et craquelé de la solitude », s'oppose « dans la pluie tiède d'avril [...] les graines huileuses / des bourgeons [des marronniers] » (p. 135).
Peter Huchel ne dispense évidemment pas de leçon, il dit fermement, dans une langue sans effets, que la nuit peut venir dans toute société, qu'il arrive que « le soleil décline vers les Enfers » (p. 117) et qu'il est nécessaire, comme le cincle plongeur, d'aller chercher ses mots dans les profondeurs, dans l'obscur surtout « quand un souffle glacé / balaie l'aire des mots » (p. 147). Quand on lit dans Jours comptés des poèmes de circonstance (Huchel a aussi vécu dans l'ancienne RDA), les circonstances n'épuisent pas le sens. Le dernier poème du livre, "Le tribunal", revendique sans mots inutiles le droit de penser contre le « droit du plus fort » :
Pas venu au monde
pour vivre sous l'aile du pouvoir
j'optai pour l'innocence du coupable.
© Tristan Hordé, Les carnets d'eucharis, N°32 (Hiver 2012)
■ LITTERATURE DE PARTOUT (Tristan Hordé)
22:33 Publié dans ALLEMAGNE/AUTRICHE, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Peter Huchel, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
16/01/2012
Zbigniew Herbert, Corde de lumière (une lecture de Tristan Hordé)
Zbigniew Herbert Corde de lumière
(Œuvres poétiques complètes I)
- traduites du polonais par Brigitte Gautier, édition bilingue -
Editions Le Bruit du Temps, 2011
LECTURE : Tristan Hordé
Les œuvres de Zbigniew Herbert (1924-1998) — une dizaine de livres de poèmes, des essais — restent peu connues en France(1). Le premier volume des œuvres poétiques (qui en comprendra trois) rassemble Corde de lumière (1956), Hermès, le chien et l'étoile (1957) et Étude de l'objet (1961) ; il est précédé d'une "conversation de l'auteur avec lui-même" autour du thème de l'écriture de poèmes. Parallèlement à cet ensemble, paraît un volume d'essais, Le Labyrinthe au bord de la mer (2000 en polonais, donc posthume), consacré aux voyages du poète en Grèce et en Italie et à ses réflexions sur l'Antiquité ; il sera suivi de deux autres.
On peut commencer l'exploration des poèmes, en vers et en prose, en examinant ce que Zbigniew Herbert rejette. Dans les réponses qu'il propose à ses propres questions, il marque nettement son refus du réalisme socialiste qui ne tient aucun compte de la réalité observable. Il revient sur ce point à plusieurs reprises dans ses poèmes, par prudence sans allusion directe à ce qu'imposait le pouvoir en Pologne mais sans aucune ambiguïté. Un écrivain peut sans doute présenter un monde idéal, décrire les choses quotidiennes en gommant toutes aspérités, et donc ignorer que le réel s'imposera à un moment ou à un autre ; ainsi l'image de la "La chambre meublée" [titre d'un poème] sera, pour ne pas choquer, celle d'un « monde faux » — mais « du papier peint arraché / des meubles non apprivoisés / les taies des glaces sur le mur / voilà l'intérieur réel » (p. 225). De manière analogue, il est inutile de peindre « toute la nuit en rose » les murs gris de la prison : cela n'empêchera pas l'enfermement. Donc, il faut sortir des leçons imposées, quoi qu'il en coûte — et Z. Herbert a payé le pris — et tenter de dire ce qui est en sachant que tous « nous avons des cailloux / noirs à la place des yeux » (p. 75).
Quoi écrire ? « [...] le domaine des choses, le domaine de la nature me semblait être un point de repère, et également un point de départ, permettant de créer une image du monde en accord avec notre expérience » (p. 17). Donner une "image du monde" en choisissant pour point de départ un tabouret, des chaises ou une table, c'est aller contre toute idéalisation de la réalité et, en même temps, affirmer que « nous sommes réels » (p. 113). Cette attention à ce qui passe inaperçu peut aussi être la base d'une critique d'une certaine poésie ; dans un portrait de la poule (bien différent de celui de Jules Renard dans ses Histoires naturelles), il retient la rupture entre elle et les autres oiseaux, comportement né de la vie avec les hommes, et notamment « cette parodie de chant, ces supplications brisées pour une chose incroyablement ridicule : un œuf souillé, blanc, rond. // La poule rappelle certains poètes. » (p. 343) Décrire ces choses sans relief, qui conduisent à séparer « la chose de l'apparence » (p. 167), ne signifie pas pour Zbigniew Herbert qu'il faudrait seulement s'attacher à un réel "nu" ; bien des poèmes, surtout ceux en prose, débordent ce cadre et construisent un univers de fantaisie, parfois de non-sens : ainsi, le chat « arrache les oiseaux des arbres avant qu'ils soient mûrs » (p. 321), l'ours refuse d'aller à l'école, etc. La poésie est comme le coquillage vide qui « raconte / les mers évaporées dans le sable » (p. 421)
Pour ce qui est du "domaine de la nature", il apparaît de manière récurrente sous une forme élémentaire : l'eau, la terre, le feu, l'air, puis les fleurs (seule la rose est citée, abondamment), les arbres (« un tronc de bouleau comme une corde de lumière », p. 85), les oiseaux, auxquels le Poète est associé :
que serait le monde
s'il n'était plein
de l'incessant va-et-vient du poète
parmi les pierres et les oiseaux
(p. 197)
Ce monde naturel se caractérise par le fait qu'il donne sans détour ce qu'il est. On pourrait reconnaître une forme de panthéisme dans la poésie de Zbigniew Herbert qui, l'une des rares fois où il s'adresse à un lecteur, écrit : « sans attendre de meilleure récompense / assieds-toi sous l'arbre » (p. 85). Et c'est à partir des éléments naturels que le poète peut décrire le monde des choses : « il me faut regarder les toits comme la pleine mer » (p. 219), écrit-il.
L'univers de Zbigniew Herbet est plus complexe ; y est intégré une relation active à la tradition, qu'il s'agisse de l'Antiquité — des poèmes ont pour thème Athéna, Marc-Aurèle, Néfertiti, Jonas, etc. — ou plus largement du passé. Les références ne doivent rien à une quelconque nostalgie, l'Antiquité est toujours une source vivante et, à l'occasion, se révèle un instrument critique ; si Arion, ce cheval doué de la parole, chante l'harmonie, le paradis perdu (« tout est aussi bon / qu'au commencement », p. 147), ce n'est cependant qu'un chant..., et il s'éloigne sur la mer, « seul » (p. 149). Et de la statue d'Apollon appréciée dans la jeunesse, « il ne reste qu'un socle vide » (p. 49). Quant au passé, il est doublement important : opposé aux "lendemains qui chantent" du pouvoir, c'est aussi un appui pour comprendre ce qui est vécu aujourd'hui — « la poésie est fille de mémoire / elle veille les corps dans le désert » (p. 273).
On lira, insistante dès le premier livre, une volonté d'être lisible, d'écrire sans détour — « je donnerai toutes les métaphores / pour une expression / comme une côte écalée de ma poitrine / pour un mot / qui rentre / dans les limites de ma peau » (p. 169). Une poésie donc qui s'en tient à un vocabulaire commun, à une syntaxe sans recherche, qui privilégie l'énumération plutôt que l'image : l'essentiel, toujours, est de parvenir à « décrire la simple émotion » (p. 169), de la susciter chez le lecteur non pour rejeter la réflexion mais pour qu'elle ne soit pas première. Dans un poème de circonstance, "Aux Hongrois", écrit au moment de l'insurrection en 1956 contre le pouvoir communiste, les quatre brefs quatrains ne visent pas à décrire ce qui se passait, plutôt à exprimer « d'une manière aussi pure et transparente que possible » (p. 16) la solidarité avec ceux qui luttaient pour des valeurs. Cela est peu ? C'est que les mots du poète n'ont pas le pouvoir de changer quoi que ce soit, ni d'expliquer le monde. Dans une parabole, le "Poète" relate que « deux ou trois / fois / [il a] été sûr / de toucher au fond des choses / de savoir » (p. 475) ; sa recherche a été interrompue par une intervention extérieure mais, quand il l'a reprise, il a atteint son but et a pu enfin contempler « le cœur des choses // une étoile morte // une goutte noire d'infini » (p. 477).
Alors ? Il y a sans doute dans l'affirmation de l'absence de pouvoir de la poésie un refus de l'aveuglement de ceux qui écrivaient pour vanter « le royaume de l'avenir », pour faire croire que le « paradis sera prêt / à la fin de la lutte des classes » (p. 277). C'est en même temps dire que les poèmes, comme le reste des créations humaines, disparaîtront dans l'oubli. Dans la série des éléments de la nature, le dernier cité par Zbigniew Herbert est l'herbe : « l'herbe qui survient lorsque l'histoire s'accomplit / et qui est un chapitre du silence » (p. 117). On relèvera ici la rencontre avec un poète fort différent, Jude Stéfan, qui évoque dans les Suites slaves « l'oubli des herbes » (André Dimanche, 1983, p. 81).
(Les carnets d’eucharis, Tristan Hordé, janvier 2012)
1 Trois recueils, tous épuisés, ont été traduits : Monsieur Cogito et autres poèmes (Fayard, 1990), Redresse-toi et va (Orphée/La Différence, 1995) et Élégie pour le départ suivi de Rovigo (Le Passeur, 2000). Deux essais sont disponibles, Un barbare dans le jardin (Le Rocher, 2000) et Nature morte avec bride et mors (Calmann-Lévy, 2003).
20:37 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, POLOGNE, Tristan Hordé, Zbigniew Herbert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
09/12/2011
Jude Stéfan, Ménippées (P(r)o(so)ésies)
Lecture Tristan Hordé
Jude Stéfan, Ménippées (P(r)o(so)ésies)
Editions Argol, 2011
■■■Le titre et le sous-titre apparaissent, comme la plupart du temps chez Jude Stéfan comme un programme. Ménippées ne s’inscrit pas dans la tradition de la Staire Ménippée, texte essentiellement satirique, mais, ce que suggère le pluriel, évoque sans doute possible les Ménippées de Varron, c’est-à-dire des écrits qui mêlent vers et proses et abordent tous les sujets sans établir de hiérarchie entre eux, passant de remarques sur la vie quotidienne à des considérations sur la philosophie ou la littérature. C’est bien de cela qu’il s’agit dans les cinq ensembles, datés de 2006 à 2010 du livre de Stéfan ; s’y succèdent les fragments d’un journal, des "litanies du Muséomane" (parallèles aux Litanies d’un scribe), des ajouts à Pandectes (Pandectes (ou le neveu de Bayle), 2008), la traduction d’un poème de Rubén Darío, des poèmes, des remarques sur la littérature, d’autres sur une lecture, des propos entendus au café, des citations (parfois non traduites), des idées de titres, des notations de rêves, des jeux phoniques à partir du grec et du latin ; etc. Le sous-titre, P(r)o(so)ésies, qui, littéralement, ne peut être lu, dit autrement le refus de distinguer entre des genres, de séparer prose et vers. C’est là une constante dans l’œuvre de Stéfan, affirmée dès le premier livre (Cyprès (poèmes de prose), 1968) et régulièrement répétée dans les textes critiques, dans des titres, par exemple La Muse Province (ou 76 proses en poèmes), et dans les poèmes : le sous-titre apparaît dans Épodes (1999), ouvrant le premier ensemble, "Des vers" :
78 : Arthur affiché sur les portes d'acier
aux Transformateurs
la poésie en la prose
la poésie en le PO M
ou la prose en prosoésies les
proêmes en prosies proésies
le poèmenprose en la prosenpoème
[etc. ; p. 11]
La radicalité de ce choix déconcerte certains lecteurs pour qui les genres existent toujours, partage ancré par les habitudes de lecture scolaire figées. Si la plupart des lecteurs admet qu’un coucher de soleil ou une déclaration d’amour ne sont pas "poétiques" par nature ( ?), il faut encore redire que la poésie ne se définit pas plus par la présence du vers — le passage à la ligne — que par le sens dénoté : « En lisant Zanzotto (Phosphènes) ; enfin des textes dépourvus de sens, du sens appris de lecture scolaire ou conformiste, enfin pouvoir lire les mots tels quels en leur indépendance syntaxique. » (p. 80) Le sens n’est pas absent, certes, ou l’émotion, la présence du sujet, mais rien du « ça veut dire », ni dans Zanzotto ni dans des œuvres en cours fort différentes comme celles de Philippe Beck, Caroline Sagot-Duvauroux ou Jean-Louis Giovannoni.
Dans Ménippées, les lignes de force de l’œuvre sont bien présentes si l’on met en valeur celles qui organisent presque tous les livres : l’amour, le temps, la mort. Non pour classer des éléments du texte mais, ici et là, sous diverses formes. Ainsi le motif du temps clôt le premier ensemble daté (I, 2006) avec l’évocation d’une maison dont les éléments progressivement se défont, allant vers la ruine
Anti-poème
à l’arrière-cour
fenêtre murée
verrous, gouttières, auvents
barreaux, grille rouillée
rideaux pendants
en muet abandon
tenons et chenil
dans une aire sans accent
que des cadenas
Ainsi le motif de la mort se lit dans un rappel des noms perdus ou dans la proposition d’un récit où reviendrait à intervalles réguliers la phrase : « X… est mort ». Quant au motif de l’amour, c’est un solide fil conducteur, au début du livre avec le souvenir d’un film d’amour « bouleversant », ensuite avec le récit d’anecdotes — un adieu dans une gare —, la notation d’un « cri de Fille », de conseils pour séduire une femme, d’affirmations lapidaires (« Amour. Le moins aimé souffre le plus ») ou, pour conclure un rêve, avec une équivalence, « L’amour : inquiétude/apaisement ».
Le lecteur retrouve les formules qui se veulent sans réplique (« Il n’est de plaisir pur que dans l’égoïsme »), les remarques sur la difficulté à vivre la solitude et, nombreuses, les assertions provocatrices : à l’ouverture de Ménippées, la lumière et la naissance (la venue au jour) sont associées à la défécation (la disparition) : « Confession d’Optimiste. Il s’avèrera moins lugubre d’allumer, dans les lieux d’aisances, afin d’honorer ce rite quotidien, en remerciant d’être né. ». À la page suivante, c’est l’art d’être grand-père qui est parodié : « Lorsque l’enfant paraît traînant son pot [etc.] » ; ajoutons un éloge du port de la burka et de la masturbation en public (puisqu’elle est « naturelle »…), et le rejet de Mozart, Beethoven et quelques autres, seulement capables de « flatter l’oreille », « art mélodique […] qui longtemps retarda la Musique ».
Ce regard peu amène sur ses contemporains et leurs choix n’est pas nouveau mais, parallèlement, Stéfan considère avec peu de complaisance son personnage. Le commentaire de l’exposition qui lui était consacrée en 2010 — « Une vie d’ombre, une œuvre de non-vie » — est symboliquement noté le 1/7, jour de la naissance de qui signe de ce nom ; le thème de la "non-vie", comme celui du "vide", est récurrent dans l'œuvre. Symboliquement encore, Ménippées s'achève sur une sortie avec une note du 31/12 : « Excipit. Le dégoût d’avoir écrit l’emporte sur le plaisir d’écrire », qui répond au dernier vers de Que ne suis-je Catulle (2010), « Ne Plus Écrire ». ■■■
Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Tristan Hordé
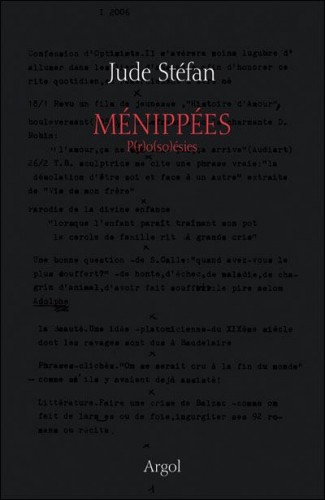
01:36 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Claude Royet-Journoud et Alain Cressan (une lecture de Tristan Hordé)
Lecture Tristan Hordé
TABOURET
Claude Royet-Journoud et Alain Cressan
Editions Lnk, 2011
■■■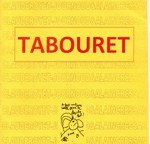 Il faudrait un jour écrire l'histoire de ces éditeurs qui, depuis des années, travaillent en marge, diffusant leurs livres vaille que vaille, grâce au bouche à oreille, sans souci premier d'être "rentables". Pascal Quignard a évoqué, dans une lettre à Bénédicte Gorillot qui ouvre Inter (Argol, 2010) comment Emmanuel Hocquard, l'hiver 1978, tirait « à la main sur la presse d'Orange Export Ltd » ses livres, « dans l'atelier de Raquel, à Malakoff, sur un plancher de bois exhaussé, le chien hurlant de ne pouvoir monter les échelons ». Quelques passionnés, sans beaucoup plus de moyens, poursuivent cette tâche patiente, obscure, donnant à lire quelques titres chaque année — je cite, au hasard des livres sur la table, L'arrière-pays (Josette Ségura et Éric Dazzan), Poliphile (François Lallier et Géraldine Toutain), Ficelles (Vincent Rougier), Contrat Main (Pascal Poyet et Françoise Goria).
Il faudrait un jour écrire l'histoire de ces éditeurs qui, depuis des années, travaillent en marge, diffusant leurs livres vaille que vaille, grâce au bouche à oreille, sans souci premier d'être "rentables". Pascal Quignard a évoqué, dans une lettre à Bénédicte Gorillot qui ouvre Inter (Argol, 2010) comment Emmanuel Hocquard, l'hiver 1978, tirait « à la main sur la presse d'Orange Export Ltd » ses livres, « dans l'atelier de Raquel, à Malakoff, sur un plancher de bois exhaussé, le chien hurlant de ne pouvoir monter les échelons ». Quelques passionnés, sans beaucoup plus de moyens, poursuivent cette tâche patiente, obscure, donnant à lire quelques titres chaque année — je cite, au hasard des livres sur la table, L'arrière-pays (Josette Ségura et Éric Dazzan), Poliphile (François Lallier et Géraldine Toutain), Ficelles (Vincent Rougier), Contrat Main (Pascal Poyet et Françoise Goria).
Je n'oublie pas les livres fabriqués "à la maison" avec un ordinateur, un scanner et une imprimante, mais qui n'entrent pas dans le circuit commercial ; les textes sont publiés autour d'une centaine d'exemplaires et distribués à des amis. Ce type d'édition, confidentiel, propose poèmes et dessins que leur éditeur, ici Alain Cressan, a sollicités auprès d'écrivains et d'artistes qu'il apprécie, sans souci de la notoriété des uns et des autres — pas seulement français : la part des travaux venus des États-Unis est importante (Peter Gizzi, Rosmarie Waldrop, Jill Magi, etc.). L'un des deniers titres, Tabouret, donne à voir des "peintures numériques" de Claude Royet-Journoud accompagnées en légende d'un récit d'Alain Cressan. La première page pose deux éléments à partir desquels se construit l'histoire : un personnage, Igor, et un tabouret, liés par une phrase écrite avec maladresse (comme celle d'un enfant qui apprend ses lettres)1, « Igor dessine son tabouret et il se couche tout content » ; le récit double partiellement ce dispositif : « Igor pense à un tabouret. Le dessine. Dort. Action faite. »
Seront introduits au fil des pages des éléments variés ; quelques-uns appartiennent à la vie d'aujourd'hui (le plan d'un appartement et ses W.C., un écran de cinéma, une porte où s'inscrit "DRH" quand « Igor cherche un travail »), certains sont rêvés ( une plante dans un pot, un âne), d'autres évoquent le loisir ou la sortie dans l'imaginaire (un livre, une bibliothèque, la mer, des bateaux, la nuit). Igor, absent une seule fois (remplacé par le plan de son appartement), devient double ou sextuple, une autre fois quatre Igor « regardent les bateaux », plus loin trois « observent le ciel ». De manière analogue, les tabourets se multiplient — il suffit de les dessiner —, et les livres, et le récit se développe à partir de jeux sur les nombres et de la répétition de l'absence (motifs privilégiés de conte) : c'est un tabouret, ou un livre, qui a disparu, c'est une tête perdue, une plante rêvée, une hypothétique « île aux tabourets » qu'il faut chercher, et même le travail manque.
 Le personnage d'Igor, malléable, change sans cesse de vêtements : pantalon jaune rayé, bleu, rose, rouge, grenat, gris, blanc, jaune, et le fond de l'image varie en même temps. Les dessins se veulent naïfs pour la mise en scène de cette figure toujours souriante, d'une naïveté très contrôlée cependant : Igor, pour une fois sur une chaise, lit de la poésie..., et sur la dernière image abandonne le tabouret pour un fauteuil ; c'est qu'alors, comme "l'Étranger" de Baudelaire (« J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages ! »), il « observe les formes des nuages à travers les fenêtres, voit des formes d'idées. Quelles idées ? » Oui, quelles idées dans ces insaisissables mouvements ? ■■■
Le personnage d'Igor, malléable, change sans cesse de vêtements : pantalon jaune rayé, bleu, rose, rouge, grenat, gris, blanc, jaune, et le fond de l'image varie en même temps. Les dessins se veulent naïfs pour la mise en scène de cette figure toujours souriante, d'une naïveté très contrôlée cependant : Igor, pour une fois sur une chaise, lit de la poésie..., et sur la dernière image abandonne le tabouret pour un fauteuil ; c'est qu'alors, comme "l'Étranger" de Baudelaire (« J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages ! »), il « observe les formes des nuages à travers les fenêtres, voit des formes d'idées. Quelles idées ? » Oui, quelles idées dans ces insaisissables mouvements ? ■■■
Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Tristan Hordé
01:14 Publié dans Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
17/11/2011
François Lallier, Vita Poetica (par Tristan Hordé)
Une lecture de Tristan Hordé
FRANCOIS LALLIER
Vita Poetica

L’Arbre à Paroles, Amay (Belgique), 2010
On sait qu’en France l’enseignement des langues classiques se réduit chaque année, considéré comme peu rentable, sans utilité dans une société où l’argent et les biens qu’il procure sont devenus les "valeurs" dominantes.1 Il existe encore, bien heureusement, des amoureux de l’Antiquité pour lire et relire les Grecs et les Latins, et ne pas penser que tout a été écrit à leur propos. François Lallier, poète et lecteur attentif de la poésie contemporaine2 publie avec Vita poetica des analyses neuves des poètes latins de la fin de la République.
Cette plongée dans les temps anciens conduit à mettre au jour un moment où la relation entre l’écrivain et son œuvre se transforme ; changement des plus importants, une séparation entre les deux se construit : « Une biographie […] advient au poète, parce qu’il ne se confond pas avec son chant, mais porte un masque sous lequel apparaît une autre vie que celle que peint le poème » (p. 10). Un peu plus loin : « Dans le clivage des déguisements et de la personne, une « vie poétique » se fait jour, s’opposant à des rôles, des conditions auxquelles toutefois le poète n’est pas soustrait, précisément parce que l’exercice de la poésie n’est pas une condition, un métier moins encore, mais une construction, sinon une fiction, vécue et mise à l’épreuve selon le cours de l’existence commune. » (p. 11) Quelles conséquences ? Cette transformation implique l’élaboration d’un « mythe éthique », celui qui oppose le choix éthique (la vita poetica) du "pur amour" à la violence de la société et qui modifie en profondeur, notamment, le rapport du poète, de la poésie au politique. Ce mythe, on le sait, aura longue vie…
François Lallier analyse minutieusement quelques textes de Virgile, Horace et Catulle pour cerner et préciser son propos. Ce qui retient dans ces lectures, c’est la relation essentielle établie entre la recherche d’une fonction de la poésie et les événements que vivent les trois poètes. Pour eux, la poésie ne peut (ne peut plus) se définir par la seule écriture en vers ; certes, la perfection de la métrique est nécessaire et il suffit d’évoquer leur virtuosité pour en être convaincu, mais le poème ne peut se limiter à cela. En même temps, c’est la thématique de l’épopée qui est abandonnée ; Horace, par exemple, affirme son incompétence à manier le style épique pour vanter la politique d’Auguste, alors même qu’il prouve une éblouissante maîtrise du vers. C’est que le poète se refuse à mettre la tête dans le sable et à accepter la violence sociale, les injustices, la vilenie des ambitions, à faire comme si la « voix du monde » n’était qu’harmonie.
L’éloignement de l’épique, sa mise à l’écart même, par la réflexion sur les choses du monde, conduit parallèlement à construire une autre poésie qui deviendra une source majeure pour l’Occident. François Lallier suit des moments de cette élaboration et montre comment une poésie amoureuse se substitue au genre épique, comment l’exaltation du sentiment amoureux, de la passion humaine s’oppose à la Fable. Il ne s’agit évidemment pas d’un simple changement thématique. François Lallier dégage dans Virgile l’importance de la « musicalité intérieure aux mots » (p. 45). Le même soin est apporté dans l’étude des Noces de Thétis et de Pélée ; Catulle y laisse de côté la continuité narrative propre à l’épopée et adopte une composition toute différente en faisant se succéder des tableaux, modification lisible en particulier dans la description du voile nuptial. En même temps, ce qui importe, c’est la recherche d’une « émotion de la forme » (p. 72), qui naît d’un travail sur le matériau sonore. À propos de la danse des Ménades, l’analyse attentive de quelques vers fait apparaître comment le jeu des sons, le rythme visent à "peindre" la scène, à en restituer le mouvement, et à imiter par la langue quelque chose de l’accompagnement musical. Ce qui se dessine et se décide, c’est « une idée de la poésie dont on retrouvera sans peine, sous le thème mythologique, les grands axes que sont la centralité de l’amour et la quête tout ensemble ironique et ardente d’un sens au destin de la cité, entre le mystère salvateur et la funeste logique de la puissance. »
Le passage de l’épique à l’élégie, c’est d’une certaine manière l’affirmation que le poète n’est pas (n’est plus) au service d’un pouvoir. Catulle, par exemple, suit d’abord Callimaque de près, mais Les Noces de Thétis et de Pélée se concluent par une critique forte qui place le lecteur « au cœur du temps et du lieu où l’auteur écrit » (p. 76). Le monde de Catulle n’a plus ses dieux, sinon dans la Fable, et la poésie aura pour fonction première de « rendre à la visibilité [le] mystère de l’amour » (p. 76).
Je n’ai retenu de cette lecture savante, qui est aussi celle d’un poète, que quelques conclusions. Ponctuée d’extraits en latin traduits, suivie de traductions, elle conduit à reprendre avec un autre regard les œuvres des Latins — mais pas seulement : elle incite à réfléchir sur la tradition de la thématique de l’amour. Précisons que Vita poetica est le premier ensemble d’un vaste livre qui comprendra les chapitres suivants : Ut pictura, La vie divine, Les amours, L’horreur épique.
© Tristan Hordé, Carnets d’eucharis n°30 (sept/oct 2011)

François Lallier, Vita Poetica
L’Arbre à Paroles, Amay (Belgique), 2010
■ LE SITE DE FRANCOIS LALLIER :http://www.francoislallier.com/
1 Un rappel : "classique" reprend le latin classicus, « de première classe », appliqué aux citoyens, puis classici [sciptores] a désigné les écrivains de première valeur…
2 Je renvoie à La Voix antérieure II (Jouve, Jourdan, Michaux, Frénaud, Munier), 2010, La Lettre Volée, et à La Semence du feu, 2003, L’Atelier la Feugraie. F. Lallier a organisé le volume collectif Avec Yves Bonnefoy, De la poésie (P. U. de Vincennes, 2000) et co-dirigé le Cahier Roger Munier paru au Temps qu’il fait (2011) ; avec Géraldine Toutain, il a fondé en 2004, à Dijon, les éditions Poliphile (www.editions-poliphile.fr).
22:26 Publié dans François Lallier, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
13/07/2011
Sereine Berlottier, "Attente, partition" (une lecture de Tristan Hordé)
ATTENTE, PARTITION – Sereine Berlottier
(éditions Argol, 2011)
(Editions
Une lecture de Tristan Hordé
Le poème récit qu’est Attente, partition a adopté la forme du journal, propice pour noter les mouvements intimes. Genre qui permet également au récit de s’insérer dans un ensemble : ici, un nouveau carnet est commencé, dont la narratrice précise les dimensions (14 sur 9), et placé dans une série, manière de dire que ce qui est à écrire — les jours de la vie — est inachevable ; le dernier vers sans ponctuation finale (« et qui est une main levée ») laisse explicitement suspendu le récit.
Comme c’est souvent le cas, le journal ne mentionne pas les années : 2 avril, 8 avril, etc. (1). Deux dates précises seulement apparaissent, mais à l’intérieur d’une notation. La première (« Je crois que c’était le 13 février 2004. / J’ai le souvenir d’une page », p. 102) renvoie à l’ouverture du carnet : « Tu te demandes comment ça commence, ce qui commence au juste pour toi […] » (p. 11) (2), liée à l’écriture dont la nécessité est évoquée à plusieurs moments par la suite, soit en marquant qu’écrire exige un travail continu, peut-être sans fin (« Il faut écrire longtemps pour écrire », p. 45), soit parce qu’écrire n’est pas à dire vrai inventer un récit mais a sa propre fin (« L’illusion d’avoir à écrire une histoire qui serait arrivée alors que l’écriture est tout ce qui peut m’arriver écrivant », p. 146). Le journal n’est pas tenu chaque jour — mais parfois la narratrice le reprend plusieurs fois le même jour — et il peut se passer un long temps entre deux notations : par exemple, rien n’est inscrit entre le 27/4 et le 20/6, entre le 5/7 et le 7/8, etc., et ces lacunes sont d’ailleurs relevées une fois : « 16 août / Ici même le lieu délaissé [= le carnet]. Quand il faudrait nourrir le temps chaque jour. Creuser chaque jour sur la page un geste net comme la tranchée d’une pelle menée sous le pied. (p. 75) »
La seconde mention d’une date précise se rapporte explicitement à ce qui construit aussi le récit, l’enfant à venir : « 15 déc. / L’enfant n’est pas la question du 15 décembre 2005. Seul le livre. Charnel. Givré de secrets. // Le tenir. Ne pas le lâcher quand il sera, oiseau faible, l’habitant de tes paumes nues. » (p. 46) La liaison entre "enfant" et "livre (écriture)", si forte ici, organise d’une certaine manière tout le livre ; non pas qu’un parallèle soit présenté entre l’un et l’autre — on est très loin de la métaphore de l’"accouchement" d’un livre — , les deux motifs existent, chacun évoqué à sa place ou parfois dans la même phrase comme on l’a vu ; citons encore : « dans le ventre du bruit qui n’est pas du langage » (p. 71).
Attente, partition peut s’entendre en effet de deux manières ; "attente" renvoie aussi bien à l’espoir qu’au fait que l’on demeure quelque part jusqu’à ce que quelque chose se produise, et "partition" s’entend au sens de « séparation » (« tenir et pourtant / se quitter », p. 22) et de « composition musicale » ; les différents emplois s’associent, que l’on pense à la part(ur)ition ou au livre, l’attente de l’enfant étant elle-même un récit : « On colle l’oreille à ce ventre / comme si on cherchait pour de bon // si on a mal / on fait comme / si c’était une façon d’avoir une histoire encore. » (p. 99)
Composition musicale, si l’on accepte la métaphore, avec son alternance de très courts récits (« Elle est debout sous la douche [etc.] ») et d’ellipses, de mots comme jetés dont la référence au réel n’est pas ce qui importe (« Tandis que / (Ça bouge.)/ Dessus, dessous. / Son front de miel. / Un cil d’or. », p. 17) ; avec le mouvement subtil des moments de prose-poésie et de vers ; avec le jeu très réglé des pronoms : à côté de "je", un "tu" et un "elle" qui peuvent être aussi la narratrice, également un "on" quand se vit une distance avec soi (p. 127-128). Seul "il" n’est pas ambigu, et l’on note l’écart entre le "je" et le "il" dans l’attente quand la diariste n’emploie pas le possessif attendu ("son visage, le mien"), mais le pronom personnel : « Quelque chose est dans le silence entre le visage de lui et de soi » (p. 61). On peut encore ajouter les récits récurrents des rêves de chute, la relation à la série des Alien, le retour des motifs de la perte, de la disparition, de la déception, de la solitude aussi (« On est sans force et seule au milieu de la nuit, comme quelqu’un dont la maison brûle et dont le troupeau a fui sans retour », p. 63).
Attente, partition… On a peu dit de ce récit complexe (mais la lecture est-elle achevable ?) qui travaille sans cesse le dedans-le dehors du corps, les mouvements de retournement y compris dans la langue avec, par exemple, l’anagramme « du sien au sein » — et le très beau motif de l’attente(3) :
9 février
l’attente — et si
l’attente ne meurt pas
et qu’il faille
l’ensevelir de force
vivante
son cri dans loin
ne pas se préparer
ne pas consentir
À lire et relire…
Tristan Hordé
Les carnets d'eucharis
Juillet 2011
1 Une seule fois mention est faite du jour de la semaine : « Dans le soir du vendredi 1er juin » (p. 136) — il s’agit donc de l’année 2007 si l’on se reporte aux autres indications.
2 On pourrait rapprocher ce début de L’innommable de Samuel Beckett où, par une série de questions, est amorcée la question du récit : « Où maintenant ? Quand maintenant ? Qui maintenant ? sans me le demander. Dire je. […] » Quant à la dernière phrase, elle annonce que l’écriture ne peut être interrompue : « […] il faut continuer, je vais continuer. »
23:38 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sereine Berlottier, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
16/06/2011
Hilde Domin (sur le site Littérature de partout proposé par Tristan Hordé)

Jamais encore, semble-t-il, la réalité n’a été aussi perfide que celle qui nous entoure aujourd’hui. Elle menace de détruire la réciprocité entre elle et nous, elle menace, d’une manière ou d’une autre, de nous anéantir. C’est le danger le plus subtil qui semble presque le plus inquiétant : il existe sans exister. Tout le monde en parle. Personne ne le rapporte à soi. Ce danger s’appelle la « chosification », c’est notre métamorphose en une chose, en un objet manipulable : la perte de nous-mêmes.
La poésie peut-elle encore nous aider à affronter une telle réalité ?
[…]
Hilde Domin (1909-2006), "À quoi bon la poésie aujourd’hui", Lire la suite sur le site LITTERATURE DE PARTOUT(Tristan Hordé)
23:00 Publié dans Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
26/05/2011
Fabienne Raphoz, Jeux d’oiseaux dans un ciel vide augures (éditions Héros-Limite, 2011)
NOTE DE LECTURE
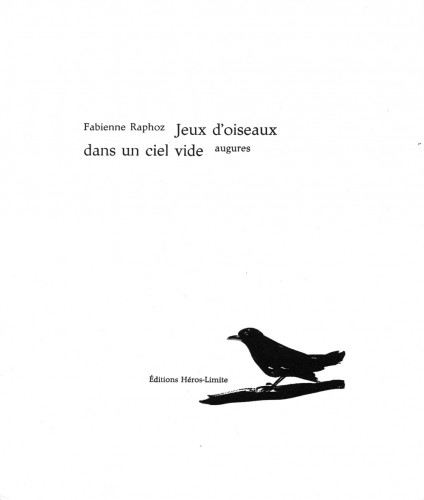
par Tristan Hordé
Voici un livre singulier, écrit par une passionnée des oiseaux (1), s’ouvrant sur une page explicative titrée "Quelques précisions — peut-être" qui, bien qu’elle introduise les distinctions d’ordre, famille et espèce, n’est pas la présentation d’un livre d’ornithologie. Le lecteur apprendra sans doute à propos des formes, couleurs, habitat, etc., des oiseaux, mais le propos n’est pas scientifique. Ou, si l’on préfère, puisqu’il s’agit d’un livre de poésie, la poésie travaille ici des matériaux divers ; des ouvrages savants est tiré et réécrit le fond du livre (les augures, à gauche), s’y ajoutent des fragments de dits traditionnels, de livres de voyage, etc. également recomposés, des citations, le tout lié par les notions venues de la classification du vivant. Enfin, s’introduisent dans cet ensemble des textes de Fabienne Raphoz, de dimensions très variables — quelques vers, quatre pages —, souvent datés et avec une indication de lieu, textes qui marquent une distance entre la poésie et la connaissance, distance qui semble presque effacée dans le plus gros du livre : la première page ne porte-t-elle pas en exergue une citation du paléontologue George Gaylord Simpson, « La taxinomie, qui est la mise en ordre par excellence, possède une éminente valeur esthétique » ?
Aux "jeux d’oiseaux dans un ciel vide" (le ciel de la page ?) répondent ceux d’oiseaux qui l’emplissent :
« Comment remplir le ciel ?
ne jamais se poser
le bleu fantôme les écrit partout » (p. 111)
"les" désigne les martinets, dont le nom apparaît en anglais (Swift) dans le titre, "Swiftizzall"(= « Swift is all »). En poursuivant l’image ciel / page, on pourrait dire que le livre est une immense volière, sans dimensions définies, susceptible de réunir tous les oiseaux, y compris ceux qui sont en danger de disparaître et ceux que les hommes ont exterminés, comme cela est mentionné systématiquement (par exemple : Le Pluvier roux le Pluvier de Sainte-Hélène sont en danger / Le Vanneau hirondelle est éteint (p. 71)), les oiseaux, comme la plus grande partie des êtres vivants, étant dans nos sociétés des marchandises : « Vingt millions de perroquets sont en captivité. / Plus l’espèce est en danger, plus sa cote est élevée. » (p. 90). Tous les oiseaux réunis : ceux de la préhistoire et ceux rencontrés au Crest, à Paris, au Costa Rica, en Savoie, etc., ceux évoqués dans les traditions populaires (Indiens d’Amérique ; hittite : française : Sébillot ; etc.), dessinés par le naturaliste (Audubon), présents dans un poème (Thoreau, Char, Shelley, Emily Dickinson, Du Bartas, Cummings, etc.), ceux liés à un contemporain de Fabienne Raphoz (Claude Adelen, Éric Sautou) ou à une personne proche (« La nonette a fait écrire un beau livre à Caroline », p. 176, « Le Rouge-gorge de Caroline SD s’appelle Blanchot », p. 162 — Caroline Sagot-Duvauroux) . Tous les oiseaux du monde : avant le Livre I, "Uccelli" (2), un poème est constitué par l’écriture du nom « oiseau » dans plus de cent langues. La nécessité qu’il y aurait de les nommer tous dans cette « randonnée en l’honneur de l’oiseau » (p. 207) tient sans doute au fait que les oiseaux symbolisent plus que tout autre vivant le monde naturel — ils sont présents partout, sur terre, dans le ciel — en tant qu’il n’est pas une réalité simple, qu’on ne peut lui assigner de limites :
Le Colibri pampa
porte le ciel au front
la forêt sur le dos
les nuages à la gorge
et
dessine l’infini
25 fois par seconde
(p. 109). Si l’on se souvient que les oiseaux sont l’ancêtre de l’homme, on comprend que leur proximité avec le ciel les transforme, avec un jeu sur la couleur du plumage, en voleurs de feu, qu’ils transmettent à l’homme :
le roitelet a pris le feu du ciel
s’est pris dans ses ailes
au rouge gorge l’a passé
s’est pris dans sa gorge
à l’alouette l’a passé
l’a donné aux hommes
(p. 144)
Les caractérisations des oiseaux sont, comme l’ensemble des noms, en quantité indéfinie ; de chacun est retenu un élément distinctif qui, souvent, n’a rien d’encyclopédique :
« (Trogloditydés)
En Europe nous n’avons que le mignon
Tous les troglodytes sont un peu roux
Tous les troglodytes lèvent la queue en chantant
Tous les troglodytes ne sont pas toujours des troglodytes
Le troglodyte est le roi des haies
Le troglodyte est le roi de l’hiver » (p. 154)
L’usage de l’anaphore, comme celui très régulier du parallélisme des constructions, introduit un rythme et suffit à éloigner (sans l’effacer) le caractère didactique de certains énoncés. Mais la seule énumération de noms construit souvent une série sonore séduisante et étrange : « Éroesses couturières dromoïques bathmocerques camaroptères éminies apâlis prinias sont des cisticoles qui l’eût cru ? » (p. 169). La question « qui l’eût cru ? » marque une distance et introduit l’énonciateur dans le texte. Sa présence se manifeste à d’autres endroits de manière variée, par exemple par l’allusion à l’activité d’éditeur de Fabienne Raphoz et Bertrand Fillaudeau : le vers « Troglodyte est le nom d’un personnage de La Route fantôme », (p. 154) évoque un livre de Frédéric Cosmeur édité en 2007 aux éditions José Corti ; le renvoi est aussi transparent dans « Le Cincle d’Amérique est très aimé de John Muir et de ses éditeurs français » (p. 148). Ailleurs, la trace du « je » est visible par la marque verbale : « Le Pipit maritime est le moineau domestique de Penn Arlan Ouessant (et d’autres îles mais n’y étais pas) ».
Enfin, un long poème, "Au merle de mon jardin", en même temps qu’il réunit une partie de ce qui est vivant (oiseaux, bien sûr, et autres animaux, et plantes — image d’un éden : « Paradise indeed in the hidden garden », p. 188, dans un autre poème), exprime la relation du "je" aux oiseaux (« un jour le merle de mon jardin comme le Merle de Grand Caïman éteint je le chialerai », p. 160) et précise la place du sujet dans ce monde foisonnant : « le merle de mon jardin n’est sûrement pas mon merle, comme mon jardin n’est finalement pas mon jardin » (p. 160). On retrouvera la fonction particulière du merle et de ce jardin dans le livre : pour ne retenir qu’un passage, « Puisqu’il faut bien mourir alors mourir sue le chant du Sirli du désert […] sur le chant du Rossignol Philomèle (ou sur le chant du merle de mon jardin) » (p.144 ; voir aussi p. 70).
Tous les oiseaux du monde, ai-je écrit ; toutes les variations aussi les couleurs, mais l’une seule peut être retenue, jeu de l’anaphore et du parallélisme de la construction qui rapproche de la litanie :
Le bleu de la tête du Motmot à tête bleue
est plus bleu que le bleu de Fra Angelico
Le bleu de la tête du Motmot à tête bleue
est plus bleu que tous les bleus de terre
Le bleu de la tête du Motmot à tête bleue
est l’expression du bleu dans la densité du vert
Le bleu de la tête du Motmot à tête bleue
est l’expression du bleu entre ciel et terre
Le bleu de la tête du Motmot à tête bleue
Le bleu de la tête
Le bleu
(p. 116). Les langues sont parfois mêlées, traduisant la variété des lieux, mais se construit ainsi une langue très particulière. Des désignations sont simplement juxtaposées : « L’engoulevent est un Tête-Chèvre un Succiacapre un Chotacabras a Goatsucker ein Ziegenmelker », ou des éléments de langue différentes constituent le poème : « […] la cellule dans la vase bouillonnante // all over again ? // .. // .. // .. // vielleicht » (p. 107 ; les // figurent un espace double). Fabienne Raphoz revendique « un rapport passionnel avec l’anglais » (p. 160) et ses deux poèmes écrits en anglais le prouvent. On lit dans ce goût de juxtaposer des langues le même plaisir à associer les mots, mots qu’elle n’hésite pas à créer quand besoin est : « Les souimangas colibrient l’Afrique » (p. 178), « Le véloce se maghrèbe en hiver / Le fitis subsahère son moteur sur le point de caler / Les pouillots vélocent le bord de l’Arve […]» p. 172), « grecquerait guerre » (206), « effontièrent la limite » (p. 146), etc. Ou à reprendre des termes régionaux : « Le Canard souchet est un bec en cuillère un louchard un barbelle une cuillerasse une goule large un rouge de rivière » (p. 43). Trouble du lecteur : ignorant tous les noms d’oiseaux, il ne sait plus si un mot est une unité de sa langue (La sitelle truffle) ou une création (verdiens pirsons).
Henri Pichette et, d’une façon différente, Jacques Demarcq (3), ont récréé (onomatopées ou verbes) les chants de quelques oiseaux. Fabienne Raphoz, qui suit cette voie ici et là (« Chi ! riou ! Chiou ! c’est moi qui suis le roi, / dit parfois le troglo à dos d’aigle au roitelet », p. 154), sait comme ses prédécesseurs l’impossibilité de la transcription, mais elle propose un "poème de lettres", qu’on peut lire pour les bruits des oiseaux en vol :
snn ! snn ! cnsnn !
!
n jr ps l’tmps
d slr L verdr
:
fffftttttttzzzzzzz
fffftttttttzzzzzzz
llw wngs
etc., (p. 197). Que l’on puisse dans cette suite recomposer des mots (temps, wings, etc.) conduit à signaler l’extrême richesse de la mise en pages : emploi de différents corps, jeu de l’italique et du romain, fer à gauche-fer à droite, emploi de colonnes, fragments suscrits, et dispositions complexes sur la page. Rien de calligraphique dans tout cela qui dessinerait une figure de l’oiseau, mais recherche de rythmes, volonté de proposer une lecture des mots et des blancs, dans la lignée par exemple (mais différemment) de Reverdy et du Bouchet.
On n’a fait ici que retenir des bribes de ce Jeux d’oiseaux…, il faut le lire et relire comme tout vrai livre de poèmes. Terminons avec le dernier poème titré "L’oiseau bleau" (mot-valise : beau + bleu ; et/ou bleu + allemand blau, « bleu »), qui réunit création verbale (création amusée), répétition (« bleu ») et énumération jusqu’au vertige :
Dans les deux livres [Uccelli et Uccellini] l’invisible est randonnée
dans la coda impossibleu n’est contoiseau
L’aigrette bleue le Lori nonette le Lori ultramarin le Ara hyacinthe le Ara de Lear le Ara glauque le Ara de Spix le Ara bleu le Touraco géant le Coua bleu le Martin-chasseur à longs brins le Martin-chasseur de Kofiau le Martin-chasseur de Biak le Martin-chasseur à poitrine bleue le Martin-chasseur bleu noir le Martin-chasseur des Moluques le Martin-chasseur Iazuli
(etc)
1 Fabienne Raphoz, qui dirige avec Bertrand Fillaudeau les éditions José Corti, a publié en 2009 L’aile bleue des contes : l’oiseau, Anthologie suivie de « l’oiseau-monde : une omniprésence » (2009), recueil de contes dans la collection "Merveilleux" qu’elle a créée.
22:44 Publié dans Fabienne Raphoz, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook

































































