11/02/2024
Jennifer Grousselas, Il nous fallait un chant
Jennifer GROUSSELAS
IL NOUS FALLAIT UN CHANT
[extraits]

■ Jennifer Grousselas
■■■
---------------------------
Extraits
Le Manteau & la Lyre
Obsidiane, 2024
La main droite du prince
Notre pilote sans jambes commence à galoper
la grande table tandis qu’il psalmodie syncopes
d’un iambe qui sonne un temps chaotique
Bientôt nous reconnaissons la langue inouïe au rythme mi-clos, la langue cheval échappé qui de nous ne fut jamais comprise, la langue étrange bouleversée qui de nous ne fut jamais apprise
La voix lance-pierres entrouverte se ferme à notre intelligence, et la parole imprévisible au sens convulsif aux rênes qui ne se laissent saisir
Toute tonnante toute flamboyante la langue dénouée à elle-même rendue qui digère par hoquets mystiques ses anciens iambes
Me perce quelque part et fait
Mes paupières boiteuses, mon regard tressaillir
[p.33]
-------------------------
Jouxtant la mer je sais les montagnes qui se joutent s’ébranlent et qui dansent
Sous mes pieds la caresse de la cendre jouxtant les montagnes de sang de la mer à la chevelure hirsute sanglante
Et sur mon cœur mort sur le soir perdu sur ma vie qui s’achève, se met à remuer comme l’oiseau-nuit
La touffeur me griffant par saccades dans ma gorge la lave mugit révolte sur la vie qui m’achève je sens en moi vengeance monter naissante grandir, tourner gutturale râler-rugir
Et la mer sans mesure où je baignerai mon corps nouveau, la mer dans son bain mouvant m’éclaboussant mer d’écume noire au goût de sang, la mer seule m’offre ses signes reculant ses barrières de sel la mer m’appelle
Révolte sans mesure la mer m’approuve m’ouvrant pour
m’appeler vengeance sans mesure
Œuvrer
Par le bec de l’oiseau-nuit ses serres, par élan de tire-d’aile, au nom des frères de sacrifices à venir, au nom de la boue sur les yeux fermés par le jour abattu, pour la fin du nom qui fut d’abord mien
Par seul amour restant de la mort je ferai œuvre
Et dans l’achèvement du temps qui se signe
Nuit de la nuit véritable
après les derniers mots que je saigne les mots
n’auront plus jamais place
Fin de l’enfance mauve
bleus sombres sur mon âme et neuve violence
[pp.45-46]
-------------------------

■ © Obsidiane
14:51 Publié dans Jennifer Grousselas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
10/02/2024
Maurice Chappaz, Testament du Haut-Rhône (suivi de) Les Maquereaux des cimes blanches
Maurice CHAPPAZ
TESTAMENT DU HAUT-RHÔNE
[extraits]

■ Maurice Chappaz
(1916-2009)
■■■
---------------------------
Extraits
Éditions Zoé (poche), 2016
Avec une préface de Pierre Starobinski
Considérons ces collines, ces grottes aux fées percées d’une multitude d’embouchures noires infimes telles des orbites d’insectes. Avec nos existences dispersées dans plusieurs pays, nos liaisons (le bagage de toutes les familles humaines), les polycéphales que nous sommes pourraient aménager là leur gîte. Pendant des milles, unissant parfois des étangs obscurs, des pertuis nous conduisent vers les plages inférieures. La lampe du mineur éclaire sur les parois le prodigieux alphabet des chasses et des danses de ces bêtes portraiturées dans le style des roses. Mais une nouvelle (une lettre oubliée là par d’autres peuples) nous parvient ; mais une image nous cloue sur le sol. Gravée à des milliers d’années d’intervalle par des mains pareilles à des becs de tourterelles dans l’ombre, au flanc d’une unique roche un renne et un tigre voisinent ; la flore et la faune de l’Equateur s’entremêlent ainsi que des saxifrages avec celles de la Sibérie. Deux âges du monde se sont succédé et nous replacent entre jungle et glacier. Sur le même petit pan de mur le temps s’efface. Un sentiment de mort et de victoire me partage à fixer ce tigre et ce renne pareils à deux voyelles confondues dans la crase des millénaires. La chaîne qui unissait les êtres les uns aux autres se rompit et ils furent remis aux méditations de la nature.
C’est à de grandes destructions que nous sommes conviés. Devant les figures écrites sur les os et les pierres ensevelies, je suppute le sens même du chant et ce but ultime, épique, mystérieux des scribes quand ils doivent tracer les signes telles les mouchetures des œufs, afin de permettre à un pays de passer. Vous, montagnes désertes, vous, bois de mûriers, qu’est-ce donc que vos amères beautés ? Je regarde des hardes de moutons roux, des porcs noirs, des femmes avec des fourrures de plumes de coq et un être fugitif qui surveilles des mulets près d’un marécage. J’écris à tous les hommes une lettre avec cette encre de myrtille qui ne veut pas couler de tout son bleu rougi. Carpe en son vivier, je me promène dans la forêt qui entoure l’abbaye maternelle. J’ai pu croire me suffire à moi-même en recomposant les parfums et les sels de ma substance : je goûtais à un flocon de mousse fraîche et aux baies violentes des buissons ; je choisissais des minéraux ; j’observais la teinte de la rivière et mes oreilles étaient marquées comme d’un stigmate, les nuits d’été, par le cri du grillon ; je mariais une nouvelle fois l’eau et le feu, la terre et l’eau. Mais j’ai touché à un bonheur vénéneux. Le bourdon du lourd clocher de Châble m’enténèbre et mon ombre errante le suit sur la terre comme une ancre. Un goût de cendre et un goût d’absinthe luttent dans ma bouche. Ô dernier baiser de l’Église à notre race. Les doigts des courtiers et des porteurs de férule de trois collèges ont frotté la poussière des ailes du sombre papillon. Jadis pourtant, ma chair avait vu le salut de Dieu. Toute œuvre tombe en déliquescence. Pareilles à des châtaignes, des jeunes filles sont cloîtrées dans ces bourgades où s’est dissimulée autrefois une goutte de sang maure. Nous vivons comme l’eubage. La solitude sur les assignés se referme. Nulle source ne chantera plus sur le tranchant des monts et les places de l’acacia sauvage se tairont.
[…]
[pp.34-36]
-------------------------
Amère ma terre et plus amer moi-même qui suis devenu à la langue de mes amis un rêche grain de cassis. Je vis blotti, hanté sur le vaste van des collines. Je suis hors-les-murs parce que dans le grand ménage paysan nulle place ne m’est plus offerte parmi les créateurs. La caste instruite des tièdes, l’épine bourgeoise a étouffé le besoin du chant mais, sans échange, nul homme ne peut terminer sa tâche. Plein d’élans, plein de soupirs meurt aussi le peuple. La tête bourdonnante de légendes doit être tranchée et arrachées du tronc les douces entrailles. Si les cueilleurs de froment sont sauvés, elle resplendira la vocation d’un être unique, un bacchus dont je n’ai porté qu’un goût muscat et je tombe. De quel secret dépendent nos vies ? notre temps les prédestine à un long divorce entre la grâce et la justice. Je regarde une église posée comme un fragile verre d’eau au milieu de la plaine. La constellation des Poissons s’émiette dans l’abîme. Le soir du monde mûrit. Je me sustente de ce pain et de ce vin de douleur ; le siècle en a arrangé ma condamnation. Car je crierai : l’argent m’a inquiété ; inutile, étranger j’ai été la feuille morte détachée de mon âpre parenté. La ferveur seule anime ma destinée, j’ai suivi les chanteurs d’histoires, je cherche ma patrie (nos maisons, nos vaisseaux de bois !). Gens des campagnes, je m’accuserai de ne pas participer à vos travaux, de ne savoir dompter ni la vigne traîtresse, ni le blé aujourd’hui où je vous ai vus fidèles à votre ancien testament ; vous vivez cependant une migration qui ne diffère pas de celle des âmes, vous êtes la résine d’une bible encore noire et fraîche. Un oracle dans une ville du haut Rhône réclame une victime volontaire.
[…]
[pp.63-64]
-------------------------

LES MAQUEREAUX DES CIMES BLANCHES
[extrait]
[VI. Le Valaisan universel]
J’ai rencontré des villageois.
Les grives, les chevreuils, les renards étaient aussi des villageois.
La violence des ombres ! Les ouvriers qui montaient, descendaient de nuit un sentier, contre le mur de ma maison, au-dessus du Rhône et dérobaient une grappe de raisin. Les fours. La soif. Ils économisaient un peu de force sur l’usine pour faucher leurs prés à l’aube.
Et le nom de leur usine qui était craché, qui était pissé.
Et les autres paysans devant les chalets, têtes de proue disparues avec leurs petits sacs de cuir, couleur de pluie. Un seul mot pour dire la terre : le bien. Transmettre le bien.
Génocide fiscal.
Ce type d’homme qui a tenu trente ans (le temps de la Conquête avec trente mille morts – par silicose – massacre incognito, « indiens » empoisonnés dans la montagne, scellés et oubliés dans les caisses de l’Etat). Le mineur des hauts barrages, stoïque et fraternel. Dix fleuves capturés, les hommes du grand noir avec un dieu : le vin jaune.
J’ai eu mes amis parmi eux.
Le Valais visible et invisible. Le pays de la nuit obscure, les hautes transmigrations. C’est sûr : la race des guides ! Les chasseurs, les vignerons. Le long cheminement des gouttelettes de sève, du coteau dans le sang.
Celui qui a émigré au Canada et qui a envoyé sa photo à mon père, devant le champ de blé.
Celui qui est revenu de Paris, où il a été portier, avec des livres et des doctrines et qui enseignait qu’il n’y avait rien et qu’il y avait la liberté.
Et le saint inconnu, parmi dix autres, fromager sur un alpage, cachant ses miracles dans le cœur de ses frères.
Le petit fabricant d’orgues.
Les hommes qui regardaient passer les trains (sucre surtout). Le progrès se dépêche.
Je n’ai pas salué les portraits d’ancêtres mais j’ai aperçu les mystiques un doigt sur les lèvres. Silence, toujours silence.
Puis la liaison avec l’homme vierge qui donnait la communion a été rompue. L’évêque lui-même a trahi en dormant.
Après, les hommes de la grande cassure : les étudiants.
Je laisse les coloniaux de côté : les agents d’affaires, les entrepreneurs, les hôteliers, soudards de leurs inexistantes patries, les banques. Où l’argent « fait des petits ». Et dans les études poussiéreuses, avec le couchant rouge des reliures du Code pénal et du Code civil, dans l’ombre, les notaires tissent leurs toiles d’araignées.
Il y a l’internationale des salauds.
Les politiciens, tous ignobles.
La Feuille d’Avis des mensonges, dans toutes les langues.
Nous sentons cela aussi, ici. Le tic-tac des bâtisseurs de ruines.
Car tout le bien doit être vendu.
Ceux du Pater à rebours, du village à rebours ont signé.
Aucun espoir si ce n’est la crise la plus terrible. La préhistoire est devant nous. Mais à cause de cela, à cause de l’abîme creusé par les malfaiteurs, j’ai confiance en l’homme.
Partant du désert, lentement, lentement les poètes remontent les assassins.
[pp.107-109]
-------------------------

■ © Éditions Zoé
22:03 Publié dans Maurice Chappaz | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Stefanu Cesari, Peuple d'un printemps
Stefanu CESARI
PEUPLE D’UN PRINTEMPS
Pòpulu d’una branata
[extraits]

■ Stefanu Cesari
■■■
---------------------------
Extraits
Bilingue Corse-Français
Éolienne, 2021
Mention spéciale/Salon du livre insulaire d’Ouessant 2022 – Prix des lecteurs de Corse 2022
Si elle avait l’odeur du romarin passé sur la peau et votre langue parlée était pour la racine sous la terre vous partageriez le nom des choses venues dans la lumière parce que tout était vivant à portée de la main / son visage la flamme d’un petit renard s’en allant par les vignes, brûlées la nuit et qu’il n’en reste rien, qu’une page noire, une histoire pleine de ce que l’on mange ce que l’on sacrifie / elle te dit le lait ne peut cailler sans l’agneau, et tu la regardes faire ce qu’elle a fait depuis toujours, prier pour le troupeau et le multiplier / assise sur ta dépouille elle te gouverne et ton désir jamais tu n’oublies, si tu la laisses dormir au milieu de son œuvre, des cordes nouées pour le chien des couteaux pour les herbes, qui veillera sur ta vie revenue au-dedans ?
Elle aurait voulu que tu dises que tu fasses parler les arbres les cailloux tout ce sel toute cette sève et que la joie vienne après bourdonnante aux oreilles, martèle poitrine, des quatre membres à la roue, s’élève la voix du sang battu, à l’heure de la quatrième veille, quand des milliers de pierres plantées droites seront un vrai calvaire, tu ne sauras plus, si la lueur des cierges t’aveugle, ou bien ces yeux cernés de noir, la sueur tombée du front.
[p.73]
-------------------------
Danse improvisée, il faut aller chercher chaussures si les pieds sont nus pour battre la terre t’essouffler à la peine petit accordéon posé sur un mouchoir offerte la tête, quatre membres et poitrine pour la mesure, un langage chanté un essaim d’abeilles posé contre musique et chaque parole me blesse il n’appartient qu’à toi une femme cherche son amour perdu se transforme en oiseau, annò / è troppu luntanu, Oi riturnella / non mi rišpunna, annò, è troppu luntanu / è sutt’a na frišcura / è sutt’a na frišcura chista durmennu, Oi riturnella è sutt’a ma frišcura chi sta durmennu si tu perdais le fil que deviennent les vêtements les sortes de tissus coupés cousus ensemble feuilles de couleur sans émaux, ou de très fines rayures d’un autre ton, tous tes enfants maigres auraient la même vêture, c’est la danse qu’ils font, elle les fait ressembler à la jupe de leur mère, tous les instruments des ténèbres rassemblent leurs forces, vivant au bout des mains, bruits d’une nuit d’avril, de poumons sans voix, sortes d’insectes, d’une violente clarté pas encore venue, l’annonce, elle pointera par les yeux, regard perçant la moindre apparence, remontant le fil d’or dans le vivant tissu, voyant l’infime grouillement dans tout quel effroi la mouvante musique est folle et tourne encore bien après toi, beau détail d’une damnation.
[p.89]
-------------------------
Il y a toutes sortes de scorpions celui que l’on porte au front celui pour la main sous la pierre l’un pour se garder de l’autre, pour la peine, je ne saurais pas dire ma mère quelle a été la route je ne saurais pas dire mon père si je vous rêve encore, c’est la fièvre sûrement cette piqûre au rouge infime, tous ces visages peints pour chaque nom sans fin, l’innocence revenue elle fut volée tant de fois, je ne saurais pas dire avec si peu toute la vie se cachant sous la courbure des morts, elle y cache si bien ses yeux épouvantés, ses yeux si doux d’une bête qui attend, je passerai sans voir sans toucher, je ne brûlerai rien, ni la racine d’une bruyère qui ne brûle jamais ni ma parole reprise, ni les quelques chromos, de corps de sarments sous la vigne, ces lieux sont un livre fermé, même en ne dormant jamais je ne saurais pas dire même en comptant mille-huit-cents mille-neuf-cents médailles et stylets registres effacés pour nier les ardeurs, moisissures, enfantements mises-bas, fosses communes, hôpitaux, villes en ruines et nouvelles aux espoirs bien vendus, je ne saurais pas dire pourquoi, je ne suis jamais seul d’un scorpion à l’épaule porté cet autre qu’il faut nourrir, il précéda la naissance et de loin c’est une ombre au soleil, maintenant il dort.
[p.123]
-------------------------
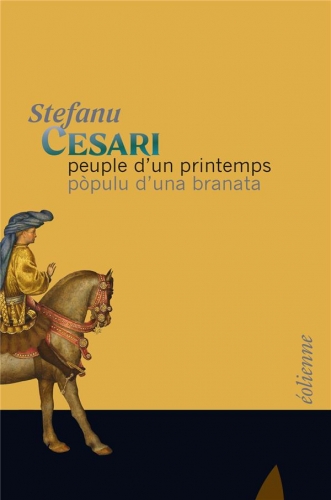
■ © Éoliennes
17:43 Publié dans CORSE, Stefanu Cesari | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
































































