29/10/2023
Italo Calvino, un regard jamais à sec - par Nathalie Riera

italo calvino, UN REGARD JAMAIS À SEC
Une lecture de NATHALIE RIERA
___________________________________
calvino
LIGURIES
Traduit de l’italien et présenté par Martin Rueff
Edition bilingue
[Editions nous, 2023]
De ma lecture de Liguries d’Italo Calvino (livre composé de 5 textes inédits écrits entre 1945 et 1975 et de 6 poèmes, « Les eaux-fortes de Ligurie », écrits pendant la Résistance), outre le regard précis et lucide de l’écrivain, je retiens que son écriture ne relève pas seulement de son goût à explorer le monde ou à seulement donner forme à ses propres émotions, mais qu’elle est surtout le moyen de faire usage du « juste emploi du langage », celui même qui « permet de s’approcher des choses (présentes ou absentes) avec discrétion, attention et prudence, en respectant ce que les choses (présentes ou absentes) communiquent sans le secours des mots. »[1]
Italo Calvino est connu pour son souci de l’exactitude en littérature, et ce au moyen « d’images visuelles nettes, incisives, mémorables » ou d’« un langage aussi précis que possible ». Ce qu’il attendait de la littérature c’est qu’elle lui soit « la Terre promise où le langage devient ce qu’il devrait être en vérité », à même de pouvoir créer des anticorps contre « la peste langagière » mais contre aussi celle des images véhiculées par les médias, lesquels « ne cessent de transformer en images le monde, le multipliant dans une fantasmagorie de jeux de miroirs ». Chez lui la « recherche de l’exactitude » reposait sur « l’emploi de mots qui rendent compte avec la plus grande précision possible de l’aspect sensible des choses ». On lui connait aussi la pratique des exercices de description et sa reconnaissance pour les poètes Williams Carlos Williams, Marianne Moore, Montale, Ponge, Mallarmé. Avec Liguries, récemment publié aux éditions Nous, c’est le regard éclairé d’un documentariste et en même temps celui d’un écrivain désarmé et dans le désarroi face à un territoire menacé, celui de la Ligurie qui, présente dans beaucoup de ses écrits, lui était particulièrement chère.
Dans le premier texte « Ligurie maigre et osseuse », Calvino dresse un portrait minutieux de la Ligurie oubliée des paysans : « Différentes de toutes les campagnes qu’on trouve en plaine ou dans les collines, la campagne ligure semble, plus qu’une campagne, une échelle. Une échelle de murs de pierre (les “maisgei”), et d’étroites terrasses cultivées, (les “fasce”), une échelle qui commence au niveau de la mer et grimpe parmi les hauteurs arides jusqu’aux montagnes piémontaises : témoignage d’une lutte séculaire entre une nature avare et un peuple aussi travailleur et tenace qu’il a été abandonné et exploité. »
Avec le Piémont et l’Abruzze, la Ligurie est une des régions qui compte un fort pourcentage de propriétés paysannes. Mais les transformations sociales, économiques et territoriales vont bouleverser progressivement cette civilisation paysanne dès les années 1920 et 1930 et plus fortement encore dans les années 1950 et 1960. Dans Vent largue, l’écrivain Francesco Biamonti, ami d’Italo Calvino, définit ce bouleversement irréversible par une image très significative, celle d’une « Ligurie qui entre dans l’Erèbe »[2]. Cette transformation radicale se traduit par une exploitation du paysan ligure, soumis autant par le capitalisme terrien que le capitalisme industriel, mais aussi par l’exode rural, la désertification des villages, le développement d’une économie touristique et de la spéculation immobilière qui s’y rattache. Mais l’un des points forts reconnu chez le paysan des montagnes ligures c’est la formation de son caractère à force de « lutte continue contre les adversités », souligne Calvino, et parmi elles, la dure période de la Résistance pendant laquelle il a fait montre d’enthousiasme, d’esprit combatif, de solidarité et de désintérêt. Les Casteluzzi, ainsi nommés les habitants de Castelvittorio, village « confiné sur une hauteur de la Val Nervia », sont décrits par Calvino comme de grands travailleurs et grands chasseurs qui « se rendirent célèbres par l’acharnement avec lequel ils défendirent leur village à chaque fois que les Allemands ou les fascistes tentèrent de le conquérir. Castelvittorio compta plus de soixante morts pendant les vingt mois que dura le combat, la plupart des maisons furent incendiées par les Allemands, mais le nombre des Allemands morts sous les coups de quatre-vingt-onze vieux chasseurs de sangliers fut plus élevé encore. […] Dans l’histoire de ces vallées, la guérilla des brigades Garibaldi restera comme leur épopée […]. » Les populations des régions de la Ligurie, ruinées par la guerre, et parce que le fascisme leur interdit l’expatriation, seront alors vouées à une émigration vers les villes proches de la Riviera italienne. Là-dessus, Calvino s’interroge : « Un progrès pour la vie et la production des populations de l’arrière-pays ligure est-il envisageable ou ces populations sont-elles vouées à l’émigration ou à la disparition ? »
Nous sommes en 1972 quand l’idée d’une zone protégée dans la province d’Imperia (à l’intérieur des terres de Vintimille et de Sanremo) est à l’étude. Les premières investigations autour d’un projet de « Parc naturel » dans les Alpes Ligures démarrent en 1980, mais il faut attendre 1997 pour parvenir à un accord minimal et 2007 pour un accord sanctionné à l’unanimité. Le Parc Naturel Régional des Alpes Ligures est réparti sur trois vallées (Nervia, Argentina et Arroscia). Sur la question du devenir de la Ligurie et de son espace rural, je renvoie à la lecture d’un article de Françoise Lieberherr[3], pour son analyse juste et pertinente sur l’opposition des autochtones à ce projet, du fait que celui-ci a surtout été « conçu par des urbains, pour des urbains ». Lieberherr souligne l’existence d’une « domination du discours urbain sur le rural »[4]. Face à l’expansionnisme technologique sur l’environnement, écrit-elle, mais aussi « la consommation accrue d’espace, le gaspillage d’énergie, la destruction irréversible des sites et des ressources, les urbains se préoccupent de la protection du territoire, encore peu technicisé, et demandent sa conservation. » On imagine alors fort bien les types de projets qui vont s’élaborer en réponse à ce besoin de protection. Lieberherr évoque entre autres « les stratégies protectionnistes ou productivistes de l’espace ». La question du maintien de la paysannerie est également posée, la composante du tourisme agissant davantage comme élément complémentaire plutôt que concurrentiel ! Si Lieberherr n’hésite pas à soulever des « contrastes écologiques », à ceux-ci, écrit-elle, s’ajoutent des « contrastes sociologiques révélateurs » : « en 1979 dans l’aire du parc, 82 % des habitants concernés résident sur la côte, alors que 85 % du territoire se situent dans la zone périphérique de l’arrière-pays […] le parc naturel localisé dans l’arrière-pays est créé pour répondre aux besoins de la population côtière. » Toujours d’après Lieberherr, il est à noter qu’« en 1861, presque les trois-quarts des habitants résidaient dans l’arrière-pays, et les bourgs des vallées étaient plus importants que les villes côtières. Le mode de vie s’articulait sur une économie à prépondérance agricole autarcique. » Mais dans l’après-guerre, face au développement du tourisme de masse, le décor n’est plus le même. Les pôles d’attraction se jouent désormais sur la frange côtière, avec une extension de l’urbanisation, source d’accélération économique, peut-on lire, mais aussi de « dévitalisation parallèle de l’arrière-pays ». Dans l’exemple de la culture de l’huile en Italie, pays depuis longtemps ruiné par la floriculture estimée plus rentable, Calvino dénonce déjà à son époque que : « la production ligure fondée sur le système de moulins rudimentaires privés sera supplantée par l’affluence des huiles espagnoles et tunisiennes. Les oliveraies seront de nouveau abandonnées ou vendues pour faire du bois. » Autre ennemi pointé du doigt, et peut-être le pire, est la rareté de l’eau dans les campagnes ligures : « Pour les cultures florales, l’eau se trouve canalisée dans des tuyaux et conservée dans des bassins de ciment. Il ne serait pas très difficile de faire venir des cours d’eau des montagnes, de construire de nouveaux aqueducs, des bassins artificiels, des structures de soulèvement : il ne serait pas très difficile de faire de la Ligurie une zone agricole florissante. Mais les revenus des maisons de jeu et des grands hôtels servent à construire des funiculaires, des terrains de golf, des établissements de bain, servent à enrichir davantage les propriétaires des maisons de jeu et des grands hôtels. » Pour Calvino, il revient donc au paysan de continuer « sa lutte vaine et solitaire à coups de bêche » !
Parce que l’Italie est un pays qui figure parmi mes tropismes géographiques, un article de Frédéric Fogacci[5] va retenir mon attention, et ce afin de mieux appréhender cette « Ligurie maigre et osseuse » décrite par Calvino.
En Italie, la création de l’Etat-Nation s’est opérée par unification progressive. Lente mise en place de la construction de la nation italienne, lente adhésion à l’autorité d’un Etat centralisé et surtout lent développement d’une conscience politique nationale, notamment dans la paysannerie italienne la plus pauvre, soumise à une double exclusion à la fois économique et politique. Le monde rural, assurément opposé au pouvoir central, est perçu par l’élite bourgeoise comme un obstacle au projet national, le définissant comme un espace marginal anti-unitaire. Mais ce sont principalement dans les régions du nord de l’Italie que se tiendront plusieurs mobilisations paysannes et manifestations ouvrières, génératrices d’un ensemble de mouvements influents, comme Les Ligues de Résistance (peu après 1870, dans la vallée du Pô notamment), ou encore le mouvement hétérogène de La Boje ! (1884-1885), rassemblant des journaliers agricoles, des métayers et des petits propriétaires terriens, mais également l’insurrection du Bienno Rosso, deux années rouges qui suivront la Première Guerre mondiale (de 1919 à 1920), sans oublier la création de l’organisation syndicale paysanne italienne, la Federterra (en 1901). Il commence à se faire entendre dans la sphère rurale un discours contestataire anti-monarchiste, nourri des idées socialistes et catholiques, mais non sans le risque d’un embrigadement au sein des partis fascistes. Frédéric Fogacci précise que durant les grèves de 1901, « le taux de syndicalisation des grévistes est, fait assez rare, plus important chez les ruraux que dans le monde industriel (en 1902, environ 71% des grévistes dans le monde rural agissent sous la direction d’une organisation syndicale) […] Ce n’est qu’après 1906 que la Federterra […] se mue en organisation rénovatrice du monde paysan. » Supprimée par le gouvernement Mussolini, la fédération se réorganisera à Bari en 1944 sous le nom de Nuova Federterra.
***
Ces textes précieux d’Italo Calvino, rassemblés ici sous le titre de Liguries, ne souffrent d’aucun anachronisme, mais nous éclairent plutôt sur une réalité plus que jamais criante de vérité, avec la promesse d’une immersion historique et sociologique dans la Riviera du Ponant, et ses villes comme Sanremo, Savone et Gênes.
Baptisée « ville de l’or », Sanremo va participer à la construction intellectuelle de Calvino comme elle va conditionner sa vision du monde et sa poétique littéraire. Le Sanremo de l’écrivain, c’est la route de San Giovanni qui mène à la maison familiale la Villa Meridiana ; c’est aussi l’ancien quartier de la Pigna avec son empilement labyrinthique de ruelles, les volets verts de ses maisons « recroquevillées comme des artichauts, ou comme des pignes de pin », mais il y a aussi le Sanremo devenu « ville de grand tourisme » dès 1905, où toute « la fine fleur de la bourgeoisie internationale » y régnait, pendant que les pauvres grouillaient dans la Pigna, « à quelques pas du casino où l’on joue avec de l’or », la Pigna « toujours plus vieille et toujours plus sale, avec les étables au rez-de-chaussée, sans égouts, sans toilettes, avec le chariot qui passe le matin pour renverser les pots de la nuit. » L’écrivain ne peut que se désoler à chaque fois de ce triste tableau du monde aux « contradictions les plus stridentes » !
Une des autres réalités vécues par l’écrivain sera sa première formation partisane à la Résistance armée, avec son rattachement à la 2ème Division d’assaut Garibaldi « Felice Cascione ». Après l’Armisitice du 8 septembre 1943, Italo Calvino prend part à la bataille de Bajardo le 17 mars 1945. Le village de Bajardo, dans la province d’Imperia, devient un bastion de la Résistance partisane pour beaucoup de jeunes qui refusent de se laisser enrôler par la République de Saló connue pour être sous influence nazie.
Une présentation des Liguries d’Italo Calvino est signée Martin Rueff avec un très beau texte, Du fond de l’opaque j’écris. À propos de « l’œil vivant » que Calvino-reporter a exercé, notamment dans plusieurs de ses textes rassemblés dans Descriptions et reportages, ces mots du traducteur : « Calvino est un observateur d’une rigueur extrême qu’on ose dire impeccable et même implacable ; il excelle à décrire la nature, les étendues, les reliefs, les couleurs et les atmosphères d’un lieu. Il sait, comme Pavese et comme Pasolini, mais différemment d’eux aussi, inscrire les hommes dans une terre et une terre dans des visages et leurs destins. »
Octobre 2023
[1] Pour cette introduction, je ne pouvais passer à côté de l’une des 6 conférences d’Italo Calvino, « Exactitude » de Leçons américaines et dont les citations sont issues.
[2] « C’est la civilisation de l’olivier. Une civilisation magnifique. Il y a deux mille ans, les Grecs nous apprirent à greffer l’olivier sur le chêne vert. Aujourd’hui, après deux mille ans, cette civilisation est morte et ses communautés sont mortes avec elle. C’était une société très douce. Quiconque pouvait bien y vivre avec un peu plus de cinq cents oliviers. Maintenant, cela n’est plus possible : les oliveraies restantes sont presque toutes abandonnées, les gens d’aujourd’hui sont seuls, dénaturés. On survit avec les floricultures, les serres ont remplacé les oliveraies et les plus malchanceux sont obligés d’être serveurs à Monaco. La civilisation de l’olivier est morte, mais aucune autre ne l’a remplacée. », Vent largue, éd. Verdier, 1993.
[3] « L’espace rural, ultime “colonie” des pays développés ? paru dans Revue de géographie alpine, tome 71, n°2, 1983.
[4] https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1983_num_71_2_2527
[5] « La politisation des campagnes italiennes : enjeux et bilan » : https://www.cairn.info/revue-parlements1-2006-1-page-91.htm

Pour + d'infos

19:16 Publié dans ITALIE, Italo Calvnio, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
12/02/2023
Anne-Emmanuelle Fournier
Une lecture de Gaël de Kerret
___________________________________
Anne-Emmanuelle Fournier
L’OFFRANDE AUX FANTôMES
SUIVI DE
Il y a longtemps que je t’AIME
[Editions Unicité, 2022]

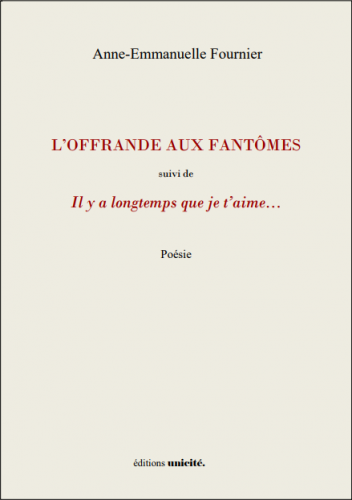
■ © Anne-Emmanuelle Fournier
Commençons, peut-être, par interroger ce double titre. La seconde partie est-elle vraiment un ajout ou une suite ? En réalité, j’ai ressenti cet ouvrage comme un chiasme, dont l’inclusion centrale est un poème isolé qui a pour rôle de transformer toute l’aspiration de la première partie en Réalisation finale.
Il est aisé de rentrer dans la première partie : ces « carrés » de prose nous placent dans une géographie par le mot. Le mot fait l’espace. Le lecteur s’y rend comme si c’était aussi un peu le sien. Les phrases sont courtes, prévenant toute tentation discursive. Ne reste que le primat de la sensation, comme un envol de l’initiation de l’auteure vers la science des vivants.
Le mot, disais-je, détaille la géographie, mais il détaille aussi les bruits quotidiens, non comme une lassitude potentielle, mais comme le sentiment d’un trésor qui est encore questionnement. Ces bruits sont entendus sans tout-à-fait être dans l’Entendement, en cohérence avec la conscience d’un sujet encore enfant au début de ce livre.
Le lecteur reste alors bouche bée devant ce que l’auteure/jeune fille appelle pudiquement « le vieil homme » qui lui enseigne tout, mais « ne reparaîtra plus ». Cet homme vieux de deux millions d’années – comme l’écrivait Carl Gustav Jung – parle la langue des oiseaux, car les Anciens transmettent non ce qu’ils disent, mais ce qu’ils sont. Puis vient l’impressionnisme de l’été. Tourisme nostalgique maintes fois réitéré en littérature ? Sauf que des mots tels que « la piscine municipale » nous empêchent résolument de fuir vers le faux et enterrent tout embourgeoisement du discours. Et l’on se demande si l’exactitude des mots ne cache pas une aspiration qui ne peut encore se dire.
Cependant, la petite fille grandit et veut prendre sa place dans ce monde. L’état de tension entre le bruit banal et l’homme vieux de mille ans ne cache plus qu’un sens de vie est en train de se constituer. Cette question du Sens est prégnante dans ce livre. Depuis que Copernic nous a dit que la terre n’était plus au centre de l’univers, l’homme baroque, avec Caravage, est devenu ombre et lumière se posant la question du sens de sa présence dans l’univers. Alors, dans la nuit qui est forcément nuit éveillée, l’adolescente cherche à découvrir la lumière qui habite les ténèbres. Même la pluie qui affole les 'raisonnables' est pour elle l’expression de la liberté « qui ruisselle par tous les pores de la nuit ». D’autres nuits, il y a même des étoiles dans cette marche que jonchent tant d’obstacles. Ces étoiles sont la métaphore du chemin « vers une source ». Elle sait la source, mais elle ne la connaît pas. Ce sera dans le quotidien du mot que se recueillera le sens : « Une pliure du multivers où tu réponds au téléphone, sarcles tes parterres ». On trouve en ce processus les trois acceptions du mot sens en français : sensation, direction, signification ».[1] Pour François Cheng, on glisse alors subtilement vers le Yi puis le Yi King comme « accord, entente communion ». Pour l’auteure en quête d’initiation, c’est là le plus important. Elle voit l’agitation des touristes, mais « rien de tout cela ne parvient jusqu’au ventre de pénombre de la maison, où la grand-mère attend. »
Puis la femme advient dans son statut d’adolescente, qui parvient à s’aimer par le tissu enveloppant son corps, donnant au « rêve de soi » la beauté exemplaire. À cet âge, parce qu’elle a pris l’univers comme amant, elle sait ce que veut dire : « partager un plat odorant à l’ombre d’un platane », avec les « valides et les fracturés ».
Fracturés ? Quand il lui est donné de voir les morts malgré tout, les rôles sont étrangement renversés : ce sont les vivants les crucifiés. Preuve en est : son lieu de visions, d’odeur et d’intangible, son topos de la Lumière spirituelle est dorénavant une pancarte : À vendre. Oui, les choses passent, mais la Lumière n’est pas à vendre. Les armoires, les lits sont médusés face à ce qui va être leur drame absolu, mais l’enfant d’autrefois s’approche du piano pour un dialogue avec les morts car elle sait « qu’ils rêvent ». Soudain monte en elle l’exigence d’une décision. La méditation doit faire place à la résolution, sous peine de rejoindre ces morts.
Cette résolution est le Kaïros du livre : ce poème adressé directement à l’homme de sa vie avec qui elle va pouvoir exercer chez elle, pour elle, toutes les visions recueillies de l’enfance. À cause de cette métanoïa du chiasme, il fallait changer d’écriture. Ce sera donc de la poésie (librement) versifiée, dans laquelle le mot isolé est roi de prophétie, parce que l’auteure sait que la poésie est création au sens du poïein grec. En 1951, le philosophe Martin Heidegger commente ainsi ce que devrait être la poésie :
« Poétiquement habite l’homme sur cette terre. Dans quelle mesure l’homme habite-t-il poétiquement ? S’il habite ainsi, c’est qu’il parle... que pouvons-nous faire pour sauver le Poème de son manque de pays ?
Libérer la poésie de la littérature, c’est une chose.
Il faut sauvegarder la terre dans son intouchable source à partir du Haut-jeu entre les divins et les mortels, pour ce jeu même. » [2]
C’est ainsi que je définirais la poésie d’Anne-Emmanuelle Fournier : mots rendant sacré le quotidien, sacrés les changements de statut de l’enfant né à la vie, mots qui donnent la verticalité du « Haut-jeu entre les divins et les mortels ». C’est un quotidien semblable à l’épi de blé surgissant de terre, porteur de tant d’archétypes immémoriaux. Renversement ici encore : dans cette partie placée sous le signe de la chanson traditionnelle À la claire fontaine, c’est l’enfant qui enseigne : « cet amour est plus grand, plus ancien que tout ce que je crois être ». Il enseigne par le « désir de parole », écrit l’auteure, et non par la « langue domestiquée ». En archê ên o logos : à l’origine était la parole, écrit le Prologue de Saint Jean. Et du côté de la fin, les rêves montrent que l’âme continue son travail, que la Lumière continue son travail malgré l’extinction de la forme, ce que l’auteure dit par ces mots : « Lorsque le temps aura dissout mon nom sur mes propres lèvres ».
Chacun des poèmes de ce dernier temps du recueil commence par « Je pourrais vivre ». Cette anaphore m’a rappelé la structure du poème « Liberté » de Paul Éluard, extrait de Poésie et Vérité et par exemple fiévreusement mis en musique par Francis Poulenc dans Figure humaine. L’apostrophe d’Éluard résonne : j’écris ton nom, j’écris ton nom, j’écris ton nom : liberté ! On peut penser qu’Anne-Emmanuelle Fournier, qui témoigne en réalité d’une double mise au monde, pourrait faire sienne cette déclinaison : mon enfant-liberté, j’écris ton nom.
[1] François Cheng, Cinq méditations sur la beauté, Albin Michel, 2006, p.35
[2] Revue Obsidiane, « Heidegger » 1982, p. 145. Cette prise de parole prend place lors d’une lecture de poèmes à Bühlerhöhe, ville d’Allemagne près de Baden-Baden.
12:51 Publié dans Anne-Emmanuelle Fournier, FRANCE, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
12/03/2022
Les Carnets d'Eucharis - "Sur les routes du monde, vol. 3" - Une lecture de Mazrim Ohrti (Poezibao)

par Mazrim Ohrti – POEZIBAO
___________________________________
[Les Carnets d’Eucharis – Sur les routes du monde #3 – 2021]
Une fois de plus, explorons la magnifique revue toute en nuances de Nathalie Riera et de ses complices dont le sous-titre promet une pérégrination « tous azimuts ». Confrontons-nous à une mondialité affranchie des affres du mondialisme. L’édito convoque les écrivains-voyageurs, d’Homère à Sylvain Tesson en passant par Chateaubriand, Jack London, Nicolas Bouvier, Kerouac, Jacques Lacarrière. Peinture, arts visuels, danses des mots et des corps nous invitent à suivre ce mouvement perpétuel dans les pas de Pina Bausch avec son Tanztheater, de Pippo Delbono, ce « poète intranquille de la scène » ou d’Ilse Garnier à laquelle se rattache d’emblée le nom de spatialisme. On apprend combien l’Afrique lui fut source d’inspiration autrement qu’à travers « un monde exotique ou un réservoir de motifs pittoresques ».
Il y en a comme à l’accoutumée pour la détente et l’érudition, dans l’idée que l’un ne va pas sans l’autre pour peu qu’on veuille se refaire une santé culturelle par les temps qui courent sans se retourner. Rythme et mesure et liberté créatrice extatique ne s’opposent pas, bien au contraire. ▪ LIRE LA SUITE
18:45 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Les Carnets d'Eucharis - "Sur les routes du monde, vol. 3" - Une lecture de Jean-Pierre Longre
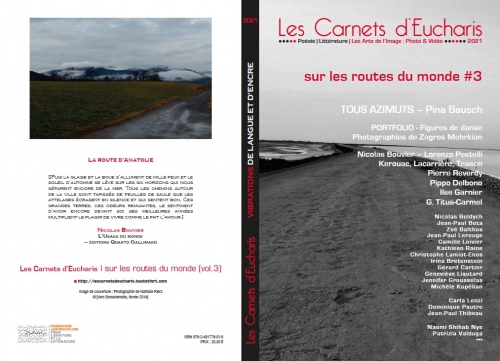
par Jean-Pierre Longre
___________________________________
L’art en mouvement
[Les Carnets d’Eucharis – Sur les routes du monde #3 – 2021]
Les Carnets d’Eucharis, c’est une belle revue à lire comme voyageait Montaigne, sur des modes divers et par étapes curieuses. Montaigne dont il est question avec d’autres, (Chateaubriand, Lamartine, Nerval, Flaubert…) sous la plume de Patrick Boccard, Montaigne, l’un des premiers à pratiquer l’écriture « nomadisée » qui forme le thème du premier dossier de ce numéro. « Sur les routes du monde », nous rencontrons Nicolas Bouvier (avec Jean-Marcel Morlat), Lorenzo Postelli (avec Zoé Balthus), Homère, Kerouac, Lacarrière, Tesson etc. (avec P. Boccard), et nous suivons les itinéraires poétiques, descriptifs, narratifs, souvent illustrés, de Nicolas Boldych (à « Rome-en-Médoc »), Jean-Paul Bota (à Lisbonne), Zoé Balthus (au Japon), Jean-Paul Lerouge (en Ouzbékistan) – et nous nous imprégnons des pages que l’on découvre comme les écrivains-voyageurs se sont imprégnés des lieux qu’ils ont explorés..
18:37 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Anne-Emmanuelle Fournier "La part d'errance" - Une lecture de Rodolphe Houllé
Anne-Emmanuelle Fournier
LA PART D’ERRANCE
[Editions Unicité, Coll. « Le Vrai Lieu », 2021]

■ © Anne-Emmanuelle Fournier (sur sa page Facebook)
par Rodolphe Houllé
___________________________________
Maurice G. Dantec disait qu'une bibliothèque est un arsenal. Si cela est vrai, alors ce livre serait une arme de précision dotée d'un silencieux. Mais une bibliothèque est aussi un bunker et l'on a effectivement le sentiment que ce recueil est écrit alors qu'une catastrophe s'est produite – et continue à se produire. Il témoigne de l'état actuel du monde. Si quelqu'un du futur le lisait, il penserait : alors c'était ainsi, ce monde était ainsi. Car il n'y a pas, en le lisant, de quoi douter de cet état.
Le monde est fracturé. L'homme debout, le dieu et l'animal couchés. Couchés aussi l'air du soir, la lumière et le cadavre. Arrogance de la verticalité, surtout quand elle est immobile.
Cueillir, marcher, passer, traverser, tanguer, ployer, s'incliner, s'écouler.
La fission atomique symbolise cette fracture. L'autoroute, l'usine à porcs, la centrale nucléaire, dans ce triangle où l'homme sain ne peut que perdre la raison se joue quelque chose d'essentiel. Et qu'a-t-il à nous dire, ce « prométhée cafardeux » qui erre de nuit entre le « feu dérobé aux étoiles » et les « animaux concentrationnaires » ? Rien, ou si peu. Devant l'énormité du crime il ne peut que « psalmodier » et « sangloter doucement », abandonner seulement la camisole de la parole technocratique qui catalogue, classe et dissèque, s'identifiant ainsi à l'homme hypothétique évoqué par Paul Celan dans Tübingen qui, « s'il venait […] au monde, aujourd'hui, avec / la barbe de clarté / des patriarches : il devrait / s'il parlait de ce / temps, il / devrait bégayer seulement, bégayer, / toutoutoujours / bégayer ».
C'est que la fracture du monde matériel conduit inévitablement à celle de l'être. La séparation est une autre manière de nommer la fracture. A ce point radical que, même si « Voilà plus de mille ans que nous marchons / sans trouver l'eau », nous ne savons même plus « si nous saurons encore la reconnaître ».
La droite et l'angle dessinent la ligne de fracture qui traverse de part en part l'homme mutilé, « rogné ». Il n'y a pas de ligne droite dans la nature, la forme géométrique apparaît dans l'infinitésimal qui nous a engloutis, nous qui avons consommé le « fruit anguleux de la connaissance » et, munis de l'horloge atomique, disséqué le temps même, abandonnant « le cœur dilaté de ce présent » que rien ne saurait mesurer, sinon « la main pleine de son propre pouls », la « pendule arrêtée » dans le « fond animal des jours ».
Mais ce n'est pas du tout un livre politique, même si à défaut d'une politique, une manière d'envisager l'humain pourrait s'en dégager. Ce n'est pas non plus un livre de colère, même si l'un de ses piliers est la colère, car la colère ne convient pas. Et encore moins un manifeste, car nous avons déjà bien trop pensé (c'est-à-dire, pensé de cette manière voracement tendue vers l'avenir) et que cent-cinquante ans après Rimbaud, plus terrifiant encore, on voit toujours « roulant comme une digue au-delà de la route hydraulique motrice, / Monstrueux, s'éclairant sans fin, — leur stock d'études ».
Assez d'idées. Assez de choses. Assez d'avenir. La Que Sabe chante au-dessus des os, elle sait, que comprendre n'est rien.
Main : « crevassée ». Rumeur : « obscure ». Vent : « aride ». C'est ainsi qu'est le monde, parfaitement inintelligible. Pourquoi donc chercher à comprendre ? Et que comprendre ?
Que faire ? Rien. Cueillir, marcher, passer, traverser, tanguer, ployer, s'incliner, s'écouler.
Errer. Errer sous la force de gravité, « mère de toutes les forces ».
Marcher à côté du cheval et l'abreuver. Le cheval sait, lui aussi. Sa « mâchoire d'ombre », « sa sueur et ses muscles ». Rien d'autre, « dans le soir qui respire / à peine ». C'est le compagnon du lecteur, qu'il marche sous la steppe chamanique ou attende la nuit. Regarder son « visage ».
Regarder les insectes venus « manger aux pieds » de celle « qui ne vieillit plus depuis longtemps » et le moucheron qui « tournoie au-dessus de la table / […] sans doute plus proche que moi / de ce que serait Dieu ». Regarder ce qui est, regarder ce qui vit, c'est-à-dire tout. Brûler le vêtement de cette pensée mortellement civilisée devant le « dieu à tête de buffle » afin de se présenter nu devant « le dieu à quatre pattes ».
Ne plus être séparé.
Nous avons oublié ce que « vivre a de terriblement élémentaire » notait Jean Grosjean dans sa magnifique préface au Journal du manœuvre de Thierry Metz. Anne-Emmanuelle Fournier relève que cet oubli ne saurait cependant être complet et – c'est là sans doute l'un des aspects les plus troublants et les plus dérangeants de son livre – parvient à nous faire ressentir à quel point notre époque, comme toute époque, n'est qu'une pellicule dérisoire immergée dans un temps immémorial où presque rien de ce que nous imaginons connaître n'a de valeur et qui parfois, à la faveur d'un relâchement de l'attention, dissout toute certitude pour nous plonger dans le mystère fondamental et éternel du monde. Le poème qui débute par « Murmurée à l'après-midi / dans la stase d'une saison jaune » réussit de manière admirable à évoquer le malaise, l'étrangeté et la fascination dans lesquels nous emporte irrésistiblement cette lame de temps venue d'un passé vertigineusement lointain submerger le présent.
La « Méditation terrestre » qui clôt l'ouvrage évoque aussi ce glissement, d'une manière peut-être moins inquiétante, mais l'on ne peut s'empêcher de penser que « le son d'une voix » qui « de loin en loin » « perce mollement la canicule », « comme engourdie » et que nous avons « peut-être rêvée / dans cette journée ou dans une autre » n'est autre, incertaine, chancelante, que celle de l'homme, qu'une simple promenade par un après-midi d'été aura suffi à effacer presque entièrement du monde.
Livre compact, sec et lourd comme une pierre. Livre liquide, livre aérien.
Très grande maîtrise du silence. Livre silencieux. Livre qu'on écoute plus qu'on ne le lit qui, refermé, continue à vibrer longtemps dans la mémoire, comme planté dans le mille d'une cible inconnue par une magicienne inquiète. Souhaitons que sa parole soit entendue.
18:21 Publié dans Anne-Emmanuelle Fournier, Les Carnets d'Eucharis, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (5) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
11/02/2018
Les Carnets d'Eucharis (2017) par Mazrim Ohrti (pour Poezibao)
LES CARNETS D’EUCHARIS
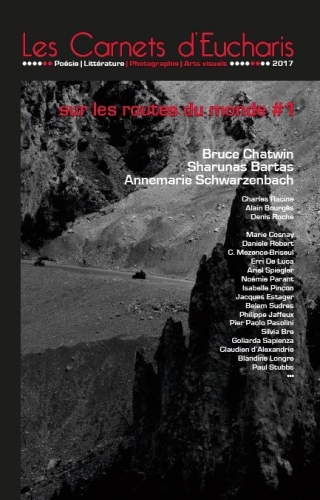
Sur les routes du monde (vol.1)
[Revue "Les Carnets d'Eucharis", par Mazrim Ohrti]
Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, la revue Les Carnets d’Eucharis rassemble poésie, littérature, photographie, arts visuels ; elle est visible également sur le site de Nathalie Riera, chapeautrice en chef donc, qui se révèle très impliquée.
Revue qui naquit en numérique en 2008 pour s’enrichir d’une version papier annuelle dès 2013. A son comité de rédaction figurent quelques noms du moment concernant cette parole créatrice de bien des nourritures terrestres, les uns poètes s’accommodant des autres plutôt critiques, et réciproquement. Inutile de les nommer (au risque de vouloir faire caution), ils se reconnaîtront. Toute de noir toute de blanc (à quelques reproductions près, photos et peintures), toute de noir et blanc, et le rouge parfois aidant, la revue laisse voir dossiers, études, entretiens, traductions, portraits, critiques et poèmes.
Ce numéro confirme les autres par sa densité, sa luxuriance lumineuse au regard des disciplines qui s’interpénètrent et ainsi se supportent mutuellement. Ce qui lui donne un air de permaculture, soit une alternative à ce que l’industrie du prêt-à-penser impose par ses ornières… dans le secteur culturel aussi. Et il y a là de quoi nourrir toute la planète. Même cinéma, vidéos, photo et peinture en sont le sujet dans une large mesure ; notamment sous l’œil de Richard Skryzak, vidéaste et écrivain dont le travail fut visible dans l’émission « Die Nacht/La Nuit » sur Arte. Ainsi Sharunas Bartas est à l’honneur dans ce numéro, mais pas que. C’est ce poète méconnu, Charles Racine, qui ouvre la voie par un dossier où « hommage » lui est rendu ; par un témoignage, des extraits de poèmes et des propos exégétiques à son endroit. La thématique mentionnée « sur les routes du monde » s’illustre par Bruce Chatwin, Annemarie Schwarzenbach et Bartas, écrivains ou cinéaste, et voyageurs, cherchant ce qu’il y derrière la notion de nomadisme. Si dans un premier temps il s’agit d’accéder à un ailleurs possible, un « otherground » (illustré par Sylvie Ballester) dans le but très clair d’expérimenter la verdeur de l’herbe, dans un second temps, c’est davantage pour se repaître d’une certaine aridité au contraire, où pousse malgré tout une humanité profonde et spontanée, élémentaire et inconditionnelle, rendue à sa quintessence car dénuée, car libre au-delà de tout idéal préfabriqué et de modèle théorique, en des paysages, des lieux où la beauté réside avant tout dans leur vérité. Autant sur les vestiges de peuplades disparues depuis longtemps que chez des groupes minoritaires actuels mais marginalisés, tout autant oubliés. C’est pour chacun de ces auteurs en rupture avec leur temps, par sa critique devant l’Histoire en sa fabrique, sous couvert d’études sociologiques et d’actions anthropologiques lointaines, le moyen de se nourrir de ces cultures qui fait office de lieu commun. Au regard de quoi on peut se demander s’il n’y a jamais eu des lieux où vie et poésie se confondent, où la vérité de l’individu transparaît un tant soit peu dans son expression ? Ces trois auteurs issus de trois générations différentes (se suivant comme en filiation), ont su organiser leur fuite pour des motifs différents. Mais dans tous les cas, afin de surmonter leur quête de soi impossible dans les lieux qui les ont vus naître et grandir en se confrontant à eux-mêmes par le voyage. S’il y a une seule route à suivre, c’est ce « chemin excentrique » selon Hölderlin, quitte à s’y brûler.
Concernant les arts visuels, il faut lire les propos d’Alain Bourges sur la télévision, sujet de son livre très circonstancié écrit en 2008, au titre ambivalent : « Contre la télévision, tout contre ». Débat inépuisable à propos de ce « monde devenu visible à lui-même », machine dont l’homme n’a jamais été aussi dépendant et ne cesse d’explorer de nouveaux champs d’action. L’omniprésence de l’image, dont l’enjeu s’étend désormais à l’exploration de ses avatars technologiques, cette image à tous les étages de notre vie, laborieuse et pratique, comblant également notre espace culturel (au sens large), a-t-elle de quoi se justifier en tant que nouveau langage ? Et entretiens encore, et entretiens toujours, beaucoup, dans la revue qui traque les conditions de l’expérience de l’écriture soumise à celle de la vie, illisible et insaisissable ; chez des personnalités telles que Marie Cosnay ou Erri De Luca (« citoyen de (s)a langue »), dans l’intimité de leur voix portée, le cas échéant, vers la traduction puisqu’il y est aussi beaucoup question ici. Ainsi, on trouvera de la poésie italienne (à partir de poètes à qui rendre justice ou hommage selon leur notoriété), britannique également, et même de la poésie française traduite en anglais (why not !). Et bien sûr, de la poésie française circonscrite à la langue de Molière ; représentée, entre autres, par Philippe Jaffeux, Noémie Parant, Ariel Spiegler ou Isabelle Pinçon. « Et banc de feuilles descendant la rivière » (jamais la même donc), rubrique introduisant notes, portraits et lectures critiques, de Corso à Martine Konorski, où le bateau s’arrête enfin. Les Carnets d’Eucharis vivent avec leur temps-suspendant-la-matière sous un regard mouvant. Cette matière qui, si elle échappe à certains, à chaque fois s’invite en viatique au pérégrin.
Mazrim Ohrti, vendredi 15 décembre 2017 ………………………………………
Les Carnets d’Eucharis, « Sur les routes du monde », 2017, 192 p. 19€.
| Site : POEZIBAO
18:58 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
09/09/2017
To Each Unfolding Leaf

Pierre Voélin
To Each Unfolding Leaf
To Each Unfolding Leaf est une anthologie américaine proposée et dirigée par John Taylor. Son choix est porté sur une partie de l’œuvre poétique de Pierre Voélin, depuis ses premiers recueils – Sur la mort brève (1984) et Les Bois calmés (1987) – jusqu’aux plus récents – Y (2015) et Des voix dans l’autre langue (2015). Les poèmes sélectionnés s’étendent sur quatre décennies, de 1976 à 2015.
Ainsi que le souligne John Taylor, si Pierre Voélin est sans conteste l’une des figures les plus importantes de la poésie contemporaine suisse francophone, il reste toujours très peu connu des pays anglophones. J. Taylor assure une longue introduction en même temps que la traduction (du français à l’anglais) de l’ensemble paru récemment à New York chez l’éditeur Paul Roth de Bitter Oleander Press.
Né en 1949, à Courgenay, dans le Jura, Pierre Voélin dira être « Suisse par inadvertance ». À ce propos, J. Taylor nous met en garde, ce serait une grave erreur de lire la poésie de P. Voélin dans un contexte littéraire exclusivement suisse. Parmi les influences poétiques de sa jeunesse, on peut allégrement citer, au premier chef René Char, puis Henri Michaux et Francis Ponge, sans omettre son admiration pour Jacques Dupin et Jean Grosjean.
Sur cette étendue de 40 années de poésie, les paysages évoluent dans leurs particularités, nous assurant que le pouvoir de la poésie est d’être toujours « ce mince filet d’eau que l’on continue d’entendre au cœur de la nuit ». P. Voélin est particulièrement sensible aux tragédies de l’Histoire (les génocides de la Shoah, du Rwanda, la guerre en ex-Yougoslavie) et à la nuit des poètes qui ont souffert de l’enfer de leur temps (Akhmatova, Mandelstam, Celan…). Marion Graf précise que « La diction de Voélin, brisée, étincelante, elliptique, reste marquée par la fréquentation décisive de ces poètes ». Pour René Char, nous rappelle P. Voélin, le poète est le « conservateur des infinis visages du vivant ».
Les poèmes choisis révèlent des thèmes récurrents, comme l’exaltation de l’amour (et la perte), le rapport de l’individu à la nature (et particulièrement à l’environnement rural), les possibilités d’une quête spirituelle au cœur du monde contemporain… Dans son rapport au monde, le poète reconnait entretenir « un rapport panique… Il y a une intensité, une urgence ». De fait, ce rapport donne à sa poésie d’être ancrée dans le réel « où il n’y a pas de gras, mais de l’os, de la structure », dit-il.
Les 8 sections de l’anthologie nous font entendre une poésie que le seul mot de « lyrique » ne suffirait pas à définir, les poèmes étant conduits par une profonde empathie pour le monde du vivant, et envers quoi le poète veut tenir parole, faire tenir la parole debout, l’écriture en recours, à ne cesser de louer (pour ne pas oublier) les victimes et les opprimés de l’Histoire. « Écriture (…) établissant, / rétablissant partout sur les vieilles terres d’Europe le cadastre du feu ». Mais plus encore : « Écriture comme on partage le pain et le sel. » Le texte « Des cris et du silence », écrit en 1994, porte une épigraphe en hommage aux habitants de Sarajevo, du temps de la Bosnie assiégée par l’armée serbe.
Le poème « Nuit du premier Novembre » est dédié à Paul Celan, le poète est ici célébré au cœur d’une écriture amie : « Il rouvre encore les pages noires de l’ortie / avant que d’un coup ne l’embarque un fleuve ». Le poème « Les Bois Calmés » s’adresse à Pierre Chappuis, l’ami proche : « Douleur est l’autre voix qui nous rassemble ». Si la toponymie est la poésie des géographes, elle est aussi celle des poètes. Une note de Pierre Voélin nous apprend que Les Bois Calmés est une localité que l’on peut trouver sur la carte de France, quelque part en Franche-Comté. Il précise : « c’est un lieu-dit repéré sur la carte au 25/000 millième lors de mes nombreuses promenades de l’adolescence dans ce coin de pays – ce doit être un angle de forêt, et un bout de pré où paissent des vaches de la race montbéliarde, à grandes taches rouges sur le ventre, le dos, le haut des pattes ». Pierre Voélin se définit « comme un poète frontalier, un poète français de la façade est de l’Hexagone ».
L’Arménie comptera parmi ses pays d’élection. Il dit avoir rêvé d’un voyage en Arménie en découvrant le texte éponyme d’Ossip Mandelstam, dans la traduction d’André du Bouchet. C’est en 2009 qu’il y met les pieds, en compagnie de quelques amis. Et c’est à cette occasion qu’il écrit « Le poème en Arménie : notes ».
Avec To Each Unfolding Leaf, nous entrons dans les sous-bois et les hauts-plateaux de la langue. Poésie qu’on peut dire vallonnée, en rien étale, d’où la langue est « langue contournée / debout dans le chêne / … et si longtemps perdue ». Paysages accidentés d’où écouter dans leur étrange consonance « le myosotis poudreux de la douleur ». Le froid accompagne toute parole, écrit Pierre Voélin, « Je chante avec les pousses du froid / et les ramures et le noir d’écorce ». Puis, « l’esprit s’ouvre à des puis de neige (…) / Février jette sur la neige une poignée d’abeilles ». Et enfin, « Vivre de ce peu – de cette lumière de neige / de ce rien qu’offre la neige ».
Y, séquence écrite entre 2011 et 2013, a pour légende un extrait de la Vita Nuova de Dante. Y voir peut-être comme une espérance toujours possible, entre les nœuds et les décousus de la nuit, qui donne aux fleurs les plus « accourcies » d’encore pouvoir fleurir et au cœur de pareillement battre « en son jardin de graines ». Dans l’épissure du monde, « l’exil infini de l’amour ».
« Amour que j’appelle … / Que les pluies viennent te prendre par la taille / qu’elles célèbrent ton pas d’amoureuse / la menuiserie de ta gorge ».
08/09/2017
:- :- :- :- :- :
© Nathalie Riera
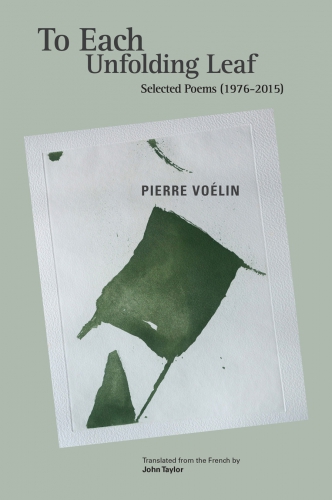

ǀ SITE : bitter oleander press (bop)
Cliquer ICI
15:17 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pierre Voélin | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
02/09/2017
Olivier Rolin
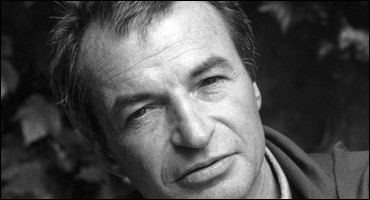
Olivier Rolin
Olivier Rolin, un écrivain de l’investigation
Appréhender l’œuvre d’Olivier Rolin, en fournissant quelques clefs de lecture, tel est le défi et le vœu exaucé de Gérard Cartier en réunissant 16 contributeurs dans le dernier numéro de la revue Europe (juin-juillet-août 2017). En tant que proches ou amis, C. Garcin, M. Enard, J. C. Bailly, P. Michon, J.C. Milner… tous auscultent une œuvre essentiellement composée de romans et de récits géographiques, une production intellectuelle où Littérature, Histoire et Géographie se définissent pour G. Cartier comme les trois pôles « du triangle magique qui structure l’imaginaire d’Olivier Rolin ».
Cartier interroge l’écrivain, notamment sur sa période de militantisme politique, une expérience que Rolin ne manque pas de juger comme initiatrice à son activité de romancier. Son engagement au sein de la Gauche Prolétarienne (1967-1974) puis, par la suite, son investissement en qualité de reporter-journaliste, auront été sûrement déterminants dans sa nécessité de s’inscrire dans le « réel » – comme Rolin le précise, entendre par « réel » la géographie, la topographie –. Son regard sur le roman en tant que forme littéraire s’appuie chez lui sur deux figures illustres, Barthes et Kundera. Dans les Propos recueillis par G. Cartier, à la question de savoir à partir de quoi écrivons-nous, la réponse de Rolin est claire et sans emphase : « C’est à partir d’une débâcle que j’ai commencé à écrire ». Il affirme que la littérature a été sa « sortie d’Egypte ».
Parler d’écriture chez Rolin relève d’une certaine modestie, celle de tenter des hypothèses et de ne pas être toujours dans des affirmations radicales : « (…) écrire répond au début à un désir de sortir du carcan des certitudes politiques, et aussi de ‘m’en sortir’, tout simplement. C’est une démarche d’éloignement, un mouvement centrifuge (…) C’est Barthes encore qui le dit : écrire, c’est faire sécession ».
Poètes, écrivains, artistes ne sont pas toujours en accord avec leur société. Parmi les désaccords ou les colères de Rolin, on retiendra son refus à « cette détestation actuelle de la nostalgie », puis à cette « étrange maladie » que peut être la haine du passé. Parce qu’il est aussi poète, Gérard Cartier sera particulièrement sensible à l’usage de la langue d’Olivier Rolin, à son « extrême diversité » qui est de recourir « à tous les niveaux de vocabulaire, du plus savant (le latin et le grec) au plus familier et même, à l’occasion, au trivial ». L’écriture chez lui n’est pas une écriture qui se répète, souligne G. Cartier, elle « se réinvente de livre en livre ».
Pour Christian Garcin, « O. Rolin est un écrivain qui a du souffle » ; pour Pierre Michon, il « est l’exemple de celui qui à grands pas (…) m’aide à sortir de la terreur » ; pour Jean-Claude Milner il « est habité par une passion. Elle a un objet qui se nomme monde ». Norbert Czarny retient de la littérature telle que lue et pratiquée par Rolin qu’elle « n’est pas un jeu mondain. Elle à avoir avec la mort, elle est un risque, pour qui écrit et pour qui lit ». Agnès Castiglione interroge le lien de la Littérature et de l’Histoire. Chez Rolin la Littérature ne peut pas être conçue sans un écho du passé, avec lui le roman se fait plutôt « art de la mémoire », « c’est cette aptitude de la littérature à faire dialoguer entre elles, à travers tous les siècles, les grandes voix de l’humanité, à mettre en communication le passé et l’avenir, comme dans la transmission d’un héritage ».
Jean-Claude Pinson a connu « fugitivement » Rolin à une époque lointaine, du temps où tous deux fréquentaient le même lycée. Pinson analyse les raisons qui ont conduit Rolin à recourir à la littérature, et notamment à l’écriture romanesque, choix déterminé, selon lui, par le fait que le recours au roman « est justifié par des valeurs d’ordre philosophique (éthique) autant qu’esthétique. C’est qu’il s’agit d’abord d’en finir avec le mensonge entretenu par les illusions et les simplifications de la pensée militante. Prenant acte de ce que fut le XXe siècle, ‘celui de grands mensonges sanglants’, O. R. choisit, en lieu et place de l’idéologie politique, de ses certitudes et de ses ‘mots d’ordre’, le roman, son scepticisme, son sens de la complexité… ». Si le roman est bien trop souvent l’ennemi du poète – jugement partagé et admis par Olivier Rolin – , le choix de la prose chez lui est justement de ne pas mettre de côté la poésie. Pinson souligne qu’ « il n’y a pour lui qu’une nature de la littérature ».
Pour Jean-Pierre Martin, la littérature comme régénérescence, comme possesseuse d’une « vertu », comme réparatrice du passé, « appelle à une refondation ». Martin ajoute : « Ce qui réunit Ponge et Michaux, Nabokov et Orwell, Borges et Cendrars, d’autres encore – tous plus ou moins passeurs de Rolin –, c’est l’exploration et la réinvention du dictionnaire. Le langage comme investigation ».
Investigation, un mot qui sied bien à cet écrivain de notre temps, lequel ne manquera pas – après son aventure subversive au sein de la Nouvelle Résistance Populaire – de pratiquer l’humour et l’auto-dérision, probablement comme un recours à plus de justesse.
© Nathalie Riera
Les Carnets d’Eucharis
01/09/2017
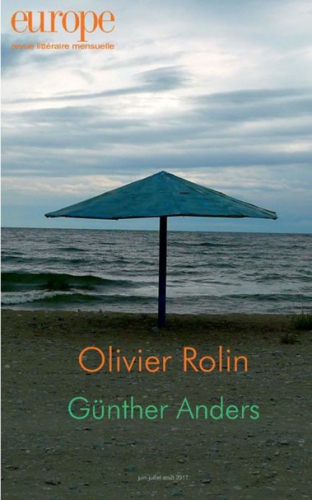
ǀ La Revue EUROPE
Cliquer ICI

© Vignette : Axel Boyer
ǀ Les Carnets d’Eucharis

Cliquer ICI
Autre site à consulter : ǀ remue.net
18:21 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Olivier Rolin | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
22/08/2016
Charles Reznikoff - Rythmes 1 & 2, Poèmes (Ed. Héros-Limite)

Charles Reznikoff
AVEC LE RÉEL
Avec « No ideas, but in things » (Pas d’idées, sinon dans les choses), maxime du poète américain William Carlos Williams, dans son poème A sort of a Song, perçu comme un mantra pour la poésie au début du XXème siècle, le poète se tient en marge des concepts et des métaphores, des abstractions et des fioritures métaphysiques. Se concentrer sur la chose pour la traiter dans son aspect défini, aux yeux des Imagistes modernes la poésie est en prise directe avec le réel, ce qui veut dire précision, économie de mots, être à l’écoute des rythmes de la parole de tous les jours : on parlera d’une esthétique démocratique.
Fils d’émigrants juifs, Charles Reznikoff, poète du courant dit « objectiviste », commence à écrire en 1918. Rhythms (1918) & Rhythms II (1919) et Poems (1920), puis Separate Way en 1936, chez Objectivist Press*. Viendront ensuite deux livres majeurs : Témoignages/Testimony (1965) puis Holocauste (1975). Ce qui réunit ces deux ouvrages, c’est la construction d’une œuvre à partir d’archives des tribunaux américains (Témoignages) et d’archives du Procès des criminels devant le Tribunal militaire de Nuremberg (Holocauste).
La poésie, pour Reznikoff, « présente l’objet afin de susciter la sensation. Elle doit être très précise sur l’objet et réticente sur l’émotion ».
* Ces deux livres sont en parution aux éditions Héros-Limite : Rythmes 1 & 2 Poèmes (2013), Chacun son chemin (2016)
22/08/2016
:- :- :- :- :- :
© Nathalie Riera
EXTRAITS
14
Comment donc vous pleurer, qui fûtes tués, gâchés,
certain que vous ne mourriez pas sans avoir achevé
Votre tâche,
Comme si la faux dans l’herbe s’arrêtait pour une
fleur ?
---------------------------------------------(p.23)
Rythmes 1
(traduit de l’anglais par Eva Antonnikov et Jil Silberstein)
How shall we mourn you who are killed and wasted,
sure that you would not die with your work unended,
as if the iron scythe in the grass stops for a flower ?
***
1
Pas même eu le temps de me tenir parmi les prés,
ni de m’offrir pleinement à la tendre écume,
et déjà te voici, vent mauvais.
---------------------------------------------(p.29)
Rythmes 2
I have not even been in the fields,
nor lain my fill in the soft foam,
and here you come blowing, cold wind.
***
13
Depuis son lit, elle pouvait voir la neige envahir
lentement les ténèbres,
compacte autour des réverbères comme phalènes en été.
Tout juste si elle pouvait bouger la tête. Des mois
qu’elle était alitée.
Son fils s’était fait grand, large d’épaules, son
visage rappelant toujours plus celui de son père à elle,
mort depuis des années.
Elle reposait sous l’édredon comme si elle-même était
recouverte de neige,
calme, affrontant la noirceur de la nuit
qu’emplissaient des flocons tourbillonnant ainsi que des étoiles.
Mort, cloué dans une caisse, son fils lui avait été expédié,
à travers villes et prairies transies et blanchies par la neige.
---------------------------------------------(p.71)
Poèmes
From where she lay she could see the snow crossing the darkness slowly,
thick about the arc-lights like moths in summer.
She could just move her head. She had been lying so for months.
Her son was growing tall and broad-shouldered, his face becoming like that of her father,
dead now for years.
She lay under the bed-clothes as if she, too, were covered with snow,
calm, facing the blackness of night,
through which the snow fell in the crowded movement of stars.
Dead, nailed in a box, her son was being sent to her,
through fields and cities cold and white with snow.
ǀ SITE : Les Éditions Héros-Limite
Cliquer ICI
19:34 Publié dans Charles Reznikoff, Héros-Limite, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
27/05/2016
P. P. Pasolini, La rage - éditions Nous, 2016
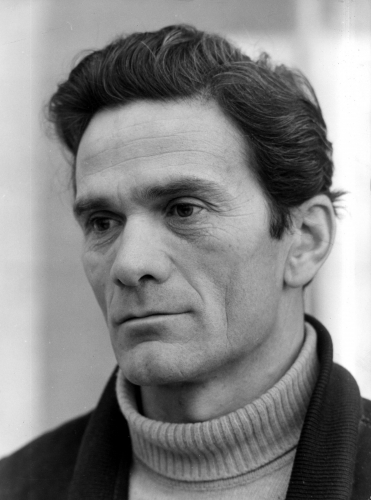
LA RAGE
La « force diagonale » avec Hannah Arendt, la « Survivance des lucioles » avec Georges Didi-Huberman, « organiser le pessimisme » avec Walter Benjamin… relire ces textes en ces temps où l’on n’a toujours pas « couper la mèche – avant que l’étincelle n’atteigne la dynamite » - revisiter les « Ecrits corsaires » du scandaleux P. P. Pasolini et son célèbre article du 1er février 1975, l’article de son pessimisme définitif et radical : « La disparition des lucioles ». Puis, parmi les nouveautés, « La rage », texte du film « La rabbia », enfin traduit pour la première fois en France aux Editions Nous. Retrouver ici un Pasolini en résistance, allié des minorités, à l’époque des dernières utopies, et avant sa rupture au début des années 1970 avec un cinéma plus métaphorique.
LA RAGE (La Rabbia), film sous-estimé par le grand public, produit par Gastone Ferranti (Directeur de la société Opus Film), est sorti en Italie en avril 1963. Construit à partir d’archives d’actualité des années 1950 et 1960, sa réalisation en deux parties convoque P.P. Pasolini et l’écrivain, journaliste et satiriste Giovannino Guareschi. Les deux hommes, dans leurs visions diamétralement opposées, sont conviés de répondre à la question: «Pourquoi notre vie est-elle dominée par le mécontentement, l'angoisse, la peur de la guerre, la guerre?». Avant la réalisation de ce film, Guareschi n'était pas prévu au projet. Ferranti dirigeait depuis de nombreuses années des images d'actualités non-utilisées qu'il confia à Pasolini pour le montage. Mais la version proposée par le cinéaste - le choix du sujet, le montage et les commentaires - ne sera pas validée. Liés par un contrat, néanmoins les deux hommes s'accorderont à faire suivre la version de Pasolini d'un volet supplémentaire, en le confiant à un autre auteur. Pasolini pensait aux journalistes Montanelli, Barzini ou Ansaldo, mais ce sera l'humoriste réactionnaire Guareschi qui assurera la deuxième partie du film. LA RAGE est en fait deux films en un: un film de Pasolini et un film de Guareschi, aux antipodes l'un de l'autre. La Rage restera en salles à peine quatre jours.
Film italien aujourd’hui presque oublié, en France les Éditions NOUS nous offrent la lecture d’un «journal lyrique et polémique à l’époque des dernières utopies pasoliniennes» (Roberto Chiesi). Comme l’écrivait Alberto Moravia, Pasolini a toujours «fait passer le poétique avant l’intellectuel», la critique littéraire avant l'essai idéologique. Scandaliser, blasphémer, on dira de l’écrivain, du cinéaste et du critique qu’il est «l’homme qui dit tout ce qu’il pense, l’homme de la transparence, de l’athéisme politique. Grâce à quoi, il était devenu une sorte de conscience publique pour les Italiens»[1].
Nous savons que presque toutes les œuvres de Pasolini ont fait l’objet de procès, de condamnations jusqu’à souffrir de la censure. Les insurrections de Pasolini sont nombreuses: contre l’homme-masse, contre le néo-fascisme parlementaire en tant que continuum du fascisme traditionnel, contre le «développement» et la montée du matérialisme capitaliste, contre la fossilisation du langage, contre la télévision qu'il comparait à l'invention d'une nouvelle arme «pour la diffusion de l'insincérité, du mensonge, du mauvais latin»[2]. Du temps des Scritti Corsari Pasolini ne pouvait tolérer l’idéologie hédoniste, car c’était pour lui tolérer « la pire des répressions de toute l’histoire humaine ».
Chacune de ses interventions polémiques pourrait se définir ainsi que ce que lui-même en disait: «d'être personnelle, particulière, minoritaire. Et alors?»[3].
Certaines séquences de LA RAGE seront abandonnées par le producteur, mais seront reprises par Pasolini dans la rédaction définitive du texte littéraire: «Cent pages élégiaques en prose et en vers et un tissu d'images en mouvement, photographies et reproductions de tableaux: dans le laboratoire du film La rage, Pier Paolo Pasolini expérimenta pour la première fois une forme différente de la narration filmique traditionnelle et des conventions du documentaire»[4].
27/05/2016
:- :- :- :- :- :
© Nathalie Riera
[1] Pier Paolo Pasolini, Écrits Corsaires, éd. Champs Arts, 2009 – Traduit de l’italien par Philippe Guilhon – Philippe Gavi et Robert Maggioni, p.13.
[2] Pier Paolo Pasolini, La rage, éd. Nous, 2016 – Traduit de l’italien par Patrizia Atzei et Benoît Casas – Introduction de Roberto Chiesi Nouvelle édition en format poche, p.50.
[3] Écrits Corsaires, p.151.
[4] La rage (Roberto Chiesi), p. 7.
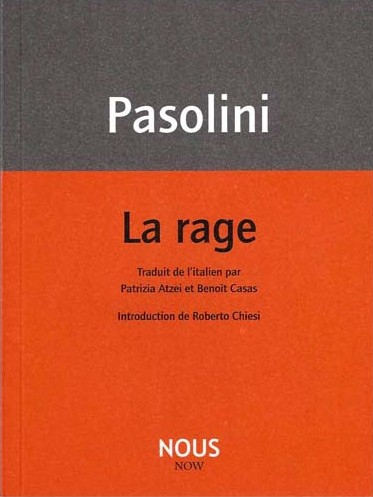
ǀ SITE : Les Editions Nous
Cliquer ICI
ǀ LA RABBIA : Le film sur youtube
14:59 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Nous, Pier Paolo Pasolini | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
06/05/2016
Jacques Estager, Fée et le Froid, Ed. Lanskine, 2016

Jacques Estager
Photo © Nathalie Riera, 2012
FÉE ET LE FROID
De Jacques Estager, en poésie, ces quelques recueils depuis 2010 : « Je ne suis plus l’absente », « Deux silhouettes, Cité des Fleurs » (2012) « Douceur » (2013), - trois recueils chez le même éditeur Lanskine – jusqu’à ce tout dernier petit opus Fée et le Froid qu’on pourrait dire de même veine que les précédents, tant la main est parcourue par ce qui ne sera plus retrouvé, par ce qui est fantôme, par ce qui est Fée et Froid, par ce qui s’efface. Parcourir le long chemin du poème pour s’y perdre, se perdre dans la sente du poète qui aime nous perdre, c’est peut-être cela le secret de l’écriture de Jacques Estager. Aucune place à l’analyse, mais plutôt un poème qui s’offre jusqu’à nous appartenir, et ensuite l’invitation à nous en dessaisir totalement : la dissection ne serait que préjudice à notre propre lecture.
Certes « glacées les herbes de la sente », mais il y a la belle nuit, « la nuit fée », ainsi va le monde, tout un autre monde, de notre propre introspection. Toujours écrire toujours plus, quand « la clarté c’était hier », celle de la neige, celle des « reflets de feu dans les vitres ». Fée et le Froid est une constellation de mots-étoiles comme les plus mystérieuses des étoiles filantes, ou des étoiles de mer. Sans oublier que l’étoile est une boule de plasma de même qu’elle possède un champ magnétique. Ainsi le poème est cette étoile à la croisée de nos routes intérieures, ces mêmes routes réempruntées tant et tant de fois ou jamais, et sur lesquelles on s’attarde comme « terres franchies ». L’imagerie de Jacques Estager est comme la nuit, de nulle prétention, la morphologie des phrases participant à ce qui se veut méconnaissable, discordant non par provocation. Mais plutôt une syntaxe rompue à toute bienséance.
Fée et le Froid s’écrie entre « des mondes de détresse » et « la rivière des enfants ». Ce qui fait non pas toute sa contradiction, mais son humanité sans larme.
Froissement de mots, « déchirure la soie », le rouge et le rose toujours à se mêler, et « ce soleil » et cette « herbe or » qu’il ne faut pourtant pas prendre pour promesses. Juste cela : avec Fée et le Froid, ne pas décomposer, mais juste cela : lire le poème à l’œil nu comme une photographie nous dit le temps révolu à jamais.
06/05/2016
:- :- :- :- :- :
© Nathalie Riera
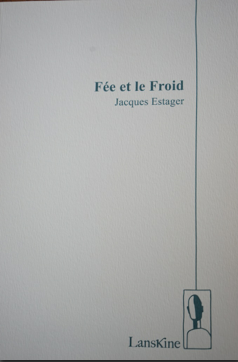
ǀ SITE : Les Editions Lanskine
Cliquer ICI
21:50 Publié dans Jacques Estager, LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
31/03/2016
Ryôichi Wagô, Jets de poèmes, dans le vif de Fukushima (lecture de Nathalie Riera)
Ryôichi Wagô
Jets de poèmes
dans le vif de Fukushima
po&psy a parte érès, 2016
Traduit du japonais par Corinne Atlan
Encres sur papier de soie: Elisabeth Gérony-Forestier

Ryôichi Wagô
Retour temporaire à leur domicile de personnes évacuées de Minamisôma et Tomioka, préfecture de Fukushima. Première autorisation de retour accordée par les collectivités régionales de la zone côtière.
15217 morts, 8666 disparus.
(25 mai 2011)
Le 11 mars 2011, le poète japonais Ryôichi Wagô décide de rester dans son appartement à dessein de témoigner et de donner à l’espoir une forme palpable, tout en répétant inlassablement « Il n’est pas de nuit sans aube ». Se métamorphoser en asura, écrire comme un asura, ce démon perturbateur de la mythologie hindoue et bouddhique, c’est alors et aussi pour le poète une manière de « ne pas renoncer à Fukushima, vivre avec Fukushima, vivre Fukushima ». La rage est noire. Et la rage au cœur, Ryôichi décide de tweeter ses pensées, « avec radiations et répliques pour compagnons de route ». Lancer son jet de poèmes, quand dehors, c’est la nuit sans autre perspective que la nuit, avec 100396 maisons entièrement ou partiellement détruites par le séisme, des coupures d’électricité, des largages d’eau par voie aérienne sur les réacteurs, des vrombissements d’hélicoptères, leurs tournoiements incessants dans le ciel, et le nombre de morts qui augmente d’heure en heure. Gymnase et terrain de base-ball se transforment en morgue et en crématorium. Désormais, le nom de Fukushima sonne comme « Ile-du-Malheur ».
Mon pays natal est un crépuscule.
5 avril 2011 – 22 : 25
Dans la cuisine de l’appartement la vaisselle est en miettes, et dans la salle de bains l’eau de la baignoire est rouge. Le poète se sent désormais revêtu d’un autre moi, « un moi pesant, désespéré, triste, inconsolable ». La catastrophe s’empare de tout, jusqu’à l’intérieur de vous : « La catastrophe est en toi ». Survivre à Fukushima c’est vivre avec les répliques de plus en plus nombreuses, et « l’impression de trembler en permanence », et la solitude de s’approfondir, et la rage à vous tordre le ventre, et votre corps qui n’est plus que larmes. Il faut pourtant pouvoir apaiser la colère, trouver à guérir, malgré la mort et l’anéantissement, « continuer à vivre, même à petit feu ».
Ce qui ne bouge pas, ce sont les souvenirs. Il y a la grand-mère et ses boulettes de riz au miso, l’enfance aux couleurs d’arc-en-ciel, et au bout du tunnel de la catastrophe – la pire depuis le séisme du Kantô de 1923 et le grand tremblement de terre de Kôbe en 1995 –, la prière de voir s’approcher « en catimini le printemps et ses bourgeons », même si demain ce sera vivre le prolongement d’aujourd’hui, endurer le prolongement d’aujourd’hui, écrit le poète.
Notre monde a produit le lait du chagrin.
27 mars 2011 – 22 : 22
Les poèmes-tweet de Ryôichi sont des mantras dispersés chaque jour et chaque nuit sur la toile numérique. Deux mois et dix jours d’un travail d’écriture commencé le 16 mars 2011, avec le soutien de centaine d’abonnés.
Ryôichi Wagô vit toujours à Fukushima. Son recueil « Jets de poèmes/shi no tsubute » a fait l’objet d’une publication au Japon, suivi de : « Hommage silencieux/shi no mokurei » (à la mémoire des disparus) et « Retrouvailles/shi no kaikô » (adressé aux survivants).
© Nathalie Riera, 31 mars 2016.
Les Carnets d’Eucharis
EXTRAITS
Dis, grand-père, quel goût avaient les steppes de Sibérie pendant la guerre ? Tu sais, grand-père, ici aussi, l’après-guerre a commencé. Sibérie, métaphore de l’hiver. Terre lointaine, quel vent te balaye aujourd’hui ? Je vois un arbre gelé sur une colline.
20 mars 2011 – 22 : 38
------------------------------------------------------ (p.77)
Alerte sismique. Epicentre au large de Miyagi. Alerte sismique. Epicentre au large d’Ibaraki. Alerte sismique. Epicentre au large d’Iwate. Alerte sismique. Epicentre sur la troisième étagère du réfrigérateur. Alerte sismique. Epicentre sur ma chaussure droite. Alerte sismique. Epicentre sur la cagette d’oignons. Alerte sismique. Epicentre sur mon dictionnaire. Alerte sismique. Epicentre au cœur du printemps.
20 mars 2011 – 22 : 52
------------------------------------------------------ (p.79)
Que signifie « maitriser » ? Réplique.
22 mars 2011 – 22 : 08
Est-ce que vous savez la « maitriser », l’énergie nucléaire ? Réplique.
22 mars 2011 – 22 : 13
L’humanité a-t-elle déjà vu le vrai visage de l’énergie nucléaire ? Réplique.
22 mars 2011 – 22 : 16
------------------------------------------------------ (p.103)
J’appelle la « maîtrise » de mes vœux. Il me reste encore un semblant de famille et de ville natale. C’est une bénédiction… en comparaison de ceux qui ont tout perdu… Que faire sinon pleurer ? Nous sommes pareils à des voyageurs dans une lande sauvage battue par les vents, sur le point de perdre leurs précieuses sandales de paille. Réplique.
22 mars 2011 – 22 : 32
------------------------------------------------------ (p.104)
Les montres du nord-est du Japon retardent toutes d’une minute. Les numériques, les analogiques, les magnétiques, les sabliers, les clepsydres, les cadrans solaires, les horloges à vent, les horloges biologiques. Est-ce qu’elles sont toutes restées bloquées sur 2h47 de l’après-midi le 11 mars ?
1er avril 2011 – 22 : 25
------------------------------------------------------ (p.195)

L’ouvrage sera disponible en librairie à partir de la mi-avril.
Association PO&PSY
95A rue du Castelas, 30260 LIOUC
06 72 67 41 98
http://www.poetpsy.wordpress.com
Les personnes intéressées peuvent s'adresser aussi directement à l'éditeur :
Contact
■ ICI
19:04 Publié dans JAPON, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Po&Psy, Ryôichi Wagô | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
29/01/2016
André Du Bouchet (Entretiens avec Alain Veinstein) - L'Atelier Contemporain et l'I.N.A., 2016
André Du Bouchet
« Entretiens avec Alain Veinstein»
| © L’Atelier Contemporain & Institut National de l’Audiovisuel, 2016
par Nathalie Riera
_______________
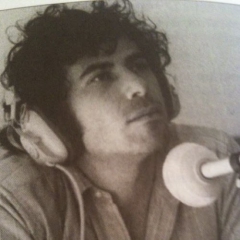

© Alain Veinstein et André Du Bouchet
Si la poésie est sans pouvoir, il y a selon André du Bouchet « un grand vouloir ». Et s’il fallait chercher l’origine de la modernité du côté de Mallarmé comme il en a toujours été le cas, à cela Du Bouchet n’hésite pas à dire : « La modernité selon moi est sans origine ». À la place de la modernité, Du Bouchet évoque l’idée d’un « intemporel qui ne se laisse pas localiser ».
L’Atelier Contemporain, avec le concours de L’Institut National de l’Audiovisuel, vient de publier un recueil d’entretiens d’André Du Bouchet avec Alain Veinstein, entretiens donnés entre 1979 et 2000. L’homme de radio est aussi poète, mais la lecture quotidienne de livres, tout son temps donné à suivre l’actualité littéraire, éloignera Alain Veinstein de l’essentiel, c’est-à-dire, comme lui-même l’écrit : « au point même de perdre longtemps le goût d’écrire ».
Parce que sa relation à André Du Bouchet était placée sous le sceau de l’intensité et d’une évidente sincérité, Veinstein décidera de poursuivre les lectures du poète et ses rencontres avec lui par le biais d’entretiens radiophoniques réalisés au domicile d’André Du Bouchet, ce qui ne rendra pas la tâche aussi aisée pour l’interviewer qui reconnait être investi d’une double peur : « devenir un autre aux yeux d’André ; ne pas réussir à transmettre à ceux qui nous écouteront le choc de sa présence ».
Si Du Bouchet pratique un certain détachement à l’encontre de la poésie, on peut lui concéder une grande fidélité à certains poètes, ainsi que peuvent l’attester sa longue fidélité à Baudelaire et son admiration pour Pierre Reverdy. Il y aura l’écriture de Baudelaire irrémédiable (publié en 1956) et dans le souvenir des premières lectures de jeunesse, Rimbaud et Du Bellay. Si Du Bouchet affirme qu’une conversation avec Baudelaire ou Reverdy « peut être engagée », ce ne sera pas le cas avec Rimbaud. Il n’écrira pas sur lui, parce que Rimbaud a déjà tout dit et « ajouter quoi que ce soit serait incongru ».
Pas d’écriture chez le poète sans l’intention d’un renversement. Il le dit en ces termes : « il y a un mouvement qu’il s’agit de renverser : ne pas aller dans le fil de ce qui se détruit à chaque instant sous nos yeux ». L’édification contre la destruction ? L’écriture chez Du Bouchet c’est d’abord des prises de notes « sans finalité » dans des carnets, dont la plupart seront perdus, égarés. Noter dans un carnet n’a pas forcément de finalité, c’est aussi « écrire en pure perte ». Le livre n’est pas une fin en soi, dit-il. Néanmoins, le carnet est non plus ce lieu où les notations peuvent devenir poèmes. Tout ce qui est consigné est sans visée, rien de préétabli. Du Bouchet voit en l’existence de l’écrivain quelque chose qui n’est pas continue, mais plutôt momentanée, ce qui lui fait dire qu’on peut être écrivain « trois minutes à peine ». Et l’on est écrivain que lorsqu’on écrit.
Le poète ne « s’attable » pas pour écrire des poèmes. Bien souvent, les notes sont prises debout, au long de randonnées, «…elles ont été écrites, en somme, pour me tenir compagnie ». André Du Bouchet a du mal à justifier son activité d’écrivain. Autant de mesure, de retenue, cela ne doit pas pour autant le placer dans une solennité ennuyeuse. Il y aurait plutôt en son geste d’écrire comme une forme d’insoumission, mais également une nécessité de redécouvrir la « relation » ou « l’échange », c’est-à-dire ce qui est le contraire de la « communication ». Redécouverte qui sollicite « un mouvement de retour à la langue », ce qui signifie « un mouvement de retour à soi ». Chez lui, donc, cette exigence en même temps que cette liberté fondamentale de revenir aux racines, aux origines de la langue, de toucher « à une fraîcheur d’étymologie », contre « une sorte de bande dessinée (qui) tend à se substituer à la langue ». Il s’agit de se rejoindre et, par conséquent, rejoindre « un autre à l’infini ».
Dans la relation que Du Bouchet entretient avec le lecteur, il y a cette même implication, ce même engagement. Ce n’est pas d’un simple lecteur qu’il s’agit, mais d’un « vrai lecteur », c’est-à-dire de quelqu’un qui « n’est pas différent de celui qui se trouve impliqué dans un rapport avec quelqu’un d’autre, qui est engagé dans une conversation avec quelqu’un d’autre ». L’écriture, la lecture, qu’est-ce qui pourrait différencier ces deux activités singulières, si ce n’est qu’être un écrivain c’est aussi être un « lecteur virtuel », et que lire implique deux êtres en conversation, « deux êtres en présence, qui ne font plus qu’un ».
Sur l’élaboration du poème, il y a cette parenté avec Alberto Giacometti dans le fait même de vouloir retrouver « le point de départ, qui est le point vivant, toujours perdu, noyé, dans cette accumulation de mots ». Du Bouchet dira du sculpteur qu’il « rejoint la tige de métal plantée dans le sol (…) Pour lui, élaguer, c’est retrancher ce qui a été ajouté et retrouver la tige, cette tige d’un homme dans l’économie de la langue, pour retrouver ce point vivant qu’on appelle parfois un poème (…) ». Veinstein souligne que la syntaxe du poète est très travaillée, qu’elle coexiste avec des mots qui « relèvent de l’élémentaire ». Faut-il également ajouter que Du Bouchet ne prête pas aux mots d’être immobiles : « un mot est toujours au futur, mobile, mouvant à l’infini ».
Du Bouchet est aussi connu pour ses traductions de Shakespeare, Hopkins, Joyce, Mandelstam, Hölderlin, Celan. Le poète a toujours relié l’expérience de la traduction à l’expérience de la poésie, « tout est toujours affaire de traduction ». Également ouvert à l’espace de la peinture, il fréquentera Jean Hélion, Alberto Giacometti, Bram Van Velde, Pierre Tal-Coat. Les livres d’artistes seront tous « issus d’un rapport d’amitié ». La première couverture de ces entretiens reprend un portrait du poète en mine de plomb, signé Tal-Coat, en 1975.
Le regard d’André Du Bouchet sur le monde est celui d’un homme confronté à tous les « éboulements », à tous les bouleversements dans tous les coins du monde. Durant son dernier entretien enregistré le 9 novembre 2000, à Paris, dans l’appartement de la rue des Grands-Augustins – cette même rue où Picasso peignit Guernica – quelques mois avant sa disparition, Du Bouchet dira de la violence qu’elle « prend des formes différentes, mais elle est toujours à l’œuvre sous nos yeux. Et c’est peut-être là aussi que se détermine un rapport avec le langage. Le langage n’est plus donné. Nous sommes toujours dans un rapport d’affrontement. Nous sommes en guerre dans la langue ».
Lorsqu’on sait que la poésie tend, encore aujourd’hui, « à être tout à fait niée », n’est-il pas essentiel de ne prêter à la poésie aucun masque, de ne pas l’affubler d’un rôle. C’est sans la moindre affèterie que ces entretiens sont à l’image de ce que Du Bouchet dira de la poésie, d’être « la forme de communication singulière qui est, je crois, la seule réelle».
« La poésie (…) c’est une fraîcheur de communication ». Et il n’y a pas de poème sans « un geste d’amitié ».

| Le site de l’éditeur
http://editionslateliercontemporain.net/
22:59 Publié dans André du Bouchet, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
25/11/2015
Philippe Lacoue-Labarthe, la poésie comme expérience (une lecture de Nathalie Riera)

(à gauche) Paul Celan
Mesdames et Messieurs, il est aujourd'hui passé dans les usages de reprocher à la poésie son «obscurité». – Permettez-moi, sans transition – mais quelque chose ne vient-il pas brusquement de s'ouvrir ici ? –, permettez-moi de citer un mot de Pascal que j'ai lu il y a quelque temps chez Léon Chestov : « Ne nous reprochez pas le manque de clarté puisque nous en faisons profession ! »
– Sinon congénitale, au moins conjointe-adjointe à la poésie en faveur d'une rencontre à venir depuis un lieu lointain ou étranger – projeté par moi-même peut-être –, telle est cette obscurité.
Paul Celan, Le Méridien & autres proses, Seuil, 2002, traduit par Jean Launay
Le poème peut, puisqu’il est un mode d’apparition du langage et, comme tel, dialogique par essence, être une bouteille à la mer, mise à l’eau dans la croyance – pas toujours forte d’espérances, certes – qu’elle pourrait être en quelque lieu et quelque temps entraînée vers une terre, Terre-Cœur peut-être. Les poèmes sont aussi de cette façon en chemin : ils mettent un cap. Sur quoi ? Sur quelque chose qui se tient ouvert, disponible, sur un Tu, peut-être, un Tu à qui parler, une réalité à qui parler.
Paul Celan, « Allocution de Brême », in Le méridien & autres proses
■■■
« La poésie comme expérience » (paru pour la première fois en 1986), une nouvelle édition dans la collection « Titres » des Editions Christian Bourgois, nous est donnée à relire. Il s’agit d’un essai du critique et philosophe Philippe Lacoue-Labarthe. Livre-phare qui nous conduit à revenir sur Le Méridien de Paul Celan – texte de l’allocution qu’il prononcera le 22 octobre 1960 à l’occasion de la remise du prix Georg Büchner –. Si Le Méridien est une réponse à Martin Heidegger, ce texte vient aussi inaugurer à sa manière un « art poétique », ainsi que le fera Ingeborg Bachmann avec ses fameuses « Leçons de Francfort/problèmes de poésie contemporaine », durant le semestre d’hiver 1959-1960, et dont le discours s’en tiendra essentiellement à la question de l’expérience poétique.
Chez Lacoue-Labarthe, en référence à Celan, il est question de l’acte poétique qui doit être entendu comme acte de la pensée. En première partie de son essai, nous retrouvons « Deux poèmes de Paul Celan ». Il s’agit de deux poèmes connus, qui portent des noms de lieux : Tübingen et Todtnauberg ; des lieux qui sont associés à Friedrich Hölderlin et à Heidegger, précisant à ce sujet que l’itinéraire linguistique de Paul Celan se caractérise par l’acceptation de l’allemand « comme langue de son œuvre »[1]. Avec ces deux poèmes, Lacoue-Labarthe s’appuie sur plusieurs traductions, dont celles d’André du Bouchet et de Martine Broda pour le poème « Tübingen, janvier » et à nouveau du Bouchet, puis Jean Daive pour le poème « Todnauberg ». Si pour Lacoue-Labarthe il n’est aucunement question de juxtaposer ces traductions « pour les comparer ou les commenter », précise t-il, pas plus qu’il n’est souhaitable de les « critiquer », ces traductions vont néanmoins servir à nous « orienter ». D’une part, vers ce constat que les deux poèmes de Paul Celan sont « strictement intraduisibles, y compris à l’intérieur de leur propre langue, et pour cette raison d’ailleurs incommentables »[2]. Et d’autre part, Lacoue-Labarthe argumente, en précisant que ces poèmes « se dérobent nécessairement à l’interprétation, ils l’interdisent. Ils sont écrits, à la limite, pour l’interdire. C’est pourquoi l’unique question qui les porte, comme elle a porté toute la poésie de Celan, est celle du sens, de la possibilité du sens »[3].
Au cœur de cet essai, des questions affleurent, notamment la question du « sujet » que Lacoue-Labarthe dit être « la question de qui pourrait, aujourd’hui […], parler une autre langue que celle du sujet et témoigner de – ou répondre à – l’ignominie sans précédent dont fut – et reste – coupable l’ ‘’époque du sujet’’ »[4]. Pour en revenir à la question du rapport entre « poésie et pensée », Lacoue-Labarthe interroge ce que peut être une œuvre de poésie qui, « s’interdisant de répéter le désastreux, le mortifère, le déjà-dit, se singularise absolument ? Que donne par conséquent à penser (que reste t-il encore de pensée dans) une poésie qui doit se refuser, avec tant d’opiniâtreté parfois, à signifier ? Ou bien, tout simplement : qu’est-ce qu’un poème dont le ‘'codage'’ est tel qu’il désespère à l’avance toute tentative de déchiffrement ? »[5]
On a souvent dit de Paul Celan, de sa poésie, qu’elle est obscure, froide et hermétique. Mais l’hermétisme en poésie n’est-il pas le propre d’une intériorité inquiète, en même temps que le moyen privilégié d’accéder à l’Etre ? De Paul Celan, on ne peut en douter, son obscurité semble aller bien au-delà de ce que l’on entend par hermétisme ou renoncement à l’intelligibilité. Lacoue-Labarthe pose alors la question de la singularité, c’est-à-dire de l’expérience singulière, au sens où : y-a-t-il ou « peut-il y avoir une expérience muette absolument non traversée de langage, induite par nul discours, aussi peu articulé soit-il ? »[6] D’abord, que faut-il entendre par le terme « expérience » ? Lacoue-Labarthe nous renvoie à l’étymologie : ’experiri’, qui en latin se traduit par ‘'la traversée d’un danger'’. Ce que dit et veut dire l’expérience poétique, ce n’est pas « au sens d’un ‘'vécu'’ ou d’un ‘'état'’ poétique. Si quelque chose de tel existe, ou croit exister – et après tout c’est la puissance, ou l’impuissance, de la littérature que d’y croire et d’y faire croire –, en aucun cas cela ne peut donner lieu à un poème. À du récit, oui ; ou à du discours versifié ou non. À de la ‘’littérature’’, peut-être, au sens où tout au moins on l’entend aujourd’hui. Mais pas à un poème. Un poème n’a rien à raconter, ni rien à dire : ce qu’il raconte et dit est ce à quoi il s’arrache comme poème »[7].
Entre solipsisme et autisme, entre le « vouloir-ne-rien-dire » d’un poème et le trop vouloir dire, Lacoue-Labarthe soulève le tort causé à la poésie de souvent vouloir la confondre avec la célébration. S’il ne peut s’agir de célébration, pour Labarthe il s’agit de dire que « le poème commémore ». C’est l’évènement singulier que le poème commémore. Au sujet de la démesure de la parole, le philosophe nous rappelle ce qu’Hölderlin entendait de l’éloquence, de cette perte vertigineuse dans l’enthousiasme – « l’enthousiasme excentrique », est-il précisé, pour dire autrement ce qu’il désignait par le « pathos sacré » dont il fut lui-même victime et qui le réduisit au silence –.
Lacoue-Labarthe dira de Celan et d’Hölderlin qu’ils souffriront de la même solitude et de la même douleur. Mais de quelle douleur est-il question ? Ou de quelle solitude, en particulier chez Celan ? Il y a un moment du discours du poète, qui dit : « (…) ne voit-on pas que le poème a lieu dans la rencontre – dans le secret de la rencontre ?
Le poème veut aller vers un autre, il a besoin de cet autre, il en a besoin en face de lui. Il est à sa recherche, il ne s’adresse qu’à lui.
(…) Le poème devient (…) un dialogue – souvent c’est un dialogue désespéré »[8].
A quelle rencontre fait-il allusion ? Et si rencontre il y a, peut-elle permettre le dialogue, autant que Celan peut l’espérer ? Une réponse est avancée par Lacoue-Labarthe : « (…) je crois que la poésie de Celan est tout entière un dialogue avec la pensée de Heidegger »[9].
Paul Celan rencontre Heidegger au printemps 1967. – Il semblerait comme une confusion dans les dates, car je lis ailleurs, notamment dans les annotations d’un texte de Jean-Pierre Lefebvre,[10] que la rencontre aurait eu lieu le 25 juillet 1967 – Il lui rend donc visite dans son chalet à Todnauberg, en Forêt Noire, lieu de vie et d’écriture du philosophe. Le souhait de Celan, le grand souhait : que Heidegger réponde à son passé nazi, à son engagement dans le national-socialisme au début des années 1930. Le poème « Todnauberg » est issu de cette rencontre, et que Labarthe analyse comme étant « à peine un poème : unique phrase nominale, hachée et distendue, elliptique, ne se formant pas, c’est non pas l’esquisse, mais le reste – le résidu – d’un récit avorté : des notes ou des notations, comme simplement griffonnées à la hâte en vue d’un poème espéré, brèves, exclusivement compréhensibles pour celui qui les a prises ou écrites. C’est un poème exténué ou, pour mieux dire, déçu. C’est le poème d’une déception : en tant que tel il est – il dit – la déception de la poésie »[11].
Un (seul) mot de Heidegger : il n’en fut rien. « Celan, le poète – et le poète juif – venait avec une seule prière, mais précise : que le penseur qui écoutait la poésie, mais aussi le penseur qui s’était compromis, fût-ce le plus brièvement et le moins indignement possible, avec cela même dont allait résulter Auschwitz – et qui là-dessus, sur Auschwitz, quel qu’ai été le luxe de ses explications avec le national-socialisme, avait (aura) observé un silence total –, que ce penseur dise un mot, un seul : un mot sur la douleur. À partir duquel, peut-être, tout soit encore possible. Non pas la « vie » (elle est toujours possible, elle l’était même à Auschwitz, on le sait bien), mais l’existence, la poésie, la parole. La langue. C’est-à-dire le rapport à autrui »[12]. Lacoue-Labarthe s’interroge sur le « mot » tant attendu par Celan. Que voulait entendre le poète : « Quel mot, pour lui, aurait eu assez de force pour l’arracher à la menace aphasique ou idiomatique (…) Quel mot aurait pu faire, soudain, évènement »[13]. Pour Lacoue-Labarthe, Celan nous a situés en face d’un mot, celui « le plus humble et le plus difficile à prononcer (…) – ce mot que tout l’occident, dans son pathos de la rédemption, n’a jamais pu prononcer, et qu’il nous reste à apprendre à dire (…) : le mot pardon ».
L’évènement de la singularité chez Celan, c’est justement, au sujet du poème « Tübingen, janvier » : détruire l’image, et avec le poème « Todnauberg » : le poème ne contient plus aucune image. N’est-ce pas, là, la définition même de la poésie, de l’essence de la poésie, c’est-à-dire quand « le poème n’est effectivement poème que pour autant qu’il est absolument singulier ».
Pour conclure, j’en reviens au texte de Jean-Pierre Lefebvre – en guise de préface au « Choix de Poèmes » publié chez Gallimard en 2004 – pour lequel la poésie de Celan répond aussi « à la provocation de l’interdit d’Adorno, en développant une poésie qui n’est pas celle de l’après-Auschwitz, mais qui est « d’après Auschwitz », d’après les camps, d’après l’assassinat de la mère, d’après les chambres à gaz (…) »[14].
25 novembre 2015 © Nathalie Riera – Les carnets d’eucharis
CONSULTER Site de l’éditeur
Editions Christian Bourgois
| © http://www.christianbourgois-editeur.com/catalogue.php?IdA=11

TELECHARGER & IMPRIMER L’ARTICLE
| © Nathalie Riera_Philippe Lacoue-Labarthe2.pdf
[1] p.17
[2] p.23
[3] p.23/24
[4] p.24
[5] p.25
[6] p.27
[7] p.33
[8] p.49
[9] p.50
[10] Paul Celan, « Choix de poèmes », NRF Gallimard, 2004.
[11] p.53
[12] p.57
[13] p.58
[14] Paul Celan, « Choix de poèmes », NRF Gallimard, 2004. (p.19)
22:18 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
26/09/2015
Enrique Vila-Matas, "Marienbad électrique ... Dominique Gonzalez-Foerster"

Enrique Vila-Matas en 1997
Dominique Gonzalez-Foerster

Lecture
Marienbad électrique
« littérature et scénographie de l’évasion »
__________________________________________________________________________________________
■■■ Marienbad électrique, publié à l’occasion de l’exposition de Dominique Gonzalez-Foerster au Centre Pompidou (du 23 septembre 2015 au 1er février 2016), est un livre curieux, à commencer par son titre qui nous invite à la ville d’eaux et au film L’année dernière à Marienbad du réalisateur Alain Resnais, Marienbad entendu comme « la ville du film le plus incompréhensible de l’histoire ». Bien qu’aucune scène n’ait été tournée à Mariánské Lázně,le rapprochement est inévitable. Pour Enrique Vila-Matas, le choix de cette ville n’est pas un hasard. Parce que de cette ville se dégage une atmosphère particulière et que pour l’écrivain « tout y était immortel et moribond », le projet d’y séjourner sera pour lui une manière de mieux comprendre les contraintes de l’artiste – et c’est de DGF dont il est question – à savoir : « me mettre dans sa peau, savoir ce qu’on ressentait quand il fallait transformer un espace apparemment condamné à ne jamais changer ». [1]
À l’occasion de M.2062 (la partie de l’opéra), qui est présenté à la Fondation Louis Vuitton, on peut lire en présentation de cet autre évènement : « DGF explore les relations entre réalité et fiction sous forme d’environnements, de performances, de photos et de films ». En effet, cinéma, littérature et musique s’interpénètrent, Vila-Matas n’hésitant pas à trouver des points communs entre DGF[2] et Duchamp dans leur manière de procéder, notamment sur leur façon d’utiliser « des techniques de recyclage de matériaux existants », de transporter « des pièces dans des endroits inattendus » et de mettre en relation des éléments très différents.[3]
Les scénographies de DGF, sous-tendues par la thématique de l’« évasion », inspirent Vila-Matas, non sans un parallèle direct avec les récits de Robert Walser. Sa référence à « Promenade » permet de mieux saisir ce qui peut lier l’artiste à l’écrivain dans leurs œuvres respectives : « les intrigues finissent par construire un récit qui, en général, donne toujours l’impression de parler de quelque chose de différent de ce que nous y voyons. C’est comme si elle cherchait par le biais de l’art la vivacité que Walser savait perdue… ».[4]
Dire de DGF qu’elle est « une romancière très active », c’est aussi pour Vila-Matas l’occasion de se dévoiler en tant que « cinéaste secret » : « j’imagine des séquences, je crée des scènes pour une future anthologie du cinéma invisible ».[5] La méthode de travail de DGF passe pour Vila-Matas comme singulière. Il cite d’ailleurs Ana Pato[6] en rapport à cette méthode qui « donne lieu à une nouvelle forme de littérature, non pas circonscrite dans les mots ou la communication linguistique mais multidimensionnelle… ».[7] Pour DGF les livres sont des créateurs d’espaces ; ils sont son « matériau de construction ». Vila-Matas précise que « pour elle tout commence par les livres. Puis, à partir d’eux, elle enquête, voit des films, voyage, prend des photos, des tas de notes, interroge, écoute, tout aura à un moment donné la possibilité d’entrer dans le monde de sa prochaine installation ».[8] Le paradoxe chez Vila-Matas n’est-il pas aussi celui de « chercher mon originalité d’écrivain dans l’assimilation d’autres voix. Les idées ou les phrases prennent un autre sens quand elles sont glosées, légèrement retouchées, replacées dans un contexte insolite… ».[9]
Entre DGF et Vila-Matas, un dialogue se poursuit depuis des années, par des courriels échangés et par des rendez-vous « intenses, chargés de mots et d’idées » au Café Bonaparte. Rivalité et compétition sont exclues du champ de leur relation. Leurs conversations, autant sur l’art que sur « l’état des choses », n’entendent pas mettre à l’épreuve l’envergure intellectuelle de chacun. Même si l’art est « l’une des formes les plus hautes de l’existence », ni l’un ni l’autre ne s’entichent de « l’horrible masque de l’artiste ».
Lorsque Vila-Matas demande à Gonzalez-Foerster quelles années couvriraient la rétrospective, celle-ci répond : « de 1887, année de la naissance de Marchel Duchamp, à 2666, date qu’il est très difficile de séparer du roman de Bolaňo »[10].
Nathalie Riera, septembre 2015
Les carnets d'eucharis
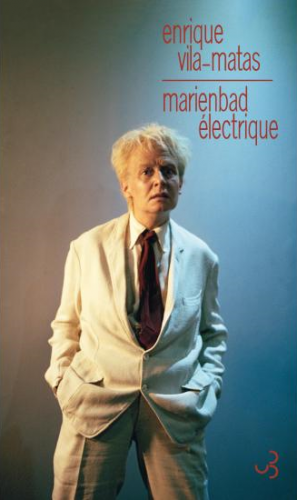
CHRISTIAN BOURGOIS – 2015
Traduit de l΄espagnol par André Gabastou
CONSULTER Site de l’éditeur
Editions Christian Bourgois
| © http://www.christianbourgois-editeur.com/une-nouvelle.php?Id=243
[1] p.90
[2] DGF est lauréate du Prix Marcel Duchamp en 2002.
[3] p.82
[4] p.53
[5] p.45
[6] « (…) comme l’a dit l’essayiste Ana Pato, elle a trouvé « d’autres manières d’écrire des romans » et pratique depuis déjà un bon bout de temps l’art de la Littérature en expansion » (cité par E. Vila-Matas, p.37)
[7] p.110
[8] p.59
[9] p.72
[10] p.101
10:56 Publié dans Enrique Vila-Matas, LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : enrique vila-matas; dominique gonzalez-foerster |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
07/09/2015
Italo Calvino, Ermite à Paris (éditions NRF Gallimard, 2014)
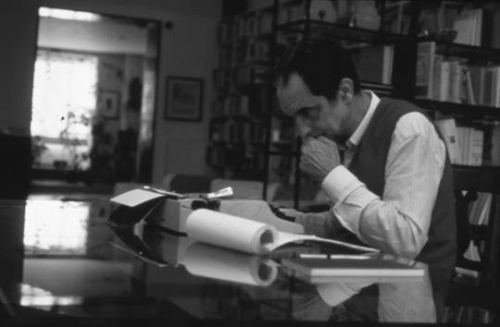
Italo Calvino
« Les histoires que j’aime raconter sont toujours des histoires de recherche d’une intégration, d’un achèvement humain, auxquels parvenir à travers des épreuves à la fois pratiques et morales, au-delà des aliénations et des réductions imposées à l’homme contemporain. Je crois que c’est là qu’il faut chercher l’unité poétique et morale de mon œuvre. »
I. Calvino, Ermite à Paris (Pages autobiographiques), Nrf Gallimard, 2014 – (p. 21) –
« (…) si nous avons la capacité de penser en termes non nationaux mais mondiaux (c’est le minimum que l’on puisse demander à l’ère interplanétaire), nous pourrons être non pas des pions passifs de l’avenir, mais ses véritables ‘inventeurs’. »
I. Calvino, Ibid., (p.164)
■■■
« Ermite à Paris, Pages autobiographiques » réunit 19 textes d’Italo Calvino, dont un inédit « Journal américain » et un récit du même nom « Ermite à Paris » (publié en tirage limité en 1970). Le « Journal américain, 1959-1960 », au-delà d’un ensemble de lettres adressées à son ami Daniele Ponchiroli, est un document autobiographique « essentiel », selon Esther Calvino : « l’autoportrait le plus direct et le plus spontané ».[1]
Une naissance en 1923 à Santiago de las Vegas, petite ville cubaine de la Havane ; une enfance sur la côte Ligure, à San Remo ; puis un premier roman, en 1947, « Le sentier des nids d’araignée », Calvino connaîtra également une vie de résistant sur une dizaine d’années d’appartenance au Parti Communiste Italien (PCI). Il aurait pu choisir Milan, Rome, Florence, lui qui a passé enfance et adolescence sur une terre, la Ligurie « qui n’a d’une tradition littéraire que quelques fragments ou allusions »,[2] Calvino se fait « oiseau migrateur » et choisit Turin comme terre d’adoption – avant lui, l’écrivain et théoricien politique Antonio Gramsci se fera aussi Turinois d’adoption –. Le premier texte « Étranger à Turin » donne le ton, informe déjà le lecteur de la personnalité de l’écrivain. Pourquoi cette ville italienne plutôt qu’une autre ville ? Calvino est clair dans ses choix. En quelques lignes et en évoquant Piero Gobetti (« Turinois de pure tradition ») son choix repose sur son attrait pour « le Turin des ouvriers révolutionnaires (…) le Turin des intellectuels antifascistes ».[3] Ce sera l’attirance d’un Turin en rapport à une image « morale et civique » qu’il s’en fait. Mais Calvino connaît aussi un Turin littéraire de par son amitié avec Cesare Pavese. Comme il l’écrit, l’enseignement de Turin c’est en même temps et aussi l’enseignement de Pavese :
« Il est vrai que ses livres ne suffisent pas à rendre une image achevée de sa personne : parce que, chez lui, ce qui était fondamental c’était l’exemplarité du travail – voir comment la culture de l’homme de lettres et la sensibilité poétique se transformaient en travail productif, en valeurs mises à la disposition du prochain, en organisation et commerce d’idées, en pratique et école de toutes les techniques qu’implique une civilisation culturelle moderne ».[4]
La vie dans la région du Piémont sera pour Calvino marquée par Pavese. Ce sera entre les deux hommes une amitié sans pareil. D’autres écrivains auront aussi leur importance, à des degrés variables : Alberto Moravia, Mario Tobino, Carlo Levi, et parmi ses écrivains de prédilection : Ernest Hemingway, Thomas Mann, Edgar Allan Poe, Mark Twain, Saul Bellow…
La passion de la politique, le journalisme (il écrit dans l’Unità), la littérature (il est rédacteur à la maison d’édition Einaudi en 1947), toutes ces activités participent à sa formation intellectuelle. À travers les lettres du « Journal américain », Calvino nous parle de sa « tâche d’ambassadeur de la culture italienne d’opposition » dans une Amérique où la bonne littérature est clandestine « dans les tiroirs d’auteurs inconnus », confie t-il. [5] Dans chaque ville visitée ou approchée des Etats-Unis (New York, Middle West, Californie, San Francisco, South West), Calvino se refuse à l’écriture de description de paysage, de monument ou de parcours touristique de la ville, peut-être du fait qu’il considère ce pays « d’une platitude sans issue »[6] : « Ces paradis terrestres où vivent les américains, je n’y vivrais pas, même mort ».[7] Il reconnait cependant en la ville de San Francisco être « la seule ville américaine qui ait une ‘personnalité’ au sens européen »[8]. Los Angeles, selon lui, demeure « le véritable paysage de l’Amérique ». Tout ce que voit Calvino passe au tamis de la critique, comme après sa visite d’un ranch en Californie. Nous sommes alors en 1960, quand il écrit :
« Toujours sans êtres humains, comme d’habitude dans l’agric. américaine : tout est fait par des machines, même le gaulage des noix. La récolte des oranges, en revanche, est confiée à un syndicat de Mexicains spécialisés. Là aussi j’ai vu des cow-boys, ils passaient entre des palissades qui, sur des étendues immenses, enclosent les vaches : elles ruminent, ennuyées, les aliments synthétiques qui leur arrivent par des conduits et qui sont dosés comme il faut par un moulin spécial. Jamais de leur vie les vaches ne verront une prairie, pas plus que les cow-boys. »[9]
L’intelligence « éclairante » de Calvino ne fait pas de place à la fioriture ou à la démesure de la pensée, les observations reposent sur des situations réelles, rapportées avec précision, comme cette journée du 6 mars 1960, à Montgomery, Alabama : « C’est une journée que je n’oublierai pas tant que je vivrai. J’ai vu ce qu’est le racisme, le racisme de masse, accepté comme une des règles fondamentales de la société. »[10]
Le 7 mars 1960, l’écrivain traverse l’Alabama et la Géorgie en autobus « à travers la campagne pauvre, les masures en bois des Noirs, les little towns désolées – on peut tristement constater que l’économie américaine n’a pas la moindre aptitude à résoudre les problèmes des zones sous-développées ; tout ce qui a été fait l’a été au temps du New Deal (…) et la prostration économique du Sud saute aux yeux (…) ».[11] Si Calvino se refusait d’écrire un livre sur l’Amérique, il n’a pas hésité à reconsidérer la question : « les livres de voyage sont une façon utile, modeste, mais pourtant complète, de faire de la littérature ».[12]
« Le communiste pourfendu » est le titre donné à un entretien de Carlo Bo avec Italo Calvino, le 28 août 1960. À la question de savoir si le fait de voyager est profitable pour un écrivain, nul doute : « Humainement, mieux vaut voyager que rester chez soi. D’abord vivre, ensuite philosopher et écrire. Il faudrait avant tout que les écrivains vivent avec une attitude à l’égard du monde qui corresponde à une plus grande acquisition de vérité. C’est ce quelque chose, quel qu’il soit, qui se reflètera sur la page et sera la littérature de notre temps ; rien d’autre. »[13] Dans ce même entretien, Calvino évoque ses « souvenirs de ligurien », son histoire politique qu’il définit comme être « d’abord une histoire de présences humaines ». Son adhésion au communisme ne prend appui sur aucune motivation idéologique, il s’agit plutôt pour lui « de partir d’une tabula rasa ». Communisme et anarchisme = recommencer à zéro. Mais Calvino démissionne du PCI l’été 1957, la politique ne sera plus pensée « comme une activité totalisante » : « Je pense aujourd’hui que la politique enregistre avec beaucoup de retard des choses qui se manifestent dans la société par d’autres biais et j’estime que souvent la politique réalise des opérations abusives et mystificatrices ».[14] Il quittera donc le Parti pour continuer la politique autrement, et ce en qualité de franc-tireur.
Une jeunesse sous le fascisme laisse des traces, « une ligne de jugement ne se forme qu’avec les années ».[15] Son premier souvenir politique (nous sommes en 1939) sera celui d’un socialisme frappé par des bandes fascistes organisées, les Squadristi. Périlleuse entreprise que celle d’écrire des souvenirs autobiographiques. Calvino se gardait de cette erreur commune à bien des écrivains, « la tendance à présenter sa propre expérience comme l’expérience ‘moyenne’ d’une génération et d’un milieu donnés, en faisant ressortir les aspects les plus communs et en laissant dans l’ombre ceux qui sont plus particuliers et plus personnels (…) Je voudrais à présent mettre l’accent sur les aspects qui s’écartent le plus de la ‘moyenne’ italienne, parce que je suis convaincu que l’on peut tirer toujours plus de vérité de l’état d’exception que de la règle ».[16] Les « Pages autobiographiques » s’élaborent autour de deux figures tutélaires : le père et la mère définis comme des « libres-penseurs ». Le conditionnement familial est un des éléments qui a conduit Calvino « à partager spontanément des opinions antifascistes, antinazies, antifranquistes, antibelliqueuses et antiracistes ».[17] L’engagement dans la lutte politique sera une réponse à un autre type de conditionnement, celui du « conditionnement historique ». L’expérience de l’histoire pour toute la génération d’Italo Calvino se démarque des générations précédentes. Sa génération « a été précocement dotée de ce sentiment de la continuité historique qui fait du véritable révolutionnaire le seul « conservateur » possible, c’est-à-dire celui qui, dans la catastrophe générale des vicissitudes humaines abandonnées à leur impulsion biologique, sait choisir ce qui doit être sauvé, défendu, développé, ce qui doit fructifier ».[18] Jusqu’à la fin de sa vie, Italo Calvino aura une haute reconnaissance pour « l’esprit partisan » qui, à son goût, répond à « une attitude humaine sans égale pour se mouvoir dans la réalité contrastée du monde ».[19]
« Ai-je été stalinien moi aussi ? » fait un retour sur les désillusions d’un communisme nouveau, et « Les portraits du Duce » nous parlent des vingt premières années de la vie de Calvino passées avec le visage de Mussolini : les portraits du Duce envahissent toute la sphère publique.
Après un idéal politique sans lendemain, il semble que chez Calvino il n’y ait pas eu de place pour un idéal littéraire. Dans un entretien avec Maria Corti, Calvino cite un extrait de « Giorni aperti » de Giorgio Caproni, un des auteurs qui l’aura le plus marqué, en réponse à ce que pourrait être son « idéal d’écriture ». Si le rêve de Calvino était d’avoir l’illusion d’être invisible dans une ville de n’importe quel pays, l’invisibilité semblait alors sonner chez lui comme un « idéal d’écrivain » :
« Je crois que la condition idéale de l’écrivain est (…) proche de l’anonymat ; c’est alors que l’autorité maximale de l’écrivain se développe, quand il n’a pas de visage, de présence, mais que le monde qu’il représente occupe tout le tableau (…) Aujourd’hui, au contraire, plus l’image de l’auteur envahit le terrain, plus le monde qu’il a représenté se vide ; puis l’auteur aussi se vide, et de tous les côtés il ne reste que le vide. »[20]
Septembre 2015 © Nathalie Riera – Les carnets d’eucharis
CONSULTER Site de l’éditeur
Editions Gallimard
| © http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Du-monde-entier/Ermite-a-Paris
![]() TELECHARGER & IMPRIMER L’ARTICLE
TELECHARGER & IMPRIMER L’ARTICLE
| © Nathalie Riera_Italo Calvino_Les carnets d'eucharis 2015.pdf
19:50 Publié dans Italo Calvnio, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
25/06/2015
Pierre Cendors (une lecture de Nathalie Riera)
●●●
UNE NOTE DE NATHALIE RIERA
…
L’invisible dehors
Carnet islandais d’un voyage intérieur
Pierre Cendors
Isolato, 2015

Pierre Cendors | © mel
■■■
Sur le chemin d’un Nord physique-métaphysique
« …quelque chose là-bas d’intensément libérateur … un avant-goût d’éternité » : l’Islande offre à Pierre Cendors un territoire au règne sauvage, une haute poésie de la terre, et bien que dans l’ignorance des raisons profondes qui peuvent motiver un tel voyage, sur cette Ice-Land entre l’Europe et l’Amérique, il est quelque chose là-bas qui n’est pas de notre monde façonné et policé, mais s’avère un lieu aux forces entières dont la souveraineté appelle au plus de silence en soi, une ascèse de l’esprit, et où l’acte de vivre se transmue en « science poétique immédiate » : La rudesse des éléments, leurs puissants débordements, exige une vigilance constante en même temps qu’un détachement, une coordination et une lenteur, qui font de la marche solitaire un acte incantatoire.[1] L’Islande se fait synonyme de « pays inconnu pour s’avancer seul à travers l’informe » et de « solitude pour rompre avec d’anciennes formes »[2]. Pierre Cendors a une grande fascination pour l’originel qu’il a pu observer ailleurs, dans d’autres lieux sur terre (Connemara, Ecosse, Grèce) et c’est sans mystère et sans mysticisme qu’il fait se rejoindre le corps et l’esprit, tous deux dans la lente progression d’un devenir corps-esprit qui ne joue plus le jeu du temps fermé ou l’épreuve de l’horloge, mais se meut vers un autre horizon non atteint par le social.
À Hornstrandir, dans sa géologie d’ancien plateau basaltique, péninsule connue comme la plus septentrionale d’Islande, sans aucune route pour s’y rendre, c’est « le début d’un dialogue approfondi entre l’originel et la pensée personnelle, un revif corporel de l’esprit, une parole désencombrée, un silence ardent, un non-agir à l’unisson d’un agir recueilli et fervent… » 3].
Par l’extinction de la parole et le verbe éteint, les « ressources indigènes du lieu » se révèlent et voyager devient le chemin où marcher c’est alors « puiser dans l’élémentaire une longueur de clavier existentiel supplémentaire »[4], mais aussi « incursionner en liberté dans l’invisible dehors »[5]. D’où le titre « L’invisible dehors/Carnet islandais d’un voyage intérieur ».
À Reykjavik, capitale de l’Islande, ville au niveau de la mer, où la lumière du jour se fait permanente en juin et juillet, il y a une exposition du peintre Georg Gudni Hauksson. Cendors envisage la visite de son atelier, en prévision d’un entretien autour « de son cheminement, de sa vision de la nature, de l’art, du paysage », mais en regagnant Reykjavik, c’est à une cérémonie funéraire (du 30 juin 2011) qu’il se rendra, dans une église Luthérienne pleine de la famille et des amis de Gudni : « La culture, écrit Werner Herzog, ce n’est pas aller à l’opéra, c’est ressentir une excitation vitale de l’esprit. C’est précisément ce que suscitait la peinture de Gudni : une densification vitale de l’esprit, et dans mon cas, une reconnaissance, une figuration fulgurante de mes pistes intérieures. Je décidai sur le champ de rencontrer le peintre, ignorant que mon regard, deux semaines plus tard, fixerait un cercueil blanc, recouvert de l’étendard islandais et d’une poignée de terre, où reposerait sa dépouille. »[6]
Le voyage déploie sa partition avec ses notes manquantes, ses signes illisibles, une lecture heurtée, une succession de paysages intérieurs/extérieurs et comme l’avait si justement écrit Nicolas Bouvier dans son Journal d’Aran et d’autres lieux : « Dans ces paysages faits de peu je me sens chez moi, et marcher seul, (…) est un exercice salubre et litanique qui donne à ce peu – en nous ou au-dehors – sa chance d’être perçu, pesé juste, exactement timbré dans une partition plus vaste (…) »[7].
Nathalie Riera, été 2015
© Les Carnets d’Eucharis

À CONSULTER
Site de l’auteur
| © http://endsen.blogspot.fr/
Black Herald Press
| © https://blackheraldpress.wordpress.com/2015/04/14/lage-du-noir-the-age-of-darkness-pierre-cendors/
![]()
Nathalie Riera_Pierre Cendors.pdf
22:39 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pierre Cendors | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
04/06/2015
Pascal Boulanger, Confiteor (une lecture de Claude Minière)
●●●
UNE LECTURE DE CLAUDE MINIÈRE
…

Pascal Boulanger
Confiteor
Éditions Tituli, 2015
■■■
Pascal Boulanger fait paraître Confiteor aux éditions tituli. Dans le VI° arrondissement de Paris, ces libraires se font éditeurs et organisent des lectures dans leur galerie (www.tituli.fr). L’écriture poétique, dit Pascal Boulanger, « va tenter de renverser la malédiction (la malédiction de toute existence) en exultation. » Pour Confiteor, il a regroupé ses notes et paragraphes selon quatre « pôles », en quatre chapitres : L’enfance des choses ; Imprimer un monde ; Liberté divine ; Poésie politique. « Mon écriture alors s’ouvre au hasard, aux circonstances, aux accidents ». Ce qui fait la logique même de Pascal Boulanger : il ne réclame pas l’adhésion. Mails il a des soutiens, des amis en écriture, en pensée, et dans la lutte. Avec Baudelaire, il revendique le droit de se contredire. Comme Claudel, pour une célébration du passage et de la haute alliance (célébration pascale) il fait feu de tous bois (« Le laurier, s’il y en a, ou la palme encore mieux s’il y en a, ou le rameau d’olivier, ou le buis tout simplement… » lançait l’auteur de Le jour des rameaux), il force une voie, passe outre, entend lui aussi, « l’accord dans le désaccord parfait ». Il n’épargne pas, ne s’épargne pas et n’épargne personne mais parle avec émotion et gratitude de ceux qu’il aime. « Vivre ses sensations, c’est trouver un hors-lieu, c’est bâtir des stèles de l’enchantement simple ».
Où se jouent les choses ? Qui est à l’abri des fantasmes qui consistent (je tiens que les fantasmes consistent) à imaginer qu’il est au bon endroit, qu’il occupe la bonne position ? Pascal Boulanger bouscule les positions, pousse sa ligne contre les vents des actualités et marées humaines, contre ou plutôt en dehors de l’utilité, des calculs, de la spéculation. Comme Saint Paul, il doit passer par un certain aveuglement pour confirmer son chemin. Il regagne le temps perdu. Sans pruderie, et sans prudence. C’est un nerf de la croyance qui a un sens politique. La croyance longe la foi. C’est pas fini. L’auteur de Confiteor rappelle son avant-propos de Fusées et paperoles (2008, Comp’Pact) : « Aujourd’hui, j’entends toujours les cris effacés du silence, je vois toujours le ciel surgir des draps cachés de la terre… »
Page 57 : « J’ai été confronté, en commençant d’écrire, au psychologisme lourd de mes contemporains, au sociologisme pesant,… » On peut comprendre qu’étant donnée la belle mansuétude qui caractérise l’espèce humaine et les propriétaires d’un supposé pouvoir culturel, le « psychologisme » est une arme (misérable) de découragement. Mais Pascal Boulanger a du courage, du « courage poétique » (selon le mot d’Hölderlin).
Ce n’est pas sans raison que le premier chapitre de Confiteor est pour l’enfance. L’enfance, retrouvée à volonté, et l’archive conduisent à confronter la question « poésie et politique ».
Claude Minière | © Les Carnets d'Eucharis, N°45 - Printemps 2015
À CONSULTER
Le site de l’éditeur | © http://www.tituli.fr/

18:38 Publié dans Claude Minière, LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Bruno Fern, Le petit test (une lecture de Tristan Hordé)
●●●
UNE LECTURE DE TRISTAN HORDÉ
…

© Bruno Fern │
Bruno Fern
Le petit test
Éditions Sitaudis, 2014
■■■
En quatrième de couverture, Bruno Fern renvoie explicitement au Testament, invitation modeste à lire Le petit test comme un prolongement de ceux de Villon ; il repose sur une lecture approfondie du poète du Moyen Âge, non pour imiter, à quelque point de vue que ce soit, mais pour en conserver l’esprit : l’humour, une certaine paillardise, le plaisir de parler des choses de la vie quotidienne et d’être dans une « matière pleine d’érudition et de bon savoir ».
« Voici un livre fait de greffes et d’excroissances », précise Bruno Fern. L’une des greffes consiste à retenir le huitain du Testament — il y en a cent — et à y introduire d’autres éléments, non des ballades mais trois envois, le livre s’achevant par un « renvoi ». Les vers ne sont ni comptés ni rimés, mais il faut tout de suite indiquer les exceptions. Un huitain est en vers de 3 syllabes et rimé, aaaabcbc (93)1, le suivant en vers mêlés, 44544544, avec rimes, abbcbcac (94), et sa seconde version en vers de 4 syllabes, non rimé (94). Le lecteur relèvera ici et là des rimes : elles ont toujours une fonction qui déborde le rôle habituel ; ainsi reprenant « le trou Perrette », qui rimait chez Villon avec « cornette », Bruno Fern développe autrement le thème burlesque (ou paillard, si l’on veut) (59) :
préférant (et de loin) le trou Perrette
qui sent pas que la violette
mais le rose nuancé bat
ant jusqu’au sang [..]
On trouvera des variations d’un autre genre. Un poème est uniquement formé de questions prélevées dans Villon ; le premier vers d’un autre, « celer mes amours », vient aussi du Testament (« Je pense celer mes amours, xcv), dans les vers suivants seul le complément est conservé (« mes amours »), le premier mot retenu est homophone du verbe ou en conserve la première syllabe :
celer mes amours
seul et " "
semer " "
seller " "
serer " "
céder " "
cesser " "
c.v. " "
Une autre greffe, comme on l’a vu ci-dessus, consiste à introduire dans chaque poème un fragment emprunté à Villon, signalé en caractères gras. On situe sans trop de difficulté des vers ou des parties de vers (« Dieu sait quelle sueur », « Les vers n’y trouveront pas graisse »), mais Bruno Fern introduit des grains de sable : par exemple, reprenant le vers de Villon « En petits bains de femmes amoureuses », il remplace "femmes" par "filles" ; par ailleurs, « en », « plus aigu », « des flûtes », etc., présents dans le Testament, pourraient évidemment se trouver ailleurs... Un mot repris dans le Testament est commenté, non pour sa place juste dans le vers original mais en tant qu’élément grammatical adéquat : « rondement / c’est l’adverbe qui convient ».
Comme le faisait Villon, Bruno Fern mêle les registres et le vocabulaire dit populaire, ou familier, est bien représenté : kif kif, fastoche, cool, triquer, tire-larigot, rien à branler, accro, à donf, etc. Mais surtout, il introduit dans presque tous les poèmes des lieux communs, des slogans publicitaires, des formules de mode d’emploi, des syntagmes propres à l’administration, toutes manières complètement usées d’être dans la langue qui, mises ici en évidence, apparaissent pour ce qu’elles sont, marques d’une totale absence d’inventivité : y a pas photo, ça le fait pas, y a comme un défaut, [Pince-mi et Pince-moi] sont sur un bateau, sonnerie personnalisée, intégralement recyclables, etc. — ajoutons ce qui est en relation directe avec l’actualité, par exemple renforcer la lutte contre la délinquance, made in China, vive émotion dans la communauté internationale. Des expressions rebattues sont détournées, ainsi : tombe au champ d’odeurs, la ligne bleue des cours, en mourant par la Lorraine, mais aussi un chant révolutionnaire : c’est la lutte finale grouillons-nous et deux mains ; etc.
Viennent s’ajouter des citations en italique, presque toutes littéraires et dont l’auteur est signalé en note — Kafka, Mallarmé, Nathalie Quintane, Soupault, Beckett, Malherbe —, mais il y a aussi Lacan et le compositeur Steve Reich ; d’autres, non signalées comme telles, passent inaperçues, parfaitement intégrées : on lit « bijoux sonores » et l’on se souvient de Baudelaire ("Les bijoux"), et de Mallarmé dans « la nue à câbles » : avec "accable" on retrouve "À la nue accablante". Entrent aussi dans des poèmes des figures d’écrivains contemporains ; « à J. S. l’ardeur des mots » (62) évoque Jude Stéfan, dont le prénom en toutes lettres et l’allusion à une nouvelle viennent un peu plus tard (69) ; « à Jean-Pierre V. une bouteille » (75) débute un récit à propos de Verheggen, « à Ch.P. cette vigueur qu’il prouve » est l’entrée d’un portrait de Prigent lisant : deux écrivains dont Bruno Fern est proche par certains aspects de son écriture. La "géographie" littéraire est toujours complexe ; sont également présents Petr K.[ral] et ses cigares, Philippe Boutibonnes à qui un poème est dédié.
Parmi les moyens d’ « essayer [...] tous les sens possibles », Bruno Fern emploie abondamment le chevauchement : un mot2 appartient à deux séries syntaxiques différentes ; par cette épargne des mots, la lecture est freinée et, surtout, la polysémie permet des effets comiques. Des exemples : « tendance à sous estimer [le monde] / roule pour lui-même » ; avec bilinguisme : « à tue / [tête] bêche dans le raidillon n° 69 / of [course] au cotillon (page 62) ; en jouant sur l’homophonie : « ténue [= t’es nue] jusqu’aux sourcils / à donf tombe en un comme en / [sans] attendre » (page 63) ; le mot commun est verbe dans le premier ensemble, adjectif dans le second : « se [grise] de préférence dans l’entrejambe / toutes les chattes le sont la nuit » (73) ; c’est un article et un mot-une syllabe qui sont communs : « présents les pieds posés sur [le sol] / stice d’hiver stigmate à son échelle », et remarquons qu’ici p est repris dans le premier vers, sti[c,g] dans le second.
La répétition d’un son est régulièrement un des éléments du burlesque dans Le petit test, comme dans les deux premiers vers du "Renvoi" final : « ainsi se clôt s’exclut s’excla / s’achève la période d’essais [...] » (page 61). On a pour ce registre burlesque une liste d’homophonies, de par mon et par vos et le classique neiges – que n’ai-je à en pur don de soie et toute en R – s’envoyer en l’air, des séries d’à-peu-près comme des mouvements divers et avariés et d’un pas décédé, des anagrammes parfois signalées (parties-patries). À chaque lecture, on découvre de nouvelles pistes dans l’usage plein de jubilation de la langue et, comme chez Villon, s’expriment des « préoccupations diverses » (4ème de couverture), tragique et burlesque liés : dans le huitain 99 adressé à un "tu" (« tu branles carcasse... »), si l’on réunit mots et syllabes en gras, on obtient : « car en amours mourut martyr ».
Tristan Hordé | © Les Carnets d'Eucharis, N°45 - Printemps 2015
À CONSULTER Sitaudis
Terres de Femmes
———————————
1. sauf indication contraire, le nombre entre parenthèses renvoie au numéro d’un poème.
2. noté ici entre crochets.
18:07 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sitaudis, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
21/02/2015
« CHRISTA WOLF : UNE ŒUVRE À CŒUR OUVERT » par Nathalie Riera
Hommage àCHRISTA WOLF
(1929-2011)

Christa Wolf


REVUE EUROPE – avril 2011 – N° 984
CHRISTIAN BOURGOIS EDITEUR
■http://www.christianbourgois-editeur.com/
TERRES DE FEMMES
■http://terresdefemmes.blogs.com/
« (…) lorsqu’il y a bien des années, j’écrivais Trame d’enfance, un livre de souvenirs sur mon enfance, et qu’au cours du travail préparatoire et en rassemblant de la documentation, je pus me rendre compte du caractère douteux des souvenirs sur lesquels je devais pourtant m’appuyer, j’ai accompagné l’écriture du livre d’une réflexion sur la mémoire, relativisant ainsi l’affirmation : C’est ainsi que cela s’est passé, et pas autrement. Et Günter Grass, dans son livre autobiographique récemment paru, Pelures d’oignon, a avoué et désigné des lacunes dans le souvenir, et notamment à des moments importants, présentant par ailleurs un curieux matériau que sa mémoire a gardé pour des raisons inexplicables. L’écriture autobiographique doit être, à notre époque en tous cas, une recherche sur soi, c’est-à-dire une plongée dans les abysses de notre propre mémoire, faisant l’expérience de la douleur et de la honte, en remettant sans cesse en question l’authenticité des trouvailles extraites des éclaircies de la conscience. Même si la neurobiologie a trouvé la région du cerveau où loge la mémoire autobiographique, elle ne peut pas dire selon quelles lois psychologiques elle travaille. (…) Nos points aveugles, j’en suis convaincue, sont directement responsables des points de désolation sur notre planète. Auschwitz. L’archipel du Goulag. Coventry et Dresde. Tchernobyl. Le mur entre la RDA et la République fédérale. La déforestation au Vietnam. Les tours détruites du World Trade Center à New York. » – « Réflexions sur le point aveugle », in « Lire, écrire, vivre » Christa Wolf, Christian Bourgois Editeur, 2015.
« CHRISTA WOLF : UNE ŒUVRE À CŒUR OUVERT »
Par Nathalie Riera
________________________________________________________

« Que le rayon laser des pensées puisse percer rétrospectivement et prospectivement les strates du temps me semble un miracle. Raconter fait partie de ce miracle, parce que sinon, sans le don salutaire de raconter, nous n’aurions pas survécu, ni pu survivre. »
Christa Wolf, Ville des Anges.
■■■
Écrivain de l’« authenticité subjective », Christa Wolf s’est toujours interrogée sur les racines du besoin d’écrire, et par là-même sur son propre engagement en tant qu’écrivain, engagement vécu alors comme une revendication face au mortier du national-socialisme qui va pétrifier le peuple allemand et conduire C.W., après avoir été elle-même, alors enfant, séduite par les idées propagées par les nazis, à réagir aussitôt face à la monstruosité politique du Troisième Reich. En 1949, dans la division de l’Allemagne, elle adhère au Parti de l’unité socialiste (S.E.D.), mais c’était alors troquer une idéologie contre une autre, reconnaîtra l’écrivain.
« Christa Wolf n’a certes pas été confrontée à la violence des armes, mais à une autre violence, celle d’un système qui s’était voulu porteur d’utopie et d’espoir et était devenu normatif et répressif. » ([1])
La vie littéraire de Christa Wolf s’étendra sur plusieurs décennies, entre succès et vicissitudes, entre enthousiasme et désillusion, et alors que l’espérance peut à tout moment briser sa dernière amarre, Christa Wolf, en dépit des retournements et des bouleversements, des accusations et controverses dont elle fera l’objet, ne cédera pas à la tentation du désespoir. Seule une transformation lente, mais non sans douleur, sera souhaitable, espérée même, et en passera forcément par l’écriture. Il faudra s’en tenir plus que jamais à l’écriture et plus exactement à « la tentative épuisante, douloureuse de concilier des choses inconciliables », et à partir de quoi va naître en l’écrivain : « l’engagement comme processus contradictoire ; c’est ainsi, de l’accord ou de la friction, de l’espoir ou du conflit, que sont nés les livres que j’ai écrits jusqu’à présent. » ([2]) Mais chez Christa Wolf tout va prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps avant de pouvoir dire, avant de pouvoir avouer, avant de pouvoir cerner, comprendre, ou simplement tenter de répondre. Dans son récit Ce qui reste, publié au début des années 1990 et dont les premières versions de ce texte ont été rédigées antérieurement à 1982-1983, précise l’auteur, récit controversé suite à la révélation de ses contacts occasionnels avec la Stasi de 1959 à 1962, on peut lire :
« N’aie pas peur. Dans cette autre langue, que j’ai dans l’oreille, pas encore sur les lèvres, j’en parlerai aussi un jour. Aujourd’hui, je le savais, ce serait encore trop tôt. Mais saurais-je sentir quand le moment sera venu ? Trouverais-je jamais ma langue ? » ([3])
Dans son remarquable journal Un jour dans l’année, qui recouvre plus de la moitié de la vie de Christa Wolf, et « où le « je » n’est pas un « je » littéraire mais se livre sans protection » ([4]), l’écrivain détermine cette expérience du journal comme un moyen pour l’écrivain de « se voir historiquement » : « c’est-à-dire installé dans son époque, lié à elle. Il s’instaure une distance, une objectivité plus grande par rapport à soi-même. Le regard scrutateur et autocritique apprend à comparer, sans devenir pour autant plus clément, mais en se faisant plus juste peut-être. » ([5]) Il est clair que même si l'écriture de ce journal soit survenu suite à des moments de crises profondes et pour répondre à la recherche d’un nouvel équilibre, la publication de cet ensemble de 41 chroniques de la vie de C.W., tenues le 27 septembre de chaque année, entre1960 et 2000, répond à une responsabilité, « comme un devoir professionnel » commentera Christa Wolf. « Notre histoire récente me semble courir le risque de se voir réduite dès maintenant à des formules commodes et de s’y retrouver enfermée. Des communications comme celle-ci peuvent peut-être contribuer à entretenir la fluctuation des opinions sur ce qui s’est passé, à examiner encore une fois les préjugés, à dissoudre ce qui s’ankylose, à reconnaître des expériences propres et à mieux les assumer… » ([6])
La pratique d’une écriture réaliste « socialement et politiquement engagée » sera la particularité des écrivains en RDA.Anne Wagniart nous éclaire sur le rôle de la littérature en tant qu’elle tenait le rôle des médias à l’ouest : « (…) elle permettait le dialogue sur les valeurs communes de la République Démocratique et avait une fonction représentative. La littérature était le porte-parole d’une opinion publique par ailleurs censurée. Les écrivains d’envergure comme Christa Wolf côtoyaient les hauts dirigeants du SED tels Ulbricht et Honecker. Ils avaient parfois le pouvoir d’intervenir en faveur de personnes qu’ils savaient menacées. Être le poète officiel d’un tel État ne s’apparentait nullement à servir la propagande du Troisième Reich. » ([7])
Christa Wolf ne laissera certes pas indifférents les pouvoirs politique et médiatique dont elle sera la cible, mais recevra, en compensation, de quelques intellectuels, notamment en France, soutien et profonde admiration. Sur sa « collaboration informelle » avec la police politique de la R.D.A., plusieurs années après les faits, ce qu’on peut lire ici et là pourrait se traduire comme une manière de procéder à une réhabilitation de l’écrivain :
« On l’accuse d’avoir collaboré avec la Stasi il y a trente trois ans. C’est vrai. Mais elle-même était surveillée par une police politique entraînée à manipuler et à déformer ; mais sa personnalité a changé, bougé, évolué en trente années d’expérience ; mais la vie sous un régime autoritaire n’a rien à voir avec une vie sous un régime démocratique. » ([8])
« Christa Wolf sait que ni les médias, ni l’opinion publique ne voudront croire qu’elle – l’écrivain de la mémoire – a pu tout simplement oublier. D’où ces interrogations qui sont l’un des fils rouges du récit, « Comment ai-je pu oublier ? », comment fonctionnent la mémoire et l’oubli ? Oublier est-ce refouler ? Comment assume-t-on la faute ? » ([9])
« Elle était encore une jeune femme lorsqu’elle a parlé avec la police secrète de son pays, par la suite elle a refusé de collaborer, puis tout oublié. Et des décennies plus tard l’ouverture des dossiers de la Sécurité de l’État est-allemand et les médias rappellent cet ancien contact, ou plutôt réduisent la vie de l’écrivain à cela. À la une des journaux un index accusateur pointe sa photo, on banalise brutalement sa vie et la ramène à quelques entretiens avec la police secrète, à quelques rapports de cette police. Elle, elle avait oublié, et du jour au lendemain ce grand écrivain n’existe plus, il disparait derrière une caricature élaborée à partir des dossiers de la police secrète. Je n’ose même pas penser à ce que cette situation peut provoquer, et a provoqué, chez un être, pour un être. Je suppose que celui qui ne s’est jamais trouvé au centre de l’accusation publique ne peut pas se rendre compte à quel point ces semaines, ces mois et ces années ont eu un effet déprimant durable et ont menacé sa vie. » ([10])
Si Christa Wolf s’accuse d’avoir nui à elle-même, en rapport à ses engagements et à ses choix, Christoph Hein, dans son discours prononcé en 2010 à l’occasion de la remise du Prix Uwe Johnson à Christa Wolf, sera sans réserve, dans un parti-pris aussi émouvant que légitime :
« À un moment de sa vie, elle a pris une décision qui correspondait absolument à la vie qu’elle menait alors, à ses convictions d’alors. Elle a défendu un État auquel elle croyait à cette époque-là, il lui semblait digne d’être défendu, elle voulait s’engager pour ses valeurs et son existence. La jeune femme qu’elle était croyait aux idéaux qu’il proclamait et voulait lutter pour eux. Lorsque cet idéal s’avéra précaire, pourri, mensonger, lorsqu’elle constata qu’il était une illusion, elle eut le courage de se séparer d’eux, non seulement d’eux, mais de camarades du parti et d’amis. Elle s’engagea sur ce chemin d’une façon exemplaire, singulière, admirable. Lorsqu’elle était une jeune femme qui partageait leur crédo, elle avait été élue dans les plus hautes instances, et là, au sein du Comité central d’un parti tout puissant, elle résista publiquement ; aujourd’hui encore son attitude force l’admiration. Quand on lit les documents, ou écoute les enregistrements de ces réunions du parti, on ne peut que souhaiter qu’il y ait aujourd’hui encore des gens comme elle qui, au sein d’un gouvernement ou d’un parti, osent contredire la ligne d’un système avec autant de détermination, de façon aussi suicidaire, et apparemment ce n’est pas plus facile dans une démocratie que dans une dictature ; c’est en effet rarement le cas. » ([11])
février 2015 © Nathalie Riera (Les carnets d’eucharis)
Le corps même
(EXTRAIT)
[…] C’est comme si chaque espace donnait dans d’autres espaces où je n’ai encore jamais pénétré, au fond dans un coin il y a une porte à claire-voie qu’on arrive difficilement à ouvrir parce qu’elle racle le sol, mais il le faut, même si j’hésite, car je dois trouver cette cave où le nourrisson a été assassiné. Les caves sont imbriquées les unes dans les autres selon un schéma obscur, à présent mes pieds s’enfoncent dans la poussière, il y a dans les coins de très anciens tas d’ordures, un rat s’enfuit sans se presser devant mes chaussures. Je m’aperçois seulement maintenant que le bocal lumineux avec l’homoncule a disparu, plus rien pour me montrer la direction, cela fait longtemps que j’ai perdu mon chemin, tout ce que je sais, c’est que je dois chercher le nourrisson assassiné, bien qu’il m’inspire une indicible horreur. Un jour vient où l’on doit rechercher ce qu’on a oublié. J’erre dans le labyrinthe où gisent les tombes des enfants que l’on n’a pas mis au monde, il faut que je m’attache à la signification de l’expression, « ne pas mettre au monde » tout en marchant, trébuchant, avançant à tâtons, maintenant il n’y a même plus d’ampoule blafarde, maintenant je tiens une lampe de poche qui éclaire faiblement, quelqu’un tient absolument à ce que je continue, il a pensé pour moi au plus important. Maintenant je suis des flèches tracées au mur, jadis blanches, à présent presque totalement effacées, sous lesquelles on lit des initiales que celui qui les a connues un jour n’oubliera jamais : LSR, Luftschutzraum, abri antiaérien. L’espace d’un instant, je m’étonne que ce local ait été placé aussi loin de notre bâtiment dans ce labyrinthe souterrain car notre maison a été presque épargnée, tandis que la maison voisine avait été touchée par une bombe lors d’une des dernières attaques aériennes et totalement détruite, et pour la première fois je dois me demander si les gens de la maison voisine ont tous été tués cette fois-là, si quelques uns ont pu être sauvés, peut-être en parvenant, à partir de l’autre côté, jusqu’à cet endroit devant lequel je me trouve à présent et où je déchiffre cette inscription pâlie : PERCEMENT DU MUR. Un réflexe d’effroi : quel mur ? Ce mur-ci a été percé depuis longtemps ; en me courbant et en grimpant sur des éboulis je peux franchir l’ouverture et me retrouver dans une pièce qui ressemble à s’y méprendre à celle d’où je viens, et les suivante est identique à la précédente, je la reconnais aux restes d’étagères en bois fixées sur la cloison auparavant de droite, maintenant de gauche, avec des bocaux à conserves recouverts de poussière et de boue sur lesquels je peine à déchiffrer des étiquettes jadis soigneusement écrites en lettres gothiques par une ménagère allemande : cerises 1940, lapin 1942, j’essaie d’imaginer où cette femme a bien pu se procurer du lapin en 1942, en pleine guerre, peut-être que ses parents avaient un jardin ouvrier, mais ce qui m’inquiète vraiment c’est le soupçon, puis la certitude qu’après avoir franchi le mur je suis arrivée dans un terrain qui est l’exact reflet de celui que j’ai traversé avant ce percement du mur. Voilà, indiquant la direction opposée, les flèches aux murs, voilà les ordures dans les coins, enfin le premier interrupteur branlant qui me paraît familier, ce qui me met mal à l’aise, puis le rat qui détale. Qu’est-ce que cela signifie ? Vais-je être éternellement conduite vers de nouveaux couloirs en miroir ? Je sens que j’accélère, que je respire avec une précipitation croissante, je veux sortir d’ici, alors l’homoncule resurgit, dans son bocal, dégageant une lueur bleuâtre, c’en est trop. […]
[Le corps même/Leibhaftig – Librairie Arthème Fayard, 2003, pour la traduction française– p.118/120]
-------------------------
Aucun lieu. Nulle part
(EXTRAIT)
[…] Une nuit, c’était sur ce trajet honteux du retour, en revenant des côtes françaises, lorsque même la perspective de la mort s’était volatilisée, Kleist traversait une contrée de basses collines. Il était près de minuit et, en dépit de la fatigue, ses sens étaient tout à fait en éveil. Chaque fois qu’il redescendait une pente, il avait les collines autour de lui, comme les dos de grands animaux chauds, il les voyait respirer, s’arrêtait pour sentir battre le cœur de la terre sous la plante des ses pieds, et il rassemblait ses forces pour tenir bon devant le spectacle du ciel, car les étoiles n’étaient pas ces lumières qu’il avait l’habitude de voir, mais de terribles corps scintillants qui menaçaient de fondre sur lui. Il eut un instant d’égarement, sans capituler pour autant, et il courut un long moment avant d’apercevoir enfin, à main droite, les lumières matinales d’un village ; il frappa à une porte, une femme lui ouvrit, dont le visage éclairé par la chandelle lui sembla beau, elle le fit entrer, lui avançant sans rien dire une jatte de lait sur la table en bois brut et lui indiqua un lit de paille. Il s’y allongea, venant de faire l’expérience physique de la liberté, sans que ce mot même lui fût venu un seul instant à l’esprit. Une limite lui était donnée, qu’il devait essayer d’atteindre, la promesse qu’en tout être humain, et en lui également donc, existe un chemin qui mène à l’espace de la liberté ; car ce que nous pouvons désirer doit bien être à la mesure de nos forces, pensa-t-il, ou alors ce n’est pas un dieu, mais Satan qui gouverne le monde, et dans une de ses folles lubies il a crée un monstre condamné à hisser, à la sueur de son front, son propre malheur attaché à une chaîne de sorcière, plongeant dans le ventre des temps. […]
[Aucun lieu. Nulle part//Kein Ort. Nirgends – Éditions Stock/La Cosmopolite, 2009, pour la traduction française– p.296/297]
-------------------------
Lire, Écrire, Vivre
(EXTRAIT)
[…] La voix ne recule pas sans livrer combat, elle ne se tait pas sans avoir protesté, elle n’est pas résignée quand elle quitte le champ de bataille. Prendre conscience de ce qui est, réaliser ce qui doit être. La littérature n’a jamais pu se fixer objectif plus ambitieux.
Elle porte plainte ? Pas contre ce qui est insignifiant, et jamais dans la lamentation. Contre le mutisme aux aguets. Contre la disparition menaçante de toute communication entre littérature et société, ce qui est une évidence pour tout écrivain intègre dans un environnement bourgeois. Contre la perspective de rester seul avec le mot (« le mot ne fera qu’entraîner d’autres mots, la phrase une autre phrase »). Contre l’inquiétante tentation de devenir complice des dangers mortels auxquels le monde s’expose par l’adaptation, l’aveuglement, l’acceptation, l’habitude, l’illusion et la trahison. […]
[Lire, écrire, vivre – Christian Bourgois Éditeur, 2015– p.8]
-------------------------
■■■
Christa Wolf (1929-2011) :
Ecrivain de langue allemande elle a suivi des études de germanistique à Iéna puis à Leipzig. En 1951, elle a épousé l'écrivain Gerhard Wolf, avec qui elle a eu deux enfants.
Collaboratrice scientifique de l'Union des écrivains de la RDA - dont elle a été membre du comité directeur de 1955 à 1957 - Christa Wolf a également été lectrice pour différentes maisons d'édition et a collaboré à la revue de la Nouvelle littérature allemande. Elle a par ailleurs été membre du SED (Parti Socialiste Unifié d'Allemagne) de 1949 jusqu'à sa dissolution.C'est à partir de 1962 qu'elle s'est entièrement consacrée à l'écriture. Son premier roman, Le Ciel divisé, a paru en 1963. En 1976, Christa Wolf s'est installée à Berlin. Elle est a été nommée à l'académie européenne des sciences et des arts à Paris en 1984 et a adhéré deux ans plus tard à l'académie libre des arts à Hambourg. Elle est considérée comme l'un des plus grands écrivains de langue allemande ; son œuvre est traduite dans le monde entier. En Allemagne, elle a reçu les prix littéraires les plus prestigieux, parmi lesquels le prix national de la RDA en 1964 et en 1987, le prix Georg Büchner en 1980 et le prix Thomas Mann pour l'ensemble de son œuvre en 2010. Elle est morte le 1er décembre 2011.
-------------------------
Les livres de Christa Wolf : (traduits en français)
Le Ciel partagé, traduit par Bernard Robert, Éditeurs français réunis, 1963.
Le Ciel divisé, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Stock, 2009.
Cassandre. Les Prémisses et le Récit, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Alinéa, 1985 ; rééd. Stock 1994, 2003.
Trame d’enfance, traduit par Ghislain Riccardi, Alinéa, 1987 ; rééd., Stock, 2009.
Ce qui reste, traduit par Ghislain Riccardi, Alinéa, 1990 ; rééd. avec d'autres textes, Stock, 2009.
Aucun lieu. Nulle part, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Stock, 1994 ; rééd. avec d'autres textes, Stock, 2009.
Adieu aux fantômes, traduit par Alain Lance, Fayard, 1996.
Médée. Voix, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Fayard, 1997.
Ici même, autre part, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Fayard, 2000.
Christa T., traduit par Marie-Simone Rollin, Fayard, 2003 ; rééd. avec d'autres textes, Stock, 2009.
Le Corps même, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Fayard, 2003.
Un jour dans l'’année, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Fayard, 2006.
Ville des anges ou The Overcoat of Dr Freud, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Le Seuil, 2012.
August, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Christian Bourgois, 2014.
Mon nouveau siècle. Un jour dans l’année (2001-2011), traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Le Seuil, 2014.
Lire, écrire, vivre, traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Christian Bourgois, 2015.
-------------------------
Christa Wolf – Le Corps même
traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein,
(Fayard – 2003)
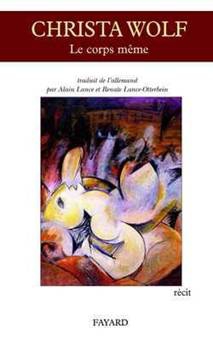
■Site Éditions fayard
http://www.fayard.fr/le-corps-meme-9782213614922
■Site LE BLOG DE LA QUINZAINE
https://laquinzaine.wordpress.com/2011/12/09/christa-wolf-le-corps-meme/
Au seuil de l'été 1980, une femme est emmenée d'urgence à l'hôpital. Atteinte d'une grave péritonite, ses jours sont en danger. Elle passe plusieurs semaines dans une polyclinique de RDA entre la vie et la mort. C'est le récit de ces heures de fièvre qui nous est donné ici, journées et nuits de souffrance et d'angoisse tandis qu'affleurent des souvenirs de jeunesse, mais aussi des événements survenus ultérieurement, étapes d'une rupture progressive avec l'Etat est-allemand. Le récit est rythmé par des plongées oniriques saisissantes qui la font survoler Berlin, sa ville divisée, ou pénétrer dans de labyrinthiques souterrains.
Dans ce moment de péril extrême, la romancière est prise entre la tentation de renoncer et le désir de vivre. La fêlure du temps, celui du déclin d'une société, traverse le corps même, corps de la narratrice et de ce texte bouleversant.
Christa Wolf – Aucun lieu. Nulle part
et neuf autres récits (1965-1989)
traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein,
(Stock – 1994. rééd. avec d'autres textes, Stock, 2009)
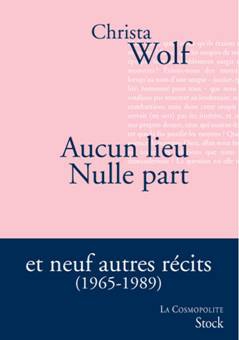
■Site Stock/La Cosmopolite
http://www.editions-stock.fr/aucun-lieu-nulle-part-et-neuf-autres-recits-1965-1989-9782234062061
Christa Wolf écrit ces dix récits de 1965 à 1989, année décisive au cours de laquelle elle met la dernière main au manuscrit de Ce qui reste. Il était important de redonner à lire la description saisissante une journée durant laquelle la romancière constate qu’elle est sous la surveillance de la Stasi.
Les six premiers textes du recueil mettent en lumière le ton nouveau que Christa Wolf apportait dans la prose de la RDA : poétique du quotidien, monologue intérieur, irruption du rêve et veine satirique. Puis en 1979 paraît un magnifique récit dans lequel l’auteur imagine une rencontre entre deux héros tragiques du romantisme allemand, Kleist et Caroline de Günderode. Le titre est éloquent : pour le bonheur, la création, la liberté, il n’existe Aucun lieu. Nulle part. L’écrivain traverse alors une période de crise et d’affrontement avec le pouvoir. Elle choisira, pendant plusieurs années, de situer ses récits loin de l’époque contemporaine, avant d’y revenir, avec Incident, suscité par la catastrophe de Tchernobyl, et le roman Scènes d’été, publié quelques mois avant les bouleversements de l’automne 1989.
Ce recueil permet d’apprécier combien Christa Wolf, sans jamais entrer dans une dissidence ouverte, a manifesté une attitude de plus en plus critique envers le pouvoir est-allemand et a contribué, par ses prises de position, au tournant de l’automne 1989.
Christa Wolf – Ville des anges
ou the overcoat of Dr. Freud
traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein,
(Seuil – 2012)

■Site ÉDITIONS DU SEUIL
http://www.seuil.com/livre-9782021041019.htm
■Site REMUE.NET
http://remue.net/spip.php?article3798
Los Angeles, la ville des anges.
La narratrice doit y séjourner neuf mois, au début des années 1990, après avoir obtenu une bourse de recherche. Il s’agit pour elle de percer un secret : dans quel but Emma, sa chère amie, lui a-t-elle remis avant de mourir une liasse de lettres qu’une certaine L., allemande comme elle, mais émigrée aux États-Unis, lui avait écrites ?
À la recherche de L. dans la ville des anges, donc. Là où trouvèrent refuge beaucoup d’émigrés allemands fuyant le nazisme. Brecht, Thomas Mann. Là où Christa Wolf elle-même s’installa deux ans après la réunification de l’Allemagne pour se protéger des incriminations qu’eurent alors à subir nombre de ceux qui étaient nés de l’autre côté du Mur.
La découverte de l’Amérique, anges et enfers, au moment même où l’Histoire ne laisse plus le choix et vous contraint à entreprendre un douloureux travail sur soi que l’éloignement permet enfin.
Christa Wolf – LIRE, ÉCRIRE, VIVRE (1966-2010)
traduit par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein,
(Christian Bourgois Éditeur – 2015)

■Site Christian Bourgois Éditeur
http://www.christianbourgois-editeur.com/catalogue.php?IdA=441
Essais, récits, discours écrits entre 1966 et 2010, les neuf textes, inédits en français, réunis dans ce recueil témoignent de la réflexion sur la littérature que Christa Wolf a menée de façon constante parallèlement à sa création romanesque.
On y découvre, entre autres, son admiration pour certains auteurs de la scène littéraire allemande, les raisons qui l'ont poussée à élaborer sa poétique de l'« authenticité subjective » - en rupture avec les normes du réalisme socialiste - mais aussi son sens de l'humour.
IMPRIMER

http://lescarnetsdeucharis.hautetfort.com/media/00/01/3164605227.pdf
[1]« C’est ce qui échappe aux mots que les mots doivent dire » – une contribution de Nicole Bary, (p.255), Revue Europe, N°984, avril 2011.
[2]« Hors-d’œuvre » – une contribution d’Alain Lance (p.134), Ibid.
[3] Christa Wolf, Aucun lieu Nulle part, (p.635), Editions Le Cosmopolite, Stock, 2009.
[4] Christa Wolf, Un jour dans l’année (1960-2000), (p.11), Editions Fayard, 2006.
[5]Ibid., (p.11).
[6]Ibid., (p.12).
[7]Référence électronique : Anne Wagniart, « L’ailleurs d’une « poétesse d’État » : ruptures idéologiques et construction identitaire dans l’œuvre de Christa Wolf », Germanica [En ligne], 40 | 2007, mis en ligne le 10 juin 2009, consulté le 05 février 2015. URL : http://germanica.revues.org/263
[8] Extrait d’un article de Marie-Laure Delorme, Le Journal du Dimanche, 10 septembre 2012.
[9]« C’est ce qui échappe aux mots que les mots doivent dire » – une contribution de Nicole Bary (p.256), Revue Europe, N°984, avril 2011.
[10]« Confession d’une vie » – Extrait du discours de l’écrivain Christoph Hein prononcé le 24 septembre 2010 à l’occasion de la remise du Prix Uwe Johnson à Christa Wolf (p.267), Revue Europe, N°984, avril 2011.
[11]« Confession d’une vie » – Extrait du discours de l’écrivain Christoph Hein prononcé le 24 septembre 2010 à l’occasion de la remise du Prix Uwe Johnson à Christa Wolf (p.270), Revue Europe, N°984, avril 2011.
14:59 Publié dans Christa Wolf, Christian Bourgois Editeur, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
































































