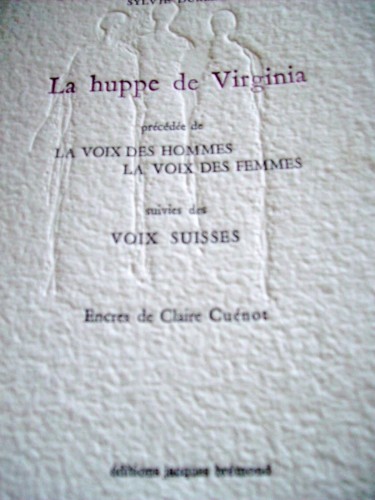18/01/2012
Revue Europe, Georges Perec (Georges Perec, un regard en biais - par Nathalie Riera
Lecture Nathalie Riera
Georges Perec
Revue Europe, janvier&février 2012 – N° 993-994
Site Revue Europe/ http://www.europe-revue.net/
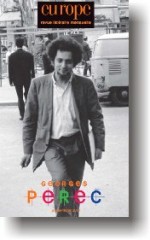
Georges Perec, « un regard en biais »
____________________________________________________________________________
■■■ Trente ans après la disparition de l’écrivain oulipien « à 97 % », quelles sont la place et l’importance de son œuvre aujourd’hui, dans le paysage littéraire ? Claude Burgelin, qui répond aux questions de Jean-Pierre Martin, se réjouit « de voir qu’il continue à incarner une image amicale, démocratique (je veux dire : non élitiste) de l’écrivain, celui qui ouvre large les portes de son atelier et laisse entendre que le langage est à tous, que regarder de tous ses yeux est à la portée de chacun, qu’une simple énumération peut mener à l’intelligence de la littérature et du monde ».[1]
Perec s’implique dans la masse du quotidien. Avec son premier livre « Les Choses » (1965), « chronique des années 60 » selon Gianni Celati, ce n’est pas l’intériorité de l’homme ou la psychologie du personnage qui charrie l’écriture, mais plutôt l’ouverture vers l’extériorité. Sur ce sujet, Celati précise : « Cette ouverture de champ est la question centrale de Perec. Il s’agit d’aller vers les choses et de les interroger, d’accumuler des descriptions de leurs caractéristiques. Dans ses textes tout devient important : les meubles, les ustensiles, les espaces, les catalogues de vente par correspondance, les emprunts faits à d’autres auteurs, une collection de cartes postales, un inventaire des aliments consommés au cours d’une année, ou des notes comme celles qui forment le cahier des charges de La Vie mode d’emploi et qui peuvent concerner tout ce qui tombe entre les mains, d’un bouquet de tubéreuses à une carte du Massachusetts, pour entrer ensuite mot pour mot dans les scènes du livre. L’idée est celle d’un magasin où même les objets immatériels, les souvenirs, les pensées et les rêves sont traités comme des choses matérielles, dans l’extériorité de tout ».[2] Citant l’écrivain et urbaniste Paul Virilio, c’est aussi « une façon de créer une mémoire du monde ».
L’extériorité et sa multitude de choses et d’objets, d’éléments sériels, invite à une manœuvre d’écriture dont le souci chez Perec est : non pas analyser, mais décrire, énumérer ce qui habite notre quotidien, ce « night-and-day de la vie de masse », « espace multiforme » qu’on ne se donne jamais vraiment la peine d’observer, la banalité étant toujours considérée comme désuète et sans intérêt. Mais de quelle quotidienneté est-il question ? si ce n’est « la quotidienneté inaperçue » qu’il s’agit de vraiment apercevoir, découvrir, voire même surprendre. Domique Rabaté rappelle ce que tout projet de livre chez Perec signifie, celui « de rompre un aveuglement », et en mémoire de l’écrivain, ce beau portrait de « l’usager de l’espace » : « un individu parmi d’autres qui changent de lieux, qui rêvent d’une impossible patrie, et voyagent de signes en signes. Lui le fait par l’écriture qui est peut-être la meilleure inscription possible, dans un espace à la fois mental et matériel ».[3]
Maryline Heck re-convoque l’origine du mot « l’infra-ordinaire » (inventé par Paul Virilio) : « description de ce bruit de fond de nos existences, habituellement passé sous silence » ; l’infra-ordinaire chez Perec : « Interroger l’habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l’interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s’il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s’il n’était porteur d’aucune information. Ce n’est même plus du conditionnement, c’est de l’anesthésie. Nous dormons notre vie d’un sommeil sans rêves. Mais où est-elle, notre vie ? Où est notre corps ? Où est notre espace ? ». [4]
Observateur des « réalités silencieuses », Georges Perec est ce peintre du quotidien, dans son ingéniosité d’inventorier et d’inventer.
« Les textes de Perec ouvrent une partie de mon inconscient (c’est pour moi le signe distinctif de la grande littérature), à l’inverse de la plupart des livres vantés par les médias et qui, eux, le bloquent, ne sachant jouer que sur l’obsession, la peur, la rage et autres rétrécissements internes ». (« La vengeance de Perec », Pierre Furlan, p.158)
(Les carnets d’eucharis, Nathalie Riera, janvier 2012)
PRESENTATION ■
http://www.europe-revue.net/presentation-janvier-fevrier.html
■ Imprimer 
Nathalie Riera_Georges Perec, _un regard en biais__Les carnets d'eucharis, 2012.pdf
21:53 Publié dans Europe, Georges Perec, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
16/01/2012
Zbigniew Herbert, Corde de lumière (une lecture de Tristan Hordé)
Zbigniew Herbert Corde de lumière
(Œuvres poétiques complètes I)
- traduites du polonais par Brigitte Gautier, édition bilingue -
Editions Le Bruit du Temps, 2011
LECTURE : Tristan Hordé
Les œuvres de Zbigniew Herbert (1924-1998) — une dizaine de livres de poèmes, des essais — restent peu connues en France(1). Le premier volume des œuvres poétiques (qui en comprendra trois) rassemble Corde de lumière (1956), Hermès, le chien et l'étoile (1957) et Étude de l'objet (1961) ; il est précédé d'une "conversation de l'auteur avec lui-même" autour du thème de l'écriture de poèmes. Parallèlement à cet ensemble, paraît un volume d'essais, Le Labyrinthe au bord de la mer (2000 en polonais, donc posthume), consacré aux voyages du poète en Grèce et en Italie et à ses réflexions sur l'Antiquité ; il sera suivi de deux autres.
On peut commencer l'exploration des poèmes, en vers et en prose, en examinant ce que Zbigniew Herbert rejette. Dans les réponses qu'il propose à ses propres questions, il marque nettement son refus du réalisme socialiste qui ne tient aucun compte de la réalité observable. Il revient sur ce point à plusieurs reprises dans ses poèmes, par prudence sans allusion directe à ce qu'imposait le pouvoir en Pologne mais sans aucune ambiguïté. Un écrivain peut sans doute présenter un monde idéal, décrire les choses quotidiennes en gommant toutes aspérités, et donc ignorer que le réel s'imposera à un moment ou à un autre ; ainsi l'image de la "La chambre meublée" [titre d'un poème] sera, pour ne pas choquer, celle d'un « monde faux » — mais « du papier peint arraché / des meubles non apprivoisés / les taies des glaces sur le mur / voilà l'intérieur réel » (p. 225). De manière analogue, il est inutile de peindre « toute la nuit en rose » les murs gris de la prison : cela n'empêchera pas l'enfermement. Donc, il faut sortir des leçons imposées, quoi qu'il en coûte — et Z. Herbert a payé le pris — et tenter de dire ce qui est en sachant que tous « nous avons des cailloux / noirs à la place des yeux » (p. 75).
Quoi écrire ? « [...] le domaine des choses, le domaine de la nature me semblait être un point de repère, et également un point de départ, permettant de créer une image du monde en accord avec notre expérience » (p. 17). Donner une "image du monde" en choisissant pour point de départ un tabouret, des chaises ou une table, c'est aller contre toute idéalisation de la réalité et, en même temps, affirmer que « nous sommes réels » (p. 113). Cette attention à ce qui passe inaperçu peut aussi être la base d'une critique d'une certaine poésie ; dans un portrait de la poule (bien différent de celui de Jules Renard dans ses Histoires naturelles), il retient la rupture entre elle et les autres oiseaux, comportement né de la vie avec les hommes, et notamment « cette parodie de chant, ces supplications brisées pour une chose incroyablement ridicule : un œuf souillé, blanc, rond. // La poule rappelle certains poètes. » (p. 343) Décrire ces choses sans relief, qui conduisent à séparer « la chose de l'apparence » (p. 167), ne signifie pas pour Zbigniew Herbert qu'il faudrait seulement s'attacher à un réel "nu" ; bien des poèmes, surtout ceux en prose, débordent ce cadre et construisent un univers de fantaisie, parfois de non-sens : ainsi, le chat « arrache les oiseaux des arbres avant qu'ils soient mûrs » (p. 321), l'ours refuse d'aller à l'école, etc. La poésie est comme le coquillage vide qui « raconte / les mers évaporées dans le sable » (p. 421)
Pour ce qui est du "domaine de la nature", il apparaît de manière récurrente sous une forme élémentaire : l'eau, la terre, le feu, l'air, puis les fleurs (seule la rose est citée, abondamment), les arbres (« un tronc de bouleau comme une corde de lumière », p. 85), les oiseaux, auxquels le Poète est associé :
que serait le monde
s'il n'était plein
de l'incessant va-et-vient du poète
parmi les pierres et les oiseaux
(p. 197)
Ce monde naturel se caractérise par le fait qu'il donne sans détour ce qu'il est. On pourrait reconnaître une forme de panthéisme dans la poésie de Zbigniew Herbert qui, l'une des rares fois où il s'adresse à un lecteur, écrit : « sans attendre de meilleure récompense / assieds-toi sous l'arbre » (p. 85). Et c'est à partir des éléments naturels que le poète peut décrire le monde des choses : « il me faut regarder les toits comme la pleine mer » (p. 219), écrit-il.
L'univers de Zbigniew Herbet est plus complexe ; y est intégré une relation active à la tradition, qu'il s'agisse de l'Antiquité — des poèmes ont pour thème Athéna, Marc-Aurèle, Néfertiti, Jonas, etc. — ou plus largement du passé. Les références ne doivent rien à une quelconque nostalgie, l'Antiquité est toujours une source vivante et, à l'occasion, se révèle un instrument critique ; si Arion, ce cheval doué de la parole, chante l'harmonie, le paradis perdu (« tout est aussi bon / qu'au commencement », p. 147), ce n'est cependant qu'un chant..., et il s'éloigne sur la mer, « seul » (p. 149). Et de la statue d'Apollon appréciée dans la jeunesse, « il ne reste qu'un socle vide » (p. 49). Quant au passé, il est doublement important : opposé aux "lendemains qui chantent" du pouvoir, c'est aussi un appui pour comprendre ce qui est vécu aujourd'hui — « la poésie est fille de mémoire / elle veille les corps dans le désert » (p. 273).
On lira, insistante dès le premier livre, une volonté d'être lisible, d'écrire sans détour — « je donnerai toutes les métaphores / pour une expression / comme une côte écalée de ma poitrine / pour un mot / qui rentre / dans les limites de ma peau » (p. 169). Une poésie donc qui s'en tient à un vocabulaire commun, à une syntaxe sans recherche, qui privilégie l'énumération plutôt que l'image : l'essentiel, toujours, est de parvenir à « décrire la simple émotion » (p. 169), de la susciter chez le lecteur non pour rejeter la réflexion mais pour qu'elle ne soit pas première. Dans un poème de circonstance, "Aux Hongrois", écrit au moment de l'insurrection en 1956 contre le pouvoir communiste, les quatre brefs quatrains ne visent pas à décrire ce qui se passait, plutôt à exprimer « d'une manière aussi pure et transparente que possible » (p. 16) la solidarité avec ceux qui luttaient pour des valeurs. Cela est peu ? C'est que les mots du poète n'ont pas le pouvoir de changer quoi que ce soit, ni d'expliquer le monde. Dans une parabole, le "Poète" relate que « deux ou trois / fois / [il a] été sûr / de toucher au fond des choses / de savoir » (p. 475) ; sa recherche a été interrompue par une intervention extérieure mais, quand il l'a reprise, il a atteint son but et a pu enfin contempler « le cœur des choses // une étoile morte // une goutte noire d'infini » (p. 477).
Alors ? Il y a sans doute dans l'affirmation de l'absence de pouvoir de la poésie un refus de l'aveuglement de ceux qui écrivaient pour vanter « le royaume de l'avenir », pour faire croire que le « paradis sera prêt / à la fin de la lutte des classes » (p. 277). C'est en même temps dire que les poèmes, comme le reste des créations humaines, disparaîtront dans l'oubli. Dans la série des éléments de la nature, le dernier cité par Zbigniew Herbert est l'herbe : « l'herbe qui survient lorsque l'histoire s'accomplit / et qui est un chapitre du silence » (p. 117). On relèvera ici la rencontre avec un poète fort différent, Jude Stéfan, qui évoque dans les Suites slaves « l'oubli des herbes » (André Dimanche, 1983, p. 81).
(Les carnets d’eucharis, Tristan Hordé, janvier 2012)
1 Trois recueils, tous épuisés, ont été traduits : Monsieur Cogito et autres poèmes (Fayard, 1990), Redresse-toi et va (Orphée/La Différence, 1995) et Élégie pour le départ suivi de Rovigo (Le Passeur, 2000). Deux essais sont disponibles, Un barbare dans le jardin (Le Rocher, 2000) et Nature morte avec bride et mors (Calmann-Lévy, 2003).
20:37 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, POLOGNE, Tristan Hordé, Zbigniew Herbert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
09/12/2011
Alda Merini - Delirio amoroso/Délire amoureux (par Nathalie Riera)

Lecture Nathalie Riera
Alda Merini,
Délire amoureux/Delirio amoroso
Collection « Debout poète, debout »
Oxybia Editions, 2011
Traduction Patricia Dao/ Préface deFlaviano Pisanelli
Quatrième de couvertureAndré Chenet
Alda Merini, « de sa fièvre amoureuse »
____________________________________________________________________________
■■■ Pour avoir été très lié à la poète Alda Merini, Angelo Guarnieri, psychiatre de la réforme Basaglia contre l’asile totalitaire soumis à une législation italienne des plus arriérées d’Europe [1], assurait la préface du recueil « Après tout même toi/Dopo tutto anche tu » [2] , dans une écriture portée par « une amitié authentique et profonde, résistante à l’usure et à l’ennui de notre temps ».[3] Il y a ceux comme Guarnieri qui auront eu la chance de rencontrer Alda Merini et de l’entendre lire ses poèmes, et il y a ceux qui s’en tiendront à cette chance de pouvoir la lire en France, deux ans après sa disparition. Si rien dans la poésie de Merini ne laisse entendre un quelconque dégoût pour la folie (« Je crois que la folie est un profond lien d’amour »), il ne peut s’agir non plus d’une idéologie de la folie, et comme l’écrit l’ami psychiatre à son propos : « Alda Merini est devenue un ruminant, qui régurgite la douleur et la reboit ».[4] Quel est donc chez elle ce rapport poésie/folie ? :
parce que le jour du poète,
si semblable à la folie,
ne trouvera pas
sa mesure
dans l’éthique moderne.
[p. 21]
Chez Merini, il y a surtout « l’enfer/des sens/qu’est la vie », « les enfers de la grande pensée », mais sans que ceux-ci ne viennent supplanter son profond humour et la gravité de sa fantaisie. Et que dire du sens de la poésie chez un être frappé par ces enfers irrémissibles ? Dans sa « Lettre à Angelo G. » [5] : « La poésie n’est-elle pas une sorte de méchanceté adressée à soi-même ou une sorte de bénédiction ? ».[6]
« La folie est un artisanat ».
[p. 71]
Et à la question sur la « loi Basaglia », Alda Merini répond [7] : « Voyez-vous, l’hôpital psychiatrique n’a pas pour moi la même fonction que pour les autres, pour moi ce fut… je ne sais pas, je n’en ferais pas un cas national… je l’ai bien vécu ; mais j’aurais bien vécu n’importe quoi, la guerre… la poésie aussi… est un traumatisme, vous le savez vous aussi. C’est une espèce d’asile psychiatrique personnel… ».
Deux ans après Dopo tutto anche tu, Les éditions Oxybia poursuivent un hommage à la poète milanaise avec l’édition bilingue de Délire amoureux/Delirio amoroso, lumineusement traduit par Patricia Dao, passionnément préfacé par Flaviano Pisanelli, ce bel ensemble rejoint par une quatrième de couverture du poète et passeur André Chenet.
Comme le précise F. Pisanelli, à chaque recueil de Merini, la notion même de « folie » « ne se limite à aucune définition conventionnelle ni médicale ».[8] C’est dans l’Italie du Sud (Milan, Taranto) que Merini fera l’expérience de l’incarcération psychiatrique :
« Elle ne cesse de vouloir comprendre les raisons de l’univers déshumanisé et déshumanisant de l’asile psychiatrique. Cette attitude de révolte et de résistance amène l’écrivain à défendre son rôle d’individu et de femme : elle continue à vivre sa condition d’épouse et de mère, en essayant de ne jamais perdre le contact avec la réalité qui semble toutefois s’arrêter au-delà des barreaux des fenêtres de sa chambre et de son lit de contention, des électrochocs et de la stérilisation qu’elle subit et qui privent l’individu de son identité et de sa dignité ».
[p. 14]
« Dans Délire amoureux… la folie s’exprime tout d’abord comme une force ‘dissidente’ ».
[p. 16]
Mais comment est-il possible d’écrire dans l’enfer de l’internement ? Patricia Dao me confiera qu’il fut impossible pour Alda Merini d’écrire « dans ce lieu tourmenté et infâme qu’est l’asile psychiatrique ».[9] Ce ne sont pas les fous qui font l’asile psychiatrique. Dans « La neo-mediocrità », Patrick Faugeras relate :
C’est en 1988, dix ans plus tôt donc, qu’avait éclaté le scandale concernant la ville d’Agrigente, lorsqu’un parlementaire, Franco Corleone, avait poussé, de façon impromptue, les portes de l’asile, et avait découvert avec stupeur une situation catastrophique : « … des malades errants, nus, glissant sur un sol inondé d’urine, demandant l’aumône aux visiteurs, mangeant avec les mains… dormant nus dans des draps tachés de jaune, de marron, de pus, rongés par les rats… des malades enfermés dans des cellules, d’autres ne pouvant franchir l’enceinte de l’hôpital… » Ces faits, rapportés par le journal L’Espresso, soulevèrent en Italie une indignation générale. L’opinion publique, les politiques se mobilisèrent. Le 3 octobre 1991, un malade est retrouvé mort au pied du mur d’enceinte de l’hôpital, le visage dévoré par les rats et par les chiens. L’enquête s’élargissant, seize médecins et administrateurs sont accusés d’« abandon aggravé de personnes en difficulté », d’« homicide par imprudence », d’« incurie par imprudence ». Il faut préciser qu’entre 1977 et 1988, cent quatre-vingt-dix personnes ont trouvé la mort, la moitié de ces décès étant dus à une épidémie de tuberculose non enrayée, non soignée. [10]
« Je fus déchargée à l’entrée de l’hôpital psychiatrique Paolo Pini, mais je ne comprenais pas encore. Les âmes bénies ne croient pas qu’il puisse y avoir de la violence dans le monde ».
[p. 31]
La psychiatrie de Taranto ne cesse d’être une insulte : « Incroyables sont les malversations, les intrigues, les compromis auxquels recourt le personnel des Centres Psychiatriques pour piéger le malade qui parle, discute, dénonce. Le malade est coupable : tout ça pour eux est savoir psychiatrique. Tout ça pour moi est crime».[11]
Alors reconnue par les critiques et les plus grands poètes du XXème siècle (Montale, Pasolini…), le premier internement d’Alda Merini aura lieu dans la jeunesse de ses 16 ans, suivi d’un autre internement, de plusieurs années (de 1955 à 1972), et c’est en 1979 qu’elle recommencera à écrire.
« Je suis devenue poète peut-être parce que la poésie m’importait guère. Même si j’ai dévoré les livres, même si en moi était le chant (mais c’était le chant de la vie, et ça ils ne l’ont pas compris)
[…]
J’ai vécu ma première société poétique Via del Torchio. Par société, je veux dire que j’étais sur le divan coude-à-coude avec les grands de la poésie, avec la classe du renouveau littéraire. J’étais trop petite pour comprendre ce que faisaient ces grands hommes.
Erba, toujours joyeux et éparpillé. Pasolini, taciturne et plein de résistance physique. Turoldo, à la voix tonnante et belle qui semblait la réincarnation de la « scapigliatura » affranchie.
Nous étions pauvres, mais pleins de patience et avec une grande capacité d’absorption. Plus qu’un écrivain, j’étais leur mascotte : jeune, taciturne, peut-être belle, avec deux flancs dont j’avais honte et que j’essayais de cacher.
Manganelli était un brave homme. Il lançait des miettes dans mon décolleté en riant, mais il avait aussi un sourire tendre. Erba semblait toujours à la recherche d’un cerf-volant qui lui échappait des mains ».[12]
Dans cette vie constellée de malédictions, Alda Merini parle souvent de la peur, la peur est au centre de sa vie, de sa chair, comme elle évoque souvent ces deux années d’isolement total, chaque jour marqué par « un douloureux calvaire de solitude », sans « aucune solution de mémoire ni de chant ».[13] Et même si « la psychiatrie et la littérature n’ont rien en commun » : « Avec ‘Delirio amoroso’ Alda Merini décrit précisément cette ‘folie d’amour’ qui lui valut de sortir des ornières de la pensée admise. Un chant halluciné remontant des grandes profondeurs de l’être sous-tend ce récit d’une tragédie qui se dénoue, comme une prière muette, dans la divinité de l’amour universel ».[14] ■■■
Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Nathalie Riera

Régis Daubin - 12, rue des Roumègons – 06520 MAGAGNOSC
Tél. : 09 53 61 72 31 ou 06 76 96 96 67
Extraits
____________________________________________________________________________
J’ai été trahie : je ne sais pas par qui. Un jour, un nuage gris tomba sur mon existence. Un nuage sans couleur. Difficile que les hommes puissent remuer le ciel, mais parfois ils se servent des devins pour cela. Par le biais de chaudrons, de serpents et de sorcières je fus envoyée loin de ma vieille patrie, où je ne connus plus rien. Je fus enterrée en psychiatrie. Pour l’honneur, par le pouvoir. Le « diario » fut mon passeport pour une folie dense d’amour et de pauvreté. Je suis pauvre, seule l’obole de mes amis me permet de vivre. Il y a en cela un certain romantisme, mais je reste fondamentalement pauvre, alors que je voudrais avoir mon domaine secret. Si on me trahit, je me cache dans l’enchevêtrement des mots et les mots sont des haies vertes et hautes où se tapissent de nobles faons.
L’homme est un cannibale qui veut à tout prix manger ses semblables, après quoi il exhibe avec clameur ses appareils électroniques, ses machines à laver dernier cri, les ordinateurs et tout ce qu’il appelle progrès (et que j’appelle carnage).
[p. 42/43]
Ça fait maintenant deux ans que je suis malade, exactement deux ans, et c’est moi qui l’ait voulu. Encore une fois j’ai fermé le lourd temple de ma vie. J’ai reculé en me plongeant dans un indéchiffrable inconscient. L’inconscient est riche comme le fond des mers, plein de coraux et d’éponges, de sirènes et de personnages de rêves. Plein de fleurs carnivores. J’habite ici depuis deux ans comme quand j’étais à l’asile psychiatrique. L’asile psychiatrique est une grande caisse de résonance où le délire devient écho. J’ai vécu en asile psychiatrique parfois volontairement. D’autres fois sans le savoir.
[p. 83]
[1] Lire l’article de Patrick Faugeras « La neo-mediocrità » - Sud/Nord 1/2004 (no 19), p. 31-39.
[8] Le feu de la folie : Délire amoureux d’Alda Merini (Préface de Flaviano Pisanelli), Délire amoureux/Delirio amoroso, Oxybia Editions, 2011, p. 13
22:04 Publié dans Alda Merini, ITALIE, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Zbigniew Herbert, Corde de lumière
Zbigniew Herbert Corde de lumière
(Œuvres poétiques complètes I)
Editions Le Bruit du Temps, 2011
LECTURE : (Nathalie Riera)
« … un poème qui sonne comme un disque de vieux tango ne m’attire pas », [1] mais ce n’est pas pour autant que le grand poète polonais Zbigniew Herbert(1924-1998) soumettra sa passion de penser à « ce malheureux intellectualisme de la poésie contemporaine », refusant pour cela l’épithète de « poète intellectuel ». Pour Herbert, entre le poète et son lecteur, la complicité est plus que jamais primordiale : « Je fais confiance à mon lecteur pour être mon complice, travailler avec moi. Ceux qui dispensent une distraction facile méprisent leur public. Moi, je le traite comme un partenaire, en respectant sa différence, sa capacité de juger et de critiquer ».[2]
« Une flamme qui pense », en titre d’un article de Claude Mouchard dans La Quinzaine Littéraire,[3] le poème chez Herbert n’est pas un moyen d’expression mais le moment d’une expérience intérieure, le lieu d’une autre connaissance. Pour faire un parallèle avec le réalisateur russe Andreï Tarkovski : « … mes films ne sont pas une expression personnelle mais une prière. Quand je fais un film, c’est comme un jour de fête. Comme si je posais devant une icône une bougie allumée ou un bouquet de fleurs. Le spectateur finit toujours par comprendre lorsqu’on lui parle avec sincérité (…) Le manque d’honnêteté détruirait le dialogue ». [4]
Que peut offrir la poésie dans un monde trahi ? La poésie, antithèse du concept et de la puissance négatrice, chaque poème est une ligne du cœur sans mélodie artificielle, la volonté d’une union du rêve et de la mémoire. « (…) les poètes n’ont pas de pouvoir sur le monde. La langue est leur unique royaume. Ce n’est que dans ce domaine qu’ils peuvent gouverner et légiférer ».[5]
Corde de lumière est le premier volume des Œuvres poétiques complètes, publié aux éditions Le Bruit du Temps, et traduit du polonais par Brigitte Gautier.
(Les carnets d’eucharis, Nathalie Riera, décembre 2011)
EXTRAITS
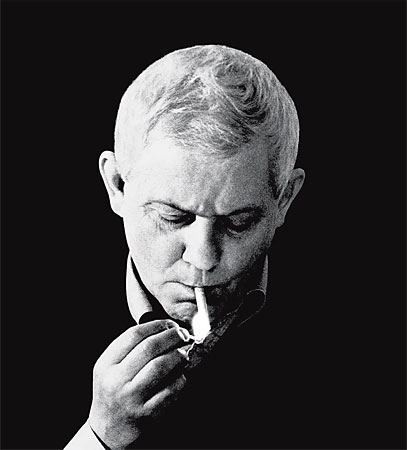
La forêt d’Ardenne
Joins les mains pour puiser du rêve
comme on puise eau ou graine
et apparaît une forêt : nuée verte
et un tronc de bouleau comme une corde de lumière
et mille paupières vont battre
une langue feuillue oubliée
tu te remémoreras alors le matin blanc
où tu attendais que les portes s’ouvrent
tu sais l’oiseau entrouvre cette contrée
il dort dans l’arbre et l’arbre dans la terre
source ici de nouvelles questions
sous les pas les courants des mauvaises racines
vois le dessin de l’écorce où
s’imprime une corde de musique
le luthiste tournant les chevilles
afin que résonne ce qui se tait
écarte les feuilles : des fraises des bois
la rosée d’une feuille l’arête d’une herbe
plus loin l’aile d’une libellule jaune
une fourmi enterre sa sœur
plus haut au-dessus de la belladone traîtresse
mûrit doucement un poirier sauvage
sans attendre de meilleure récompense
assieds-toi sous l’arbre
joins les mains pour puiser de la mémoire
des morts les prénoms la graine flétrie
une autre forêt : nuée calcinée
le font marqué d’une lumière noire
et mille paupières serrées
fort sur des globes immobiles
l’arbre et l’air brisés
la foi trahie des abris vides
et cette forêt-là est pour nous pour vous
les morts réclament aussi des fables
une poignée d’herbes l’eau des souvenirs
alors sur les aiguilles de pin sur les murmures
et des odeurs les fils fragiles
peu importe que la branche t’arrête
que l’ombre te mène par des chemins sinueux
car tu retrouveras et tu entrouvriras
notre forêt d’Ardenne
(p.85/87)
Le sel de la terre
Une femme passe
son foulard tacheté comme un champ
elle serre contre sa poitrine
un petit sac en papier
cela se passe
en plein midi
au plus bel endroit de la ville
c’est ici qu’on montre aux excursions
le parc et son cygne
les villas dans les jardins
la perspective et la rose
Une femme avance
avec la bosse d’un baluchon
- que serrez-vous donc ainsi grand-mère
elle vient de trébucher
et du sac
sont tombés des cristaux de sucre
la femme se penche
et son expression
n’est rendue
par aucun peintre de cruches brisées
elle ramasse de sa main sombre
sa richesse dissipée
et remet dans le sac
les gouttes claires et la poussière
Elle
reste
si
longtemps
à genoux
comme si elle voulait ramasser
la douceur de la terre
jusqu’au dernier grain
(p.144/145)
01:52 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Zbigniew Herbert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Jude Stéfan, Ménippées (P(r)o(so)ésies)
Lecture Tristan Hordé
Jude Stéfan, Ménippées (P(r)o(so)ésies)
Editions Argol, 2011
■■■Le titre et le sous-titre apparaissent, comme la plupart du temps chez Jude Stéfan comme un programme. Ménippées ne s’inscrit pas dans la tradition de la Staire Ménippée, texte essentiellement satirique, mais, ce que suggère le pluriel, évoque sans doute possible les Ménippées de Varron, c’est-à-dire des écrits qui mêlent vers et proses et abordent tous les sujets sans établir de hiérarchie entre eux, passant de remarques sur la vie quotidienne à des considérations sur la philosophie ou la littérature. C’est bien de cela qu’il s’agit dans les cinq ensembles, datés de 2006 à 2010 du livre de Stéfan ; s’y succèdent les fragments d’un journal, des "litanies du Muséomane" (parallèles aux Litanies d’un scribe), des ajouts à Pandectes (Pandectes (ou le neveu de Bayle), 2008), la traduction d’un poème de Rubén Darío, des poèmes, des remarques sur la littérature, d’autres sur une lecture, des propos entendus au café, des citations (parfois non traduites), des idées de titres, des notations de rêves, des jeux phoniques à partir du grec et du latin ; etc. Le sous-titre, P(r)o(so)ésies, qui, littéralement, ne peut être lu, dit autrement le refus de distinguer entre des genres, de séparer prose et vers. C’est là une constante dans l’œuvre de Stéfan, affirmée dès le premier livre (Cyprès (poèmes de prose), 1968) et régulièrement répétée dans les textes critiques, dans des titres, par exemple La Muse Province (ou 76 proses en poèmes), et dans les poèmes : le sous-titre apparaît dans Épodes (1999), ouvrant le premier ensemble, "Des vers" :
78 : Arthur affiché sur les portes d'acier
aux Transformateurs
la poésie en la prose
la poésie en le PO M
ou la prose en prosoésies les
proêmes en prosies proésies
le poèmenprose en la prosenpoème
[etc. ; p. 11]
La radicalité de ce choix déconcerte certains lecteurs pour qui les genres existent toujours, partage ancré par les habitudes de lecture scolaire figées. Si la plupart des lecteurs admet qu’un coucher de soleil ou une déclaration d’amour ne sont pas "poétiques" par nature ( ?), il faut encore redire que la poésie ne se définit pas plus par la présence du vers — le passage à la ligne — que par le sens dénoté : « En lisant Zanzotto (Phosphènes) ; enfin des textes dépourvus de sens, du sens appris de lecture scolaire ou conformiste, enfin pouvoir lire les mots tels quels en leur indépendance syntaxique. » (p. 80) Le sens n’est pas absent, certes, ou l’émotion, la présence du sujet, mais rien du « ça veut dire », ni dans Zanzotto ni dans des œuvres en cours fort différentes comme celles de Philippe Beck, Caroline Sagot-Duvauroux ou Jean-Louis Giovannoni.
Dans Ménippées, les lignes de force de l’œuvre sont bien présentes si l’on met en valeur celles qui organisent presque tous les livres : l’amour, le temps, la mort. Non pour classer des éléments du texte mais, ici et là, sous diverses formes. Ainsi le motif du temps clôt le premier ensemble daté (I, 2006) avec l’évocation d’une maison dont les éléments progressivement se défont, allant vers la ruine
Anti-poème
à l’arrière-cour
fenêtre murée
verrous, gouttières, auvents
barreaux, grille rouillée
rideaux pendants
en muet abandon
tenons et chenil
dans une aire sans accent
que des cadenas
Ainsi le motif de la mort se lit dans un rappel des noms perdus ou dans la proposition d’un récit où reviendrait à intervalles réguliers la phrase : « X… est mort ». Quant au motif de l’amour, c’est un solide fil conducteur, au début du livre avec le souvenir d’un film d’amour « bouleversant », ensuite avec le récit d’anecdotes — un adieu dans une gare —, la notation d’un « cri de Fille », de conseils pour séduire une femme, d’affirmations lapidaires (« Amour. Le moins aimé souffre le plus ») ou, pour conclure un rêve, avec une équivalence, « L’amour : inquiétude/apaisement ».
Le lecteur retrouve les formules qui se veulent sans réplique (« Il n’est de plaisir pur que dans l’égoïsme »), les remarques sur la difficulté à vivre la solitude et, nombreuses, les assertions provocatrices : à l’ouverture de Ménippées, la lumière et la naissance (la venue au jour) sont associées à la défécation (la disparition) : « Confession d’Optimiste. Il s’avèrera moins lugubre d’allumer, dans les lieux d’aisances, afin d’honorer ce rite quotidien, en remerciant d’être né. ». À la page suivante, c’est l’art d’être grand-père qui est parodié : « Lorsque l’enfant paraît traînant son pot [etc.] » ; ajoutons un éloge du port de la burka et de la masturbation en public (puisqu’elle est « naturelle »…), et le rejet de Mozart, Beethoven et quelques autres, seulement capables de « flatter l’oreille », « art mélodique […] qui longtemps retarda la Musique ».
Ce regard peu amène sur ses contemporains et leurs choix n’est pas nouveau mais, parallèlement, Stéfan considère avec peu de complaisance son personnage. Le commentaire de l’exposition qui lui était consacrée en 2010 — « Une vie d’ombre, une œuvre de non-vie » — est symboliquement noté le 1/7, jour de la naissance de qui signe de ce nom ; le thème de la "non-vie", comme celui du "vide", est récurrent dans l'œuvre. Symboliquement encore, Ménippées s'achève sur une sortie avec une note du 31/12 : « Excipit. Le dégoût d’avoir écrit l’emporte sur le plaisir d’écrire », qui répond au dernier vers de Que ne suis-je Catulle (2010), « Ne Plus Écrire ». ■■■
Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Tristan Hordé
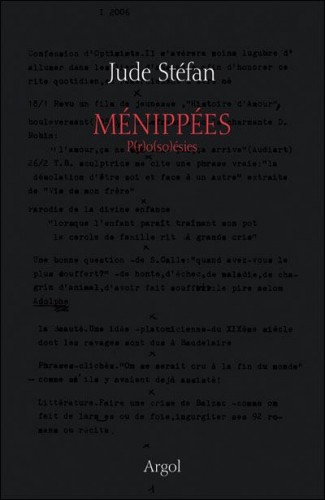
01:36 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Claude Royet-Journoud et Alain Cressan (une lecture de Tristan Hordé)
Lecture Tristan Hordé
TABOURET
Claude Royet-Journoud et Alain Cressan
Editions Lnk, 2011
■■■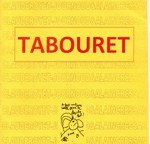 Il faudrait un jour écrire l'histoire de ces éditeurs qui, depuis des années, travaillent en marge, diffusant leurs livres vaille que vaille, grâce au bouche à oreille, sans souci premier d'être "rentables". Pascal Quignard a évoqué, dans une lettre à Bénédicte Gorillot qui ouvre Inter (Argol, 2010) comment Emmanuel Hocquard, l'hiver 1978, tirait « à la main sur la presse d'Orange Export Ltd » ses livres, « dans l'atelier de Raquel, à Malakoff, sur un plancher de bois exhaussé, le chien hurlant de ne pouvoir monter les échelons ». Quelques passionnés, sans beaucoup plus de moyens, poursuivent cette tâche patiente, obscure, donnant à lire quelques titres chaque année — je cite, au hasard des livres sur la table, L'arrière-pays (Josette Ségura et Éric Dazzan), Poliphile (François Lallier et Géraldine Toutain), Ficelles (Vincent Rougier), Contrat Main (Pascal Poyet et Françoise Goria).
Il faudrait un jour écrire l'histoire de ces éditeurs qui, depuis des années, travaillent en marge, diffusant leurs livres vaille que vaille, grâce au bouche à oreille, sans souci premier d'être "rentables". Pascal Quignard a évoqué, dans une lettre à Bénédicte Gorillot qui ouvre Inter (Argol, 2010) comment Emmanuel Hocquard, l'hiver 1978, tirait « à la main sur la presse d'Orange Export Ltd » ses livres, « dans l'atelier de Raquel, à Malakoff, sur un plancher de bois exhaussé, le chien hurlant de ne pouvoir monter les échelons ». Quelques passionnés, sans beaucoup plus de moyens, poursuivent cette tâche patiente, obscure, donnant à lire quelques titres chaque année — je cite, au hasard des livres sur la table, L'arrière-pays (Josette Ségura et Éric Dazzan), Poliphile (François Lallier et Géraldine Toutain), Ficelles (Vincent Rougier), Contrat Main (Pascal Poyet et Françoise Goria).
Je n'oublie pas les livres fabriqués "à la maison" avec un ordinateur, un scanner et une imprimante, mais qui n'entrent pas dans le circuit commercial ; les textes sont publiés autour d'une centaine d'exemplaires et distribués à des amis. Ce type d'édition, confidentiel, propose poèmes et dessins que leur éditeur, ici Alain Cressan, a sollicités auprès d'écrivains et d'artistes qu'il apprécie, sans souci de la notoriété des uns et des autres — pas seulement français : la part des travaux venus des États-Unis est importante (Peter Gizzi, Rosmarie Waldrop, Jill Magi, etc.). L'un des deniers titres, Tabouret, donne à voir des "peintures numériques" de Claude Royet-Journoud accompagnées en légende d'un récit d'Alain Cressan. La première page pose deux éléments à partir desquels se construit l'histoire : un personnage, Igor, et un tabouret, liés par une phrase écrite avec maladresse (comme celle d'un enfant qui apprend ses lettres)1, « Igor dessine son tabouret et il se couche tout content » ; le récit double partiellement ce dispositif : « Igor pense à un tabouret. Le dessine. Dort. Action faite. »
Seront introduits au fil des pages des éléments variés ; quelques-uns appartiennent à la vie d'aujourd'hui (le plan d'un appartement et ses W.C., un écran de cinéma, une porte où s'inscrit "DRH" quand « Igor cherche un travail »), certains sont rêvés ( une plante dans un pot, un âne), d'autres évoquent le loisir ou la sortie dans l'imaginaire (un livre, une bibliothèque, la mer, des bateaux, la nuit). Igor, absent une seule fois (remplacé par le plan de son appartement), devient double ou sextuple, une autre fois quatre Igor « regardent les bateaux », plus loin trois « observent le ciel ». De manière analogue, les tabourets se multiplient — il suffit de les dessiner —, et les livres, et le récit se développe à partir de jeux sur les nombres et de la répétition de l'absence (motifs privilégiés de conte) : c'est un tabouret, ou un livre, qui a disparu, c'est une tête perdue, une plante rêvée, une hypothétique « île aux tabourets » qu'il faut chercher, et même le travail manque.
 Le personnage d'Igor, malléable, change sans cesse de vêtements : pantalon jaune rayé, bleu, rose, rouge, grenat, gris, blanc, jaune, et le fond de l'image varie en même temps. Les dessins se veulent naïfs pour la mise en scène de cette figure toujours souriante, d'une naïveté très contrôlée cependant : Igor, pour une fois sur une chaise, lit de la poésie..., et sur la dernière image abandonne le tabouret pour un fauteuil ; c'est qu'alors, comme "l'Étranger" de Baudelaire (« J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages ! »), il « observe les formes des nuages à travers les fenêtres, voit des formes d'idées. Quelles idées ? » Oui, quelles idées dans ces insaisissables mouvements ? ■■■
Le personnage d'Igor, malléable, change sans cesse de vêtements : pantalon jaune rayé, bleu, rose, rouge, grenat, gris, blanc, jaune, et le fond de l'image varie en même temps. Les dessins se veulent naïfs pour la mise en scène de cette figure toujours souriante, d'une naïveté très contrôlée cependant : Igor, pour une fois sur une chaise, lit de la poésie..., et sur la dernière image abandonne le tabouret pour un fauteuil ; c'est qu'alors, comme "l'Étranger" de Baudelaire (« J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages ! »), il « observe les formes des nuages à travers les fenêtres, voit des formes d'idées. Quelles idées ? » Oui, quelles idées dans ces insaisissables mouvements ? ■■■
Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Tristan Hordé
01:14 Publié dans Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
20/11/2011
Jean Genet ou la rébellion d'un moraliste (par Claude Darras)
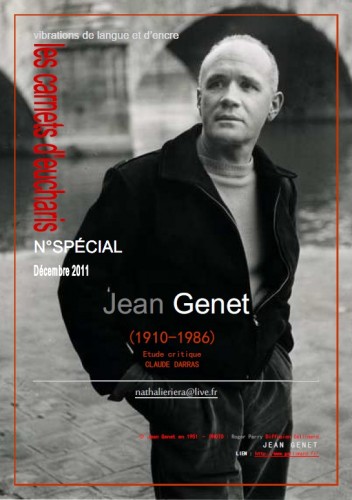
Portrait et lectures Claude Darras
Jean Genet ou la rébellion d’un moraliste
■■■« Si écrire veut dire éprouver des émotions ou des sentiments si forts que toute votre vie sera dessinée par eux […], alors oui, c’est à Mettray et à quinze ans, que j’ai commencé d’écrire » : Jean Genet explique, en 1981, la genèse de ses travaux d’écriture à Bertrand Poirot-Delpech, journaliste au Monde, à la faveur d’entretiens (filmés) qui seront édités (et diffusés) un an avant sa mort (L’Ennemi déclaré). À cette époque-là, en 1925, il est ébloui par les sonnets de Ronsard. Situé à huit kilomètres de Tours, Mettray (département d’Indre-et-Loire) est proche du pays du poète de la Pléiade ; c’est une colonie pénitentiaire agricole fondée en 1839 pour quatre cents jeunes placés sous le régime de la liberté surveillée. Le souvenir de l’institution de redressement innerve la plupart de ses livres ; le roman Miracle de la rose lui est presque entièrement consacré et le texte de L’Enfant criminel s’en inspire largement. Auteur dès l’âge de dix ans de multiples chapardages et coutumier de fugues, il y entre en détention à l’automne de 1926 (Jean Genet matricule 192.102) et non l’année précédente ainsi qu’il le raconte.
Le 15 mars 1925, le compositeur René de Buxeuil engage à son service le pupille de l’Assistance publique. Le parolier de « L’Âme des violons » relate, quelque vingt ans plus tard, la découverte émerveillée des Fleurs du mal de Charles Baudelaire par son jeune secrétaire, une révélation qui semble décider de ses premières tentatives littéraires, en l’occurrence la rédaction de « Mémoires » qu’il entreprend dans un cahier d’écolier sous la signature de Nano Florane. Dans l’ouvrage Saint Genet comédien et martyr, Jean-Paul Sartre confirme que son modèle s’est familiarisé « avec la prosodie et les lois de la rime » auprès du musicien tourangeau. Au romancier et journaliste allemand Hubert Fichte (quotidien Die Zeit), Jean Genet rapporte qu’il a éprouvé pour la première fois à la prison de Fresnes (1939-1940) une émotion au moment d’écrire à l’occasion d’une « carte de Noël » adressée à Anne Bloch ou à Lily Pringsheim (ses seules amies, féminines, avec l’écrivaine Andrée Pragane dite Ibis). « C’était en 39, raconte-t-il, 1939. J’étais seul au cachot, en cellule enfin. D’abord, je dois dire que je n’avais rien écrit, sauf des lettres à des amis, des amies, et je pense que les lettres étaient très conventionnelles, c’est-à-dire des phrases toutes faites, entendues, lues. Jamais éprouvées. Et puis, j’ai envoyé une carte de Noël à une amie allemande qui était en Tchécoslovaquie. Je l’avais achetée dans la prison et le dos de la carte, la partie réservée à la correspondance, était grenue. Et ce grain m’avait beaucoup touché. Et au lieu de parler de la fête de Noël, j’ai parlé du grenu de la carte postale, et de la neige que ça évoquait. J’ai commencé à écrire à partir de là. Je crois que c’est le déclic. C’est le déclic enregistrable. » (L’Ennemi déclaré).
La malédiction des origines
Né à Paris le lundi 19 décembre 1910, Jean Genet est abandonné sept mois plus tard par sa mère, Camille Gabrielle Genet (Lyon, 1888-Paris, 1919). Femme de ménage, elle ne peut plus assumer la charge de l’enfant depuis que le père - un certain Frédéric Blanc, né en Bretagne en 1869 - l’a quittée. L’hospice parisien des Enfants-Assistés place le pupille chez Eugénie et Charles Regnier, à Alligny-en-Morvan, une petite commune de la Nièvre. Lui est menuisier, elle tient une boutique de buraliste de l’autre côté de leur maison…
Singulière enfance pour le paria, non pas orphelin mais rejeté d’emblée, ce qui est la pire des conditions ! Aussi la figure maternelle confisquée avive-t-elle constamment à travers son œuvre une blessure incurable : elle apparaît violemment métamorphosée en mendiante édentée ou en voleuse dévastée le long des péripéties des Pompes funèbres et des Paravents. Dans son dernier récit, Un captif amoureux, c’est la « Pietà », l’immortel couple mère-fils, qu’il place au cœur de sa quête au plus intime des camps palestiniens et des ghettos noirs d’Amérique. En dépit de son inclination au vol, l’écolier est brillant, il lit énormément (Dostoïevski et Verlaine notamment) et fréquente le catéchisme jusqu’à la communion solennelle : il apprend ainsi à respirer les effluves de l’encens et à flairer… le parfum capiteux du péché. Les pièces Le Balcon et Elle sont loquaces à fustiger, parfois jusqu’à la calomnie, l’institution ecclésiastique. Engagé dans l’armée qui lui sera un refuge intermittent durant six années (au génie puis à l’infanterie coloniale, 1929-1936), il parcourt l’Europe des mauvais garçons et des maisons d’arrêt où il conforte son homosexualité et ses mauvais penchants. Voleur, déserteur, prostitué, vagabond et taulard, il échafaude entre vingt et trente ans un système de valeurs personnel qui apparaît comme le double inversé du code moral traditionnel. Avec une rage méthodique, il se jette dans la délinquance, l’abjection, la déchéance comme vers une terre promise, une libération, une catharsis.
Gide, Sartre et Cocteau…
Du monde littéraire, les premiers encouragements viennent d’André Gide qui reçoit le militaire entre deux affectations, à Paris, en août 1933. Étonné par la culture livresque et la lucidité critique du jeune homme, le vieil écrivain l’encourage à persévérer dans l’étude. Jean-Paul Sartre et Jean Cocteau seront les premiers, en 1942, à reconnaître l’écrivain de grande race qui vient d’écrire Le Condamné à mort dont ils permettront la publication. C’est un long poème en alexandrins où leur protégé exprime la passion qu’il voue à un ami assassin guillotiné le 17 mars 1939 : à la prison de Fresnes, pour relever le défi de ses compagnons de cellule qui viennent d’applaudir les versets larmoyants de l’un d’entre eux, il compose sur-le-champ une ode très académique dédiée à l’une de ses « icônes », le meurtrier Maurice Pilorge dont le « visage découpé dans Détective enténèbre le mur de la cellule ». L’œuvre, inaugurale, est suivie de cinq romans qui sont élaborés dans la même clandestinité de la réclusion : Querelle de Brest (1945), Miracle de la rose (1946), Pompes funèbres (1947), Notre-Dame des Fleurs (1948) et Journal du voleur (1949). Dès lors, aux premiers succès de librairie, le repris de justice devient une personnalité bien parisienne et les honnêtes gens s’empressent de célébrer le poète, comme l’ont fait leurs devanciers avec d’autres « maudits », tels Villon, Ronsard et Sade…
Il n’en est pas changé pour autant. Et de nouveaux larcins, d’argent et de livres, le conduisent fréquemment en prison entre 1940 et 1945. Passible de relégation dans un bagne des colonies, le récidiviste est sauvé en 1946 par la grâce présidentielle de Vincent Auriol consécutivement à une action engagée par Sartre et Cocteau - ils ont déjà témoigné en sa faveur au tribunal trois ans plus tôt - sous la forme d’une supplique que signent de nombreux intellectuels, André Breton, Paul Claudel, Thierry Maulnier, François Mauriac, le professeur Henri Mondor, Pablo Picasso, Jacques Prévert et François Sentein, entre autres personnalités ; sollicités, Louis Aragon, Albert Camus et Paul Eluard refusent de s’y prêter.
Un activiste politique tourné vers le tiers-monde
En 1952, les éditions Gallimard entament la publication des œuvres complètes avec une préface-fleuve de Jean-Paul Sartre que l’intéressé apprécie moyennement. « Toi et Sartre, reproche-t-il à Jean Cocteau, vous m’avez statufié. Je suis un autre. Il faut que cet autre trouve quelque chose à dire. »… Les années suivantes, entre deux scénarios (Les Rêves interdits et Le Bagne), il multiplie les voyages au gré de ses relations en Grèce et en Tunisie, en Italie et au Maroc, en Allemagne et en Suède, en Hollande et en Algérie. En 1955, il noue une forte relation amoureuse avec un jeune acrobate de cirque, Abdallah, auquel il consacre un superbe essai en hommage, Le Funambule : il va jusqu’à lui composer un numéro, dessiner son costume et régler les éclairages ! En octobre 1959, Roger Blin crée avec succès Les Nègres au théâtre de Lutèce, à Paris, devenant ainsi son metteur en scène attitré. Pendant la décennie 1950-1960, il se passionne pour… la course automobile et se plaît à redécouvrir Paris où l’on reconnaît sa silhouette courte, sa tête de boxeur au crâne ras et au nez cassé, son blouson de cuir, son regard à la fois angélique et effronté.
Si l’on excepte de très nombreux articles et des entretiens, il cesse d’écrire après 1968, sacrifiant son temps et sa notoriété à des causes politiques. Les Panthères noires aux États-Unis, les travailleurs immigrés en France, la Fraction Armée rouge en Union soviétique, les Palestiniens au Proche-Orient : chacun de ses actes, chacune de ses interventions fait l’effet d’une bombe. Aux U.S.A., il se range aux côtés des militants noirs Angela Davis et George Jackson. Deux ans durant (1970-1972), il partage le quotidien des camps palestiniens. Et ses prises de position favorables à la bande à Baader et au communisme soviétique procèdent du même souci de défendre l’Organisation de libération de la Palestine (Olp) : l’Union soviétique soutient la résistance palestinienne et le groupe de Baader-Meinhof a partagé l’entraînement des fedayins, les combattants de l’Olp.
Sulfureuse, acclamée, contestée, la réputation dont il jouit ne pâlit pas un instant. En 1981, Rainer Werner Fassbinder porte son roman Querelle de Brest à l’écran (avec Brad Davis, Franco Nero et Jeanne Moreau). En 1983, Patrice Chéreau reprend au théâtre des Amandiers à Nanterre Les Paravents (avec Maria Casarès), une pièce que le ministre André Malraux défend avec pugnacité vingt ans plus tôt. Le grand prix national des Lettres lui est attribué la même année. Cerise sur le gâteau de la consécration, en 1985, Le Balcon entre au répertoire de la Comédie-Française (mise en scène de Georges Lavaudant avec Christine Fersen) !
La sainteté au cœur du mal
Curieux personnage tout de même ! Romancier, dramaturge et poète de grand format, il n’aura cessé, dans sa vie comme dans son œuvre, de catalyser l’ambiguïté et de jouer sur les contradictions, pratiquant la trahison comme un art, expérimentant l’engagement politique avec une constante ironie, recherchant la liberté dans les cachots et la sainteté au cœur du mal. « L’œuvre entier de Genet, soutient à cet égard Dominique Fernandez, est un miracle de la rose perpétuel : la prison y est le paradis, le criminel y est le saint, l’abjection y est le trésor. » (Écrivains d’aujourd’hui 1940-1960, éditions Bernard Grasset, 1960). Quant au personnage, son biographe américain (Genet, éditions Gallimard, 1993) le trouve à la fois « estimable et insupportable » : « Estimable car il est pur et hostile à toute compromission, explique Edmund White au Magazine littéraire (n° 313, septembre 1993) ; insupportable pour presque les mêmes raisons car il était toujours réticent à pardonner les fautes réelles ou supposées de ses amis, toujours prêt à exploser et à excommunier ». « Mais quel styliste ! », s’exclame Jean-Paul Sartre. « Écrire étant un acte religieux, un rite de messe noire, Genet ne déteste pas la pompe, assure-t-il dans son Saint Genet : sa phrase, difficile et nombreuse, chargée, miroitante est pleine de vieilles tournures ressuscitées, inversion, ablatif absolu, infinitif sujet ; il aime à l’allonger jusqu’à ce qu’elle se brise, à en suspendre le cours par des parenthèses : différé, attendu, le mouvement révèle mieux son urgence ; en même temps il use de la syntaxe et des mots en grand seigneur, c’est-à-dire comme quelqu’un qui n’a plus rien à perdre (…). »
Ses proches, parmi lesquels Tahar Ben Jelloun, Alexandre Bouglione (dit Romanès), Colette, Lydie Dattas, Léonor Fini, Alberto Giacometti, Juan Goytisolo et Jacques Guérin soulignent avec justesse le mérite de l’observateur, la perspicacité du physiologiste, le génie de l’écrivain, une sorte de moraliste qui sait réinventer tant de types, analyser tant de caractères, mettre en scène tant de personnages qu’il a presque tous connus, aimés ou haïs, du reste, et qui composent une flamboyante galerie de portraits : héros et traîtres, monstres et policiers, bagnards et domestiques, nazis et nord-africains, paysans et archevêques, juges et terroristes, marionnettes et bourreaux. Il ne les copie pas, loin s’en faut, il les vit idéalement, s’immerge dans leur milieu, contracte leurs habitudes, possède leur existence intime au point d’aviver le sang circulant dans leurs veines au lieu de l’encre sympathique qu’injectent à leurs personnages les auteurs ordinaires.
Jean Genet est décédé au Jack’s Hotel, rue Stéphane-Pichon, à Paris, dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 avril 1986, au lendemain du décès de Simone de Beauvoir. Son corps est enseveli à Larache, sur le littoral marocain, entre Tanger et Rabat. On a creusé sa tombe derrière le cimetière musulman, à quelques mètres de la maison qu’il avait achetée pour Mohamed El Katrani, le dernier compagnon de sa vie. Edmund White rappelle que lorsque le cercueil enchâssé dans un sac de jute est descendu de l’avion à Casablanca, il était étiqueté « travailleur immigré »… ■■■
Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Claude Darras
![]()
DOSSIER PDF COMPLET (à télécharger)
15:10 Publié dans Claude Darras, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
17/11/2011
François Lallier, Vita Poetica (par Tristan Hordé)
Une lecture de Tristan Hordé
FRANCOIS LALLIER
Vita Poetica

L’Arbre à Paroles, Amay (Belgique), 2010
On sait qu’en France l’enseignement des langues classiques se réduit chaque année, considéré comme peu rentable, sans utilité dans une société où l’argent et les biens qu’il procure sont devenus les "valeurs" dominantes.1 Il existe encore, bien heureusement, des amoureux de l’Antiquité pour lire et relire les Grecs et les Latins, et ne pas penser que tout a été écrit à leur propos. François Lallier, poète et lecteur attentif de la poésie contemporaine2 publie avec Vita poetica des analyses neuves des poètes latins de la fin de la République.
Cette plongée dans les temps anciens conduit à mettre au jour un moment où la relation entre l’écrivain et son œuvre se transforme ; changement des plus importants, une séparation entre les deux se construit : « Une biographie […] advient au poète, parce qu’il ne se confond pas avec son chant, mais porte un masque sous lequel apparaît une autre vie que celle que peint le poème » (p. 10). Un peu plus loin : « Dans le clivage des déguisements et de la personne, une « vie poétique » se fait jour, s’opposant à des rôles, des conditions auxquelles toutefois le poète n’est pas soustrait, précisément parce que l’exercice de la poésie n’est pas une condition, un métier moins encore, mais une construction, sinon une fiction, vécue et mise à l’épreuve selon le cours de l’existence commune. » (p. 11) Quelles conséquences ? Cette transformation implique l’élaboration d’un « mythe éthique », celui qui oppose le choix éthique (la vita poetica) du "pur amour" à la violence de la société et qui modifie en profondeur, notamment, le rapport du poète, de la poésie au politique. Ce mythe, on le sait, aura longue vie…
François Lallier analyse minutieusement quelques textes de Virgile, Horace et Catulle pour cerner et préciser son propos. Ce qui retient dans ces lectures, c’est la relation essentielle établie entre la recherche d’une fonction de la poésie et les événements que vivent les trois poètes. Pour eux, la poésie ne peut (ne peut plus) se définir par la seule écriture en vers ; certes, la perfection de la métrique est nécessaire et il suffit d’évoquer leur virtuosité pour en être convaincu, mais le poème ne peut se limiter à cela. En même temps, c’est la thématique de l’épopée qui est abandonnée ; Horace, par exemple, affirme son incompétence à manier le style épique pour vanter la politique d’Auguste, alors même qu’il prouve une éblouissante maîtrise du vers. C’est que le poète se refuse à mettre la tête dans le sable et à accepter la violence sociale, les injustices, la vilenie des ambitions, à faire comme si la « voix du monde » n’était qu’harmonie.
L’éloignement de l’épique, sa mise à l’écart même, par la réflexion sur les choses du monde, conduit parallèlement à construire une autre poésie qui deviendra une source majeure pour l’Occident. François Lallier suit des moments de cette élaboration et montre comment une poésie amoureuse se substitue au genre épique, comment l’exaltation du sentiment amoureux, de la passion humaine s’oppose à la Fable. Il ne s’agit évidemment pas d’un simple changement thématique. François Lallier dégage dans Virgile l’importance de la « musicalité intérieure aux mots » (p. 45). Le même soin est apporté dans l’étude des Noces de Thétis et de Pélée ; Catulle y laisse de côté la continuité narrative propre à l’épopée et adopte une composition toute différente en faisant se succéder des tableaux, modification lisible en particulier dans la description du voile nuptial. En même temps, ce qui importe, c’est la recherche d’une « émotion de la forme » (p. 72), qui naît d’un travail sur le matériau sonore. À propos de la danse des Ménades, l’analyse attentive de quelques vers fait apparaître comment le jeu des sons, le rythme visent à "peindre" la scène, à en restituer le mouvement, et à imiter par la langue quelque chose de l’accompagnement musical. Ce qui se dessine et se décide, c’est « une idée de la poésie dont on retrouvera sans peine, sous le thème mythologique, les grands axes que sont la centralité de l’amour et la quête tout ensemble ironique et ardente d’un sens au destin de la cité, entre le mystère salvateur et la funeste logique de la puissance. »
Le passage de l’épique à l’élégie, c’est d’une certaine manière l’affirmation que le poète n’est pas (n’est plus) au service d’un pouvoir. Catulle, par exemple, suit d’abord Callimaque de près, mais Les Noces de Thétis et de Pélée se concluent par une critique forte qui place le lecteur « au cœur du temps et du lieu où l’auteur écrit » (p. 76). Le monde de Catulle n’a plus ses dieux, sinon dans la Fable, et la poésie aura pour fonction première de « rendre à la visibilité [le] mystère de l’amour » (p. 76).
Je n’ai retenu de cette lecture savante, qui est aussi celle d’un poète, que quelques conclusions. Ponctuée d’extraits en latin traduits, suivie de traductions, elle conduit à reprendre avec un autre regard les œuvres des Latins — mais pas seulement : elle incite à réfléchir sur la tradition de la thématique de l’amour. Précisons que Vita poetica est le premier ensemble d’un vaste livre qui comprendra les chapitres suivants : Ut pictura, La vie divine, Les amours, L’horreur épique.
© Tristan Hordé, Carnets d’eucharis n°30 (sept/oct 2011)

François Lallier, Vita Poetica
L’Arbre à Paroles, Amay (Belgique), 2010
■ LE SITE DE FRANCOIS LALLIER :http://www.francoislallier.com/
1 Un rappel : "classique" reprend le latin classicus, « de première classe », appliqué aux citoyens, puis classici [sciptores] a désigné les écrivains de première valeur…
2 Je renvoie à La Voix antérieure II (Jouve, Jourdan, Michaux, Frénaud, Munier), 2010, La Lettre Volée, et à La Semence du feu, 2003, L’Atelier la Feugraie. F. Lallier a organisé le volume collectif Avec Yves Bonnefoy, De la poésie (P. U. de Vincennes, 2000) et co-dirigé le Cahier Roger Munier paru au Temps qu’il fait (2011) ; avec Géraldine Toutain, il a fondé en 2004, à Dijon, les éditions Poliphile (www.editions-poliphile.fr).
22:26 Publié dans François Lallier, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
13/10/2011
Jean-Philippe Rossignol (une petite note de Claude Minière)
Jean-Philippe Rossignol Vie électrique
Editions Gallimard, coll. L’Infini, 2011
 Une « odyssée » en trente jours, chacun d’eux apportant une menace, une chance, une décision, une rencontre et une séparation. Ce n’est pas une barque qui danse dans les ondes mais une vie… Quelques auteurs (au fond un petit nombre) sont capables de vous persuader que la forme-roman recèle des ressources inattendues. Inattendues non dans le choix du « sujet » mais dans le mode d’entrelacement vie/ lectures/ pensée, là sur la page, par l’énergie des coupures et liaisons.
Une « odyssée » en trente jours, chacun d’eux apportant une menace, une chance, une décision, une rencontre et une séparation. Ce n’est pas une barque qui danse dans les ondes mais une vie… Quelques auteurs (au fond un petit nombre) sont capables de vous persuader que la forme-roman recèle des ressources inattendues. Inattendues non dans le choix du « sujet » mais dans le mode d’entrelacement vie/ lectures/ pensée, là sur la page, par l’énergie des coupures et liaisons.
Claude Minière, octobre 2011
Les carnets d'eucharis
23:13 Publié dans Claude Minière, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
03/10/2011
MIREILLE CALLE-GRUBER/Claude Simon Une vie à écrire
Une lecture de Nathalie Riera
MIREILLE CALLE-GRUBER
Claude Simon Une vie à écrire
(Biographie/Seuil, 2011)
Notes
Extraits
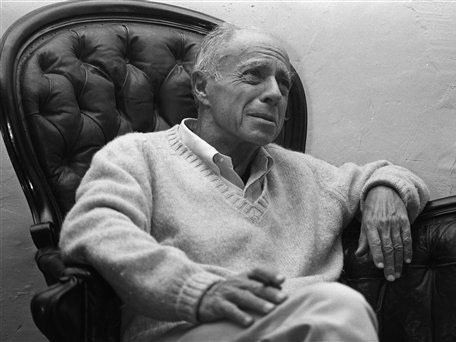
Source internet © Claude Simon
« Claude Simon, ce sera cela : une vie à écrire et réécrire. Pour que les informes affects du deuil prennent forme au travail de la langue et que le livre trace le dessin d’une vie »
Mireille Calle-Gruber
« Je crois qu’il y a une extraordinaire nouvelle de Borges où il raconte qu’un architecte paysagiste dessine un parc avec des statues, des pavillons, des petits lacs, des allées. Quand le parc est fini, il s’aperçoit qu’il fait son propre portrait. Je trouve que c’est une parabole admirable. On ne fait jamais que son propre portrait »
LE DESSIN D’UNE VIE
« Il est à jamais le cavalier éperdu de la route des Flandres, et depuis le loin, aux bords du XXe siècle, notre contemporain le plus aigu et le plus vigilant.
Il nous aura enseigné la lenteur hallucinée de l’écriture en ses transports métaphoriques, l’humilité de l’artisan, la main à l’œuvre, la peine et l’existence ailée de la littérature».[2]
Comment rendre compte d’une vie elle-même déjà écrite par Claude Simon ? confie Mireille Calle-Gruber à Alain Veinstein. Faut-il juste y voir un pari audacieux, celui de s’essayer à l’écriture biographique comme à un « nouveau genre, un nouvel exercice, une nouvelle expérience » ? Ou alors y percevoir comme une dette à l’égard d’une œuvre et d’une personne que vous avez bien connue ? Outre que M. Calle-Gruber aura eu le privilège d’une relation sans failles et d’une amitié extraordinaire tout au long des seize dernières années de la vie de « Claude Simon l’écrivain immense » et de l’homme d’exception, ce qu’il faut surtout entendre des raisons de ce monument biographique : « comme une intimation à écrire – car ce fut, oui, aussi, soudain, l’évidence intérieure d’un « il faut » - écrire, la biographie de Claude Simon, ce défi absolu… ». [3]
440 pages « entre enquête et fiction », à partir de lettres, de documents, de témoignages, autant d’éléments tangibles pour un travail d’interprétation et de savoir qui incombe à l’écrivain-biographe. La littérature ne se posant ni en termes de vrai ou de faux, il s’agit pour M. Calle-Gruber de « tirer des diagonales que j’espère aussi vraies que possible ». Et par cette biographie, non pas monumentaliser Claude Simon, mais le rendre vivant !
M. Calle-Gruber travaille sur l’œuvre de Claude Simon depuis de nombreuses années, ayant entre autres participé à l’édition de La Pléïade, avec notamment « Le récit de la description ».[4] Elle publie en 2008, aux Presses Sorbonne Nouvelle, Les Triptyques de Claude Simon ou l’art du montage présentant des inédits : scenarii, découpages techniques, correspondances, textes, manuscrits, plans de montage, entretiens, films, photographies (DVD).
***
De sa naissance à Madagascar, Tananarive, le 10 octobre 1913 jusqu’à son décès à Paris le 6 juillet 2005, Claude Simon aura traversé un XXe siècle de violences et de péripéties. Longtemps, il portera le « traumatisme du survivant » :
« « Survivant, Claude l’aura été à plus d’un titre. D’abord de ce frère aîné (…) Puis du père, mort au champ d’honneur (…) dans l’hécatombe de 1914, le 27 août (…) Puis de la mère qui succombe à un cancer, le 5 mai 1925, alors qu’il est dans sa douzième année, le laissant seul, tragique descendant d’une famille fantomatique et le dernier porteur du nom des Simon qui ont fait souche à Arbois, Jura ».[5]
(…)
« … une fois encore le survivant de son régiment anéanti lors de l’offensive allemande de mai 1940 ».[6]
Plusieurs périodes de la vie de Claude Simon sont relatées : son parcours scolaire au Collège Stanislas, à Paris, en 1925 (année du décès de sa mère, Suzanne Simon) ; son incorporation au 31ème régiment de dragons (1934) ; témoin d’une révolution : la guerre civile à Barcelone (1936) ; son voyage dans l’Europe au printemps 1937 « à travers des pays au bord de la guerre, l’Allemagne, la Pologne, l’URSS jusqu’à Odessa, puis le retour sur Paris, par la Turquie, la Grèce et l’Italie »[7] ; sa captivité (suivie de son évasion) au camp Stalag IV B, à Mühlberg, le 27 mai 1940. Ce seront autant d’évènements éprouvants qui vont nourrir son œuvre romanesque, en même temps qu’ils agiront sur la conscience et la maturité politique de Claude Simon.
« Comme pour son comportement pendant la guerre d’Espagne et pendant la seconde guerre mondiale, Claude Simon a toujours veillé à la sobriété du récit concernant son rôle dans la Résistance, craignant l’interprétation hyperbolique, voire la surenchère des clichés. Il s’est ainsi efforcé de rappeler qu’il était « bien sûr antiallemand et surtout anti-nazi mais ne brûlant pas d’un héroïque patriotisme » … ».[8]
***
Pour qui n’ignore pas « son intelligence d’observation sur le vif des situations » et sa sensibilité visuelle, au début des années 30 Claude Simon est étudiant en cubisme, découvre le surréalisme au cinéma (avec l’œuvre de Luis Buñuel). L’expérience de la peinture se révélant « décisive pour sa conception du travail d’écrivain : il sera celui qui écrit avec l’exigence de composition du peintre, et suivant une sensibilité rare aux matières et aux couleurs ».[9]
L’abandon de la peinture au début des années 50, une plus large place sera ainsi donnée à la littérature. Lectures des deux géants que furent Proust et Joyce, leçons d’écriture chez Dostoïevski, il s’ensuit que l’écrivain pour Claude Simon est celui qui – ce seront ses propres dires lors du Discours de Stockholm – « progresse laborieusement, tâtonne en aveugle, s’engage dans des impasses, s’embourbe, repart – et, si l’on veut à tout prix tirer un enseignement de sa démarche, on dira que nous avançons toujours sur des sables mouvants ».[10] Un demi-siècle d’écriture, comme une raison de vivre indiscutable, tout en affrontant et se relevant des périodes les plus noires, celle de la guerre meurtrière, (dont les scandaleux évènements des deux journées du 16 et 17 mai 1940 relatés par l’écrivain dans une lettre du 17 février 1993), puis celles de la maladie et du suicide de sa première épouse Renée Lucie Clog.
L’écriture chez Claude Simon c’est une écriture en autodidacte, mais c’est aussi cette réalité de l’écriture, telle qu’on peut la lire dans sa préface à Orion Aveugle :
« Avant que je me mette à tracer des signes sur le papier, il n’y a rien, sauf un magma informe de sensations plus ou moins confuses, de souvenirs plus ou moins précis accumulés, et un vague – très vague – projet ».[11]
***
Autre volet de cette passionnante biographie, celui des années de « compagnonnage » et des années d’opposition au Nouveau Roman.
Si la littérature a ses sujets de discorde, ce qui noue Claude Simon à la littérature, et plus exactement au plaisir de l’écriture, ce n’est jamais selon Mireille Calle-Gruber qu’une « indéfectible alliance avec le vivant ». Il s’agit de n’être attaché à aucun camp, à aucune théorie littéraire, préserver son autonomie d’écrivain, et veiller à ce que la fonction littéraire ne soit en aucune manière prétexte à une fonction sociale ou autrement agissante à des fins politiques. M. Calle-Gruber reprend alors le différend qui opposait l’écrivain Claude Simon au philosophe militant Jean-Paul Sartre ; Sartre, dont l’imposture et la démagogie du il importe peu que la littérature soit dite ou non « engagée » : elle l’est nécessairement déclencheront une série de confrontations, à commencer lors de la table ronde organisée par l’Union des étudiants communistes en 1964 sur le thème « Que peut faire la littérature ? » rassemblant les intellectuels et les Nouveaux Romanciers, parmi lesquels Alain Robbe-Grillet accusé par Sartre de ne pouvoir être lu dans un pays sous-développé. Claude Simon, qui sera un temps assez proche des idées du Nouveau Roman, marquera alors son opposition au positionnement idéologique du philosophe, notamment dans le fameux « Pour qui donc Sartre écrit ? » (L’Express, 28 mai 1964, p.32)
Une vie d’écrivain n’est-ce pas aussi pour Claude Simon de faire face, sans la moindre complaisance et non sans une certaine ironie mordante, aux griefs éditoriaux, médiatiques, aux critiques retorses et assassines, et autres « violences passionnelles » du monde littéraire.
Après moult controverses qui l’éloigneront du Nouveau Roman, un autre feu de discorde : celui d’avoir signé la fameuse Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la Guerre d’Algérie,[12] signature qui sera suivie d’une inculpation de l’écrivain en octobre 1960.
N’est-ce pas une certaine éthique qui donnera à Claude Simon de faire cavalier seul, son autonomie à jamais préservée par l’écriture de romans (tous reconnus comme de véritables chefs-d’œuvre) et par maints déplacements, en France et à l’étranger, liés à une activité effrénée de conférencier.
Quand Alain Robbe-Grillet affirmait que la meilleure récompense pour un écrivain jugé illisible est d’être lu, n’y a-t-il pas eu meilleure récompense pour Claude Simon que l’attribution du Prix Nobel de Littérature, et à l’occasion de son allocution prononcée devant l’Académie suédoise (les 9 et 10 décembre 1985) de mesurer l’émotion de l’écrivain à l’entendre dire :
« Je suis maintenant un vieil homme, et, comme beaucoup d’habitants de notre vieille Europe, la première partie de ma vie a été assez mouvementée : j’ai été témoin d’une révolution, j’ai fait la guerre dans des conditions particulièrement meurtrières (j’appartenais à un de ces régiments que les états-majors sacrifient froidement à l’avance et dont, en huit jours, il n’est pratiquement rien resté), j’ai été fait prisonnier, j’ai connu la faim, le travail physique jusqu’à l’épuisement, je me suis évadé, j’ai été gravement malade, plusieurs fois au bord de la mort, violente ou naturelle, j’ai côtoyé les gens les plus divers, aussi bien des prêtres que des incendiaires d’églises, de paisibles bourgeois que des anarchistes, des philosophes que des illettrés, j’ai partagé mon pain avec des truands, enfin j’ai voyagé un peu partout dans le monde … et cependant, je n’ai jamais encore, à soixante-douze ans, découvert aucun sens à tout cela, si ce n’est, comme l’a dit, je crois, Barthes après Shakespeare, que « si le monde signifie quelque chose, c’est qu’il ne signifie rien » - sauf qu’il est. »[13]
Nathalie Riera, octobre 2011
Les carnets d'eucharis
[2] Mireille Calle-Gruber, Claude Simon Une vie à écrire, Editions du Seuil/Biographie, 2011 - p. 440
[3] France-Culture :Alain Veinstein reçoit Mireille Calle-Gruber, - auteur de Claude Simon. Une vie à écrire (Seuil) http://www.franceculture.com/player?p=reecoute-4299317#reecoute-4299317
[4] Mireille Calle-Gruber, Le récit de la description (ou de la nécessaire présence des demoiselles allemandes tenant chacune un oiseau dans les mains, Gallimard/La Pléiade, 2006 – p. 1527
[13] Claude Simon, Discours de Stockholm, Gallimard/La Pléiade, 2006 – p. 897/898
Mireille Calle-Gruber est Professeur à La Sorbonne Nouvelle - Paris III en Littérature française, et directrice de l’Equipe de Recherche « Etudes Féminines » (Paris VIII - Paris III). http://fr.wikipedia.org/wiki/Mireille_Calle-Gruber
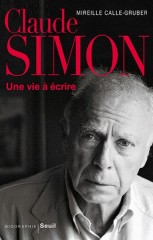
■ SITES A CONSULTER :
France-Culture/Du jour au lendemain Alain Veinstein (09/09/11) : http://www.franceculture.com/player?p=reecoute-4299317#reecoute-4299317
Editions du Seuil : http://www.seuil.com/livre-9782021009835.htm
22:47 Publié dans Claude Simon, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : claude simon, mireille calle-gruber |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Jean-Jacques Breton et Dominique Williatte - Trésors insolites des Musées de France
Lecture critique de Claude Darras
Trésors insolites : un livre d'art et de curiosités
J’ose prétendre que cet ouvrage-là est un livre d’exception. Il n’en copie aucun autre et il mériterait à coup sûr d’être imité. Jean-Jacques Breton et Dominique Williatte, ses auteurs (attachés à la Réunion des musées nationaux), ont parcouru la France des musées à la recherche d’œuvres diverses, peinture, dessin, sculpture, tapisserie, architecture, mobilier, gravure, des objets remarquables dont ils ont souhaité raconter l’histoire. Les critères de sélection postulent de divulguer des anecdotes inédites, étranges, surprenantes, insolites ; aussi les découvertes les plus inattendues sont-elles offertes au lecteur au gré d’un parcours muséal (150 lieux) jalonné de 201 œuvres originales que ce beau livre de curiosités dissèque pour mieux expliciter.
En parfaits iconoclastes, nos deux guides associent une érudition de bon aloi à une fantaisie pétillante. Savamment argumentée, l’analyse critique des « Trésors insolites des musées de France » épingle la sacro-sainte postérité, coiffe du bonnet d’âne des historiens trop zélés, corrige plus d’une interprétation gravée dans les dictionnaires et réhabilite des petits ou de grands maîtres que les caprices de leurs contemporains ont effacés de la mémoire patrimoniale. 201 œuvres insolites ? L’embarras du choix préside à la constitution d’un florilège. Tentons néanmoins l’exercice.
Conservée au musée des beaux-arts d’Agen, une huile sur bois, « Le Garrot », est longtemps attribuée à Francisco de Goya alors qu’elle est l’œuvre d’un de ses élèves, Eugenio Lucas y Velázquez (1817-1870). Émile Zola défend l’actrice et sculpteur Sarah Bernhardt (1844-1923) contre Auguste Rodin qui fustige la seconde passion de la sociétaire de la Comédie-Française : le musée des beaux-arts de Dijon rejoint le camp des zélateurs en acquérant un bronze de l’actrice, « Le Fou et la mort » (musée des beaux-arts Dijon). C’est un critique d’art et collectionneur allemand, Wilhelm Uhde, qui met au grand jour les œuvres naïves, dont « L’Arbre du Paradis » (musée d’art et d’archéologie de Senlis), qu’une femme de ménage exécute la nuit en psalmodiant des cantiques : Séraphine Louis (1864-1952). Avec le « Portrait de Meg Steinheil » (musée Bonnat à Bayonne), Léon Bonnat (1833-1922) donne à voir la courtisane (et femme de peintre) dans les bras de laquelle le président de la République française Félix Faure rend le dernier soupir le 16 février 1899. Détenu par le musée du Louvre, « L’Intérieur d’une cuisine » du peintre français Martin Drolling (1752-1817) utilise comme liant pigmentaire des… cœurs royaux momifiés. Chargé de détruire les cœurs embaumés de souverains (dont le Régent, Henriette d’Angleterre, Louis XIII et Louis XIV), l’architecte Petit-Radel vend certains des organes royaux aux peintres Martin Drolling et Alexandre Peau qui s’en servent dans leurs mixtures à l’exemple de confrères qui pilent les restes de momies égyptiennes afin d’améliorer leurs glacis… Sulfureuse peinture à l’huile de Fernand Le Quesne (1856-1932), « La Légende de Kerdeck » (musée des beaux-arts de Quimper), campe un joueur de biniou résistant sur son rocher à l’assaut d’une cohorte de lavandières s’ébrouant impudiques et nues dans l’océan ; le peintre est le fils du sculpteur Eugène Louis Le Quesne connu pour la statue de la Bonne Mère au faîte de Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille. Passionné par la science héraldique, Louis XIV est perspicace à déchiffrer les « armoiries parlantes », ces blasons qui posent un rébus ou jouent sur une homophonie. L’un d’eux plaqué en façade du musée de l’Armée, aux Invalides, à Paris, irrite le Roi-Soleil parce que son ministre de la guerre en est la vedette : une tête de loup chapeaute une lucarne ronde et cela se déchiffre « Loup – voit », c’est-à-dire « Louvois ». Charles Le Brun (1619-1690) étonne par ses études physiognomoniques qui visent à mieux connaître le caractère de l’homme à travers les traits communs l’appariant aux animaux ; « Trois Têtes de corbeaux » (lavis, musée du Louvre) affiche une singulière ressemblance entre l’homme bestialisé et l’animal humanisé. Le tympan de pierre de l’abbaye de Saint-Géry au Mont-aux-Bœufs intitulé « La Mort de Pyrame et Thisbé » (musée des beaux-arts de Cambrai) rappelle le suicide de jeunes babyloniens qui s’aiment depuis l’enfance mais que la volonté parentale entend séparer. La légende est rapportée dans les Métamorphoses d’Ovide qui a d’ailleurs inspiré William Shakespeare pour Roméo et Juliette (1595). Outre une sculpture d’inspiration analogue conservée à Cologne, ce tympan est le seul exemple connu au monde dans l’art chrétien de représentation du suicide, un acte proscrit par l’Église. L’espace Paul-Bedu de Milly-la-Forêt (Essonne) abrite « Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique », une huile sur toile de Joachim Raphaël Boronali qui est en fait l’âne du père Frédé, patron du cabaret montmartrois Le Lapin à Gill. Le 8 mars 1910, devant huissier, le romancier Roland Dorgelès (1885-1973) installe une toile vierge près du postérieur de l’âne et attache une brosse à la queue de l’animal qu’il trempe successivement dans des pots de peinture. Des remuements de l’extrémité caudale du baudet naissent un graphisme et un chromatisme inattendus que les plaisantins baptisent Coucher de soleil sur l’Adriatique et signent Boronali, anagramme d’« Aliboron », celui qui croit savoir tout faire, en fait l’âne des Fables de La Fontaine. « Une dendrite », exposée au musée Bertrand de Châteauroux témoigne de l’intérêt porté par l’écrivain George Sand (1804-1876) aux arborescences dessinées dans la roche qu’elle tente de figurer en écrasant entre deux cartons de bristol des couleurs à l’aquarelle : déplié, le support laisse imaginer un univers fantastique de formes naturelles. L’abbaye Saint-Louis-du-Temple à Vauhallan renferme une collection de… « Marrons sculptés » dus à Mère Geneviève Gallois (1888-1962). Formée aux beaux-arts de Montpellier, la religieuse modèle vers 1945-1950 ces figurines d’art brut leur insufflant l’humour corrosif des dessins de sa Vie du petit Saint Placide. Longtemps, la sanguine sur papier de Jean Baptiste Greuze (1725-1805) conservée au musée Girodet de Montargis garde l’appellation « Portrait de vieille femme » jusqu’à ce que des recherches déterminent qu’il s’agit en fait du « Portrait mortuaire de Denis Diderot sur son lit de mort ». En fait, le corps du philosophe est autopsié en 1784 et son crâne découpé, ce qui laisse à penser que le drap ceignant la tête ait été associé à un attribut féminin, d’où l’erreur du titre originel. Le musée de la Renaissance à Écouen attribue la « Nef-automate dite de "Charles Quint" » à Hans Schlottheim d’Ausbourg (1545-1625). Primitivement achetée par l’empereur Rodolphe II, l’horloge-automate est un des trésors de l’orfèvrerie horlogère de la Renaissance (XVIe siècle). Ses sept mécanismes déclenchent une infinité d’automatismes : l’émission du roulis et des jeux d’un orgue, l’action de quinze joueurs de trompette, deux joueurs de tambour, quatre matelots et deux vigies, la frappe d’une cloche aux heures et aux quarts par deux personnages et l’explosion d’une salve de canons ; également représenté dans ce chef-d’œuvre de laiton doré, de fer et d’émail, Charles Quint incline son sceptre et tourne la tête tandis que les sept électeurs du Saint Empire exultent en remuant têtes et bras !
Si j’incitais à l’imitation d’un tel ouvrage en préambule, c’est parce qu’il constitue un excellent passeport à l’univers des formes pour le néophyte, au-delà de l’intérêt documentaire et historique qu’il représente pour le spécialiste. Le langage muséal, parfois bien mystérieux, est gommé au profit d’une interprétation pédagogique et ludique qui ouvre au lecteur de nouveaux territoires. Les œuvres n’en continuent pas moins de stimuler son imagination et d’exciter sa curiosité.
Claude Darras
Les carnets d'eucharis, 2011
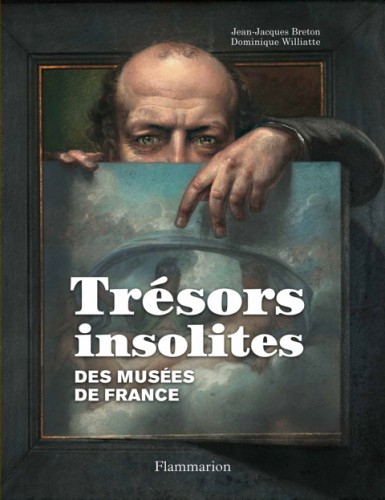
Trésors insolites des musées de France, par Jean-Jacques Breton et Dominique Williatte (éditions Flammarion, 35 €). L’œuvre montrée ici est l’« Autoportrait en trompe l’œil » de Jean-Marie Faverjon, un jeu cérébral et visuel qui rappelle l’autoportrait de Murillo à la National Gallery de Londres.
22:26 Publié dans Claude Darras, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
22/07/2011
Annie Le Brun, Ailleurs et autrement (une lecture de Nathalie Riera)
AILLEURS ET AUTREMENT – Annie Le Brun
(Editions Gallimard, “Arcades”, 2011)
Bien sûr, il s’agit toujours de trouver « le lieu et la formule » dont parle Rimbaud. Mais que savons-nous encore de cette quête, aujourd’hui que l’émiettement de nos désirs à travers une multitude de satisfactions immédiates nous dissuade autant de voir au loin que de prendre de la hauteur ? Que pourrions-nous en savoir, depuis que la presque totalité de ce qui prétend penser se fait rabatteur du réel pour accélérer l’écrasement de toute perspective imaginaire ?
Annie Le Brun n’aime pas se tenir tranquille. Dans son dernier ouvrage, Ailleurs et autrement, au-delà même d’y entendre sa verve redoutable contre toutes les bouffonneries des instances poético-littéraires en place – ces finalement « paradis culturels peu différents des paradis fiscaux » (p.34) – faut-il y reconnaître sa toujours plus grande complicité avec Alfred Jarry, grand chantre du grotesque et de l’absurde ; ainsi qu’avec Sade, Raymond Roussel, Hans Bellmer… comme autant de voix subversives, mais dont la langue sans auditeur, sans public, nous révèle à quel point la société technicienne s’emploie délibérément à nous rendre chaque jour plus triomphants dans nos cécités et nos surdités.
Ailleurs et autrement compte une vingtaine de chroniques – publiées entre 2001 et 2002 dans La Quinzaine Littéraire – et autres textes rassemblés comme autant de détonateurs prompts à desservir tout ce qui tend vers toujours plus d’incarcération, d’artificialisation, d’angélisme, d’idéologisme, et surtout ne faut-il pas entendre chez Annie Le Brun son seuil de tolérance décroître, tant ne cesse de se profiler à nos horizons communs le toujours plus sombre ghetto du « nouvel esprit du capitalisme ». Force étant de constater les réelles intentions du néolibéralisme, à savoir : absolument rien de ce à quoi l’être humain peut prétendre, mais plutôt tout pour qu’il y ait « mort du sujet », ou alors « sujet flottant, sans attache, qui se définit par son indétermination sexuelle, affective ou intellectuelle, telle que rien ne l’empêche d’être traversé par le flux d’une marchandisation généralisée ». Qu’en est-il en effet de ce monde qui nous donnerait notre chance de vivre, de nous rapprocher du monde naturel et du monde sensible, si ce n’est rien de tout cela, mais de précisément nous enfermer dans la médiocrité et l’indigence, et nous en gaver jusqu’à l’horreur. Et dans pareil monde, qui brille des falsifications de tous genres, comment entendre un Novalis, un Lautréamont, et plus proche de nous, des figures combatives comme René Riesel…
Annie Le Brun s’insurge contre « la langue stretch », contre le « langage de synthèse » qui participe à notre formatage, contre « la technicité qui vise à liquider ce qui nous reste de singularité », contre le « réalisme sexuel », contre l’idéologie du néoféminisme ou de l’actuel « féminisme pragmatique », contre le terrorisme et l’hégémonie « Du trop de théorie » incarné sous le label « French Theory », s’imposant « comme le dernier chic culturel – en ce que, pour la première fois, la théorie y proposait la possibilité d’innombrables jeux de rôles pour amateurs de subversion verbale » (p.164). Annie Le Brun décortique, décharne, répond à l’urgence d’un « Ailleurs et autrement ». Car pour elle, notre « immense chance qui ouvre toutes les autres » est de commencer par dire non. « Car si la servitude est contagieuse, la liberté l’est plus encore » (p.187). Citant Georg Grosz : « Ne cessez jamais d’être un critique féroce de la société », Annie Le Brun s’y emploie le plus férocement, non sans cesser de nous poser la question : de quelle sorte de résistance est-il encore possible ? dans un monde où règne ce qu’elle-même qualifie de « rationalité de l’incohérence ».
Ne nous contentons pas de croire que notre société atrocement anesthésiée puisse se vanter de sa capacité à la profondeur et au sérieux d’une véritable critique sur l’état des choses actuel. Lire Annie Le Brun c’est se rallier à une observation sociale réellement pertinente, sans feinte et sans épate. Car au même titre qu’un Jaime Semprun, l’art de la réflexion n’est-il pas de « déceler les approximations, les coups de bluff et réflexes conditionnés théoriques qui, depuis des années, se substituent à toute réflexion véritable » (p.276) ? Retrouver la « cohérence passionnelle », opter pour la « contrebande de la mémoire » (Jacques Hassoun), cela ne doit pas nous faire porter le masque de l’indigné (tel qu’il se porte actuellement à quelques endroits de l’Europe), mais de garder la plus haute vigilance quand on sait « l’ampleur des grandes épidémies de servitude volontaire, dont l’humanité est périodiquement affectée » (p. 244)
Nathalie Riera, Les carnets d’eucharis
Juillet 2011
 Annie Le Brun a publié aux éditions Gallimard « Les châteaux de la subversion », « Soudain, un bloc d’abîme, Sade », « Du trop de réalité », « Ombre pour ombre », « De l’éperdu », « On n’enchaîne pas les volcans », « Si rien avait une forme, ce serait cela ».
Annie Le Brun a publié aux éditions Gallimard « Les châteaux de la subversion », « Soudain, un bloc d’abîme, Sade », « Du trop de réalité », « Ombre pour ombre », « De l’éperdu », « On n’enchaîne pas les volcans », « Si rien avait une forme, ce serait cela ».
Entretien accordé au Magazine Littéraire
Propos recueilli par Benoît Legemble
Annie Le Brun : « L'actuelle bonne conscience se veut à la fois subversive et normative »
Poétesse aux accents surréalistes, figure intellectuelle à l’esprit incisif et polémique, exégète notamment de Sade, Alfred Jarry et Raymond Roussel, Annie Le Brun n’a de cesse d’explorer les marges comme d’autres sondent les lignes de faille. Son dernier livre, Ailleurs et autrement (paru récemment chez Gallimard), revient, au fil de chroniques publiées dans La Quinzaine littéraire durant la dernière décennie, sur ses engagements littéraires et idéologiques. L’occasion d’une rencontre avec l’auteur des Châteaux de la subversion.
Bon nombre des textes d’Ailleurs et autrement s’inscrivent dans la dénonciation d’une époque de la «fausse conscience» à la «subversion subventionnée», une période où la poésie même paraît menacée. Dans ce contexte, faut-il selon vous repenser le lien historique qui l’unit à la Résistance ?
Annie Le Brun.Dans ce livre, il n’y a rien de délibéré concernant l’articulation dont vous parlez puisqu’il s’agit de la réunion d’articles portant sur les sujets les plus divers mais dont la succession chronologique sur une dizaine d’années n’en rend pas moins compte d’une critique se développant à l’encontre d’une sorte de simulation critique qui est désormais une posture comme une autre. Ainsi me paraît-il insupportable qu’à tout propos on parle de «Résistance», en se référant implicitement ou non à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. C’est encore une de ces approximations, au bout du compte monstrueuses, qui en dit long sur la fausse conscience devenue norme. Et, à l’évidence, la littérature en participe, sans parler de la mômerie intitulée «Printemps des poètes», dès lors qu’elle ne se propose pas d’abord d’échapper à la confusion, mieux de la combattre en se tournant vers de tout autres horizons.LIRE LA SUITE
Annie Le Brun publie Ailleurs et autrement, et lit De l’Érotisme de Robert Desnos
Dans La Quinzaine littéraire du 16 au 30 juin dernier, Maurice Nadeau s’incline devant Annie Le Brun (ainsi est-ce annoncé en couverture [4] :
« Annie Le Brun, écrit-il, réunit les chroniques mensuelles qu’elles a tenues à La Quinzaine littéraire en 2001-2003 [5]. Elle y joint d’autres textes, préfaces et conférences [6], sous le titre général qui n’étonnera pas ceux qui la connaissent : Ailleurs et autrement [7]. Déjà, les chroniques de La Quinzaine littéraire paraissaient sous la rubrique : A distance. [...] On connaît son intérêt pour quelques grandes figures du passé, fort mal à l’aise, elles aussi, dans le monde où elles vécurent : Jarry, Sade, Roussel [8]. Pour chacun elle a étudié « l’écart » qui nous les rend contemporains. De ce que le Surréalisme a laissé de vivant elle est l’ultime représentante. [9] »
Le lecteur, ancien ou nouveau, mesurera en effet une fidélité intacte à un mouvement qui s’était attaché à repenser l’homme dans sa globalité, à son énergie, à sa révolte, comme s’y était essayé le premier romantisme allemand. L’un de ces textes pourra peut-être en donner plus particulièrement la mesure, tant il reflète les intérêts de l’auteure, sa manière, tant l’écriture que la forme de la pensée. Je n’en livrerai que quelques éléments significatifs, alors que grande serait la tentation de le reproduire in extenso !LIRE LA SUITE (La Lettre de la Magdelaine/Ronald Klapka)
21:38 Publié dans Annie Le Brun, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
13/07/2011
Sereine Berlottier, "Attente, partition" (une lecture de Tristan Hordé)
ATTENTE, PARTITION – Sereine Berlottier
(éditions Argol, 2011)
(Editions
Une lecture de Tristan Hordé
Le poème récit qu’est Attente, partition a adopté la forme du journal, propice pour noter les mouvements intimes. Genre qui permet également au récit de s’insérer dans un ensemble : ici, un nouveau carnet est commencé, dont la narratrice précise les dimensions (14 sur 9), et placé dans une série, manière de dire que ce qui est à écrire — les jours de la vie — est inachevable ; le dernier vers sans ponctuation finale (« et qui est une main levée ») laisse explicitement suspendu le récit.
Comme c’est souvent le cas, le journal ne mentionne pas les années : 2 avril, 8 avril, etc. (1). Deux dates précises seulement apparaissent, mais à l’intérieur d’une notation. La première (« Je crois que c’était le 13 février 2004. / J’ai le souvenir d’une page », p. 102) renvoie à l’ouverture du carnet : « Tu te demandes comment ça commence, ce qui commence au juste pour toi […] » (p. 11) (2), liée à l’écriture dont la nécessité est évoquée à plusieurs moments par la suite, soit en marquant qu’écrire exige un travail continu, peut-être sans fin (« Il faut écrire longtemps pour écrire », p. 45), soit parce qu’écrire n’est pas à dire vrai inventer un récit mais a sa propre fin (« L’illusion d’avoir à écrire une histoire qui serait arrivée alors que l’écriture est tout ce qui peut m’arriver écrivant », p. 146). Le journal n’est pas tenu chaque jour — mais parfois la narratrice le reprend plusieurs fois le même jour — et il peut se passer un long temps entre deux notations : par exemple, rien n’est inscrit entre le 27/4 et le 20/6, entre le 5/7 et le 7/8, etc., et ces lacunes sont d’ailleurs relevées une fois : « 16 août / Ici même le lieu délaissé [= le carnet]. Quand il faudrait nourrir le temps chaque jour. Creuser chaque jour sur la page un geste net comme la tranchée d’une pelle menée sous le pied. (p. 75) »
La seconde mention d’une date précise se rapporte explicitement à ce qui construit aussi le récit, l’enfant à venir : « 15 déc. / L’enfant n’est pas la question du 15 décembre 2005. Seul le livre. Charnel. Givré de secrets. // Le tenir. Ne pas le lâcher quand il sera, oiseau faible, l’habitant de tes paumes nues. » (p. 46) La liaison entre "enfant" et "livre (écriture)", si forte ici, organise d’une certaine manière tout le livre ; non pas qu’un parallèle soit présenté entre l’un et l’autre — on est très loin de la métaphore de l’"accouchement" d’un livre — , les deux motifs existent, chacun évoqué à sa place ou parfois dans la même phrase comme on l’a vu ; citons encore : « dans le ventre du bruit qui n’est pas du langage » (p. 71).
Attente, partition peut s’entendre en effet de deux manières ; "attente" renvoie aussi bien à l’espoir qu’au fait que l’on demeure quelque part jusqu’à ce que quelque chose se produise, et "partition" s’entend au sens de « séparation » (« tenir et pourtant / se quitter », p. 22) et de « composition musicale » ; les différents emplois s’associent, que l’on pense à la part(ur)ition ou au livre, l’attente de l’enfant étant elle-même un récit : « On colle l’oreille à ce ventre / comme si on cherchait pour de bon // si on a mal / on fait comme / si c’était une façon d’avoir une histoire encore. » (p. 99)
Composition musicale, si l’on accepte la métaphore, avec son alternance de très courts récits (« Elle est debout sous la douche [etc.] ») et d’ellipses, de mots comme jetés dont la référence au réel n’est pas ce qui importe (« Tandis que / (Ça bouge.)/ Dessus, dessous. / Son front de miel. / Un cil d’or. », p. 17) ; avec le mouvement subtil des moments de prose-poésie et de vers ; avec le jeu très réglé des pronoms : à côté de "je", un "tu" et un "elle" qui peuvent être aussi la narratrice, également un "on" quand se vit une distance avec soi (p. 127-128). Seul "il" n’est pas ambigu, et l’on note l’écart entre le "je" et le "il" dans l’attente quand la diariste n’emploie pas le possessif attendu ("son visage, le mien"), mais le pronom personnel : « Quelque chose est dans le silence entre le visage de lui et de soi » (p. 61). On peut encore ajouter les récits récurrents des rêves de chute, la relation à la série des Alien, le retour des motifs de la perte, de la disparition, de la déception, de la solitude aussi (« On est sans force et seule au milieu de la nuit, comme quelqu’un dont la maison brûle et dont le troupeau a fui sans retour », p. 63).
Attente, partition… On a peu dit de ce récit complexe (mais la lecture est-elle achevable ?) qui travaille sans cesse le dedans-le dehors du corps, les mouvements de retournement y compris dans la langue avec, par exemple, l’anagramme « du sien au sein » — et le très beau motif de l’attente(3) :
9 février
l’attente — et si
l’attente ne meurt pas
et qu’il faille
l’ensevelir de force
vivante
son cri dans loin
ne pas se préparer
ne pas consentir
À lire et relire…
Tristan Hordé
Les carnets d'eucharis
Juillet 2011
1 Une seule fois mention est faite du jour de la semaine : « Dans le soir du vendredi 1er juin » (p. 136) — il s’agit donc de l’année 2007 si l’on se reporte aux autres indications.
2 On pourrait rapprocher ce début de L’innommable de Samuel Beckett où, par une série de questions, est amorcée la question du récit : « Où maintenant ? Quand maintenant ? Qui maintenant ? sans me le demander. Dire je. […] » Quant à la dernière phrase, elle annonce que l’écriture ne peut être interrompue : « […] il faut continuer, je vais continuer. »
23:38 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sereine Berlottier, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
05/07/2011
Sylvie Durbec, La huppe de Virginia, éditions Jacques Brémond, 2011
Une lecture de Nathalie Riera
©
LA HUPPE DE VIRGINIA – Sylvie Durbec
(Editions Jacques Brémond, 2011)
I could not bear to live – aloud –
The Racket shamed be so –
Je ne pouvais supporter de vivre – à voix haute –
Le Tapage me gênait tant –
Emily Dickinson, Poème 473 (Poésies complètes, 1862) édition bilingue Flammarion, 2009, p.447)
il y aurait une femme
il y aurait un homme
ce seraient leurs voix qui diraient
et il n’y aurait plus pour traduire
que les oiseaux la terre et le pain
De belles singularités de voix et d’images parcourent La huppe de Virginia, le dernier recueil de Sylvie Durbec, aux éditions Jacques Brémond.
Tout poème ne surgit pas d’un monde intact mais de l’imparfait du monde, qui donne l’impulsion à nos voix ou qui les laisse à jamais se tarir, « puits englouti/à sec ». Il faut des fontaines à nos voix, ces fontaines qui sont les berceaux des mots pour « nous faciliter l’élan du verbe et nous permettre de nous exclamer ». Dans la première section du recueil, Sylvie Durbec nous offre un « poème bilingue » que sont « la voix des hommes/la voix des femmes ». Ils sont des voix que l’on regarde, des portraits de voix. Et d’où vient la voix des hommes ? Elle « vient d’un centre/leurs mères l’ont creusé dans leur ventre/et pour s’élever la voix des hommes doit/enjamber la prairie déserte de l’enfance ».
Nous en passons par la langue héritée, mais il est également une autre voix à placer, comme celle de « l’enfant trop grandi ne sait où glisser son corps ses fesses et surtout les mots dont il a l’usage mais dont il sait l’inconvenance c’est-à-dire qu’ils ne pourraient venir s’asseoir au sein de la famille et toujours ouvrant avec violence mâchoire à broyer la voix lui luttant pour tout de même installer sa présence invisible comme moi le fais sans en connaître vraiment l’enjeu si ce n’est que j’ai besoin de la voix sans corde ni fil/ juste ».
La voix de la poète s’essaye à « la voix de silence », « la voix du sourd », « la voix écrite », « la voix qui se tait », « la voix qui se perd ». Cependant, la voix ne se réduit pas à seulement un organe sonore ou insonore, mais c’est aussi « les yeux aveuglés comme la voix ».
« Regard, le mien, collé aux grincements des choses », écrivait Pizarnik dans son « Journal, 1962 ». « Monde de silence. Besoin de m’inventer dans la nuit, avec des mots qui me coûtent tellement ». Tenter d’habiter ce monde en poésie, mais pour quelle fin, si ce n’est comme, selon encore Pizarnik : « je sais, d’une façon visionnaire, que je mourrai de poésie ».
Sylvie Durbec nous dit que en soi la voix a un corps, « inconnu continent », ou alors évoquant la voix du chef de gare : « la bête dans sa voix celle qui fut la première à dire/ECCE HOMO/ECCE VOX ». Inversement, le corps et son trop plein de voix, un étouffement.
Ecrire est inscrire une voix, est chanter « une éternité de voix ». J’aime alors à entendre « La voix matinale », « La voix des images », des voix à lire :
LA VOIX MATINALE
la voix c’est aussi cette feuille trouvée
sur la table au petit déjeuner alors que
tristesse s’était assise à la table inquiète
et puis feuille rousse dépliée un baiser
allège de son poids petit l’ajournée
devenue le temps de l’action et de dire
un jour à construire dans le désir
La voix a pour géographie ce qui est vie ce qui est mort. Paysages de voix déterminés par le vent, sa langue brutale, par le vert qui dans la voix s’enchante, par l’encre coulée noire, par le mot monde, moi qui ne sais pas l’écrire, par le mot mort :
« la vieille Virginia déclare : quand ça vient entre
c’est une vilaine affaire quand ça vient
entre les familles ça les coupe ce serait mieux
de ne pas
ou d’avoir simplement un an ou deux de différence
entre les mères et leurs filles les pères et les fils
ce serait plus facile que la mort n’entre pas ».
Capture de pensées et d’images saisies au passage : « cornes aigües des mots », « esquissant la parole/esquissant encore le geste de la vie », « cette bouche jeune s’essayant à dire/est la fenêtre d’un monde ancien prêt à finir ».
***
Venons-en à la deuxième section de ce recueil, une fugue : La huppe de Virginia. On y croise des noms d’insignes poètes : Leopardi, Thierry Metz, Fernando Pessoa, Celan, Bonnefoy, James Sacré…, des noms qui nous disent que « c’est d’une voix pauvre que la présence en nous s’exercera ».
D’un vers de Leopardi, tentant de lui faire
traverser le détroit usé de la gorge,
avec seulement un peu de sable en guise de ponctuation
Nathalie Riera, Les carnets d’eucharis
Juillet 2011
Sylvie Durbec a récemment publié « Marseille/éclats&quartiers » (Jacques Brémond, 2009) suivi de « PRENDRE place, une écriture de Brenne » (Collodion, 2010)
00:17 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sylvie Durbec | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Sylvie Durbec, Apparitions/disparitions

Roberto Bolano, au Chili, 1970
l’enfant a petite taille et grandes enjambées
petit géant des livres disent les grands
le savant-savant si sage enrage :
voler si vite avec jambes si petites
alors que lui si pressé en pensée
rien plus jamais ne le délivre
Pourquoi commencer de cette manière en invoquant un enfant dans un poème plus ou moins raté si ce n’est à cause de l’écrivain chilien Bolano ?
Je n’écris pas. Je lis. Bolano. Et de Bolano à d’autres, il n’y a qu’un pas.
En le lisant/relisant, je découvre qu’il avait lu Daudet enfant et regrettait que cet auteur qu’il avait aimé soit tombé dans un total oubli, parlant de Tartarin de Tarascon comme d’une sorte de traité du plaisir de vivre qu’il avait justement apprécié et dont il dit certaines choses qui me paraissent d’une lucidité telle que nous n’en avons jamais eu conscience, nous, le lisant enfants ou adultes, à part peut-être le texte éclairant de la Doulou dans lequel Daudet évoque la maladie qui finit par le tuer. Dans cet oubli qui frappe bon nombre d’auteurs, hispaniques ou étrangers, Bolano range évidemment Daudet, mais aussi parmi ces auteurs qui s’éloignent, Artaud le géant, Sophie Podolski que nous avons tant aimée, Henry Miller, Macedonio Fernandez. Demandant à des amis libraires ce que les gens lisaient (ou achetaient), j’ai su qu’on ne lisait plus (ou très peu) Walser, Faulkner, Sarraute et tellement d’autres, auteurs aimés et figurant sur les étagères de nos maisons comme autant d’amis aux paroles bruissantes et vivantes mais que le monde éphémère dans lequel nous vivons oblige au silence.Invendables. Souvenirs pour étudiants. Littérature morte.
Bolano est un compagnon actif.
Il ne désarme jamais.
Se moque des jeunes écrivains qui se vantent de ne pas lire.
Fait l’éloge de Swift.
Ne décolère pas.
Même mort.
La preuve ? Il me fait courir au premier étage et ressortir de la bibliothèque du palier (celle qui attend toujours une vitre) le roman de Javier Cercas dans lequel justement, outre Rafael Sanzas, figure la ville de Blanès. Donc également Bolano lui-même mais aussi un personnage, sorte de héros républicain, dont le nom, Mirallès, est le même que celui du poète Yann Mirallès.
Le personnage du roman de Cercas (Les soldats de Salamine) disparaît. Le poète Yann Mirallès apparaît.
Le livre de Cercas est maintenant sur la table de la cuisine, là où on écrit comme on mange, bien.
Il n’y a pas encore le livre de Yann Mirallès. Mais il sera là, bientôt.
Pour l’instant, deux livres qui ouvrent à eux seuls une bibliothèque : Entre parenthèses et Les soldats de Salamine.
Entre eux, rien.
La cafetière, la voiture qui passe sur la route, la grisaille, le chant du coq.
Cette immense fatigue devant la tâche de mettre en mots la colère.
Et même plus simplement la ville de Blanès où Bolano et Cercas mangent une paëlla.
Et qui n’existe plus et n’existera plus jamais.
Plus loin, à Mexico, dort Karla Olvera, autre poète.
Vivant cette fois, ce qui est une joie à cause de tous ses livres à venir.
Comme elle est en train d’écrire, j’espère que ce livre qui n’existe pas encore et donc ne peut disparaitre, un jour sera dans la bibliothèque du palier, celle à qui il manque une vitre, et rejoindra ainsi non seulement Cercas et Bolano, mais aussi Vila-Matas qu’elle admire tant, sans oublier Mirallès.
Ce que j’aime, dit Bolano, ce sont les raisons que l’on n’exprime pas vraiment et qui font qu’on s’installe à Gerona ou à Blanès, loin de Barcelone ou Madrid, et qu’on y écrit. Des livres qui ne disparaissent pas, puisqu’ils parlent la langue des vivants.
C’est tout.
A Boulbon, 4 juillet,
SD
00:05 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sylvie Durbec | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
04/07/2011
Pascal Boulanger, le lierre la foudre (une lecture de Brigitte Donat)
Comment la poésie rencontre-t-elle l’histoire et permet-elle à la littérature de dévoiler l’envers d’un monde que ronge le nihilisme ? Pascal Boulanger poursuivait déjà cette question dans un précédent recueil poétique, Tacite (Flammarion, 2001) : il révélait l’histoire comme une reconduction de l’enfer. Cette vision s’approfondit avec le Lierre la foudre ; elle met à nu le fondement anthropologique de toute société selon lequel chaque communauté se fonde sur un crime commis en commun, dresse la généalogie d’un effondrement qu’inaugure le siècle des Lumières, met en abîme le déclin du père symbolique que creuse une insondable absence. Le dévoilement est accablant, notre modernité n’en finit pas de s’enliser au sein d’un mécénat maternel qu’accompagne un retour au paganisme et à sa violence généralisée.
« Mollesse / débordement / Quand le monde offert à la prise / à la consommation / efface les limites / qui paie sa dette / qui paie le prix d’être soumis au langage ? »
S’il est impossible d’échapper à la comédie sociale, l’aliénation cesse pourtant dès qu’un être s’éveille au jeu désintéressé de l’amour quand il est sans négoce et sans ressentiment. La vie de chaque homme peut alors s’opposer à la totalité hégélienne et, dans ce retrait, annoncer : je suis l’esprit qui toujours affirme. Son langage alors souverain, dans l’écart et la solitude, s’arrache à la fatalité du malheur et renverse la malédiction en exultation. Quand le poème se pense et s’écrit, l’existence d’un être n’est plus saturée ni close, puisque le langage excède le monde. Le vers apparaît comme un trait, chaque parole se détache, fait saillie dans l’art de la notation sèche. Composé comme une fresque, ce recueil n’en n’est pas moins diffracté afin que chaque poème, avec son titre et souvent sa dédicace, s’impose comme un îlot. Pascal Boulanger, de cette manière, rend hommage, de personne à personne, de livre en livre, dans et par le langage, à de nombreux noms – Marcelin Pleynet, Pierre Legendre, Jacques Henric, Claude Minière, Philippe Muray – qui, dans leurs singularités, sont autant d’expériences incomparables et de vérités pratiques qui permettent d’accéder à la connaissance du pire sans exclure le chant de l’affirmation. C’est dans ce continuum du poétique comme du politique que le poème déploie un dispositif chant/critique. À l’horizontalité de la série et du nombre se dresse la verticalité de l’oeuvre, qui s’ouvre au deuil fécond de l’héritage. En effet, la bibliothèque s’oppose au dressage social et permet au poète d’être écrit par ce qu’il lit. Les visions de l’écriture appellent une exigence éthique où la poésie est envisagée comme l’essence même d’un langage qui prophétise, rayonne et résonne.
Dans un contexte de relectures théologiques et en prenant appui sur les pensées de Chestov et de Kierkegaard, Pascal Boulanger rétablit la suprématie d’une pérennité christique à contre-courant du contexte poétique, qui, l’ayant refoulé, s’est attaché essentiellement au monde grec et à la pensée heideggérienne. Ce n’est donc pas anodin si les éditions Corlevour, dont les travaux tournent autour du christianisme, publient ce livre. À notre temps qui, sous prétexte de « lumière », s’est engagé dans l’ignorance, Dieu apparaît comme l’unique signifiant capable d’opposer sa transcendance à l’immanence de la barbarie communautaire.
« Le Nom au centre de tout / qui assume tout / porte tout / souffre tout… croit encore à l’échec des échecs. »
L’expérience du défaut de Dieu n’est pas celle de sa radicale absence. Soutenir son deuil, au contraire, renforce son attrait, et du Dieu sans visage, de son regard invisible, s’impose un éloignement qui trace un chemin. Le retrait de Dieu ne signifie pas que l’amour passe hors-jeu, mais indique le visage actuel de son insistance, de sa fidélité à travers son refoulement même. L’histoire, parce qu’elle est endurée, sera ainsi traversée, soutenue par l’espérance qui croit dans la promesse de l’impossible.
« Qui frappe là où il n’y a pas de porte… pour nous faire entendre / que l’impossible devient possible / quand Isaac est rendu à Abraham… »
Puisque la foi ne repose sur rien, sur l’insensé, elle est le levier qui suspend un instant les fracas de l’histoire, la violence de son mouvement. À l’interruption momentanée de l’histoire, à l’histoire devenue un instant l’impossibilité de l’histoire, se produit le vide où la catastrophe hésite à se renverser en salut, où, dans la chute, s’opère la remontée et le retour.
« Quand tout est impossible, alors la parole prophétique affirmant l’avenir impossible, dit aussi le “pourtant” qui brise l’impossible et restaure le temps » (Maurice Blanchot).
Le Lierre la foudre recompose un monde dans son ultime poème qui a pour titre emblématique Prophétie. « Des chants monteront des voûtes / des rebelles vivront cachés et goûteront l’esprit d’un monde jamais perdu / des bibles vivront dans des échoppes / des soleils éblouis d’herbes et de fleurs renverseront le paysage. » Brigitte Donat
Cette recension vient de paraître dans la revue art press n°380
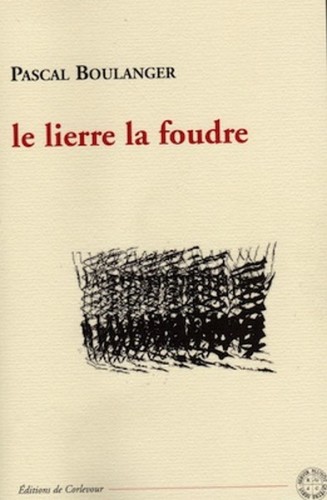
le lierre la foudre - éditions Corlevour, 2011
22:50 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
17/06/2011
Revue Triages N°23, juin 2011 (avis de parution)

Copyright © Revue Triages, N°23, 2011
« Vie ne veut pas dire
que vivre est absence.
Mais si vie exige
des brassées de fleurs,
et que fleurs disparaissent,
tu peux partir. »
Jacques Izoard « Le bleu et la poussière » (1999)
La revue littéraire et artistique Triages, des Editions Tarabuste, ouvre sa 23ème édition avec un dossier d’hommage à Jacques Izoard, une figure marquante de la poésie contemporaine (1936-2008). Dans « Merci aux poèmes de Jacques Izoard », James Sacré écrit : « Aucune œuvre ne vient de nulle part sans doute – et celle de Jacques Izoard, je suppose, pas moins que les autres. On peut penser en la lisant à des fatrasies du XIIIe siècle, à des façons de faire briller les associations de mots de Tristan L’Hermite, ou à des éclats de poèmes de Rimbaud. N’y a-t-il pas chez Izoard quelque chose de fortement rimbaldien (…). Peut-être aussi quelque chose du surréalisme, mais sans que l’image et la métaphore empoissent le poème.
Françoise Favretto, éditrice de L'atelier de l'agneau : « (…) on sait qu’il ne choisira pas la littérature « engagée » mais tendra plutôt vers l’Esthétisme. Il voit cependant les limites de l’écriture et souhaiterait davantage d’elle ». Izoard publiera sous cette enseigne : Plaisirs solitaires (avec Eugène Savitzkaya), Axe de l'œil, Petits crapauds du temps qui passe (avec Michel Valprémy), Bègue, bogue, borgne.
Les deux premiers tomes de ses « Œuvres poétiques » complètes sont disponibles aux Editions de La Différence ; un troisième volume paraîtra en 2011, consacré aux années 2000-2008.
« Langue happe libellules
Langue d’insecte,
Ou de saint sec !
Le mot « langue » bouge
Sans cesse en un étui
De fraîche salive…
(p. 29)
***
Cette 23ème édition est aussi une rencontre incontournable avec le poète Claude Minière dans un entretien avec Pascal Boulanger intitulé « Courage cœur, poussière dorée à propos de Claude Minière ». Rappelons-nous de Pascal Boulanger Une action poétique de 1950 à aujourd’hui (éd. Flammarion, 1998), Suspendu au récit... la question du nihilisme (éd. Comp’Act, 2006), et puis Fusées et paperoles (L'Act Mem, 2008), sans oublier l’ensemble de ses articles consacrés à la littérature contemporaine et publiés dans des revues comme Art Press, Europe, Action Poétique… tout le travail d’analyse de Pascal Boulanger s’établit sur le terrain non pas des clivages scolaires sur la poésie, mais sur celui de la demeure du poète dans sa relation à l’Histoire. D’un livre à un autre, ce qui s’affirme sans relâche est la question du nihilisme et des diverses intimidations de notre époque. Au cœur de ce passionnant entretien, les réponses de Claude Minière témoignent d’une profonde et réelle attention pour la poésie, et plus que jamais pour le « courage poétique ». L’enjeu d’un recueil de poésie, nous dit Claude Minière « est d’abord du rapport du poète à lui-même. Les hommes sont parés de mérites et pourtant c’est en poète qu’il faudrait habiter cette Terre. /La conviction de tout véritable poète est qu’à travers l’Histoire – à travers l’histoire de l’humanité, à travers l’histoire sociale et l’histoire de la métaphysique – un très long débat se poursuit, « visiblement » ou secrètement. Débat du poète avec lui-même (« La poésie doit avoir pour but la vérité pratique »), avec les logiques de discours qui formatent les corps et les esprits, et avec la culture. Ainsi même, le poème peut parfois avoir pour « embrayeur » la haine de la poésie quand celle-ci n’est pas à la hauteur de ses ressources mais les galvaude. Ne pas contourner la haine qui anime le poème est un premier trait du « courage poétique ». Trait de dégagement (contre le « chantage », d’exercice de la nécessité et de la liberté intime, et, comme en passant, salut adressé aux compagnons de route, de joie, de combat et de questionnement. ».
Grand lecteur d’Ezra Pound et auteur de Pound caractère chinois, paru dans la collection L’Infini chez Gallimard en 2006, un prochain essai de Claude Minière va paraître aux éditions Tristam : La méthode moderne (consacré au poète Pound).
Pour ma part, je suis heureuse de retrouver, parmi les recensions de Pierre Drogi et Brigitte Donat autour de l’œuvre de Claude Minière, ma lecture, en 2009, de Pall-Mall, Journal 2000-2003 (éd. Comp’act, 2005), sous le titre Claude Minière... et le monde dans son ordre par la justesse d'un trait. Que Pascal Boulanger, Djamel Meskache et Tatiana Lévy en soient remerciés.
Nathalie Riera, juin 2011
■ Sur Claude Minière, consulter Les Carnets d'eucharis
Pour commander la revue
Editions TARABUSTE
Rue du Fort
36170 SAINT-BENOIT-DU-SAULT
Tél. 02 5447 66 60
Fax 02 5447 67 65
23:50 Publié dans Claude Minière, Jacques Izoard, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
16/06/2011
Hilde Domin (sur le site Littérature de partout proposé par Tristan Hordé)

Jamais encore, semble-t-il, la réalité n’a été aussi perfide que celle qui nous entoure aujourd’hui. Elle menace de détruire la réciprocité entre elle et nous, elle menace, d’une manière ou d’une autre, de nous anéantir. C’est le danger le plus subtil qui semble presque le plus inquiétant : il existe sans exister. Tout le monde en parle. Personne ne le rapporte à soi. Ce danger s’appelle la « chosification », c’est notre métamorphose en une chose, en un objet manipulable : la perte de nous-mêmes.
La poésie peut-elle encore nous aider à affronter une telle réalité ?
[…]
Hilde Domin (1909-2006), "À quoi bon la poésie aujourd’hui", Lire la suite sur le site LITTERATURE DE PARTOUT(Tristan Hordé)
23:00 Publié dans Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
26/05/2011
Fabienne Raphoz, Jeux d’oiseaux dans un ciel vide augures (éditions Héros-Limite, 2011)
NOTE DE LECTURE
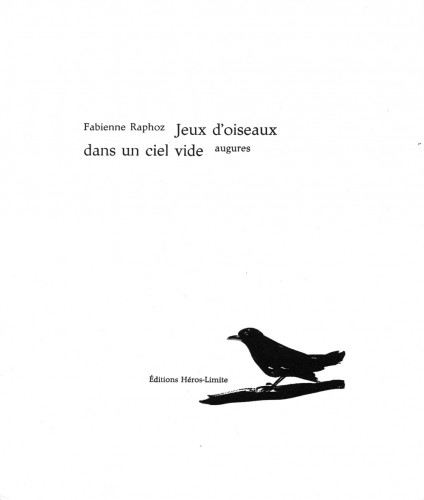
par Tristan Hordé
Voici un livre singulier, écrit par une passionnée des oiseaux (1), s’ouvrant sur une page explicative titrée "Quelques précisions — peut-être" qui, bien qu’elle introduise les distinctions d’ordre, famille et espèce, n’est pas la présentation d’un livre d’ornithologie. Le lecteur apprendra sans doute à propos des formes, couleurs, habitat, etc., des oiseaux, mais le propos n’est pas scientifique. Ou, si l’on préfère, puisqu’il s’agit d’un livre de poésie, la poésie travaille ici des matériaux divers ; des ouvrages savants est tiré et réécrit le fond du livre (les augures, à gauche), s’y ajoutent des fragments de dits traditionnels, de livres de voyage, etc. également recomposés, des citations, le tout lié par les notions venues de la classification du vivant. Enfin, s’introduisent dans cet ensemble des textes de Fabienne Raphoz, de dimensions très variables — quelques vers, quatre pages —, souvent datés et avec une indication de lieu, textes qui marquent une distance entre la poésie et la connaissance, distance qui semble presque effacée dans le plus gros du livre : la première page ne porte-t-elle pas en exergue une citation du paléontologue George Gaylord Simpson, « La taxinomie, qui est la mise en ordre par excellence, possède une éminente valeur esthétique » ?
Aux "jeux d’oiseaux dans un ciel vide" (le ciel de la page ?) répondent ceux d’oiseaux qui l’emplissent :
« Comment remplir le ciel ?
ne jamais se poser
le bleu fantôme les écrit partout » (p. 111)
"les" désigne les martinets, dont le nom apparaît en anglais (Swift) dans le titre, "Swiftizzall"(= « Swift is all »). En poursuivant l’image ciel / page, on pourrait dire que le livre est une immense volière, sans dimensions définies, susceptible de réunir tous les oiseaux, y compris ceux qui sont en danger de disparaître et ceux que les hommes ont exterminés, comme cela est mentionné systématiquement (par exemple : Le Pluvier roux le Pluvier de Sainte-Hélène sont en danger / Le Vanneau hirondelle est éteint (p. 71)), les oiseaux, comme la plus grande partie des êtres vivants, étant dans nos sociétés des marchandises : « Vingt millions de perroquets sont en captivité. / Plus l’espèce est en danger, plus sa cote est élevée. » (p. 90). Tous les oiseaux réunis : ceux de la préhistoire et ceux rencontrés au Crest, à Paris, au Costa Rica, en Savoie, etc., ceux évoqués dans les traditions populaires (Indiens d’Amérique ; hittite : française : Sébillot ; etc.), dessinés par le naturaliste (Audubon), présents dans un poème (Thoreau, Char, Shelley, Emily Dickinson, Du Bartas, Cummings, etc.), ceux liés à un contemporain de Fabienne Raphoz (Claude Adelen, Éric Sautou) ou à une personne proche (« La nonette a fait écrire un beau livre à Caroline », p. 176, « Le Rouge-gorge de Caroline SD s’appelle Blanchot », p. 162 — Caroline Sagot-Duvauroux) . Tous les oiseaux du monde : avant le Livre I, "Uccelli" (2), un poème est constitué par l’écriture du nom « oiseau » dans plus de cent langues. La nécessité qu’il y aurait de les nommer tous dans cette « randonnée en l’honneur de l’oiseau » (p. 207) tient sans doute au fait que les oiseaux symbolisent plus que tout autre vivant le monde naturel — ils sont présents partout, sur terre, dans le ciel — en tant qu’il n’est pas une réalité simple, qu’on ne peut lui assigner de limites :
Le Colibri pampa
porte le ciel au front
la forêt sur le dos
les nuages à la gorge
et
dessine l’infini
25 fois par seconde
(p. 109). Si l’on se souvient que les oiseaux sont l’ancêtre de l’homme, on comprend que leur proximité avec le ciel les transforme, avec un jeu sur la couleur du plumage, en voleurs de feu, qu’ils transmettent à l’homme :
le roitelet a pris le feu du ciel
s’est pris dans ses ailes
au rouge gorge l’a passé
s’est pris dans sa gorge
à l’alouette l’a passé
l’a donné aux hommes
(p. 144)
Les caractérisations des oiseaux sont, comme l’ensemble des noms, en quantité indéfinie ; de chacun est retenu un élément distinctif qui, souvent, n’a rien d’encyclopédique :
« (Trogloditydés)
En Europe nous n’avons que le mignon
Tous les troglodytes sont un peu roux
Tous les troglodytes lèvent la queue en chantant
Tous les troglodytes ne sont pas toujours des troglodytes
Le troglodyte est le roi des haies
Le troglodyte est le roi de l’hiver » (p. 154)
L’usage de l’anaphore, comme celui très régulier du parallélisme des constructions, introduit un rythme et suffit à éloigner (sans l’effacer) le caractère didactique de certains énoncés. Mais la seule énumération de noms construit souvent une série sonore séduisante et étrange : « Éroesses couturières dromoïques bathmocerques camaroptères éminies apâlis prinias sont des cisticoles qui l’eût cru ? » (p. 169). La question « qui l’eût cru ? » marque une distance et introduit l’énonciateur dans le texte. Sa présence se manifeste à d’autres endroits de manière variée, par exemple par l’allusion à l’activité d’éditeur de Fabienne Raphoz et Bertrand Fillaudeau : le vers « Troglodyte est le nom d’un personnage de La Route fantôme », (p. 154) évoque un livre de Frédéric Cosmeur édité en 2007 aux éditions José Corti ; le renvoi est aussi transparent dans « Le Cincle d’Amérique est très aimé de John Muir et de ses éditeurs français » (p. 148). Ailleurs, la trace du « je » est visible par la marque verbale : « Le Pipit maritime est le moineau domestique de Penn Arlan Ouessant (et d’autres îles mais n’y étais pas) ».
Enfin, un long poème, "Au merle de mon jardin", en même temps qu’il réunit une partie de ce qui est vivant (oiseaux, bien sûr, et autres animaux, et plantes — image d’un éden : « Paradise indeed in the hidden garden », p. 188, dans un autre poème), exprime la relation du "je" aux oiseaux (« un jour le merle de mon jardin comme le Merle de Grand Caïman éteint je le chialerai », p. 160) et précise la place du sujet dans ce monde foisonnant : « le merle de mon jardin n’est sûrement pas mon merle, comme mon jardin n’est finalement pas mon jardin » (p. 160). On retrouvera la fonction particulière du merle et de ce jardin dans le livre : pour ne retenir qu’un passage, « Puisqu’il faut bien mourir alors mourir sue le chant du Sirli du désert […] sur le chant du Rossignol Philomèle (ou sur le chant du merle de mon jardin) » (p.144 ; voir aussi p. 70).
Tous les oiseaux du monde, ai-je écrit ; toutes les variations aussi les couleurs, mais l’une seule peut être retenue, jeu de l’anaphore et du parallélisme de la construction qui rapproche de la litanie :
Le bleu de la tête du Motmot à tête bleue
est plus bleu que le bleu de Fra Angelico
Le bleu de la tête du Motmot à tête bleue
est plus bleu que tous les bleus de terre
Le bleu de la tête du Motmot à tête bleue
est l’expression du bleu dans la densité du vert
Le bleu de la tête du Motmot à tête bleue
est l’expression du bleu entre ciel et terre
Le bleu de la tête du Motmot à tête bleue
Le bleu de la tête
Le bleu
(p. 116). Les langues sont parfois mêlées, traduisant la variété des lieux, mais se construit ainsi une langue très particulière. Des désignations sont simplement juxtaposées : « L’engoulevent est un Tête-Chèvre un Succiacapre un Chotacabras a Goatsucker ein Ziegenmelker », ou des éléments de langue différentes constituent le poème : « […] la cellule dans la vase bouillonnante // all over again ? // .. // .. // .. // vielleicht » (p. 107 ; les // figurent un espace double). Fabienne Raphoz revendique « un rapport passionnel avec l’anglais » (p. 160) et ses deux poèmes écrits en anglais le prouvent. On lit dans ce goût de juxtaposer des langues le même plaisir à associer les mots, mots qu’elle n’hésite pas à créer quand besoin est : « Les souimangas colibrient l’Afrique » (p. 178), « Le véloce se maghrèbe en hiver / Le fitis subsahère son moteur sur le point de caler / Les pouillots vélocent le bord de l’Arve […]» p. 172), « grecquerait guerre » (206), « effontièrent la limite » (p. 146), etc. Ou à reprendre des termes régionaux : « Le Canard souchet est un bec en cuillère un louchard un barbelle une cuillerasse une goule large un rouge de rivière » (p. 43). Trouble du lecteur : ignorant tous les noms d’oiseaux, il ne sait plus si un mot est une unité de sa langue (La sitelle truffle) ou une création (verdiens pirsons).
Henri Pichette et, d’une façon différente, Jacques Demarcq (3), ont récréé (onomatopées ou verbes) les chants de quelques oiseaux. Fabienne Raphoz, qui suit cette voie ici et là (« Chi ! riou ! Chiou ! c’est moi qui suis le roi, / dit parfois le troglo à dos d’aigle au roitelet », p. 154), sait comme ses prédécesseurs l’impossibilité de la transcription, mais elle propose un "poème de lettres", qu’on peut lire pour les bruits des oiseaux en vol :
snn ! snn ! cnsnn !
!
n jr ps l’tmps
d slr L verdr
:
fffftttttttzzzzzzz
fffftttttttzzzzzzz
llw wngs
etc., (p. 197). Que l’on puisse dans cette suite recomposer des mots (temps, wings, etc.) conduit à signaler l’extrême richesse de la mise en pages : emploi de différents corps, jeu de l’italique et du romain, fer à gauche-fer à droite, emploi de colonnes, fragments suscrits, et dispositions complexes sur la page. Rien de calligraphique dans tout cela qui dessinerait une figure de l’oiseau, mais recherche de rythmes, volonté de proposer une lecture des mots et des blancs, dans la lignée par exemple (mais différemment) de Reverdy et du Bouchet.
On n’a fait ici que retenir des bribes de ce Jeux d’oiseaux…, il faut le lire et relire comme tout vrai livre de poèmes. Terminons avec le dernier poème titré "L’oiseau bleau" (mot-valise : beau + bleu ; et/ou bleu + allemand blau, « bleu »), qui réunit création verbale (création amusée), répétition (« bleu ») et énumération jusqu’au vertige :
Dans les deux livres [Uccelli et Uccellini] l’invisible est randonnée
dans la coda impossibleu n’est contoiseau
L’aigrette bleue le Lori nonette le Lori ultramarin le Ara hyacinthe le Ara de Lear le Ara glauque le Ara de Spix le Ara bleu le Touraco géant le Coua bleu le Martin-chasseur à longs brins le Martin-chasseur de Kofiau le Martin-chasseur de Biak le Martin-chasseur à poitrine bleue le Martin-chasseur bleu noir le Martin-chasseur des Moluques le Martin-chasseur Iazuli
(etc)
1 Fabienne Raphoz, qui dirige avec Bertrand Fillaudeau les éditions José Corti, a publié en 2009 L’aile bleue des contes : l’oiseau, Anthologie suivie de « l’oiseau-monde : une omniprésence » (2009), recueil de contes dans la collection "Merveilleux" qu’elle a créée.
22:44 Publié dans Fabienne Raphoz, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
04/04/2011
Nasser Al-Aswadi (par Claude Darras)
Portrait de Claude Darras
Nasser Al-Aswadi, le fabuliste de Saba
Nasser Al Aswadi : L’acrylique, les encres, la gravure associée à la photographie et accessoirement la terre cuite attestent de la multiplicité de ses curiosités (Photo Daniel Lemaire).
L’univers de Nasser Al-Aswadi a mûri en grande partie dans l’inconscient, vraisemblablement pendant les deux premières décennies d’une vie constellée de découvertes. La société yéménite et tribale ne connaissant pas le cloisonnement plus ou moins étanche des classes d’âge, il a été graduellement initié aux activités et aux comportements des adultes. Ainsi la révélation précoce de l’architecture du Yémen, l’écoute passionnée des diseurs de bonne aventure et le lent déchiffrage de la calligraphie arabe sur les manuscrits coraniques et les monuments antiques ont peu à peu sédimenté un terreau fertile de références savantes et de curiosités pastorales sur lequel a fleuri une exubérante invention. Études simplifiées mais encore reconnaissables où vibrent des lignes simples et des coloris sobres : l’académisme des premières gouaches se nourrit des minarets et des dômes peints des mosquées de Taez et emprunte aux blasons enluminés des façades chaulées de Sanaa. Sur des papiers grenus, il interprète l’harmonie glacée de la maçonnerie et les cassures tranchées au couteau entre les ombres et les lumières des édifices domestiques et des lieux saints…

Sans titre, technique mixte sur toile, 147 x 130 cm. 2010
À Maussane, au seuil des Alpilles calcaires, dans la quiétude du mas du Soleil, son esprit semble se concentrer, l’espace de quelques secondes, sur un tableautin qui l’absorbe tout entier, obscurcissant son regard : des briques d’ocre rouge bien appareillées emprisonnent des vitraux aux couleurs criardes. C’est un exercice d’école où il transcende déjà la géométrie polychrome des citadelles de basalte et d’argile perchées sur les hauts plateaux d’altitude. Tandis qu’il parle, quelque chose de spectaculaire se produit. Une lueur ironique, pleine d’appétit, ressurgit au fond de ses yeux noirs, prête à faire un sort à tous les obstacles jetés en travers de notre dialogue par les chausse-trapes de la langue française.
« Désormais, je colporte au cœur de ma peinture les histoires que m’ont racontées les bergers de mon village, justifie-t-il simplement. Ce sont de vieilles légendes ou des contes animaliers, tirés du Coran parfois, auxquels je mêle les dernières volontés des legs testamentaires. »
Sans titre, technique mixte sur toile, 120 x 60 cm. 2008
Dans la petite cité d’Al Hujr (où il est né le mercredi 4 octobre 1978), à une vingtaine de kilomètres de Taez, accroché à l’herbe tendre des massifs abrupts de la Hugariyya, l’adolescent ne se lasse pas de réécouter les mille et une versions du fabuleux voyage de la huppe, habile messagère de Bilqîs, la reine de Saba, auprès du roi Salomon, à Jérusalem. Aux heures de classe buissonnière, les pâtres l’ont persuadé que l’oiseau sacré protégeait du mauvais œil, exorcisait les sortilèges et éloignait les djinns de néfaste augure. Aussi suivra-t-il longtemps dans le ciel le flamboiement du plumage fauve orangé à pointes noires qui fait ressembler le passereau à un grand papillon noir et blanc des tropiques. Il ne goûte que modérément les enseignements de la scolastique par les maîtres égyptiens de la madrasa du village. Et le cercle de famille pourtant très moderniste lui paraît trop resserré autour d’une fratrie de douze frères et sœurs dont il est le sixième enfant. Il étouffe. Et il se rebelle. « À seize ans, j’ai osé dire non à mon père… », lâche-t-il en baissant la voix. On dirait qu’il n’en revient toujours pas ! Au milieu du visage glissent l’ocre et la nuit, et les émotions passent par un sourire fugace et une pesante concentration.
« J’ai quitté le nid parental pour la ville de Taez, débite-t-il soudain loquace. J’y ai appris le dessin industriel au sein d’un établissement d’enseignement technique. J’ai prolongé ma formation à Sanaa en alternant les cours avec des petits boulots de tailleur et de marchand de quatre-saisons. »

Sans titre, technique mixte sur toile, 136 x 97 cm. 2010
À Sanaa, l’architecte Yassin Ghaleb, son mentor, et le peintre soudanais Taïeb Al Hajj, un camarade d’atelier, l’incitent à se déprendre du badinage conventionnel inséparable des années d’apprentissage. La rencontre simultanée du langage universel des formes - avec Chagall et Picasso - et de la France des Lumières, au moyen du livre et de la télévision, de même que l’exploration assidue des terrains de fouille archéologique de la péninsule Arabique, sous le tutorat de prestigieux épigraphistes et historiens de l’art, dessinent déjà, de 1997 à 2001, les linéaments de l’œuvre futur. La bibliothèque du Centre culturel français à Sanaa et les programmes audiovisuels de Canal France International ont charpenté sa connaissance du pays de Molière et de Rimbaud. Commencés en 2004, des séjours en Touraine et en Provence ont aiguisé sa détermination à y établir un second atelier : des amis collectionneurs le persuaderont de planter son chevalet à Marseille.

Sans titre, technique mixte sur toile, 144 x 110 cm. 2010.
Le versant occidental de son activité l’introduit dans un système d’échos, de miroirs, de résonances, de métissages qui a pour effet d’élargir la conception de sa création et d’en étendre les registres. L’acrylique, les encres, la gravure associée à la photographie et accessoirement la terre cuite attestent de la multiplicité de ses curiosités. La mémoire et le lignage, l’homme et la femme, les travaux des champs et le labeur des villes, les fables et l’écriture, les graffiti rupestres et la magie des songes, autrement dit les racines immémoriales de sa parentèle, continuent de sous-tendre sa démonstration. Un peu comme la basse continue du oud cadence les chants psalmodiés au dernier étage des demeures yéménites, le mafraj, où les hommes mâchent du qat (plante aux vertus stimulantes) au gré du glougloutement des pipes à eau tout en déclamant les grands textes de mystiques soufis et de philosophes bédouins. Le pastoureau d’Al Hujr est resté fidèle aux rêves de sa jeunesse. Parmi les grands formats des acryliques et les photographies « lithiques », le bestiaire du Jebel Saber ramène au large de la Méditerranée les fragrances de l’Arabie heureuse, vapeurs d’encens et arômes épicés, odeur de menthe et de rose trémière, fumet de la shurba et du ragoût d’agneau. Des prédictions naïves enluminent la toile où la huppe symbolise la piété familiale et l’attachement aux ancêtres. Sur le vélin gaufré, l’âne agrandit les prunelles étonnées et vitreuses d’un solitaire, d’un ascète du désert. Le merveilleux qui est le cœur et le moteur de ces fables peintes et gravées laisse entrevoir l’âme du fabuliste et de ses personnages.
© Claude Darras, avril 2011

NASSER AL-ASWADI_Portrait de Claude Darras.pdf
Nasser Al Aswadi, la Citerne, Les Baux de Provence, du mardi 19 avril au lundi 2 mai 2011, tous les jours de 10 à 13 h et de 14 à 18 h. Vernissage le samedi 23 avril à 18 heures.
Renseignements : Office de tourisme des Baux 04 90 54 34 39.
18:21 Publié dans Claude Darras, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook