04/04/2011
Marie Etienne, Haute Lice (une lecture de Tristan Hordé)
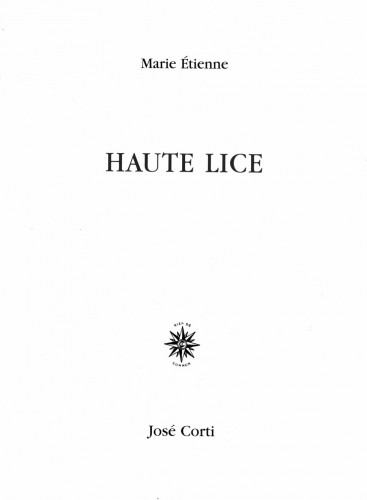
Marie Étienne, Haute Lice, éditons José Corti, 2011, 18 €.
Une lecture de Tristan Hordé
Rien de plus efficace que l’exergue tiré de Rimbaud, « Moi, j’ai toujours été stupéfait ! Quoi savoir ? » ("Remembrances du vieillard idiot") pour lire ce livre singulier ; c’est dire d’entrée de jeu que le lecteur aura à construire quelque chose — donc à lire ; « Faut-il tout dire afin qu’un jour il ne reste plus rien que la lucidité ? » (p. 124) : certes non. Haute Lice est partagé en sept ensembles de courtes séquences et se ferme sur une postface bien en relation avec l’exergue, sorte de "mode d’emploi" où l’auteur esquisse une poétique : « À proprement parler, le sens ne compte pas vraiment, ou bien ni plus, ni moins, que la sonorité, le rythme et le suspens, c’est ainsi que les choses se passent. » (p. 171) De quoi s’agit-il pour que le lecteur n’ait pas à se préoccuper du sens ?
Les ensembles sont liés grâce à la présence du début à la fin d’un personnage, Ava, c’est-à-dire Ève, narratrice des brefs récits dans lesquels elle a un rôle ; ajoutons qu’elle-même devient à l’occasion auteur : « Pour vaincre la tristesse, je m’inventais des fables troubles, dont j’ignorais la signification. » (p.20) Autrement dit, dans cet emboîtement les histoires ne se distinguent pas les unes des autres. Elles mettent en scène Ava, de l’enfance à l’âge adulte, et de nombreux personnages qui n’apparaissent qu’une fois, comme Joachim l’Italien ou Seringa le chimpanzé, ou reviennent à intervalles réguliers, comme Stone (mari d’Ava) ou Nel. Tous font n’importe quoi, le n’importe quoi ne pouvant être toujours défini, et leur apparence même n’est pas fixe. Ainsi, Ava, dans un récit est exhibée au bout d’une laisse, serait-ce dans un cirque ?, et le lecteur retrouve cette laisse bien plus loin, cette fois Ava peut-être sous une forme animale : « La laisse de ma mère, de mauvaise qualité, va céder sous mes crocs. » (p. 117)
Tout peut arriver : les oiseaux ont des dents, des fillettes sont dans des cages suspendues pour le plaisir des curieux, Ava perd sa mère dans un train ou reçoit devant sa porte « face cachée, nuque exposée, une tête sans corps » (p. 94). On multiplierait les exemples, mais ce serait recopier Haute Lice…Si une partie du livre évoque un lieu désigné par Lajenès (à lire "la jeunesse", en créole haïtien), la narratrice se trouve aussi à Paris, monte dans un étrange autobus aux vitres aveugles qui l’emporte nulle part, « dans le milieu d’une étendue d’eau grise, crêtée de loin en loin par une touffe d’herbe. » (p.166) Le lecteur renonce vite à la tentation d’organiser le tourbillon des changements d’apparence, de chercher quelque équilibre dans des récits qui, si minuscules soient-ils, le conduisent dans l’inexploré. On verrait aisément un monde à la Lewis Carroll, une Alice dans Ava, et l’auteur semblerait nous engager dans cette voie, mais il l’exclut immédiatement :
Petite sœur me conduit au miroir.
—Passe derrière, me dit-elle.
—Eh, quoi, ne me conduiras-tu ?
Elle rit, fleur goyave. (p. 124)
Le monde de Lewis Carroll a ses lois, qui relèvent somme toute d’une certaine logique, celui de Marie Étienne, qu’on pourrait lire comme relevant uniquement du rêve, est pour beaucoup un univers de mots, j’y reviendrai.
Cependant Le monde de Lewis Carroll a ses lois, qui relèvent somme toute d’une certaine logique, celui de Marie Étienne, qu’on pourrait lire comme relevant uniquement du rêve, est pour beaucoup un univers de mots, j’y reviendrai.
Cet univers n’est pas totalement coupé de l’Histoire ; on y croise par exemple un maçon « admonesté et sous-payé comme c’était la coutume » (p. 39), et les femmes, qui savent distinguer la satisfaction du désir sexuel et l’amour, peuvent surtout être elles-mêmes par le rêve ou l’écriture ; « Je commençais d’écrire c’est-à-dire de migrer vers mes terres intérieures « (p. 75) indique Ava. Mais quand elle entend bien refuser d’être dans le temps (« Je refuse de survivre à l’instant annulé en m’accrochant avide aux basques du suivant »), sa sœur se moque d’elle : « Allons, allons, tu racontes des histoires ! » L’Histoire est présente aussi par les allusions littéraires ; par exemple, "La Ravaudeuse" évoque Margot la Ravaudeuse de Fougeret de Monbron et "Nel" peut-être un personnage de Fin de partie de Beckett, "Marigda" est sans doute une allusion au livre de Viviane Forrester Le corps entier de Marigda, etc. Quant au premier récit, "La dictée", dans lequel Ava se laisse aller à uriner en classe au point que le liquide forme une grande mare, sans d’ailleurs que l’institutrice s’étonne outre mesure, il renvoie directement à "Remembrances du vieillard idiot" et donc à l’exergue :
[…] Quand ma petite sœur, au retour de la classe,
[…] Pissait, et regardait s’échapper de sa lèvre
D’en bas, serrée et rose, un fil d’urine mièvre… !
La postface introduit un jeu entre lice et lisse, d’où les termes techniques de peausserie lisser et chagriner ; dans les deux cas, le travail de l’artisan — la tapisserie, montage complexe de fils, la préparation des peaux — permet de passer d’une apparence à une autre : impossible de reconnaître dans l’œuvre achevée les matériaux travaillés. Et c’est heureux. De même, les mots sont associés non pas comme dans une fatrasie mais pour construire des ensembles pas encore vus, pas encore imaginés, pas du tout impossibles … puisqu’ils sont décrits. Voici par exemple le début d’une scène dans la loge d’une maison d’Ava :
« La femme est belle, moi je sucre, elle a les doigts qu’il faut, on lui en mangerait son cratère de plaisir, d’autant qu’elle sait ce qui convient : détecter en dansant mais sans colle ni buée les écrans de fumée qui séparent du bleu, et lire dans les yeux le tintamarre des culs. » (p. 97)
Le seul changement de position des mots (qui entraine modification du statut grammatical) produit des effets, ainsi dans ce passage : « or voilà que la terre se bombe, or voilà que les bombes se terrent » (p. 30) ; on notera les nombreux jeux avec les sons, minuscules (« je suis en pantalons, pantoise ») ou non : Ava aime une femme qu’elle nomme "Missive" ou "Mélisse" ou "Réglisse", noms qui portent le sens « de délice (ou supplice ?) », et il n’est pas surprenant que la rivale de cette femme ait pour nom "Céline" — la finale ne peut entrer dans la série….Au jeu des sons s’allie le rythme ; on prendra plaisir à entendre le mouvement de la voix dans ce passage :
« Musique en fête, en tête, en crête, en kiosque, en dents calquées sur les montagnes, en tournevis, en tour de roue, musique saoule sur les terrains poudreux, éclatée à dessein, flûtes en verve. Musique verte. (p. 80)
Il y a dans Haute Lice un amour de la langue (comment dire autrement ?) que l’on voudrait plus répandu, une jubilation que l’on partage sans peine, un humour constant — et une manière malicieuse de l’auteur d’être présente : "Marie" et "Ava/Ève" sont deux origines culturelles, et ne reconnaît-on pas "Marie" dans les noms de personnages "Mariquido" et "Marigdar" ?
© Tristan Hordé, avril 2011
■ Sur le site TERRES DE FEMMES
Dans le chagrin ouvragé de la page (une lecture d’Angèle Paoli)
18:10 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
John Muir, Célébrations de la nature (une lecture de Nathalie Riera)
JOHN MUIR
Célébrations de la nature
(traduction d’André Fayot)
Ed. José Corti, 2011
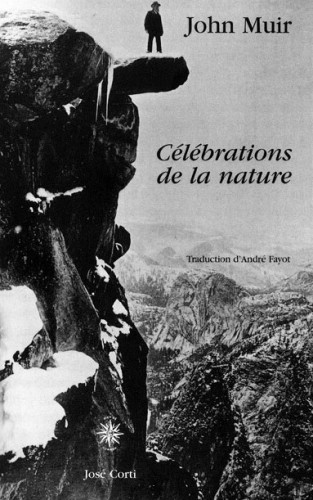
Aucun des dogmes que professe la civilisation actuelle ne forme, semble-t-il, un obstacle plus insurmontable à la saine compréhension des relations que la culture entretient avec l’état sauvage, que celui qui considère que le monde a été fabriqué spécialement à l’usage de l’homme. Tout animal, toute plante ou cristal le contredit de la manière la plus formelle. Or il est enseigné de siècle en siècle comme quelque chose de précieux et de toujours nouveau, et dans les ténèbres qui en résultent cette prétention monstrueuse peut aller librement son chemin.
[...]
Célébrations de la nature de John Muir (José Corti, 2011) rassemble plusieurs textes, dont la plupart ont paru dans diverses revues : Mountains of California (1894), Our National Parks (1901) et Steep Trails (1918).
Traverser les paysages les plus grandioses, afin de recevoir « d’utiles leçons sur la sculpture terrestre », être un habitant de la Nature, en saisir la musicalité, la radicalité, la grammaire de ses herbes et rochers : les mots de la Nature sont « là pour nous rencontrer », là pour nous revigorer, et chez Muir le préparer à de nouvelles journées « de notes, de croquis et de toutes espèces d’escalades » ; journées « qui vous agrandissent la vie ». Dans la Nature, telle que célébrée par John Muir, tout est « stricte beauté », tout mérite la plus vive attention, et nous engage à accueillir la Nature dans ses formes multiples :
On trouve ici aussi des collines de cristaux étincelants, des collines de soufre, des collines de verre, des collines de cendre, des montagnes de tous styles architecturaux, boisées ou glacées, des montagnes couvertes de nectar à l’instar de l’Hymette des Grecs, des montagnes cuites à l’eau comme des pommes de terre et colorées comme un coucher de soleil.
Chez Muir, il n’est pas vraiment question d’une Nature romantique, plus juste serait de souligner sa profonde dévotion. Chez lui, la célébration est un haut lieu sans artefact, montagnes et collines de l’esprit, dès lors qu’il peut encore entendre toute chose se transmuer en amour. La Nature revêt plusieurs figures, plusieurs statuts, et parmi ses virtuosités décelées :
On peut considérer les vallées supérieures des rivières importantes comme des laboratoires et des cuisines, où, parmi des milliers de marmites et de cornues, il est possible de voir la Nature à l’œuvre dans ses fonctions de chimiste et maître queux – composant adroitement une variété infinie de ragoûts minéraux, rôtissant des montagnes entières, cuisant les roches les plus dures dans l’eau ou la vapeur jusqu’à en faire une pâte molle, une bouillie (jaune, brune, rouge, rose, mauve, gris ou blanc crème) ou la plus jolie boue du monde, et distillant les essences les plus subtiles.
La Nature-Maçon : « les pierres de cette maçonnerie divine », et puis aussi la Nature qui travaille
avec enthousiasme, comme ferait un homme – attiser ses forges volcaniques comme un forgeron ses charbons ; pousser les glaciers sur le paysage comme un charpentier ses guillaumes ; nettoyer, labourer, herser, irriguer, planter et semer comme un paysan ou un jardinier ; faire aussi bien le gros travail que l’ouvrage plus minutieux ; planter les séquoias, les pins, les églantiers, les marguerites ; s’intéresser aux pierres précieuses dont il remplit la plus petite fissure, la moindre cavité ; distiller des essences fines ; peindre comme un artiste les plantes, les coquillages, les nuages, les montagnes, la terre et le ciel tout entiers – œuvrant et agissant pour toujours plus de beauté. (chapitre 4, Le parc national de Yellowstone)
Lire John Muir c’est apprendre que la Connaissance participe à la survie de l’homme. De par sa fonction d’échanges, elle garantit le dialogue. Curiosités, observations, découvertes, autant de façons d’être et de se sentir habitant de la Nature. Tout au long de ce livre formé de 17 sections, comme autant d’excursions et « d’années d’étude parmi ces terres vierges et splendides », la Nature apparaît dans son unicité : « Sur toute cette étendue d’architecture démente – la capitale de la nature – il semble n’y avoir aucune habitation ordinaire ». (chapitre 9, Le Grand Canyon du Colorado)
Nulle part ailleurs sur ce continent, les merveilles de la géologie, archives du passé du monde, ne sont étalées plus ouvertement ni empilées à ce point. Le Canyon tout entier est une mine de fossiles, dans laquelle mille cinq cents mètres de strates horizontales sont offerts à la vue sur plus de deux mille cinq cents kilomètres carrés de parois ; mais sur le plateau adjacent, c’est une autre série de couches, deux fois plus épaisse, qui constitue une énorme bibliothèque géologique – une collection de livres de pierre couvrant mille cinq cents kilomètres d’étagères sur plusieurs niveaux, classés de façon très commode pour l’étudiant. Et quelles merveilles que les documents qui couvrent les pages – formes innombrables des flores et des faunes successives, magnifiquement illustrées de dessins en couleur, qui nous transportent au cœur de la vie d’un passé infiniment lointain ! Et à mesure que nous progressons dans l’étude de cette vie tellement ancienne, à la lumière de la vie chaude qui palpite autour de nous, nous enrichissons et nous grandissons la nôtre.
Après les splendeurs de la Yellowstone, Muir explore les glaciers et nous amène vers une « Vue rapprochée de la Grande Sierra ». Parmi les espèces animales que Muir aura rencontré, et dont il consacre plusieurs pages tout en louanges, quelle jubilation que le pétillant écureuil de Douglas (chapitre 7) : « C’est l’animal, sans exception, le plus sauvage que j’aie jamais vu – petit brandon crépitant de vie, qui se grise d’oxygène et des meilleures essences de la forêt ». Et parmi les oiseaux de montagne, qui feront la réjouissance de Muir, de belles pages consacrées au précieux et prodigieux Cincle d’Amérique, qui ne chante en chœur qu’avec les rivières, « amoureux des pentes rocheuses », et qui « vocalise en toute saison, même dans la tempête (…), et dont la particularité est que « Jamais rien de glacé ne sort de son gosier ardent ».
Au cours de ses multiples expéditions, Muir se fera témoin de tempêtes de neige, de violents orages, d’avalanches – « Ce vol dans une voie lactée de fleurs de neige fut le plus spirituel de tous les miens, et après bien des années, son souvenir suffit à me mettre en joie » – Depuis sa cabane proche de Sentinel Rock, il assiste à un tremblement de terre : « Les roulements issus des profondeurs étaient suivis généralement de subites poussées antagonistes horizontales venues du nord, auxquelles succédaient à la fois des mouvements de torsion et des chocs verticaux. A en juger par ses effets, ce séisme de Yosemite – ou d’Inyo, comme on l’appelle parfois – était faible, comparé à celui qui a donné naissance au système de grands éboulis du massif et qui a tant fait pour le paysage ». (chapitre 15, Les cours d’eau de Yosemite)
Parmi les chefs-d’œuvre des conifères, gros plan sur le vénérable séquoia géant de la Sierra Nevada, venu « de l’ancien temps des arbres », et dont la taille colossale peut atteindre quelques 100 m de haut : « l’arbre entier a la forme d’un fer de lance, et, (…) se montre aussi sensible au vent qu’une queue d’écureuil ». Leurs troncs, pouvant aller jusqu’à 3 m de diamètre, « ressemblent plus à des colonnes d’architecture artistement sculptés qu’à des troncs d’arbre ». Le séquoia « vous maintient à distance, ne fait nul cas de vous, ne s’adresse qu’aux vents, ne pense qu’au ciel et parait aussi insolite d’allure et de comportement au milieu des arbres du voisinage que le serait un mastodonte ou un mamouth laineux parmi de vulgaires ours et des loups ordinaires ». John Muir nous apprend que la mort d’un séquoia « résulte d’accidents et non pas, comme celle des animaux, de l’usure des organes (…) Rien (…) ne préjudicie au séquoia ». (chapitre 16, Les séquoias de Californie)
Dans notre actualité du 21ème siècle naissant, tandis que les forêts du monde sont soumises à la hache et au feu, que la menace des écosystèmes les plus divers se fait grandissante (déforestation de la forêt amazonienne pour la culture du soja), des recensements inquiétants indiquent, d’année en année, les méfaits d’une destruction programmée, dont on peut mesurer les déséquilibres climatiques de par le monde. A l’époque de J. Muir, gâchis et saccages sont perpétrés sous l’indifférence du gouvernement et le mépris des tueurs « qui répandent la mort et le chaos dans les jardins sauvages et les bois les plus magnifiques ». Les forêts sont loin d’être considérées comme dispensatrices de vie. Contre autant de destruction et de pillage, qui « s’étendent chaque jour plus vite et plus loin », Muir préconisait l’alternative de laisser la forêt à l’état naturel, ou alors que celle-ci soit « objet d’une judicieuse administration ». Mais comment protéger les arbres des imbéciles ? Le monde ne cesse de tourner « sous le couvert d’or et de fables », mais le monde ne peut revenir en arrière.
Il y aura une période d’indifférence de la part des riches, endormis par leur opulence, et des millions de laborieux, endormis par la pauvreté, dont la plupart n’ont jamais vu une forêt ; une période de protestation véhémente et d’objection de la part des pillards, qui ont autant d’audace et aussi peu de honte que Satan lui-même.
Une telle lecture nous soumet à nos résignations, ainsi qu’à la fragilité de ce qui n’est plus capable de dispenser la bonne joie ou d’assurer des façons enthousiastes d’être. Un tel livre nous invite à plus d’égards pour nos survies personnelles, au sein d’une humanité coupable d’aucune autocritique et d’aucune action massive face aux saccages consentis. Dégradations répétitives, quand la Nature s’offre à nous sans concept et sans profit. Lire John Muir, c’est aussi s’encourager à ne plus douter que ce qui doit être sauvé, doit l’être rapidement.
Dans Walden, H.D. Thoreau s’interroge : Ne suis-je pas en intelligence avec la terre ? Ne suis-je pas moi-même en partie feuilles et terreau végétal ?
Nathalie Riera Les Carnets d’eucharis
25 mars 2011
Quelques autres extraits :
(…) il ne m’était jamais venu à l’esprit que les arbres sont des voyageurs, au sens courant du terme. Leurs voyages sont nombreux quoique peu étendus, mais nos petits voyages à nous, en avant, en arrière, ne sont guère plus que les oscillations d’un arbre (…) (chapitre 12, Tempête dans la forêt)
Il n’y aurait donc pas lieu de s’étonner que ceux qui aiment leur pays et qui déplorent sa nudité hurlent aujourd’hui : « Sauvez ce qu’il reste encore des forêts ! » Aujourd’hui le défrichement est sûrement allé bien assez loin : le bois d’œuvre ne va pas tarder à se faire rare et il ne restera plus un bouquet d’arbres pour se reposer ou prier. Sans nouvelle réduction de sa superficie, le reliquat, protégé, fournira quantité de bois – une récolte pérenne pour tous ses usagers légitimes – et continuera à abriter les sources des rivières qui jaillissent des montagnes, à dispenser de l’eau d’irrigation aux vallées sèches du piémont, à empêcher les crues dévastatrices et à être à jamais et pour le monde entier une bénédiction. (chapitre 17, Les forêts américaines)
18:03 Publié dans ETATS-UNIS, John Muir, José Corti, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
26/02/2011
James Sacré, Mobile de camions couleurs (par Tristan Hordé)
Une lecture de Tristan Hordé
MOBILE DE CAMIONS COULEURS
Photographie de Michel Butor
James Sacré
(Editions Virgile, 2011)
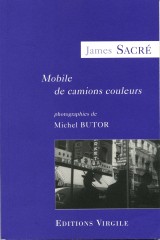 Les camions étaient présents dans un livre récent de James Sacré, America solitudes1, ils occupent toute la place dans ce livre de poèmes, accompagné de 9 photographies. Le titre rappelle sans ambiguïté le Mobile (Gallimard, 1962) de Michel Butor, construit à partir de ses séjours aux Etats-Unis où il enseignait la littérature ; les images remontent à la même époque (une dixième, Michel Butor à sa table de travail, est plus récente). Mais le titre évoque aussi le mouvement sans cesse changeant des camions et, en même temps, leur déplacement les uns par rapport aux autres comme s’ils étaient les énormes pièces d’une sculpture de Calder liées par les invisibles fils des routes. Enfin, comme le livre de Butor, Mobile de camions couleurs, est une construction complexe « où divers éléments de prosodie et de figurations bougent en lents mouvements de l’ensemble ».
Les camions étaient présents dans un livre récent de James Sacré, America solitudes1, ils occupent toute la place dans ce livre de poèmes, accompagné de 9 photographies. Le titre rappelle sans ambiguïté le Mobile (Gallimard, 1962) de Michel Butor, construit à partir de ses séjours aux Etats-Unis où il enseignait la littérature ; les images remontent à la même époque (une dixième, Michel Butor à sa table de travail, est plus récente). Mais le titre évoque aussi le mouvement sans cesse changeant des camions et, en même temps, leur déplacement les uns par rapport aux autres comme s’ils étaient les énormes pièces d’une sculpture de Calder liées par les invisibles fils des routes. Enfin, comme le livre de Butor, Mobile de camions couleurs, est une construction complexe « où divers éléments de prosodie et de figurations bougent en lents mouvements de l’ensemble ».
Les camions sont liés à l’histoire des Etats-Unis et leurs formes, leurs couleurs ont évolué, les machines anciennes abandonnées ou reléguées dans les régions les plus pauvres. Seul l’écrit garde trace (pour combien de temps ?) des temps enfouis de cet aspect de l’industrialisation de l’Amérique, « la voilà maintenant qui s’en va dans le souvenir qu’en garde ce livre [Mobile] de Michel Butor / Avec son histoire, un peu grandiloquente et vaguement ridicule ; / Pays qui oublie, qui oublie longtemps souvent ». Ce motif de l’oubli et, lié, celui des jours qui se ressemblent à se confondre, sont récurrents ; les camions passent sans cesse, comme à la fraîcheur du matin succède la chaleur du jour, comme « demain est un autre jour, le même ». Nous vivons dans un monde de la répétition, du même — avec des machines identiques à Kayenta, en Arizona, et à Cougou, en Vendée.
Ces camions très divers ressemblent à des êtres vivant hybrides, mi-ferrailles mi-animaux, chevaux de fer ou monstres bruyants mais bonasses d’une mythologie contemporaine, l’un « carré sous le coupe-vent bombé et les deux oreilles dégagées », l’autre « le museau jaune (barres rouges des pièces métalliques) comme pris dans un harnais ». Ce caractère subsiste quand ils sont immobiles, « au repos » dans des parkings « derrière un grillage haut », tout comme les bêtes d’un zoo. Ils paraissent parcourir le pays de manière autonome, tant les conducteurs sont invisibles dans leurs cabines. En outre, on ne sait pas vraiment, à les regarder passer ou quand on les croise, vers quel lieu ils se dirigent dans l’ « immense toile de parcours routiers », et peut-être roulent-ils sans fin, dans leur « vigueur aveugle », « pour que tiennent ensemble les villes du pays ».
Comment restituer quelque chose du mouvement incessant, de la profusion de formes et de couleurs ? James Sacré alterne une amorce de description des camions à l’arrêt, qu’il photographie (immobiles alors à jamais), et la saisie de leur extrême variété quand il les voit sur la route. Sur le parking, c’est surtout l’animalité, parfois un peu inquiétante, qui est mise en valeur ; la phrase alors peut s’étendre sur plusieurs vers (« Soit le long museau […], soit / Le groin carré […] / Quand […] / Où […] », ce qui est exclu quand il s’agit d’écrire à propos du passage des camions. Plus de verbes, de clausules, pas d’autres qualifications que celles relatives à la forme ou à la couleur :
Camions gris à double caisse blanche — rouge terne à caisse blanche — noir, caisse bleu clair — noir renfrogné, la caisse blanche — jaune cru à caisse blanche — blanc à caisse blanche — gris-vert à caisse blanche et lettres vert clair — noir à caisse blanche —gris-bleu costaud, caisse blanche — bleu-vert, caisse blanche ligne et lettres rouges — bleu clair, la caisse blanche et des lettres rouges — rouge à caisse blanche, lettres rouges —blanc à caisse blanche — etc.
Une autre alternance est lisible. Parmi les pages consacrées aux camions s’insèrent des poèmes autour de la vie quotidienne du narrateur, ou des chauffeurs : ces derniers non pas comme conducteurs des machines mais « comme autant d’artisans ou de pêcheurs du dimanche », parfois sans plus de lien avec leur travail, comme celui-ci endormi sur une pelouse. C’est aussi le monde du travail qui apparaît, avec la figure de l’Indien qui pourrait être contraint de quitter sa terre pour devenir routier, ou avec un lieu, Gallup, « Où le commerce et la misère, et le simple travail quotidien / Font se rencontrer […] toutes sortes de gens. » Ce qui est également visibles sur la caisse des camions, ce sont les noms des compagnies qui les possèdent ; c’est là une autre variation notée, « une troisième ligne rythmique » à côté de celle des couleurs et du mouvement bruyant. Un autre rythme encore est donné par le silence et la quasi immobilité du paysage.
Une nouvelle pièce du mobile oppose la course des camions aux États-Unis, dont on ne sait trop jusqu’où ils vont — à l’instar des pionniers du XIXe siècle construisant continûment une nouvelle frontière — à celle de camions de taille plus modeste, « gros jouets propres », sur une autoroute en France, qui font « le tour d’un petit pays ». La dernière pièce, à mes yeux, de ces constructions de rythmes est le jeu entre les photographies de Michel Butor et les poèmes : deux d’entre elles (l’entrée d’un parking souterrain, un homme endormi sur une pelouse) peuvent être associés aux camions, les autres sont relatives à la vie citadine quotidienne : la proportion est inversée dans le texte. Il est sans doute d’autres à lire ; il est certain que l’on ne quitte pas volontiers ce "mobile", singulier non par certains motifs récurrents dans l’œuvre mais par sa construction.
Tristan Hordé
(pour les Carnets d’eucharis)
21:54 Publié dans James Sacré, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
14/02/2011
Quadratures, Dominique Buisset - (par Tristan Hordé)
Une lecture de Tristan Hordé
QUADRATURES
Postface de Jacques Roubaud
Dominique Buisset
(Editions NOUS, 2010)
 Il faut répéter que la poésie n’est pas une, que « La poésie naît de ce qui, sans elle, demeurerait à jamais sans nom. »1 Elle peut donc encore être en vers comptés et rimés aujourd’hui, sauf à éliminer des œuvres aussi différentes que celles de Jacques Réda et Christian Prigent. Comme eux, Dominique Buisset choisit des formes dites traditionnelles et prouve avec une allégresse communicative qu’elles n’ont pas fini d’être explorées. Rien de contourné dans ces poèmes courts, écrits dans des mètres (7, 8, 9, 10, 11 syllabes) et des formes (septain, huitain, neuvain, dizain, onzain) classiques. Cependant, une fois que le lecteur a reconnu le cadre, il comprend vite que l’auteur en joue en tous sens : développant un art d’écrire — une poétique — et, dans le même temps, revisitant les motifs du lyrisme — le temps, la mort, l’oubli —, Dominique Buisset parcourt tous les schémas de rime, multiplie les combinaisons phoniques et fait partager le plaisir de manipuler des structures numériques.
Il faut répéter que la poésie n’est pas une, que « La poésie naît de ce qui, sans elle, demeurerait à jamais sans nom. »1 Elle peut donc encore être en vers comptés et rimés aujourd’hui, sauf à éliminer des œuvres aussi différentes que celles de Jacques Réda et Christian Prigent. Comme eux, Dominique Buisset choisit des formes dites traditionnelles et prouve avec une allégresse communicative qu’elles n’ont pas fini d’être explorées. Rien de contourné dans ces poèmes courts, écrits dans des mètres (7, 8, 9, 10, 11 syllabes) et des formes (septain, huitain, neuvain, dizain, onzain) classiques. Cependant, une fois que le lecteur a reconnu le cadre, il comprend vite que l’auteur en joue en tous sens : développant un art d’écrire — une poétique — et, dans le même temps, revisitant les motifs du lyrisme — le temps, la mort, l’oubli —, Dominique Buisset parcourt tous les schémas de rime, multiplie les combinaisons phoniques et fait partager le plaisir de manipuler des structures numériques.
Comment débuter un livre ? En disant qu’il commence et qu’il vient après d’autres. Le premier vers du livre, « Il est temps de reprendre le chant », ouvre un huitain mais, comme s’il fallait s’échauffer, le système de rimes est défaillant (a b c d e e e a) — ensuite, quand un poème ne sera pas régulièrement rimé, le lecteur inclinera à en chercher la raison. Quel parti est pris ? « la parole a besoin d’ordre », et cet ordre s’établit, par exemple, par le retour du même — nombre de vers égal au nombre de syllabes, rimes ; par extension, c’est le réel qui perd quelque peu son opacité :
[…] le poème est un rêve du nombre,
dans le désordre qui met la césure,
nomme et compte et divise le réel
pour éviter qu’il soit un chaos sombre
Sans doute ne prête-t-on pas attention à cette mise en ordre de la langue, du réel, « poussée des pages s’amoncelle / dans tous les sens apparemment ». Apparemment : bien des indices ralentissent ou interrompent le lecteur, notamment les rimes. Ici, un dizain à rime unique (an, en), là des rimes riches (consentement / contentement ; l’éclosion des mots / les cloisons d’émaux ; etc.), qui couvrent tout un hémistiche : et nous par le dedans / et nous parle de dents ; néant toussa / nez en tout ça ; rêve d’une ombre / rêve d’une ombre ; etc. L’attention se porte sur tous les jeux avec les sons et les repère ailleurs que dans les rimes : « le vent violent voyeur à l’œil / violet » ; adieu mers vaches merveilles ; apeurés tels des lapereaux ; etc. Comme le montrent des exemples ci-dessus, Dominique Buisset utilise pour les transformations phoniques un procédé cher à Raymond Roussel, jusqu’à agir sur un vers entier : dans un dizain, au vers 1 « Tout doit disparaître ! En mille, en cent ans… » répond le dernier vers, « tout dix doit paraître, cela s’entend. »
Jacques Roubaud relève dans la postface que « Quadratures suppose des tonnes de lecture, des années de travail ». Il est bon d’y insister : aucune poésie n’existe sans travail dans la langue : « Le faux n’est pas rien, l’imaginaire / est une vieille astuce et la ruse /du réel, en quoi rien ne se crée /mais tout se produit. Et la matière / est première » (souligné par moi). On le voit dans la variété des schémas de rimes, dans la reprise de rimes de la Délie de Scève (hommage annoncé par l’auteur) ou d’un thème né à la même époque (la "belle matineuse"), avec son vocabulaire. La mise en ordre, toujours rigoureuse, n’est pas à tout coup exhibée. Dans la première partie du livre (qui en compte six), 21 poèmes sont organisés en deux groupes de 10, le onzième poème, onzain de 11 syllabes, sert de pivot et suggère la règle choisie. En effet, il n’est pas rimé mais deux fins de vers (le rend / rends-le), la construction du vers 9 (nous, et sa piqûre dont s’ourlent de nous) (souligné par moi), la relation entre les premier et dernier vers (Universelle maison de l’équivoque / dans l’équivoque biais de l’universel) orientent vers une structure en palindrome. En effet, aux dix premiers poèmes (8-7-8-7-8-9-8-10-9-10) répondent en miroir les dix après le onzième (10-9-10-8-9-8-7-8-7-8) ; on peut d’ailleurs voir que la construction est plus complexe. Pour le bonheur du lecteur, la règle d’organisation peut être dite ; la quatrième partie est titrée "Six cents syllabes à circonscrire Une ballade pour rire" et propose la suite 3 dizains (300 syllabes) - une ballade - 3 dizains (à nouveau 300 syllabes). Le lecteur découvre d’autres règles de construction non explicitées et peut établir des liens avec, notamment, les poètes désignés (souvent péjorativement) par "Grands Rhétoriqueurs" et ceux de la Renaissance.2
Mais à quoi bon cette vertigineuse mise en ordre ? Dominique Buisset répond à sa manière :
Couronnant le vide souverain
Le poème est le mètre de rien
De son compte il enchante les leurres
Du silence sans fin qu’il emplit
En son lieu il arpente le champ
Des lois propres de sa gravité
Il est de nature sans objet
Car sa course exactement réglée
N’a ni sens ni centre ni sujet.
Ce qui est dit ici, on n’en sera pas surpris, est inscrit dans la forme : l’absence de rimes des vers 3, 4 et 5 attirent l’attention (a a b c d e f e f), comme les rimes souverain / rien, gravité / réglée, objet/ sujet. Forme et fond inséparables. Cependant, on laisserait beaucoup de côté si l’on ne s’attachait qu’à la très savante virtuosité, qu’à la connaissance approfondie de la poésie du passé — ce qui ne serait pas si mal ! Mais ce serait dire aussi que les "quadratures" ne sont que des ornements. Il faut relire Dominique Buisset sur ces points et réfléchir à une affirmation sur ce qu’est le poème : « l’inutile est là / seul qui donne au temps la tenue / sans laquelle il n’a pas de cesse ». Organiser strictement le flux des mots, construire un ensemble de poèmes (et non pas les juxtaposer), c’est refuser la "fuite" du temps, ou plutôt inscrire quelque chose qui peut résister un peu dans le temps, laisser une empreinte — sans l’illusion d’une fausse éternité :
envolés drames, comédies, renoms,
iambe ou trochée, poésie trépassée !
Satire, épopée, travaux de Romains,
œuvres, formes, tout a suivi les mains…
tout repose au fond du temps, in pace.
Il y a aussi dans Quadratures le sentiment fort de la solitude de chacun (De personne rien ne nous délivre / Sinon mourir) et du vide des jours, quoi qu’on fasse, sans autre perspective que la mort (Quelle mort parle en nous plus haut /que le désir). Ces motifs sont des lieux communs du lyrisme, certes. La poésie de Dominique Buisset, cependant, leur donne de la fraicheur grâce au travail minutieux et savant sur la forme : l’élégie existe, mais l’auteur introduit une distance vis-à-vis du discours, ne serait-ce que pour rappeler que le temps, la mort ne sont pas que des mots :
Non il n’y a rien à dire
L’écriture c’est la règle
Elle fait taire le pire
À coup d’arbitraire espiègle.
© Tristan Hordé, Carnets d’eucharis (février 2011)
■ AUTRES SITES A CONSULTER :
Recension d’Angèle Paoli
Extraits de Quadrature
Fiche de l’auteur sur le site CipMarseille
13:49 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
13/01/2011
Claude Dourguin, Chemins et Routes (une lecture de Tristan Hordé)
Une lecture de Tristan Hordé
©
Chemins et routes
Claude Dourguin
(Editions Isolato, 2010)
Les voyages de Claude Dourguin naissent d’une exigence, tout se passe comme s’il lui devenait impossible de continuer à rester immobile, qu’il lui fallait prendre le bâton et marcher pour savoir ce qu’est respirer, regarder, découvrir, apprendre — vivre. Cette manière de se connaître, d’éprouver le vif des choses apparaît peut-être plus dans Chemins et routes que dans ses autres livres (1), parce qu’il s’agit ici de l’expérience de multiples parcours.
La plénitude ressentie par le seul fait de quitter les habitudes, par le contact physique avec le sol, s’exprime dans les premières phrases et c’est ce bonheur d’être qui est exploré ensuite, série de variations dans une prose-poésie reconnaissable entre toutes. Se séparer donc de ce qui abrite, protège, cela se fait jour encore pas venu (« Départ dans le matin frais » est le début du livre), dans ces moments incertains, aux « adieux sans mots », pour retrouver un corps, « le réel après la trêve des songes ». Rapidement, « le pas se fait au sentier, au chemin », et c’est bientôt « la marche heureuse », « l’accord trouvé », la « continuité vive », la lumière détache les contours, le marcheur voit maintenant arbres et ruisseaux : « le monde s’ouvre, donné », vraie « terre première ».
Il n’est pas besoin d’être un marcheur pour apprécier l’exaltation de Claude Dourguin ; qui n’a pas, ne serait-ce que dans l’enfance, imaginé ce qui se trouvait au-delà de l’horizon, « ligne de promesses : là-bas, d’autres terres, d’autres champs, d’autres monts, différents, toujours renouvelés », « un monde toujours recommencé » ? C’est cette merveille (qu’y a-t-il derrière le miroir ?) que propose Chemins et routes. Avant d’atteindre l’horizon, dès qu’un village est quitté, hors du tumulte, Claude Dourguin est enveloppée dans une nature toujours accueillante, généreuse, la nature telle qu’elle apparaissait à Rousseau. Ainsi, figuiers et vignes abandonnés par la culture continuent à produire et le marcheur réinvente les gestes d’un Robinson : « Je m’arrêtais, mangeais ces fruits offerts, présents du lieu dont, ainsi, j’assimilais les vertus. » Ailleurs, c’est l’eau d’un ruisselet qui est donnée, « bonheur d’une générosité inadressée ». On verra là non pas tant une forme de panthéisme qu’un amour profond, raisonné pour cette manière de vivre, si peu de temps qu’on puisse le faire, à l’écart du tumulte, en suivant ces chemins qui gardent à qui veut les lire les traces d’une histoire séculaire : « Je les vois, tracés qui ne blessent ni ne segmentent mais relient, pas de l’homme ou de la bête et terre, cultures et demeures, cyprès riverains et ciel. Chemins religieux, en effet, si, foncièrement, on ne les éprouvait païens. »
Les chemins, bien plus que les autoroutes d’aujourd’hui, avaient une fonction de lien ; il y eut une longue période où « on allait, périple rude, surprises et peurs, mais prémunis de l’errance. Le chemin accompagnait, donnait un destin. » Claude Dourguin rappelle que les routes anciennes étaient parcourues sans cesse par les marchands, les soldats, les étudiants, les colporteurs, les ouvriers, etc., vivantes de toute une vie « bigarrée, pleine de bruits et d’odeurs ». On lit encore l’épaisseur du temps dans les noms de lieux, énumérés pour tout ce qu’ils portent du passé, ceux par exemple de l’Italie, abondants ici, ou pour le plaisir de les suivre inscrits sur la carte le long d’un sentier, « Bosch Tens, Plan Vest, Löbbia, Cadrin, Mungat, Maroz, Dent…, petites énigmes locales qui entrainent le songe dans leur récitatif mystérieux ».
Claude Dourguin vit aussi les paysages à partir de la littérature et de la peinture, évoquant les voyageurs du XIXe siècle, de Chateaubriand à George Sand ou Mérimée, Schiller, Heine…, suivant Hölderlin et Nerval, Thoreau et Montaigne, ou un personnage de Stifter. Dans un paysage de neige, l’eau sous la glace est un « jardin d’Eden, un fond de tableau de Bellini » ; ici, ce sont les campagnes des Très riches heures du duc de Berry, là des teintes pour un Douanier Rousseau, des formes admirées chez Memling ou Carpaccio, des lumières du Lorrain, "La construction d’un grand chemin" d’Horace Vernet, ou encore Poussin, Dürer, Thomas Jones…
Ce qui est esquissé dans Chemins et routes, c’est un projet rêvé dont le livre tel qu’il est, donne une idée : projet « d’un livre des chemins, catalogue et dictionnaire à la fois, qui évoquerait, recenserait sans du tout prétendre faire œuvre savante, les figures diverses des chemins, leurs histoires, leurs particularités géographiques. Ou bien un traité exact et poétique, recueil des singularités des reliefs et des terres, provinces et leurs façons de dire, de cultiver, de mener commerce, bêtes poussées devant soi […] ». De ce projet borgésien reste pour le lecteur un beau labyrinthe où il peut errer, découvrir sans cesse et des sorties et des possibilités de se perdre ; il saura aussi qu’à emprunter les chemins, « au plaisir physique d’arpenter, à la satisfaction du regard se mêle le bonheur de découvrir, d’apprendre, de comprendre, de nouer un lien intime avec une contrée et sa terre », il souhaitera peut-être avec la marche voir le monde devant lui, comme le faisait Walt Whitman cité à la fin du livre.
(1) Voir les derniers publiés, en 2008 chez le même éditeur, Les nuits vagabondes et Laponia.
12:38 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
06/01/2011
Frans Krajcberg par Claude Darras
■■■
Art et nature
Il était une fois… Frans Krajcberg

Frans Krajcberg dans l'atelier de la nature amazonienne au milieu des racines de palétuviers, son "matériau" de prédilection
De toute évidence, regardons autour de nous. Il est clair que nous avons perdu le sens de la gratuité de la nature, c’est-à-dire de cette biodiversité qui est sans prix, et qui pourtant vaut tout l’or du monde. Il est tout aussi évident que nous ne croyons plus à la force de l’art. Ce que nous appelons « art » aujourd’hui ? L’exploitation commerciale de créations souvent privée de signification et soumise à la boussole d’enchères parfois aberrantes. Ce n’est pas de cela que nos enfants ont besoin. Mais de rencontres véritables avec des œuvres et des créateurs authentiques qui vont quelque peu changer leur vie. Aussi sachons gré à Pascale Lismonde, journaliste et anciennement productrice à la station radiophonique France-Culture, de multiplier les initiatives visant à stimuler parmi nos jeunes générations le désir pour les choses de l’art et de l’écologie.

Paru dans l’attractive collection Giboulées de Gallimard Jeunesse, « L’Art révolté » raconte l’engagement du sculpteur Frans Krajcberg, 89 ans, au cœur de la forêt amazonienne. Unique survivant d’une famille juive polonaise persécutée dans son propre pays avant d’être exterminée dans les camps nazis, cet ingénieur est le mieux placé pour professer l’humanisme comme la seule idéologie susceptible d’empêcher le retour des tragédies du XXe siècle. Converti aux arts plastiques, il reçoit le soutien d’amis peintres à Paris (Fernand Léger et Marc Chagall) et à São Paulo (Lasar Segall) avant de découvrir, en 1947, une raison majeure de peindre et de sculpter au cœur de l’Amazonie au milieu des caboclos, ces Indiens métis qui vivent sur les rives du grand fleuve auquel les légendaires Amazones ont donné leur nom. En fait, face à la tragique déforestation de la région, il oppose une révolte fondée sur le postulat que l’homme a le devoir de jardiner la nature, d’en être le gardien responsable. Il soutient qu’une forêt sans oiseaux n’est plus une vraie forêt et qu’un arbre commence de mourir le jour où il cesse de chanter. Il recueille alors les bois calcinés -racines de palétuviers, lianes et troncs de palmiers. Tantôt il les sculpte, tantôt il les enduit de goudron et il les peint au moyen de pigments issus des minerais et bois primitifs. Précurseur des Nouveaux Réalistes, Pierre Restany lui rend visite en 1978. Confronté à son tour aux exactions commises au détriment des Amérindiens et témoin des incendies de forêts qui mutilent cette portion de paradis terrestre, le critique d’art lance un cri d’alarme à travers un Manifeste du naturalisme intégral.
À Nova Viçosa où il vit, dans l’état brésilien de Bahia, Frans Krajcberg a édifié un musée écologique qui abrite de surcroît une fondation Art & Nature. En 2003, au sein du musée Montparnasse, à Paris (XVe), a été inauguré l’Espace qui porte son nom et rassemble les peintures, empreintes, sculptures et photographies que l’artiste a léguées à la ville de Paris le 15 mai 2002.
L’exemplarité pédagogique de l’ouvrage mérite d’être soulignée ; elle appellerait à en prolonger la série (animée chez Gallimard par Colline Faure-Poirée). Quant à l’auteur, elle sait bien que rien n’est plus compliqué que la simplicité, rien ne se travaille davantage que la spontanéité, rien ne s’obtient plus difficilement que le naturel quand on s’adresse aux enfants. Il faut une sacrée maîtrise du métier d’écrire afin de parvenir à cette limpidité d’une histoire d’amour, celle d’un artiste fou de la canopée.
© Claude Darras, Les Carnets d’eucharis, janvier 2011

Chez lui, à Nova Viçosa, dans l'état de Bahia, Frans Krajcberg se bâtit une maison-atelier sur un arbre
© (Photos : Pascale Lismonde)
22:58 Publié dans Claude Darras, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Eté II, Bernard Chambaz (une lecture de Pascal Boulanger)
NOTE DE LECTURE
(Pascal Boulanger)
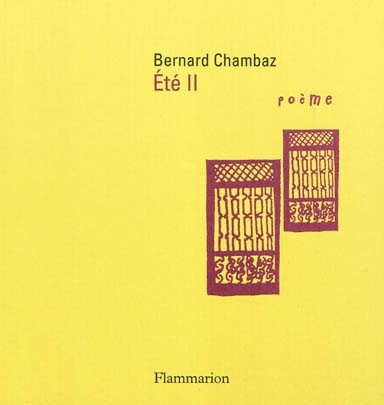
Bernard Chambaz : Eté II
Ed. Flammarion, 2010
Ce volume annonce une reprise au chant VI d’une investigation minutieuse qui a pour point de départ tragique la mort d’un fils adolescent. Ce fils – Martin – devient en poème le m-pêcheur, le poisson volant.
Le poisson volant vient de Platon / il brille mais il n’a pas beaucoup de temps pour briller.
Il faut entendre ce titre comme un retour, jamais oublié, à l’été accidentel mais aussi à ce qui a été, une fois pour toutes, lancé dans la vie, dans la litanie des jours et des nuits.
Soutenir cette douleur, dans le déploiement et le froissement du temps, ne lève aucune fixation, n’entraîne aucune consolation. C’est la mort / qui l’aura emporté / sur les mots.
Elle dévoile, par contre, l’excès en chacun de nous, cet abime d’existence infinie, cet amour long, cet amour à vif quand le courage consiste moins à combattre qu’à endurer. La répétition du deuil, dans le temps soudain suspendu, impose soit le silence absolu, soit le discours extensif proche des choses et des êtres et qui, sans masquer la détresse, la marque au contraire doublement.
Les poèmes de Bernard Chambaz, en prose ou versifiés, amples ou resserrés sont des décantations de ce qui agite et obsède. Ils passent de la perfection du monde à son imperfection, ils croisent une foule d’écrivains et de penseurs : Pétrarque, Descartes, Hegel, le tombeau d’Anatole de Mallarmé, Pound… Ils traversent des villes et des ciels, relancent des tensions, des hantises, creusent l’absence tout en évoquant la volupté de l’instant et tiennent tête à l’esprit et au cœur à jamais endeuillés. Ils rendent aussi hommage à la femme aimée, à celle qui n’écrit qu’en pensée, qu’en secret à son fils perdu. Et nous, lecteurs plus ou moins malheureux, prenons appui sur ces dix profonds chants au savoir fondamental pour saluer – malgré tout – le simple fait d’exister.
© Pascal Boulanger, Carnets d’eucharis, janvier 2011
15:48 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
02/01/2011
Cole Swensen "L'âge de verre" : une lecture critique de Tristan Hordé
Une lecture de Tristan Hordé
©
L’AGE DE VERRE – Cole Swensen
(Editions José Corti, 2010)
Maïtryi et Nicolas Pesquès ont déjà traduit en 2007, pour le même éditeur, Si riche heure, construit à partir d'un livre de piété, les Très Riches Heures du duc de Berry. Cette fois, L'Âge de verre a pour point de départ des tableaux de Pierre Bonnard et, plus particulièrement, ceux où apparaît une fenêtre. Le livre de Cole Swensen introduit, à la suite de données informatives sur le peintre (« Pierre Bonnard, 1867-1947, [...] » ou d'une amorce d'analyse (« L'œuvre de Bonnard demande implicitement ce que c'est que voir et ce que c'est que voir à travers. Nous songeons aux disputes [...] », des éléments d'un tout autre ordre, des vers coupés [1] et, ici et là, des pronoms (je, tu, nous, et les possessifs correspondants) qui modifient le propos. Ce qui s'annonçait comme une méditation poétique à propos des fenêtres dans la peinture de Bonnard, avec des digressions notamment sur Vuillard, Caillebotte et des écrivains, est un ensemble de variations autour du verre, de la transparence, du regard et de la réflexion.
D'emblée le nom de Bonnard renvoie à des tableaux que l'on peut regarder, quelques titres sont d'ailleurs donnés, mais en même temps est évoqué le temps du narrateur : « Comme beaucoup, Bonnard repeignait / alors / ma fenêtre ». Parallèlement, interviennent de minuscules débuts de récits, de scènes dans lesquels les fenêtres, les vitres, les glaces jouent un rôle ; fragments d'histoires, points de vue sur les choses du monde, analogues au "elle" apparu l'espace d'une page qui « révèle / un si multiple / visage dans la glace ». À partir d'un tableau des figures naissent qui débordent, comme s'il offrait réellement une vue sur les choses, « un chien dans la cour, et quelqu'un qui s'en va ou qui vient », comme « dans un seul grain tient une plante ». Par ailleurs, par le seul changement d'un temps verbal dans la phrase, Cole Swensen passe de la description "objective" d'un tableau ("Nu dans un intérieur", c. 1935) à l'imaginaire, la toile étant à l'origine d'un récit qui pourrait être continué, les deux points (:) marquant la frontière entre le texte sur la représentation du réel et celui qui en dérive, dans « Elle se penche pour toucher quelque chose : et puis elle se redressera pour regarder dehors, [...] ».
Que voit-on depuis la fenêtre ? Dans un tableau de Caillebotte, un homme regarde la rue — voyeur —, alors que personne n'est présent devant les fenêtres chez Bonnard ; qui regarde ? Question de la subjectivité : ici un corps qui l'incarne, là une fenêtre « devient une partie du corps, sans suture avec la continuité du monde ». Les vitres anciennes contenaient un autre monde, minuscules scories dans la fabrication qui pouvaient issues du corps, « parfois une larme, parfois une petite bulle d'air », perçues seulement quand l'œil oubliait ce qui est derrière la vitre alors limite du regard ; monde disparu au profit, au-delà du seuil, du paysage ou de la rue.
L'ouverture vers l'extérieur est une échappée dans un imaginaire maritime, « La fenêtre, entrouverte, soudain s'offre à la brise et tu vois son visage qui vogue au loin. » Dans un autre poème, l'allusion à la mer est plus claire et s'opère une métamorphose ; ce ne sont plus un paysage, les gens de la rue qui sont visibles, mais la totalité de ce que le regard pourrait embrasser jusqu'à perdre tout contour :
mais tel un rivage
la fenêtre est infinie, son périmètre
augmentant sans cesse sans jamais dépasser son cadre
n'est rien d'autre que la vue s'outrepassant.
Cette relation de la fenêtre et de la mer, de l'eau, est récurrente dans L'Âge de verre et contribue à unifier souterrainement l'ensemble. Analysant, par exemple, la composition des tableaux de Bonnard après avoir évoqué la vogue du "Monde Flottant" japonais à la fin du XIXe siècle, Cole Swensen note que chez lui le monde est comme « un plan d'eau sur lequel glisse, apothicaire-vite, le regard ». Ou encore : le Palais de Cristal, à l'exposition de 1851, était d'une telle étendue que ses visiteurs avaient l'illusion de « se croire sous les flots de quelques fabuleuse rivière ». Dans "Les fenêtres" de Mallarmé, est relevé « galères d'or, belles comme des cygnes ». Etc.
La fenêtre éclairée, vue de l'extérieur, se transforme en pièce d'un théâtre d'ombres, les personnes se meuvent sans épaisseur, passant et repassant comme s'ils étaient peints sur une plaque, devenant alors les personnages d'une histoire qui se dissipera quand les lumières seront éteintes. La fenêtre permet ainsi de réinventer la lanterne magique — « Le premier film fut une fenêtre » ; dans le premier film des frères Lumière, rappelle Cole Swensen, le spectateur voit une femme « le visage collé à la vitre, immobile », qui le regarde.
Cole Swensen mêle les espaces et les temps, le réel et sa représentation, construisant ainsi ce qui n'appartient qu'à l'écriture. Les lecteurs sont convoqués ("vous") pour voir Bonnard qui, la nuit, « regarde l'intérieur d'une pièce jaune, se demandant ce qui est dû à la lumière et ce qui est dû à la peinture ». La suite : c'est Marthe (l'épouse et le modèle de Bonnard) cette fois qui, le lendemain, regarde à l'intérieur, elle « vient s'appuyer à la fenêtre et t'appelle // toi qui regardes le tableau dans un musée ». Mondes mêlés par la grâce des mots, et qui le resteront ; ce n'est pas hasard si le livre s'achève sur « Ce qu'il y a de mieux dans les musées ce sont les fenêtres » — dit-il [Bonnard] en regardant la Seine depuis le Louvre, juin 1946.
[1] J’emprunte le terme à Nicolas Pesquès qui, en 4ème de couverture, définit avec concision l’entrelacement des propos dans L'Âge de verre.
© Tristan Hordé, Carnets d’eucharis n°25 (Spécial fin d’année 2010)
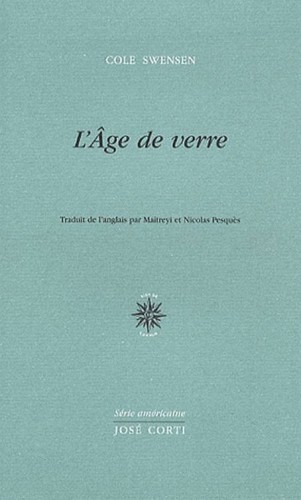
Traduit de l'anglais par Maïtreyi et Nicolas Pesquès
Série américaine
José Corti, 2010
■ Site des Editions José Corti : http://www.jose-corti.fr/titresetrangers/Agedeverre.html
16:17 Publié dans Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
23/12/2010
Les Signes-Paysages d’Olivier Debré par Claude Darras
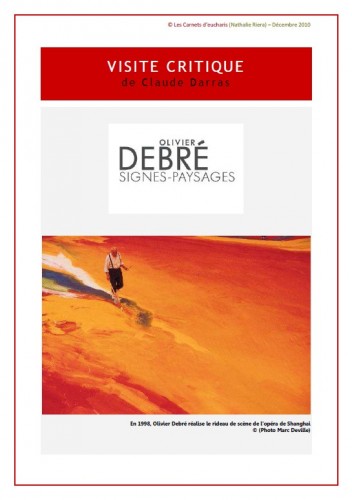
À Martigues, le musée Félix Ziem accueille les Signes-Paysages d’Olivier Debré
par Claude Darras, critique d’art et de littérature

Dossier à télécharger
les Signes-Paysages d’Olivier Debré par Claude Darras_les carnets d'eucharis_décembre 2010.pdf
16:47 Publié dans Claude Darras, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
19/12/2010
Nathalie Riera, Puisque Beauté il y a (une lecture de Nathalie Cousin)
***
Recension Nathalie Cousin
sur le site L’Ouvre-Boîte
Dehors, il neige et je pense à ces mots de Nathalie Riera « une page blanche comme un parterre de neige ». Serait-ce un signe ou une incitation ?
Depuis que j’ai entendu Nathalie Riera lire Puisque Beauté il y a le 28 novembre dernier à la Halle Saint-Pierre à Paris, je lis et relis son recueil, sa voix douce et sereine encore dans l’oreille. Ce qu’elle dit m’interpelle. J’ai envie de lire à mon tour ses textes, d’en parler, et pour cela peut-être de commencer par décrypter deux de ses questions : « Mais qu’aurais-tu à me dire poète ? et quel besoin de te lire ? »
Qu’a donc à nous dire Nathalie Riera dans les deux « Carnets de campagne » qui composent ce recueil : « Elegeia et autres chants de soleil » puis « La rosée sur les ronces l’enfance » ? Lire la suite ICI
11:27 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
04/12/2010
Franck Pavloff "Pondichéry-Goa" par Claude Darras
LECTURE CRITIQUE
de Claude Darras
« Pondichéry-Goa »
de Franck Pavloff
l’éloge de la désinvolture

L’auteur de « Pondichéry-Goa » prévient d’emblée : « Écrivain des champs outillé d’un carnet à spirale et d’un appareil photo, je vais éplucher les strates des sociétés de Pondichéry et de Goa où l’Occident chrétien a fait ses premières incursions en Inde islamo-hindouiste. Je vais relever couche par couche l’alliage des civilisations et des religions qui se sont affrontées sans parvenir à s’éliminer ». Est-il parvenu à ses fins ? Sans aucun doute. Il a même débordé ses objectifs de conjuguer l’Inde à tous les temps du passé et de la nostalgie. Tout à la fois livre d’histoire(s) -la grande et les petites-, journal intime et carnet de voyages, l’ouvrage, assurément inclassable, révèle de quelles façons la mémoire des vieux comptoirs portugais, hollandais, français, danois et anglais survit de nos jours dans la vie quotidienne des Indiens d’origine et d’adoption, à travers les rites religieux, les habitudes alimentaires, les mœurs politiques et festives, l’architecture de l’habitat et l’urbanisme des cités. Nez aux vents de la mer d’Oman au guidon d’une Vespa 125 ou secoué à l’arrière d’un rickshaw le long de la côte de la baie de Bengale, il photographie les liens inspirés et consigne les paroles de ses interlocuteurs avec la minutie d’un commissaire-priseur.
Il excelle à décrire « les tapis-brosses des rizières éclatantes » et les « cascades de bougainvilliers qui donnent aux demeures l’impression d’être découpées dans du papier crépon ». Il s’amuse à qualifier un de ses Ganesh fétiche au « regard éthéré de fumeur de shit au ventre rebondi en plâtre rose ». Il s’incline devant les rites des hindous « assis en lotus attendant que la roue du dharma les remette dans le cycle des réincarnations ». Il voue une tendresse émue à Pier Paolo Pasolini dont le récit « l’Odeur de l’Inde » traduit une connaissance intime du pays parcouru par le poète et cinéaste en 1961 dans les pas d’Alberto Moravia et d’Elsa Morante. Il chahute l’Alliance française de n’avoir pas su défendre le verbe de Molière et la syntaxe de Racine face au tamoul et à l’anglais. Il aime à rappeler que « Lorient où Colbert installa les entrepôts et les magasins de la Compagnie française des Indes orientales s’appelait alors l’Orient dont il ne reste que le vieux phare d’où on guettait le retour des vaisseaux et le quai des Indes où s’amarraient les navires marchands »…
C’est fou la désinvolture avec laquelle Franck Pavloff écrit. Il semble qu’il ne se préoccupe de rien et que les mots tombent sur la page dociles, amers, doux, épicés, brûlants, innocents et tranchants. Une ponctuation aléatoire désordonne les mots et les phrases, métamorphosés par la confidence, défigurés par la diatribe, sauvés par la spontanéité. La phrase s’en va à l’aventure, se gonfle, devient bulle, crève, s’affole, n’en finit pas de gronder ; elle clame, soupire, s’étire, murmure. Cendrars ? Faulkner ? Lowry ? Un barbare en Asie d’Henri Michaux (le littérateur et peintre belge est le dédicataire de l’ouvrage) ? Il y a assurément un peu et rien de ceux-là dans son livre, mais quelque chose de neuf, d’élégant, de jamais entendu, semble-t-il, qui fait que cela mérite d’être lu, d’autant plus que c’est preste et nerveux, mené au fouet et haletant.
Né à Nîmes en 1940, éducateur de rue devenu psychologue, cet écrivain-là n’est pas collet monté pour deux sous. Il est jubilant et pudique. À la fin de son propos, il vide son sac comme un enfant qui en a marre de garder ses billes pour lui tout seul. Il s’avoue fils des Balkans, ses ascendants ont partie liée avec les nobles rajpoutes d’Inde du Nord (du côté de cousins roms) et les tziganes bulgares de Pazardjick (où est né son père). C’est un journal intime, vous disais-je, ainsi qu’un livre d’histoire(s) et un carnet de voyages où l’esprit d’enfance et la désinvolture affleurent comme sous une baguette de sourcier l’eau d’une veine peut devenir torrent.
© Claude Darras, Les Carnets d’eucharis, décembre 2010
Pondichéry-Goa, texte et photos de Franck Pavloff (éditions Carnets Nord, 2010, 248 pages, 17 €). La photo de couverture montre un bel échantillonnage de tissus colorés dans un magasin tamoul de Pondichéry !
Lire aussi du même auteur « Matin brun » (Cheyne éditeur, 1998, 12 pages, 1 €), « le Pont de Ran-Mositar » (le Livre de Poche, 2007, 224 pages, 5,5 €) et « Le Grand Exil » (Albin Michel, 2009, 250 pages, 16 €).

© Photo : Franck Pavloff
Florilège
Pour m’aider à contourner la réalité mystérieuse de l’Inde, je serre dans mon sac mon bréviaire surréaliste Un barbare en Asie d’Henri Michaux.
Je croiserai Supriyana en fin de journée, sur le boulevard de mer, au soleil couchant, tenant par la main une adorable petite fille en robe bleue, comme si elle promenait dans l’irisation des embruns une poupée indienne à son effigie.
J’ai le sentiment aérien de voyager à contre-courant, la sensation apaisante d’être un petit caillou à qui personne ne demande rien et qui cherche à se glisser dans la chaussure du temps pour le faire boitiller et s’interroger sur sa course folle, orgueil d’écrivain en exil.
L’Inde déballe sa vie intime sur les trottoirs, montagnes de réveils, de bougeoirs, de tongs, de piles électriques, fatras de CD, biberons, boîtes en plastique, cordes, pyramides de fleurs artificielles et d’oreillers, sans compter les étals de quincaillerie qui disposent leur bimbeloterie jusqu’au milieu de la chaussée…
Si j’ai pu flâner à pied et à vélo dans la cité de Pondichéry, pour connaître la région de Goa et avaler des kilomètres d’asphalte et de mauvais chemins, il va me falloir enjamber un engin à moteur, ça n’a l’air de rien mais c’est toute une philosophie du voyage qui bascule, c’est comme demander à Théodore Monod de parcourir le désert libyen sur un trial. Je vais essayer.
Je m’en vais à l’instant chercher le bleu des faïences qui décorent des bâtiments officiels de Panjim, ce bleu azulejo qui m’a toujours porté chance depuis mon tout premier manuscrit au titre poétique « J’écris pour des collines bleues » tapé avec deux doigts et remis à Simone de Beauvoir dans un café de Saint-Germain-des-Prés à un de mes retours d’Afrique, le tout premier texte annoté de l’encre bleue du Castor, la vie chaotique d’un écrivain prend du sens si elle dure un peu, disons le temps d’une maturation d’homme.
La gare Victoria m’offre la plénitude de son architecture symbiotique, exit Français de Pondichéry et Portugais de Goa, à Bombay ce sont les Anglais qui ont laissé au sein de leur architecture gothique victorienne des années 1880, elle-même inspirée des modèles de la fin du Moyen Âge en Italie, une place aux architectes indiens qui avec un dôme de pierre, des arcs brisés, des tourelles, ont donné à l’ensemble l’ordonnancement et l’élégance d’un palais indien, le soleil caresse la gueule ouverte d’une gargouille en attente de mousson et frappe le vitrail d’une fenêtre bleutée où je distingue par transparence deux paons de facture orientale, les brigades islamistes auraient dû lever les yeux vers le bestiaire de pierre du hall de Victoria Station, avant d’ouvrir le feu sur la foule avec leurs kalachnikovs.
(Extraits de l’ouvrage « Pondichéry-Goa »
éditions Carnets Nord, 2010)
Télécharger le document

19:50 Publié dans Claude Darras, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
09/10/2010
Angèle Paoli, Carnets de Marche (une lecture de Tristan Hordé)
NOTE DE LECTURE
(Tristan Hordé)
Carnets de Marche
ANGÈLE PAOLI
La marche solitaire me semble être une activité complète : elle est un bienfait pour le corps certes, mais elle offre aussi petits et grands bonheurs par les découvertes de la faune et de la flore, on y réinvente à chaque fois les paysages et l'on ne cesse d'y examiner ses jours, ses rêves, ses craintes, d'analyser ce qu'il en est des relations avec ses proches ; on finit par s'arrêter pour lire, regarder le ciel, un arbre, les mouvements des animaux... Dans les Carnets de marche d'Angèle Paoli, tout cela est précieusement noté.
L'espace et le temps du récit sont apparemment homogènes, il s'agit des sentiers et routes empruntés à partir d'un point fixe, une maison dans un hameau du Cap Corse, pendant plusieurs saisons, et chaque séquence du récit correspond le plus souvent à une marche. Cependant, sont introduits ici et là des souvenirs de la vie passée, et ces évocations d'autres temps et d'autres lieux menacent alors l'équilibre présent : le hameau n'apparaît plus comme un havre mais comme un lieu d'exil. La boucle de la marche ne suffit plus à assurer l'ordre du récit ; il est rétabli par la présence constante d'un élément, le vent qui, outre qu'il s'accorde par son mouvement avec l'agitation intérieure de la narratrice, soude les séquences. On commence : « Tu écoutes la chevauchée du vent dans les chênes » ; avançons : « Des vents à couper le souffle», « Le vent sarcle la montagne jusqu'à l'os » ; lisons la dernière phrase du livre : « Le silence vent du matin qui gifle et qui grince plein fouet ».
C'est encore le vent qui transporte les odeurs, celle des cochons comme celle des arbres — ainsi l'odeur « de chêne mouillé, mélange subtil de terre, d'eau, de feuilles » —, découvertes au cours de la marche comme mille et une manifestations de la vie dans le maquis et la forêt, les « minuscules enchantements du jour » : chèvres qu'appelle le berger, oiseaux dont on ne connaît la présence que par le cri, lézards vite enfuis, marcassin qui passe rapidement devant vous. La narratrice voudrait tout retenir et emporte d'ailleurs dans son sac ce qui peut l'être, des rondins de bois abandonnés, un nid de mousse, un rameau d'arbouses...
Il y a très fortement un désir de fusion avec la nature qu'elle arpente ; une des belles séquences des Carnets, par exemple, est consacrée au désir de devenir végétal : « Je suis arbre [...] Mon corps s'enracine [...] Je me coule dans l'arbre, me fonds à son corps de silence et de vent. » On rapprochera ce fantasme d'une disparition heureuse à un autre moment du livre où s'exprime le « désir de retour au ventre des origines » ; pourtant bien que la mère soit présente dans les Carnets, c'est par une relation particulière à la terre que passe ce désir : « c'est par le sexe qu'il t'est donné de le vivre à nouveau. Tu caresses les forages de la roche fissurée, lèvres et ourlets de chair minérale [...] La chair se fend sous l'insistance de tes doigts [etc.] »
Bonheur, donc, de se retrouver, d'être soi-même dans une nature sensuelle et accueillante ? Ce serait trop vite oublier une partie des Carnets. Parfois, le chemin suivi se perd dans des broussailles impénétrables, le but est impossible à atteindre et il faut revenir en arrière, modifier son itinéraire. L'incident suscite de sombres réflexions chez la narratrice, « le sentier introuvable » devient la « métaphore de sa vie ». Chaque fois qu'elle cesse d'observer ce qui l'éloigne de sa difficulté à vivre, alors « elle oublie qu'elle marche. Peut-être ira-t-elle à oublier qui elle est. » Cet oubli, le lecteur le suit sans peine dans la relation qu'elle fait de cauchemars qui disent la dissolution « dans les interstices du sol », la chute dans un trou avec la sensation d'une « béance sans visage ».
En même temps qu'un bonheur rousseauiste, les Carnets relatent la rupture d'avec une femme aimée, d'autant plus pénible à supporter qu'elle s'effectue progressivement, sans être exprimée. C'est la raréfaction des courriers, leur laconisme qui font comprendre à la narratrice que "tout est fini". Amour perdu qui, à certains moments, désoriente à un tel point que le corps semble ne plus avoir de lieu, et alors « Être ici, cela renvoie à tout ce que tu as perdu ».
Cette intégration difficile de la perte de l'Autre provoque une quasi impossibilité à prendre en charge le récit. La narratrice, c'est d'abord et dans une grande partie des Carnets, "elle", que l'on ne distingue pas toujours dans certains passages du "elle" désignant la femme aimée. D'un paragraphe à l'autre, ce "elle" narratrice devient un "tu", mais le dédoublement évite encore le "je", qui obligerait peut-être à répondre à la question « Qui fuit-elle ? » Cet emploi complexe des pronoms est explicité : « Cette distanciation [par le "elle"], toujours, qui l'empêche d'assumer son "moi". Elle, elle hésite. Le "je" qui se met sans cesse en avant, ça la contrarie. Elle le trouve trop exclusif, trop égocentré. Elle lui préfèrerait le "tu", qui ouvre le dialogue avec cette autre part d'elle-même, instaure le va-et-vient entre une forme de regard et une autre, un angle de vue et un autre. »
Le "je" n'est pas absent, mais Angèle Paoli use soit des ressources de la ponctuation pour signifier la distance dans l'écriture (c'est alors "je," ou "mon,"), soit supprime toute démarcation entre les éléments du discours, ce qui donne l'impression d'un flux de pensées qui n'auraient pas besoin d'être hiérarchisées. On pourrait dire qu'alors cette absence de distance marque la fin du deuil de l'Autre — le "elle" ambigu n'est plus nécessaire —, la possibilité par la narratrice d'être ce qu'elle est, sans (se) dissimuler. Ce n'est pas le moindre intérêt de ces Carnets de marche.
© Tristan Hordé, octobre 2010
Editions du Petit Pois, Béziers, 2010
■ LIEN : http://cordesse.typepad.com/leseditionsdupetitpois/auteurs/

+ d’infos
20:58 Publié dans Angèle Paoli, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
08/10/2010
« Salah Stétié en un lieu de brûlure »
Salah Stétié
(Article de Nathalie Riera)
***
Une lampe sous l’orage
« Dans une époque où le nom même de l’Etre, celui du sens et de l’essence sont devenus objets de répulsion, de dérision et finalement d’une étrange amnésie, Salah Stétié ose dire que seule une poésie prenant appui sur les grandes interrogations fondamentales est susceptible d’éclairer la condition des hommes et de nous prémunir contre ces maladies mortelles que sont les certitudes sans horizon, les cynismes affamés, les divertissements de littérateurs enfilant des perles d’insignifiance, ou l’abandon blasé à l’esclavage de l’immédiat. » [1]
En un lieu de brûlure, (éditions Robert Laffont, oct. 2009) est l’occasion de consacrer ces quelques lignes à une personnalité intellectuelle aussi éminente et lumineuse que Salah Stétié, poète libanais de tradition culturelle sunnite, né à Beyrouth le 28 décembre 1929.
Pour celui qui avoue son arabité lui être corps et cœur, et militer activement pour une Méditerranée « frémissante de grands mythes », la langue française le fascine autant pour sa vertu de transparence, que la foi du poète est conscience en la lumière de la langue, à ses « chevaux tremblants ». Lumière de l’affranchissement.
Si Salah Stétié n’hésite pas à se positionner comme « double exilé », « invité de la langue française », son engouement est de mettre en exergue sa grande amitié pour la poésie et ses poètes européens que sont Pierre-Jean Jouve, René Char, Henri Michaux, André Pieyre de Mandiargues, Yves Bonnefoy, Cioran… et son si cher Georges Shehadé, sans oublier sa grande affection pour Gerard de Nerval.
Deux figures majeures marqueront la vie intellectuelle du poète : Gabriel Bounoure (lors de leur rencontre à l’Ecole Supérieure des Lettres de Beyrouth, en 1947), puis Louis Massignon (au Collège de France). De l’un comme de l’autre, il recevra une véritable initiation à la littérature européenne. « L’eau froide gardée » est le premier recueil publié en 1973, que Pierre Brunel [2] considère d’aussi grande facture que le recueil d’Yves Bonnefoy « Du mouvement et de l’immobilité de Douve ». A l’occasion des 80 ans du poète, il convient de dire que Salah Stétié a construit une œuvre de poésie et de prose des plus cohérentes et des plus généreuses. Aucune place à l’enflure, à la gloriole, au lyrisme ravi, à l’intellectualisme maniéré, mais place à la finesse et la fraîcheur, à la beauté convulsive et à la tension de la célébration. Salah Stétié déplore cette guerre de l’homme contre l’Etre, c’est-à-dire contre ce qui détourne l’humain de la vérité tragique. Et face à la dévastation, qui nous fait rompre avec notre ouverture à l’Etre, il convient de demeurer dans la vigilance et la résistance contre le formalisme, l’anecdotique, la pensée en régression, la métaphysique de pacotille, et contre tout ce qui participe insidieusement à l’extension du désastre.
Lampe infléchie parmi les écritures
A cause du renversement nocturne
De branche verte – et ses roses séchées.
Rocaille haute que torture une pensée
Fermée sur la poésie de mille olives
Feintes par l’arbre en attente de blessure
- Selon l’antique prophétie éblouissant
Les chèvres de subtilité du sel
XXXIII, L’être poupée
Dans Les parasites de l’improbable, qui regroupe des textes inédits, [3] Salah Stétié se demande si notre modernité est réellement excessive, et de quelle nature est son rapport au désir. À cette « modernité ravagée de tics », la réponse ne s’attarde pas : « Excessive, notre modernité ? Elle n’aurait été, aux yeux ravagés de Nietzsche, l’eût-il connue, qu’une serre à cultiver des fleurs mineures, provocatrices d’un style de scandale somme toute acceptable et intégrable. » Et ce qu’il faut entendre par « désir », précise t-il, ce n’est certainement pas «ce désir affecté et tout compte fait limité et médiocre, épuisé, essoufflé, dont nous rabattent les oreilles tant de petits romans excités de notre modernité pauvrement désirante et souffreteusement érotique, bien éloignée, en tout état de cause, de la tentation panique et de l’intensité imaginative, seuls moteurs de la vie en sa haute projection poétique. » Lieu de l’urgence sont l’amour et le désir, nous dit le poète, et il n’est pas déplacé d’affirmer que c’est à Jouve que la poésie de Stétié doit non pas sa sensualité, mais plutôt « une légitimation advenue et une confirmation du fait que la voie du poétique devait tenir compte de tous les mouvements profonds de la chair, des pulsions les plus noires, ainsi que de la splendeur avouée du corps, du « vrai corps » adorable et périssable. » [4]
L’éminence de Salah Stétié ne tient pas seulement de ses innombrables lectures, de sa passion ou son obsession à la parole poétique, elle tient avant toute chose de son goût et son respect pour l’absolu. Ainsi cette humble résolution à dire le peu, cette offrande d’un chant sans artifice, cette connaissance par les gouffres pour s’opposer à tous les faux jardins de la consolation. Ainsi ce silence dont on ne cesse d’accueillir les mots, fruit d’or de la parole. Car en poésie, il est ni question de parler ni question de se taire, pas plus que de répondre, nous dit Stétié, mais questionner sans fin. La question n’est- elle pas déjà un savoir.
En un lieu de brûlure nous offre un poète homme de deux rivages, qui ne se révèle pas seulement lecteur attentif des plus importants poètes des temps classique ou contemporain de sa génération. Une sorte de providence lui aura surtout offert complicité et proximité avec la poésie des hommes, dont celle de Mandiargues, Jouve, Cioran, et tant d’autres alliés, aussi farouches furent-ils, quand l’art et la poésie ne sont plus affirmation et beauté de l’existence, mais ne servent qu’à de bien sombres perditions au compte de ceux qui ne savent trouver jouissance que dans les scories du scandale. Ainsi, comment ne pas approuver Cioran, cité par Stétié, dans sa manière de définir les poètes, et sans que cela ne mette en doute son profond attachement à la poésie :
« Je viens de parcourir un livre de X, avec la plus grande répulsion. Je ne peux plus supporter l’inflation poétique. Chaque phrase se veut une quintessence de poésie. Cela fait artificiel, cela n’exprime rien. On pense tout le temps à l’inanité des mots recherchés. – Depuis longtemps déjà, j’abhorre tous les « styles » ; mais celui qui me semble de loin le pire, c’est celui des poètes qui n’oublient jamais qu’ils le sont. » [5]
Nathalie Riera, 2010
[1] « Salah Stétié » par Marc-Henri Arfeux, éditions Seghers, 2004 – (p.13)
[2] « Salah Stétié sur sa rive» par Pierre Brunel (en guise de préface), in « Salah Stétié en un lieu de brûlure », Editions Robert Laffont, 2009
[3] « Les parasites de l’improbable » par Salah Stétié, in « Salah Stétié en un lieu de brûlure », Editions Robert Laffont, 2009 – (p. 884)
[4] Ibid., - (p. 927)
[5] Ibid., - (p. 971)
En un lieu de brûlure, éditions Robert Laffont, 2009
Ce volume contient :
Salah Stétié sur sa rive, par Pierre Brunel
Vie d’un homme (avec post-scriptum), par Salah Stétié
POÉSIES : L’EAU FROIDE GARDÉE, FRAGMENTS : POÈME, INVERSION DE L’ARBRE ET DU SILENCE, L’ÊTRE POUPÉE suivi de COLOMBE AQUILINE, L’AUTRE CÔTÉ BRÛLÉ DU TRÈS PUR
ESSAIS : LES PORTEURS DE FEU ET AUTRES ESSAIS, UR EN POÉSIE, ARTHUR RIMBAUD, MALLARMÉ SAUF AZUR, LE VIN MYSTIQUE
PASSERELLES : CARNETS DU MÉDITANT, LE VOYAGE D’ALEP, LECTURE D’UNE FEMME
LES PARASITES DE L’IMPROBABLE
Notes - Bibliographie
Les derniers ouvrages publiés de Salah Stétié :
"Mystère et mélancolie de la poupée" , Fata Morgana, mai 2008
« Culture et violence en Méditerranée », Imprimerie Nationale Editions, mai 2008
« Louis Massignon Gabriel Bounoure », Fata Morgana, mars 2008
22:13 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Salah Stétié | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
27/09/2010
Temps mort, Paul de Brancion
NOTE DE LECTURE
(Pascal Boulanger)
TEMPS MORT
Paul de Brancion
Editions Lanskine, 2010
Temps mort doit se lire comme une approche de notre actualité la plus symptomatique, comme une traversée du nihilisme. Plié de ressentiment sous un monde en lambeaux, le dernier homme se précipite dans la dévastation sans l’attente d’autre chose, surtout pas d’un salut et dans l’hallucination froide et méthodique.
Paul de Brancion, depuis Tu-rare, trace la figure moderne de la mort et de l’apocalypse, en traits noirs et sans complaisance. Le mal exerce sa magie quotidienne, l’impatience de la technique et la corruption en marche oblitèrent le sensible. Pour Claudel, le pire n’est jamais sûr… Le pire est déjà arrivé pour Brancion.
Il a les pieds sur la table, un slip noir.
Il porte le deuil de ce jour.
La lune n’est pas encore levée,
Aucune lumière ne semble devoir surgir d’un tel entrelacs
De situations, de peines, de fautes, de cocasseries.
Temps mort / temps vivant : deux photos de Joseph Barrak représentant un bédouin portant un enfant mort tracent un écart de moins en moins perceptible entre ce qui se déploie et ce qui s’obscurcit.
© Pascal Boulanger, septembre 2010 (Les Carnets d’eucharis)
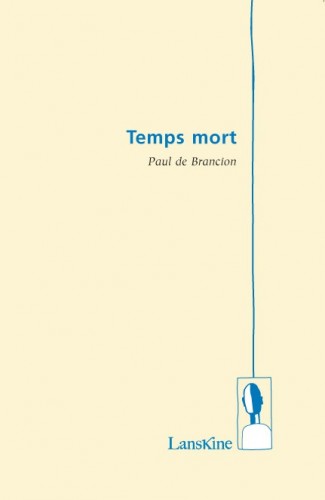
22:26 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
17/09/2010
Gérard Cartier
Une lecture de Nathalie Riera
©
TRISTRAN – Gérard Cartier
(Editions Obsidiane, 2010)
«… la nécessité d’une poésie (…) à savoir un état fidèle à l’impact de la réalité extérieure et sensible aux lois intérieures du poète. »
Seamus Heaney (Discours du Nobel, éditions La Part Commune, 2003, p.53)
Après de nombreux livres de poésie, dont Le petit séminaire (Poésie/Flammarion, 2008) Gérard Cartier fait paraître Tristran, un nouveau recueil publié aux éditions Obsidiane.
Tout au long de ce récit sauvage tracé à la pointe sèche, le poète nous met en garde : On ne doit pas/des passions/faire littérature. Le projet poétique de Gérard Cartier : tenir un chemin d’écriture où, comme le « poète de l’Ulster » et ami Seamus Heaney, croire en la poésie, non pour se détourner de la violence du monde, mais parce qu’on doit croire en elle à notre époque et en toute époque, en raison de sa fidélité à la vie.
Retrouver dans le poème le viatique de la langue, quand la langue est substance de la pensée, la seule chose qui peut encore demeurer au cœur de l’aube ravagée et ses rhapsodes meurtris. Le livre devient alors un jardin de célébration aux vertus primitives. Le livre est voyage, quand il revient au poète de célébrer les noms sortis de la mémoire : nom puissant que celui de Tristran, et le chant léger de deux voyelles que celui d’Ysé. Reconvoquer l’origine du conte celtique, depuis un néant de tourbe et de brume. Lettres effacées, pages maculées, début arraché, le poète est habité de l’éclat et de l’écharde. Dès le commencement du récit, en l’été d’un autre siècle, le corps du poète est le corps du livre, où il n’est pas seulement question de pages et de mots, mais d’argile et de chair tremblantes.
A ma naissance/Un ange amer a présidé.
Ecrire Tristran dans la joie déchirante, sans la promesse d’un soulagement. La lumière n’a pas le pouvoir de la fulmination, sans secours dans un monde de tombeaux et de stèles. L’amour une faute et un châtiment… Mais rien ne sépare les amants, leur folle passion aux lettres immortelles … ils célèbrent/Dans l’indigence leur épiphanie. Toujours ce qu’il reste de feu contre le froid de l’épreuve, et ce que l’on peut percevoir de floraisons futures.
Embrasser la faute, la chérir. Toute la force de ce recueil : laisser/Aux amants des siècles futurs une louange sans flétrissure.
L’écriture est longue pérégrination. Tristran est l’hiver du poète, un climat de lecture qui met le lecteur à l’épreuve : ce qui descend vers les tombes profondes, ce qui remonte vers les roses éclatantes. Calligraphie des métamorphoses, bibliothèque des formes et des couleurs, sous le ciel des amants périssent les palabres, les éblouissances du langage. Ne demeure que les herbes les plus pauvres.
Ils s’aiment, c’est-à-dire, rien à vaincre mais tout à surmonter.
Chante le monde à l’Ange écrit R.M. Rilke, et dans Le Livre d’Heures : On sent l’éclat d’une nouvelle page/où tout encore peut devenir.
© Nathalie Riera, avril 2010
EXTRAIT
Ils se sont tus dans un hoquet et le chagrin nous saisit à
genoux dans un marais acide qui dissout les passions et conserve
les corps pour l’édification des générations à venir tourbe
épaisse où tout revient et le poison qui coulait dans leurs veines
passe aux fleurs éclatantes aux épines aspiré par les
racines noires colorant les baies des fossés les mousses
et les pierres…
(Extrait de la séquence 5 – La mort - .VII. p.113)
Gérard Cartier, Tristran, éd. Obsidiane, 1er trimestre 2010
Sur le site Terres de femmes Angèle Paoli
Un récit sauvage tracé à la pointe sèche
■ Lien : http://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/2010/06/g%C3%A9rard-cartiertristran.html
 Gérard Cartier est ingénieur (le tunnel sous la Manche, le Lyon - Turin) et poète. Ses premiers livres tirent leur motif de l’Histoire : la déportation de Robert Desnos (Alecto !, Obsidiane, 1994) et la résistance en Vercors (Introduction au désert, Obsidiane, 1996; Le désert et le monde, Flammarion, 1997 - Prix Tristan Tzara). Ses recueils récents composent une autobiographie fantasque (Méridien de Greenwich, Obsidiane, 2000 - Prix Max Jacob), imaginaire (Le hasard, Obsidiane, 2004) ou peut-être véritable (Le petit séminaire, Flammarion, 2008).
Gérard Cartier est ingénieur (le tunnel sous la Manche, le Lyon - Turin) et poète. Ses premiers livres tirent leur motif de l’Histoire : la déportation de Robert Desnos (Alecto !, Obsidiane, 1994) et la résistance en Vercors (Introduction au désert, Obsidiane, 1996; Le désert et le monde, Flammarion, 1997 - Prix Tristan Tzara). Ses recueils récents composent une autobiographie fantasque (Méridien de Greenwich, Obsidiane, 2000 - Prix Max Jacob), imaginaire (Le hasard, Obsidiane, 2004) ou peut-être véritable (Le petit séminaire, Flammarion, 2008).
Gérard Cartier a traduit le poète irlandais Seamus Heaney (La lanterne de l’aubépine, Le Temps des Cerises). Il est par ailleurs, avec Francis Combes, l’initiateur de l’affichage de poèmes dans le métro parisien qui se poursuit depuis 1993.
TELECHARGERFORMATPDF
Gérrd Cartier_Une lecture de Nathalie Riera.pdf
21:02 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
23/08/2010
Georges Guillain, Compris dans le paysage
NOTE DE LECTURE
(Sylvie Durbec)
Georges Guillain
Compris dans le paysage
Dès le livre en main, plusieurs singularités : la couverture et à l’ouverture, les deux citations, l’une de Bob Sheppard, et l’autre de Vassili Grossman. L’une met l’accent sur la beauté d’un paysage et l’autre évoque le mot figures pour désigner les corps humains, « 100 figures, 200 figures ». La première citation se termine ainsi : « Mais c’est devant qu’il faut regarder. » Et puis il y a l’italique qui est utilisé dans tout le recueil, depuis les citations jusqu’à la coda. Le titre, les mots de Sheppard, la fermeture éclair sur le dessin nous rapprochent d’un lieu, perdu dans le « …moutonnement des Vosges », le camp de concentration du Struthof, nom que je ne découvre écrit qu’après avoir lu tous les textes, puisqu’il figure à la page 10, soit juste avant les citations. Nom d’un lieu perdu, à retrouver, à tenter d’apercevoir. Il n’est pas anodin que je ne l’aie pas vu.
Voir, il s’agit donc de voir. Des jardins.
il y aurait des jardins des fleurs des papillons des murs les gestes
d’autrefois le bleu des fours des torchons épaissis de pâte les noms
La beauté et les figures. Beauté d’un paysage.
Mais Georges Guillain parle aussi une langue où la faiblesse des mots s’inscrit contre ce qui se voit et qui cache ce qui a été là.
l’écrire
pour me souvenir
Voir, c’est aussi passer à travers le vert/le rouge/tout le mûri/, pour ceux qui n’ont pas fait partie des figures et qui ont à mener une vie, leur vie :
une vie ordinaire sans rien
sans souvenirs immondes sans
grincements de dents
C’est de cette vie-là que part celui qui écrit devant ce paysage rempli d’absence et devant cette couleur devenue majuscule :
oui
ROUGE
je l’écris
cherche les mots/hésite après
dans les failles
ce qu’on entend/du Rouge/ici
les lettres le détachent/un bloc dont se fissure la présence entre
les maisons bien assises sur la place qu’on traversait encore
ìngénument le soir/
leur toit/ROUGE/et/
le saisissement de se voir/
là/dans le tremblement/l’effarement/
de la phrase
(…)
Alors Georges Guillain invente une ponctuation, un rythme qui parle d’un lent retour, d’une montée vers une hauteur prête à disparaître. Tout en avançant sur cette route,
doutant de tout
ce que pauvrement (je)il possède
il égrène des cailloux d’ombre et la page ressemble à un ciel brûlé d’étoiles. Les figures deviennent présences et les fleurs elles-mêmes se peuplent de mots hésitants à leur redonner poids.
Jusqu’ à cette fin d’été qui conduit à l’automne et au froid du camp :
figure humaine au bois fendu comme les fentes des persiennes
un mur
de bois de haches dans le froid
où pousse aussi ton corps déjà l’hiver dans la forêt qui dure
(…)
Les figures sont des corps et ce sont eux qui nourrissent la terre :
cette
misère d’eux
balayée ramassée
(…)
La CODA nous rappelle aux couleurs, au linge, aux pommes, au pré, à ce qui bouge :
simples vols d’oiseaux surpris qui
disparaissent agitent un peu
la haie
Et le poète écrit le mot caché sous celui de figures / morts/ et à son tour il est compris dans le paysage :
et tant pis
si toujours la pression de la vie s’obstine s’exténue
à déformer le monde en rythmes un peu bancals
traçant à sa manière un chant dont on peut dire qu’il éclaire ce qui n’a pas de lumière.
© S.D., 2010
Editions Potentille, 2010

22:50 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sylvie Durbec | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
02/06/2010
Dominique Sorrente (une lecture de Sylvie Durbec)
NOTE DE LECTURE
(Sylvie Durbec)
A propos du recueil de Dominique Sorrente, Pays sous les continents, un itinéraire poétique 1978-2008
« Je t’envoie ma chanson des jours bleus… »
Lors de la venue de Dominique Sorrente à la Petite Librairie des Champs, au mois de février 2010, nous avons eu le plaisir de recevoir également Mérédith Le Dez, son éditrice, qui a réalisé, avec PAYS SOUS LES CONTINENTS, un très beau travail éditorial. Si le livre est beau, par sa couverture rouge d’abord et la qualité de l’impression, c’est évidemment aussi à cause du projet singulier à l’origine de cette publication. Sans parler des textes de Dominique Sorrente qui la composent. Qu’un poète constitue ainsi une somme de trente ans d’écriture est une entreprise originale et rare. Le titre d’abord nous arrête et nous nous demandons quel est ce pays, quels sont ces continents. La lecture nous apporte des réponses tout en ouvrant d’autres interrogations et nous nous retrouvons devant une œuvre où l’exil intérieur du poète donne le ton aux différentes sections du livre[1], évoquant un incessant départ, la recherche d’un impossible ici, que la citation de Milosz mise en exergue signale : « …il n’est pas jusqu’au mot le plus universel, Ici, qui n’ait à jamais perdu son sens… ». Rilke lui-même ne l’avait-il pas noté lorsqu’il écrivait : « Car demeurer, cela n’existe nulle part. »
Ce pays mouvant et ouvert dont parle le poète, c’est évidemment la poésie, celle croisée à Marseille sur le chemin de Christian Gabriel/le Guez Ricord, à l’âge de 17 ans et avec laquelle Dominique Sorrente va se colleter, au long de nombreux recueils ayant obtenu des prix prestigieux. Ici, c’est aussi ces continents sous lesquels se cachent le pays et toutes les voix du poète. Sans oublier la mer initiatrice du voyage. Ce qui est à l’œuvre dans cette somme, véritable fil rouge dans l’œuvre de D.S., c’est la voix adressée à celui qui écoute et lit les paroles du poète. « Apprendre à lire l’exil, nu sur son corps », voilà que s’ouvre devant nous la trace d’un passage, celui de l’écriture, à la fois rude et nécessaire :
« …dans le train qui glisse sur ses rails
avec les paysages, instantanés souverains,
qui se refusent
à l’entrée du poème »,
écrit-il, dans la Lettre du passager à la fin de cet itinéraire poétique, et ce passager est le poète, mais aussi le lecteur. En effet, le voyage de lire nous fait découvrir l’étrangeté d’une prose poétique (Parabole d’un temps, dans Empire du milieu intérieur) et la beauté aphoristique de certains vers: « Il est beau, ce claquement d’ailes entrevues dans la lenteur de la forêt », Le Dit de la neige), qui l’apparentent à des poètes comme Trakl ou des prosateurs comme Adalbert Stifter.
Plus qu’une anthologie, ce que nous donne à entendre Dominique Sorrente, c’est une traversée. Une vie en poésie.
© Sylvie Durbec, la petite Librairie des Champs, à Boulbon
MLD Editions
Pays sous les continents, Un itinéraire poétique 1978-2008 de Dominique Sorrente
MLD Éditions, 25 euros
[1] On peut en donner quelques titres pour mémoire sur les 15 : depuis Citadelles et Mers jusqu’à Cinq dérives pour les continents, en passant par La lampe allumée sur Patmos, Méridienne d’If, Empire du milieu intérieur ou encore Oiseau passeur. Tous ces titres montrent à l’évidence que le poète est traversé par le mouvement de la voix et de son cheminement de l’intérieur vers l’extérieur, vers le lecteur.
20:39 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Sylvie Durbec | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
08/02/2010
Dominique Grandmont (lecture de Brigitte Donat)
NOTE DE LECTURE
(Brigitte Donat)
Dominique Grandmont
Mots comme la route
Mots comme la route, dernier recueil poétique de Dominique Grandmont constitue une avancée d’autant plus forte qu’elle s’est formée sur beaucoup de silence.
Composée d’une alternance de bloc-textes et de courts vers syncopés, l’œuvre laisse une parole s’accroître librement jusqu’à brûler l’espace qu’elle franchit.
Ainsi la vitesse que procure l’enchaînement d’axiomes, dans le premier texte, balaient nos points d’ancrage et les mots, lie noire sur papier, forment l’asphalte d’une route lisse que nul horizon ne vient entraver. Un champ d’immanence se déploie et nous rend à notre liberté première. Détachée de toute pesanteur subjective, la langue sait alors prendre son élan, se délier, parler d’elle-même et constituer son propre dépassement.
Ces mots n’appartiennent à personne. Ce sont eux qui ont pris ma place, pour que le rien soit quelque chose.
A l’autonomie de la langue répond une charge de témoin : le poète en retrait capte les confins d’une parole qui se multiplie, ses capacités à faire de la réalité autre chose que ce qu’elle est. Il nous invite à sortir de tous les miroirs afin que l’univers puisse redevenir lui-même, infini. Si les pistes se brouillent, c’est pour mieux affronter la perte. Les mots ne comptent pas, constate Grandmont, j’ai beau écrire, je ne vois pas ce qu’ils voient dans le désert des livres, ni quelle liberté.
Puisque la signification échoue à enclore le monde dans un dire, (ne la contredit-il pas sans cesse, la débordant infiniment ?), l’écriture s’affranchit de son impuissance.
Ce que je lui fais dire n’a pas de sens, mais ce que je lui retire la grandit.
De cette béance, à notre grand étonnement, surgit la vraie vie.
Elle est cette parole qui n’a pas commencé, cette insensée qui veut tout dire mais qui n’oubliera pas un visage.
© Brigitte Donat, février 2010
Editions Tarabuste, 2009
06:58 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique grandmont, mots comme la route |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
03/02/2010
Jean Starobinski / entretiens avec Gérard Macé - (lecture d'Alain Paire)
Jean Starobinski dialogue avec Gérard Macé :
cinq entretiens publiés par La Dogana
lecture d'Alain Paire
Jean Starobinski et Florian Rodari, l'un des responsables de La Dogana
En décembre 1999, rue Candolle, dans un appartement proche de l'Université de Genève, Gérard Macé interrogeait Jean Starobinski en compagnie de techniciens de France-Culture requis pour l'émission "A voix nue". Francesca Isidori et Olivier Kaeppelin lui avaient donné carte blanche pour que soient enregistrées cinq demi-heures de conversation qui furent diffusées en matinée, du lundi au vendredi.
Dix années plus tard, parce qu'un invincible "goût d'inachevé" affectait des fragments de leur conversation, les deux protagonistes ont relancé leurs correspondances et se sont de nouveau concertés afin de reformuler par écrit leurs questions et leurs réponses. L'intégralité de leur entretien vient d'être publiée par les éditions de La Dogana. Responsable du fonds Jean Starobinski des Archives littéraires suisses de Berne, l'un des membres du comité de cette maison d'édition, Stéphanie Cudré-Mauroux s'est chargée d'assurer les va-et-vient de ce processus de réécriture.
En guise de titre ainsi que de manifeste pour ce dialogue, Gérard Macé fait réimprimer le début d'une citation de Montaigne qui figurait dans l'incipit de leur conversation : un fragment des Essais qui énonce fermement que "La parole est moitié à celuy qui parle, moitié à celuy qui écoute". Une post-face de Macé et un léger appareil critique, des repères bio-bibliographiques, complètent la transcription de cette série d'émissions. La très fine résultante de ces réemplois successifs, c'est à présent la lecture d'un élégant volume de 110 pages qui, écrit très justement Stéphanie Cudré-Mauroux, "prend ici et là des allures de mémoires ou bien de testaments".
Du côté des souvenirs, on découvre bribe après bribe quelques traits de l'existence de Jean Starobinski, principalement des moments d'une jeunesse allègrement formatrice : "Alors que j'étais encore collégien, je me glissais à l'université pour écouter les merveilleuses leçons de Marcel Raymond sur Rousseau". Marcel Raymond fut pour Jean Starobinski l'un de ses meilleurs modèles pour ce qui concerne sa tâche d'enseignant : "Il savait lier les faits à connaître et la réflexion qu'ils appelaient. Il allait droit à l'événement, aux mots chargés du sens le plus provocant et le plus troublant. Il savait soulever une question, pour éveiller une inquiétude, sans la poursuivre, quand elle aurait pu détourner la suite du propos. La construction des parties du cours, l'emploi des cinquante minutes n'étaient jamais en défaut".
Quelques pages auparavant, Starobinski évoque "un évènement bouleversant", les émotions qu'il éprouva pendant l'été de 1939 lorsqu'il lui fut donné de découvrir au cœur des malheurs de ce temps les trésors du Musée du Prado pendant quelques saisons entreposés à Genève. Celui qui continue d'affirmer fortement que les peintres qu'il préfère de très loin, ce sont ceux "qui célèbrent le don de voir. Le bonheur d'une échappée, d'une scène simple", était alors âgé de dix-neuf ans : "Les salles de notre Musée d'Art et d'Histoire offraient Goya, Vélasquez, Greco. J'ai beaucoup rêvé devant "La Bacchanale des Andriens" de Titien qui est aujourd'hui encore un des lieux sacrés où mon souvenir s'attarde... Les salles du musée, en juillet, étaient presque vides à certaines heures. Je tentais de déchiffrer les rapports entre les personnages dans les sublimes "Fileuses" ou "Les Ménines". En un sens, il y avait dans ces œuvres une force, une vérité qui prévalaient. Mais qui n'avaient pas empêché la folie meurtrière".
Les années de guerre furent également celles d'une rencontre déterminante, celle de Pierre Jean Jouve, "la première occasion où un texte de critique m'a été demandé"... "Comme il venait d'achever la grande étude intitulée "Le Don Juan de Mozart", on lui en a demandé des lectures publiques. Il fallait qu'un étudiant tourne la manivelle du gramophone pour faire écouter les exemples musicaux... Et l'étudiant, c'était moi ".
Jacques Rancière a su le rappeler en citant Rilke dans un tout autre contexte, "Perdre aussi nous appartient". Rien de superflu, aucun relâchement, des curiosités polymorphes qui touchent à Georges Canguilhem, à la fleur Narcisse ou bien aux fabriques qui se construisaient au xviiie siècle en bordure de rivière, les citations de cet entretien pourraient être multipliées. On n'oublie pas le grand âge de l'homme dont la radio et l'édition nous restituent la voix. Une parfaite courtoisie, et puis surtout une inflexible capacité de résistance, point de vains regrets chez l'immense critique qui ne laisse pas entrevoir un espoir de dénouement lorsqu'il avoue en fin de partie "une dette qui persiste" à propos de Gérard de Nerval : "Il faut que je reprenne des pages inédites où je cherche à voir comment il a vécu la quasi-simultanéité de ce qui s'annonce et de ce qui se dérobe". Celui que ses meilleurs amis appellent affectueusement "Staro" confirme tout de même, à côté d’un troisième livre à fournir pour la collection de Maurice Olender, l'imminente parution chez Gallimard d'un livre depuis longue lurette patiemment attendu, son inoubliable titre est emprunté à un passage du Neveu de Rameau : "Diderot : un diable de ramage".
A défaut d'une cascade de livres qu'il ne faut pas souhaiter, ce qui dans ces pages ne cesse pas d'advenir et de fournir d'admirables preuves, ce sont une éthique et une esthétique souverainement joueuses, incroyablement audacieuses par rapport à tout ce qui semble prévaloir dans l'air du temps. Jean Starobinski aura fait de chaque journée de son parcours l'espace d'un combat musicalement livré "pour que le passé humain ne reste pas invisible et muet dans notre présent".
Cet homme des Lumières qui, comme l'indique Gérard Macé, "nous intimide et nous enchante", "rend possible l'avenir". Jean Starobinski réaffirme clairement qu'il "pense en société" et qu'il travaille en étroite amitié avec d'autres personnes : "Je crois même qu'une vraie recherche ne commence que lorsqu'on se sent en compagnie" ... "Si les circonstances, ou la Fortune, nous sont favorables, notre parole sera une vie qui se propage. Mais elle est aussi, comme tout l'humain, comme tout ce qui possède une forme, bordée par l'oubli, menacée d'effacement. Ce qui est difficile, dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas de rompre le silence, mais de persévérer, de simplement persister, face au bruit qui se multiplie..."
Contribution d’Alain Paire
Faute de pouvoir disposer d'une photographie de Gérard Macé pendant les moments d'enregistrement effectués par France-Culture, j'utilise ici un document qui réunit deux citoyens de Genève : Jean Starobinski et Florian Rodari, le principal responsable de La Dogana. Comme l'indique le livre que détient Rodari - les Cahiers pour un temps préparés par Jacques Bonnet qui venaient de paraître à propos de Starobinski - cette photographie date des alentours de 1985.
A propos de Gérard Macé, il faut signaler chez Verdier la parution prochaine, le 5 janvier 2010 de Pêle-mêle, un recueil de textes de Jean-Pierre Richard. Dans l'un des articles de cet ouvrage, J-P Richard évoque chez Macé le portrait réinventé de trois anthropologues.
Le catalogue de La Dogana (diffusion Belles-Lettres et Atheles) comporte trois autres titres où figurent d'importantes contributions de Starobinski : "Le poème d'invitation", précédé d'un entretien avec Frédéric Wandelère et suivi d'un propos d'Yves Bonnefoy (2001). "Goya, Baudelaire et la poésie" un essai d'Y.Bonnefoy qui comporte un entretien avec Jean Starobinski suivi d'études de John E. Jackson et de Pascal Griemer (2004) ainsi qu' "A tout jamais", lieders de Gustav Mahler interprétés par Bo Skovhus, préface de Jean Starobinski (livre & CD, 2009).
Parmi les projets de livres/ CD que La Dogana concrétise actuellement depuis Grignan, on peut signaler des enregistrements de poèmes prononcés par Philippe Jaccottet.
En coproduction avec les éditions Le Bruit du temps d'Antoine Jaccottet, La Dogana met également en chantier la traduction et l'achèvement de la biographie d'Ossip Mandelstam composée par Ralph Duti.
Par ailleurs directeur de la Fondation Jean Planque, Florian Rodari sera en 2010 pour plusieurs musées d'Espagne le commissaire d'une exposition de photographies issues de la Donation Jacques - Henri Lartigue
22:00 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
19/09/2009
Patrick Kéchichian
NOTE DE LECTURE
Pascal Boulanger
Patrick Kéchichian : Petit éloge du catholicisme
Dans une écriture superbe, Patrick Kéchichian dévoile sa propre traversée en mêlant à la foi la démesure et la raison qu’elle suppose.
Au centre de son propos, il y a ce basculement que la première épître de Saint Jean proclame :
Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur.
Cette conversion du regard porté sur le monde – et sur soi-même – désencombre et déjoue le déferlement du nihilisme au profit d’un appel qui est sortie et abandon joyeux de soi.
A partir d’entrées choisies : louange, modernité, église, colère… Kéchichian montre que la foi n’efface ni crainte ni tremblement mais qu’elle fait face à l’inattendu et au retournement.
L’impossible est possible et l’impossible c’est Dieu soulignait Chestov en commentant Kierkegaard.
La clôture individuelle trace les premiers cercles de l’enfer humain et bute sur l’immonde. Donner congé à ses propres fantômes irrigue le cœur tandis que le résigné est celui qui a détourné son attention du miracle.
Le possible consiste alors à croire au surgissement inépuisable de l’amour.
Car rien ne s’achève sur soi-même. Toute poésie du drame, et le catholicisme, même sur son versant lumineux et baroque, est poésie dramatique, passe par la Croix. Cette Croix n’est pas une tolérance pour la mort et pour son spectacle, elle n’est tout simplement plus rien devant la beauté inépuisable qui co-naît (Claudel) à chaque instant et pour l’éternité.
Voici bien une économie d’abondance dont témoigne le chrétien. Il sait que si nos yeux reçoivent la lumière, ceux du Christ la donne.
© Pascal Boulanger, septembre 2009
Editions Gallimard/Folio
11:28 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook

































































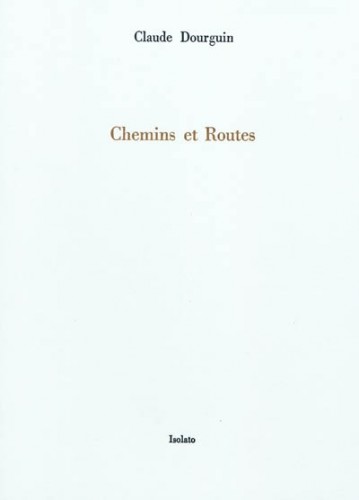
 DOCUMENT A TELECHARGER
DOCUMENT A TELECHARGER