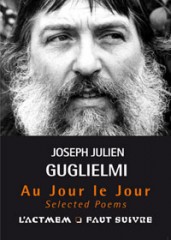06/09/2009
Claude Minière... et le monde dans son ordre par la justesse d'un trait
NOTE DE LECTURE
Par Nathalie Riera
15 avril – Écrites à Paris, à Londres ou à Oziers, ces pages du Journal accompagnent Hymne. À travers elles, je me fais le compagnon de mon poème, de son achèvement. De son départ et de son achèvement.
Claude Minière, Pall Mall, journal 2000-2003 – (p.77)
 Pall Mall
Pall Mall
Journal 2000 - 2003
Claude Minière
Editions Comp’Act, 2005
Le journal ne se veut pas lieu de confessions, et le poème ne cherche pas à rendre plus compréhensible le réel. Journal et Poème esquissent un vaste projet : demeurer lié au monde afin que le monde ne vous hait pas.
L’interrogation ne cherche pas de réponse, elle est action de remonter, de soulever, elle n’est qu’exigence de penser, à l’opposé des manières du monde et de ses vanités à ne vanter que le faux et son escorte de vulgarités.
Se défaire de l’ornement, taire le discours. Ne pas s’attarder, mais devancer. Toujours, devant, la voix menue du cœur qui aime à donner étreinte, qui aime à toujours aimer, ne pas rester dans le malheur, comme l’écrivait Hölderlin, mais chanter.
Ma poésie au fond répond à ce désir – « l’enfance retrouvée à volonté » - sans pathos, de corps immédiats, de traits et retraits, de bord de l’eau, de gestes sans jugement au rythme des feuillages. Exulter au cœur du monde.
Naître de l’esprit est nourricière du chant. La poésie de Claude Minière est certes vouée aux éléments familiers du quotidien, mais aussi et surtout à la liberté des espaces, aux paysages présents et dérobés, à ce qui fait rêve sans futiles rêveries.
Le journal est moyen de faire partir le poème, de passer par le poème, de passer par ce que l’on connaît et qui nous est nouveau. Et le poème est moyen de se tenir dans l’instant, toujours rester en la vérité, poursuivre l’enquête.
5 avril – Anna Dina Nurabelle. Plus fluides, les pensées doivent se faire plus fluides pour la sécheresse de l’arc-en-ciel, et comme « atomiques », pollens de lumière flottante.
Sécheresse d’une époque à laquelle quelques contemporains nous rappellent (à la manière d’Hölderlin) que peu de savoir nous est donné, mais de joie beaucoup.
Entre autre joie, celle du regard qui s’attache encore au sol, dans le vert profond d’une herbe, où les écrits ne flétrissent pas.
A la 112ème page de Pall Mall, le 16 novembre 2003 : Comment peut-on avoir encore envie, aujourd’hui, de publier ? Tout tombe dans la quantité à plat. Quant aux « critiques », il semble que Hymne les ait littéralement laissés sans voix. Aucun de mes livres n’a recueilli aussi peu de commentaires. Je pourrai dire que c’est bien ainsi : comment taire, comme enterre. Mais ce silence « gêné » rend d’autant plus précieux et vifs les rares gestes : celui de Marcelin Pleynet (et son invitation dans l’émission radiophonique « Surpris par la poésie », sur les ondes de France-Culture) ; celui de Pascal Boulanger (et l’article qu’il a écrit, qui paraîtra dans art press).
© Nathalie Riera, septembre 2009
08:12 Publié dans Claude Minière, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
08/07/2009
Note de lecture de Nathalie Riera sur le site Imperfetta Ellisse, blog di poesia e altro
Nota di lettura
Dopo tutto anche tu, Alda Merini
A l’occasion de la sortie de Après tout même toi d'Alda Merini, la note de lecture de Nathalie Riera est traduite par Giacomo Cerrai (imperfetta Ellisse) :
Là dove altri propongono delle opere io non pretendo altro che mostrare il moi spirito.
La vita è bruciare domande.
Io non concepisco opere che siano distaccate dalla vita.
- Antonin Artaud, L’Ombilic des Limbes
La pace è così piccola, Alda Merini, si ignora veramente ciò che è necessario per placarsi. Saggezza di bruciare ogni domanda, ma allegria quando si crede che la follia è un profondo legame d’amore. L’arte dell’amore.
Figlia dell’abbandono, ma con insieme la felice certezza d’essere stata profondamente amata, e la crudeltà di essere stata assassinata.
Je sais que l’on meurt/Lo so che si muore.
Mais que la mort vienne/Ma che la morte venga
de la main qui te devait des caresses,/dalla mano che ti doveva carezze,
mais que l’amour cache l’étreinte mortelle,/ma che l’amore nasconda l’abbraccio mortale,
Dieu résous-moi cette énigme !/Dio risolvimi questo enigma !
(p.64)
Leggervi, Alda Merini, è domandarsi : la poesia interessa al poeta ? Non è essa, alla stregua dello spirito, perfino al di fuori di ciò che chiamiamo poesia ?
Lire la suite :
Giacomo Cerrai (imperfetta Ellisse)
22:59 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
03/07/2009
Joseph Julien Guglielmi chez l'Act Mem
●●●

Préfacés par Elisabeth Roudinesco, ces « Selected Poems » de Guglielmi inaugurent une nouvelle collection aux éditions L’Act Mem. Des extraits de « Aube », recueil publié par Jean Cayrol en 1968 dans sa fameuse collection « Ecrire », aux tragiques suites de vers et de monosyllabes du « Carnet de nul retour » datant de 2006, ce sont plus de trois cent pages de textes poétiques qui nous sont offerts.
Guglielmi sait que l’on n’étreint pas la réalité rugueuse avec la pensée spéculative mais dans l’attachement à la puissance du concret que seule une traversée du pire et du meilleur peut illustrer. Le poème (à condition d’inclure swing et boogie !) est un des registres d’écriture qui, en prenant appui sur la fulgurance du vers, dispose de l’horizon hasardeux du sensible. Très tôt attentif à la poésie américaine, celle de Burroughs notamment, traducteur de Jack Spicer, jouant sur les paradoxes en défendant aussi bien Apollinaire que Reverdy, Guglielmi propose un énoncé poétique qui est, avant tout, une course de vitesse, un emmêlement d’événements, une captation de l’atomisation du temps : « la datation est un vers » et un métissage de langues à l’image de Marseille où fut créée la revue à laquelle il participa dans les années soixante : « action poétique ». D’un livre à l’autre, le dispositif versifié invente et intègre des scènes de l’intime et du sexuel, du collectif et de l’histoire, jusqu’aux dissonances contrariant le « bel canto ». Guglielmi a renouvelé la métrique, en débordant les cadres admis, en déglinguant l’humanisme plat et il l’a renouvelé dans une soumission souveraine à l’urgence du vivre baroque
A travers cette anthologie, on peut différencier les étapes, les trajectoires, mesurer la radicalité d’une œuvre qui a su, sans arrogance, dépasser l’inacceptable pacte social en relançant l’aube même de la parole poétique.
Pascal Boulanger

préface
Elisabeth Roudinesco
collection
Faut Suivre
POUR PLUS D’INFOS cliquer ci-dessous :
http://www.lactmem.com/medias/livres_2009/guglielmi_selected_poems.html
09:33 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
28/06/2009
Texte de présentation du film documentaire FIL D'ARIANE, VARIATIONS PLASTIQUES de FRA DELRICO
Art d’éloge
Préambule
au film documentaire
"Fil d'Ariane, variations plastiques"
sculptures et peintures
de
Frédérico Alagna
FRA DELRICO
Par
Nathalie Riera
■■■■
Quelque chose comme une foi, une reconnaissance au réel, une incursion dans l’éloquence et le mutisme de la matière, le film FIL D’ARIANE (variations plastiques) se compose d’une suite de sculptures, masques et figures, d'oeuvres graphiques, dessins et peintures, tout un flux de gestes et d’éloges qui célèbrent une certaine tenue esthétique et confèrent aux formes leur souffle.
Sans retenue le surgissement : force du vivant. Pouvoir actif et magnétique de la main à donner forme, et pouvoir de la matière à faire qu’il y ait oeuvre possible.
Oscillations, contorsions, déplacements, autant de contenance que d’élan lyrique, et pour l’artiste, Fra DelRico, le désir non pas d’un style mais d’un art à maintenir ces deux pôles que sont la figuration contemporaine et la vision traditionnelle, en résonance certaine aux arts premiers.
Pratique de la variation, avec d’un objet à un autre cette volonté ou manière de ne pas se complaire dans le néant, mais toujours à vouloir ce qu'il y a de plus authentique, c’est-à-dire en passant par un nécessaire abandon de la recherche du "mieux" au profit de ce qui fait « différence » ou de ce qui est « autre », s’opposant ainsi à toute uniformisation dans la notion même de perfection. Il ne s’agit pas d’espérance pour mieux vivre, mais de plus de potentialités et d’alternatives à une existence où le quotidien offre autant son lot de grâces que sa portion d’affres et de méandres.
Le poète et critique Yves Bonnefoy nous dit qu’il a bien fallu « quelque chose comme une foi pour persister dans les mots », j’ose croire que chez Fra DelRico le désir n’est pas fiction, et la foi n’est pas imaginaire. L’art a une prise directe sur son quotidien, et n’est-il pas justement cette chance souveraine, nous donnant à demeurer dans la vision et l’éveil des choses du monde? Avec lui l’art n’est pas dénigrement contre la vie et la mort, mais plutôt l’art comme preuve que l’homme a été dépossédé par le trivial, et que cette dépossession l’a affaibli.
« Dépossédé » veut dire aussi que nous avons toujours moyen de re-posséder ce qui a simplement été obscurci. Si l’art est considéré par certain comme un moyen de détournement, d’échappatoire à l’emprise du réel et du quotidien, il est pour d'autres le moyen de faire non plus obstacle à son être mais offrande. D’où ce recours de l’artiste à une oeuvre qui se déploie, à des rêves sans échardes, à des passions où la flamme ne détruit pas.
Fil D'ariane : 9 séquences sous tension. Son tracé a la qualité de ce qui est exigeant, mais aussi de ce qui sait laisser place à la mesure jusqu’à l’effacement.
Quand l’art est chuchotement, il est aussi célébration du vivant.
«Je ne m’attache pas à expliquer mon art, mais à le comprendre »
Fra DelRico fait éloge à la matière, avec, pour thème de prédilection, la figure humaine. Le peintre-sculpteur s’en vient chercher résonance et dissonance dans les couleurs du monde – ses fresques ou ses toiles du réel – dans les rumeurs du quotidien, dans les carnations de l’être. Et c’est dans ce geste de sculpter ou de peindre que se révèle le don.
Alchimie de matières, entremêlement de textiles, de tissus synthétiques, de terre et de cire : de ce geste profane des figures naissent.
Travailler/créer chez Fra DelRico c’est surtout exclure tout maniérisme. Se maintenir sur le chemin du dégagement. Poursuivre la recherche, c’est-à-dire tâtonnement, pénétration, pour au mieux continuer à comprendre son art, pour au mieux avancer sur le chemin de ce qui est promu à mûrir.
Pour ce qui est de l’action de peindre et de ce qui se propose sur la toile : donner à voir l’aura d’une figure, son essence, son empreinte.
© Nathalie Riera – Contribution mai/juin 2009

© FRA DELRICO Copyrights 2009
FRAGMENTS POESIE
Nathalie Riera
« … voir dans le nu des choses le filigrane de l’Universel et l’empreinte du Toujours »
Malcolm de Chazal
(La vie filtrée, 1949, éditions Gallimard)
I – Le nu des choses
II – La force des choses
-I-
LE NU DES CHOSES
corps c’est-à-dire régnant s’engouffrant en sens inverse en avant de cendre et de lumière se mélange à la pierre le regard
vers où les masses subsistent sans or sans air contre la tragique légèreté……………… brouillés de dédales les corps luisent……………………………………… feu et argile sont la matière des figures comme ratures peut habiter les chairs comme éther les bruits les mouvements grincements du vivant en nerfs eau nervures des socles………………………….……… c’est-à-dire corps
où peut survivre à proximité la passion des ombres raccourcis des clartés dans la courbe des épiphanies contre le zigzag des périphrases
CE QUI SUBSISTE SE PROLONGE SE LAISSE ENTREVOIR INCISIF SE REFERME

© FRA DELRICO Copyrights 2009
-II-
LA FORCE DES CHOSES
la nudité habite l’espace, les corps dans la liberté de ce qui est sans enlacement ni déformation ni sublimation
où est l’ombre est la lumière est l’épaisseur de l’origine est le voyage la chaîne le fil l’infini
ce qui est du fond de la chair ce qui est à l’intérieur ce qui est obscurité ce qui est corps dans les bras de l’invisible................... est sacré
montagne des corps où le regard puise force s’affaisse
sommets des crânes ce n’est pas la mort qui se déclare au regard mais ce qui survit qui est encore plein du monde………… rocheux humide argileux fertile herbeux aride
monde du regard
■■■■
FILM A VISIONNER CI-DESSOUS
22:57 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
"Fil d'ariane" Variations plastiques de FRA DELRICO
Film documentaire intégrale
Sur l’œuvre de FRA DELRICO
Musique de Rey Eisen
■Lien : http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=59131711
FIL D’ARIANE
variations plastiques
FRA DELRICO

PRESENTATION
AU FIL D'ARIANE_FRA DELRICO_2009.pdf
©FRA DELRICO Copyrights 2009
Entretien (Fil d'Ariane)
de Rey Eisen
■Lien : http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=59131844
22:45 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques), Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
22/06/2009
VIENT DE PARAITRE
Après tout même toi/Dopo tutto anche tu
La rencontre (im)possible entre le poète (mais aussi) psychiatre Angelo Guarnieri et la poète (mais aussi) internée psychiatrique pendant près de quinze ans Alda Merini. Ces deux êtres, chacun sur une rive de la vie, font des mots un fleuve qui les baigne et les nourrit.
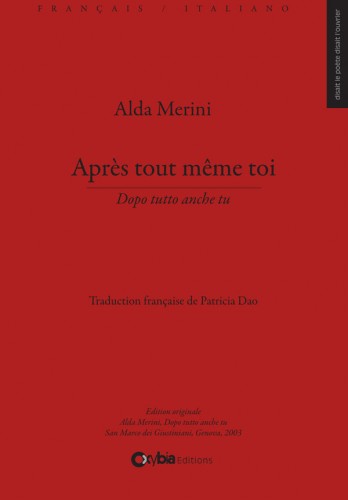
34 poèmes de Alda Merini traduits par Patricia Dao
« disait le poète disait l’ouvrier » collection de poésie contemporaine
Editions Oxybia, juin 2009 (édition originale 2003)
LECTURE
de Nathalie Riera
« Là où d’autres proposent des œuvres je ne prétends pas autre chose que de montrer mon esprit.
La vie est de brûler des questions.
Je ne conçois pas d’œuvre comme détachée de la vie. »
Antonin Artaud, L’Ombilic des Limbes
La paix est si petite, Alda Merini, on ignore vraiment ce qu’il faut pour s’apaiser. Sagesse de brûler toutes questions, mais allégresse quand croire que la folie est un profond lien d’amour. L’art de l’amour.
Enfant de la déréliction, mais avec tout à la fois l’heureuse certitude d’avoir été profondément aimée, et la cruauté d’avoir été assassinée.
Je sais que l’on meurt/Lo so che si muore.
Mais que la mort vienne/Ma che la morte venga
de la main qui te devait des caresses,/dalla mano che ti doveva carezze,
mais que l’amour cache l’étreinte mortelle,/ma che l’amore nasconda l’abbraccio mortale,
Dieu résous-moi cette énigme !/Dio risolvimi questo enigma !
(p.64)
Vous lire, Alda Merini, c’est se demander : la poésie intéresse t-elle le poète ? N’est-elle pas, à l’instar de l’esprit, en dehors même de ce que nous nommons poésie ?
Vous éprouver, Alda Merini, c’est aussitôt revenir vers Artaud, à ce que lui-même « pensait » de la pensée et de la poésie, à savoir tous les moyens qu’il faut pour les libérer de ce qu’elles-mêmes s’infligent. Et puis, acquiescer quand il écrit : ce n’est pas l’homme mais le monde qui est devenu un anormal.
***
Il y a la lutte et il y a le goût pour vivre, il y a ce qu’il faut atteindre de soi et qui est inatteignable, il y a les débâcles pour nous dire les précarités de toutes choses. Il y a ce qui s’use, ce qu’il faut endurer. Il y a les deuils, il y a le chant qui tremble, pénétration, palpitation, la voix qui aime qui se plaint, le vivant à la lisière de ce qui s’efface de ce qui revient de ce qui n’a jamais disparu.
Et puis, il y a cette histoire, entre elle et lui. Alda Merini et Angelo Guarnieri. Cette amitié tendre et solide, qui dure désormais depuis 1995 .
Une relation entre personnes qui se téléphonent et se parlent avec plaisir, qui apprennent à se connaître et à se tolérer, qui s’échangent des dons, qui rient quand c’est amusant et se plaignent et se soucient quand les choses de la vie se tournent vers leur côté obscur… (Préface Angelo Guarnieri).
Vous deviner, Angelo Guarnieri, dans cette amitié vraie, dans ce temps de votre relation où l’amour est artisanat.
Contribution Nathalie Riera
***
Ensevelie
dans l’amour de tous,
je n’ai plus un souffle de jeunesse.
Je voudrais escalader des montagnes énormes,
embrasser les murs de ma maison,
me sentir sale pleine de boue.
Pourtant ici chaque jour
ils prennent soin de moi.
Et lentement ça m’éteint.
(p.63)
Sepolta
dentro l’amore di tutti,
non ho piu un respiro di giovinezza.
Vorrei scalare montagne enormi,
Baciare i muri della mia casa,
sentimi sporca di fango.
Eppure qui ogni giorno
hanno cura di me.
E questo lentamente mi spegne.
***
Tu ne m’aimeras jamais/Non mi amerai mai
a dit un jour Salvatore Quasimodo à Alda Merini
Parce que tu aimes le monde entier/Perché ami il mondo intero…
(p.106)

http://oxybia.free.fr/index.html
La note de lecture est également en ligne sur le site poésie ~ photo ~ écrits ~ éditions d'Aldébaran ~ passeurs un atelier http://www.loyan.fr/
15:48 Publié dans Alda Merini, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
VIENT DE PARAITRE
Une bande verte verdon
Christine Bauer
Editions Atelier Pictura, mai 2009
NOTE DE LECTURE
Par Nathalie Riera
«Rien n’est bon que ce qui vient tout seul. Il ne faut écrire qu’en dessous de sa puissance. »
Francis Ponge, Proêmes
Une bande verte Verdon : pas de place aux ressacs.
Immobilités, ondulations, jusqu’à parfois quelques enlacements, tout se tient à être détachement, sorte de tranquillité inlassable, indissoluble. Rien qui ne soit réfractaire. Rien dans la langueur. Même les ombres sont calmes.
Ce qui cesse n’est plus, ce qui cesse se transforme.
Christine Bauer salue tout ce qui lui fait signe simplement. De la même manière que tout ce qui fait intrusion, comme les saletés, les odeurs fortes…
Par ailleurs, elle écrit « scintillement », mais se refuse tout effet de magnificence. Juste une invitation à regarder de près. Prêter l’œil. C’est là qu’elle semble trouver son souffle, sa source. Là où le regard prend des chemins secrets. Où le regard ne sublime rien.
Le calme plat peut se perdre, la tempérance à tout moment troublée : ce qui se répète se renouvelle, s’aère.
De quoi est fait le poème ? surtout de refuser toute prostration, et de ce qu’il peut encore parfumer l’air.
Une bande verte Verdon : le poème est l’espace d’un jardin, d’une eau claire et limpide avec ses galets, d’un sous-bois dense et jaune, d’une rivière invisible. Le poème est l’espace de ce qui est paysage… inhabituel.
Toute cette magnificence, matinée exceptionnelle, ce paysage à couper le souffle, m’insupporte au fond. Une fois arrivée au sommet, je suis apaisée. Pas de vue imprenable, pas de gorges majestueuses, que du paysage « normal ».
Ainsi suis-je capable de tourner mon regard vers le sol, vers le petit, vers le non-spectaculaire, vers le détail, vers le fade…oui, vers le fade.
Lumière pour l’œil, pour le sol, pour l’infime, le quelconque.
Se trouver là, dans l’essentiel, dans la promesse des lieux, dans le frôlement des choses. Se laisser modeler par ce qui s’approche ou se resserre, par ce qui s’éloigne ou s’élargit.
Lumière pour l’inexprimé.
© Nathalie Riera, 20 juin 2009
Editions Atelier Pictura

12:04 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
16/06/2009
Brighton West Pier, Isabelle Guigou par Loyan
NOTE DE LECTURE
Brighton West Pier, d’Isabelle Guigou
par Loyan
Editions Le chat qui tousse, 2009
Dans « Mot à mot, l’écriture reconstruit / Pierre à pierre / L’appartement / T’y transporte / Te voilà jeune encore malgré tes cheveux blancs ». En 2007, dans Le parfum des pierres aveugles (éditions Clarisse), Isabelle Guigou avait su trouver le juste équilibre entre l’émotion restituée par la poésie et l’évocation d’une réalité douloureuse. Le Brighton West Pier que vient de publier Le chat qui tousse naît, de nouveau, du rapport entre un lieu et ce qu’en retranscrit la mémoire sensible de l’auteur.
Ce West Pier de Brighton, au sud de l’Angleterre, est une jetée du XIXème siècle sur laquelle se trouvaient échoppes et salles de concerts. Mais depuis plus de trente ans le lieu est fermé au public. « N’habitent / Le West Pier de Brighton / Qu’oiseaux et photographies anciennes / La passerelle métallique / S’incline / À genoux dans la mer/ Le temps rabote l’arrogance / L’approche du rien nous plie à l’essentiel / Là, un squelette / Que la mer démembre ».
Il y eut de la vie en ces lieux, de la joie, des relations tissées entre les êtres. Mais de là, comme de la maison familiale de Pézenas évoquée dans Le parfum des pierres aveugles, la vie s’est retirée, comme une marée descendante définitive. De la méditerranée à la Manche, l’évocation a changé de rivage mais aussi de dimension, passant du cercle familial à un lieu public désormais désaffecté. Le West Pier semble figurer la descente inexorable vers la mort tandis que la passerelle parallèle, la East Pier, « plus moderne / Avec ses grandes roues et autres attractions / qui vous décollent du sol / Rabâche / Nos rêves de dépasser / La terre ». Paradoxe à vouloir ainsi quitter le sol, car aller au ciel peut aussi bien signifier s’élever, spirituellement, que cesser de vivre.
Quelle quête poursuit Isabelle Guigou dans ce poème ? Peut-être « pénétrer la mer / Comme si nous pouvions féconder / l’éternité ». Qu’en espère-t-elle ? « Assise sur le bord / Tu attends que le flot t’insuffle / La semence de l’horizon ». L’eau et ses cycles, porteuse de renouvellement, quand bien même le point d’où on l’observe est vermoulu et laisse apparaître un squelette « que la mer démembre ». Tout ceci est exprimé sans afféterie, dans une juste distance entre le refus du cliché lyrique mais aussi du cliché prosaïque – une poésie à hauteur d’être, qui regarde le ciel et le sol dans un même mouvement circulaire et rend compte des deux plans, terrestre et céleste.
La poésie d’Isabelle Guigou sait poindre sans s’en gargariser. Elle vise juste sans s’en flatter. Cette humilité se retrouverait-elle dans ces vers, allant jusqu’à la négation de soi ? « Les vagues n’auront pas même / À rouler tes os : / Tu ne fus jamais que le débris / D’un toi impossible ». De ces quelques mots doucement assemblés, jaillit une dureté quasi nihiliste. Quasi, car la vague continue de rouler et apporte à la fin du poème, malgré la disparition programmée des bâtiments fermés du West Pier, « Une lueur d’espoir notre phare / Un mot / D’amour / Pour ceux qui voguent ».
Sur des thèmes aussi usés et chancelants que le rivage, la mer, la mort, l’appel du large, Isabelle Guigou place sa voix. Peut-on la dire moderne ? Elle apparaît surtout humaine et intemporelle et cela, sans réfuter l’interrogation contemporaine sur la fabrique du poème : « (L’écriture / Une parole sur pilotis / Que cerne et emplit / Le silence) ». L’aphorisme tombe juste lui aussi ; il a sa raison d’être dans le mouvement de ce texte à la fois ample et condensé (une quinzaine de pages au format carnet, comme l’affectionne Le chat qui tousse en la personne de son éditeur, Franck Cotet). Qu’Isabelle Guigou se rassure : oui, elle réussit à parler « à la mer comme à un dieu ». Oui, elle sait trouver le langage qui lie cœur, corps et esprit.
Un être juste, vraiment, jusque dans son écriture.
LOYAN
■ Lien : http://pagesperso-orange.fr/tiens/chatquitousse/
01:02 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
08/06/2009
PASCAL BOULANGER
PARUTION 18 juin 2009
Quatrième de couverture
Cherchant ce que je sais déjà
Editions de l’Amandier
Collection Accents graves, Accents aigüs
Auteur de plusieurs livres de poésie et d’essais sur cette dernière, Pascal Boulanger joue ici du paradoxe, convoquant la bibliothèque et témoignant d’une traversée où les drames de l’existence côtoient les noces du ciel et de la terre.
La délivrance du mal passe par sa connaissance et si la parole poétique commence par une descente aux enfers, elle porte aussi le germe d’une renaissance.
Dans cette quête de l’amour loin des résignés, loin des naïfs et avec des yeux de chair grands ouverts, le poème interroge avec insistance -Qui me donnera un baiser de feuille d’or/ pour que l’existence ne soit plus une faute ? - et nous renvoie à nous-même, dévoilant l’obscurité et la lumière, l’opacité et la transparence, la terreur et le salut afin de nous tenir là, dans l’échec et la question et dans la beauté des choses qui ne fait pas question.
Je sais ce que je sais
Sur la double route
Dans le souffle de ma respiration
Dans le feu que le sommeil abrite
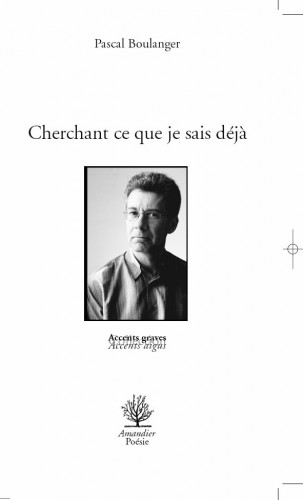
NOTE DE LECTURE
Nathalie Riera
« Il faut retirer sa foi de l’abîme. Il faut apaiser son cœur à observer de près une chose n’importe laquelle (…) Il faut surtout fermer l’abîme ».
Pierre-Jean Jouve, Proses, (p.235) Gallimard/Poésie.
« Ô Bellarmin ! qui donc peut dire qu’il se tient ferme, quand la beauté même mûrit à la rencontre de son destin, quand le divin même doit s’humilier et partager le sort des choses mortelles ! »
Hölderlin, Hypérion in Hypérion à Bellarmin (volume second, premier livre)
Etre au plus près des œuvres d’un poète, avec toute la distance qu’une telle intimité puisse exiger, c’est-à-dire sans fascination stérile. Concéder au « livre-poème » son pouvoir et sa volonté de faire musique parmi les choses. Décerner à celui qui Cherchant ce que je sais déjà une attention aussi dégagée que soutenue, comme réponse à cette évidence qu’il n’y a jamais rien à ignorer ou à renier, dans un monde où se joue sans cesse et sans concession toute la gamme des temps, dans une suite de contrastes qui font œuvre parmi les choses.
Partitions d’air et de feu, bienveillance et férocité des couleurs : là où Pascal Boulanger se tient, il n’y a pas toujours de ménagement possible. Juste se tenir dans l’extrême, c’est-à-dire là où le poète peut encore avoir désir de dire ce que les lèvres de l’homme peuvent garder d’amer, de froid, de tremblement intérieur.
La parole est aussi une forme, et cela dès lors que cette parole même est prononcée. Et ce qui se prononce dans la parole de Pascal Boulanger consiste à faire entendre que la foi, à l’égal du Verbe, dépasse d’abord la foi, au sens où P.J. Jouve préconisait que la foi soit retirée de l’abîme.* Tout grand poète nous rappelle, à sa manière, que le poète (parole jouvienne) « n’appartient qu’à sa parole ». Comme tout être n’appartient à rien d’autre qu’à sa propre histoire.
***
Au contraire de « Jamais ne dors » (Le Corridor Bleu, 2008) et ses chants amoureux, Cherchant ce que je sais déjà révèle la face douloureuse des séparations et des inquiétudes face aux proches. Est-il alors juste de penser que de la part de Pascal Boulanger ce dernier livre serait tentative de mémoire ? Mémoire dont les fils lumineux font aussi la détresse du chant. Emouvante ébauche qui fait dire : « Touchant l’étoffe qui sépare/- je ne veux plus que la mémoire humaine passe en moi ».
D’une séquence à l’autre, c’est le dénuement sans répit, ainsi la section nommée « Les ruines de la ville », qui témoigne d’une traversée en abîme, et où l’auteur lui-même se sent la proie d’un destin d’emblée verrouillé. Est-il par ailleurs besoin de préciser qu’une tentative d’anamnèse ne tient parfois qu’à un profond désir de grand silence. Quatre ans auparavant, dans Jongleur, (Comp’Act, La Polygraphe, 2005), l’auteur nous fait part de cette perspective : « Cependant, la vie que j’avais à vivre je l’avais déjà vécue/et il n’était plus question d’écrire ni de les écouter./Le tranchant du seul instant était devenu un point ».
Faut-il entendre par là un point final ? Mais à quoi ? N’y a-t-il plus de routes, plus aucun autre rendez-vous ?
Le premier cri – la buée des lèvres – le dernier souffle
la lumière et son attente
l’inexistence
le détour
le retrait
le silence
Je voisine par un abîme – je le sais – indistinct
cherchant ce que je sais déjà
***
Au cœur des drames, pas de communication possible, l’homme n’a pas vocation à trouver des réponses, mais au mieux peut-il poursuivre sa propre histoire sans cesser de faire incantation parmi les choses de la vie et les violences du monde.
Jusqu’avant les inquiétudes, le cœur a des couleurs aux ailes. Détonateur, il est ce qui nous fait partir sans nous dérober. Mais depuis longtemps déjà, il y a cette sorte de savoir, qu’il nous faut aussi vivre plusieurs autres lieux, ici ou là-bas, espérer possible ou impossible d’autres royaume, centre, espace complet… entre le vivant et le mourant. Vivre, c’est-à-dire affronter son propre exil et sa propre énigme. « Retour parmi les crimes de l’époque, les saisons de mort ». Sorte de chute qui ferme le paradis, et entraîne avec elle tous les sommeils « qui déplaçaient les montagnes ». Et à cela, comment ne pas crier, ne pas prier au sein même du grand silence :
Qui sait aimer sachant ne pas mourir ?
Je contourne les grabats du chantier
un chant glisse sur le parvis
omnia vincit amor
***
Est-ce faute d’exister ? ne devrait plus faire question, quand on sait cette autre sorte de vérité, pour ne pas dire de nouveau jour, auquel nous pouvons souscrire, même dans le plus haut déchirement, vérité conjointe à toute ruine qui ferme nos joies : éprouver et consentir que la vie nous est souveraine, indomptablement. Même au milieu des ravages elle est encore pourvue de cimes, et à jamais nous initie sa force. Ce n’est pas de la mort que naît le poème, mais de ce qu’il reste sous les décombres.
Pascal Boulanger a cet art non pas de hisser le poème mais de le faire couler, lui faire traverser tous les versants et les rives, jusqu’à ce qu’il se consume sur les sols les plus abrupts ; le sauver en quelque sorte du règne de la boue, où un grand pan de notre humanité contemporaine s’enlise. Fluidité qui assure également au poète de ne jamais cesser son invention.
Art également d’évoquer la relation de l’homme entre le clair et l’obscur, et du risque qui s’impose à notre existence :
C’est le risque du périple
- la gale démange celui qui erre dans la tourmente
- les dieux font tomber les vents
sur l’île qui se réinvente
Jamais de place pour la perdition absurde ! L’homme vit ou ne vit pas une vraie bataille.
***
Etre au plus près d’une voix qui rugit et rougit, parce qu’il y a encore espoir et toujours désespoir, le dire de tout poète est-il justement de ne plus se borner de dire, mais dire autre chose, ce qui ne veut pas dire le dire autrement.
Etre au plus près d’un désir, qui peut ressembler à ce tranchant devenu un point : dire qu’il en est assez, ou alors choisir de se rendre sourd à toutes envolées emphatiques, aux tristes chimères, aux pourrissements et autres attractions morbides, aux fausses batailles, à la vitesse qui a supplanté la contemplation, et à la nuit qui « ne ramène plus la volupté ».
Ecrire Cherchant ce que je sais déjà, comme preuve que de « se rendre au sol » n’est pas une vaine action, et que celle-ci nous rappelle que nous disposons d’un espace qui nous est à tous commun, espace clos à traverser, pour probablement un retour vers autre chose de proche, et qui touche à notre propre grandeur.
© Nathalie Riera, 30 avril 2009
NOTICE
Bio/Biblio
 Pascal Boulanger, né en 1957, vit et travaille, comme bibliothécaire, à Montreuil. Parallèlement à son travail d’écriture, il cherche depuis une trentaine d’années, à interroger autrement et à resituer historiquement le champ poétique contemporain qui, pour lui, passe aussi par la prose. Marqué par la poésie rimbaldienne et le verset claudélien, il a donné de nombreuses rubriques à des revues telles que Action poétique, Artpress, Le cahier critique de poésie, Europe, Formes poétiques contemporaines et La Polygraphe. Il a été responsable de la collection Le corps certain aux éditions Comp’Act. Il participe à des lectures, des débats et des conférences en France et à l’étranger sur la littérature et il a mené des ateliers d’écriture dans un lycée de Créteil en 2003 et 2004.
Pascal Boulanger, né en 1957, vit et travaille, comme bibliothécaire, à Montreuil. Parallèlement à son travail d’écriture, il cherche depuis une trentaine d’années, à interroger autrement et à resituer historiquement le champ poétique contemporain qui, pour lui, passe aussi par la prose. Marqué par la poésie rimbaldienne et le verset claudélien, il a donné de nombreuses rubriques à des revues telles que Action poétique, Artpress, Le cahier critique de poésie, Europe, Formes poétiques contemporaines et La Polygraphe. Il a été responsable de la collection Le corps certain aux éditions Comp’Act. Il participe à des lectures, des débats et des conférences en France et à l’étranger sur la littérature et il a mené des ateliers d’écriture dans un lycée de Créteil en 2003 et 2004.
Il a publié des textes poétiques dans les revues : Action poétique, Le Nouveau Recueil, Petite, Po&sie, Rehauts…
Parmi les études qui lui ont été consacrées, signalons celles de Gérard Noiret dans des numéros de La Quinzaine Littéraire, de Claude Adelen dans Action poétique, d’Emmanuel Laugier dans Le Matricule des anges, de Bruno Cany dans La Polygraphe, de Serge Martin dans Europe, de Nathalie Riera sur le site Les carnets d’Eucharis ainsi qu’une analyse formelle de Jean-François Puff (sur le recueil : Tacite) dans Formes poétiques contemporaines.
Certains de ses textes ont été traduits en allemand et en croate.
Livres :
Septembre, déjà (Messidor, 1991)
Martingale (Flammarion, 1995)
Une action poétique de 1950 à aujourd’hui (Flammarion, 1998)
Le Bel aujourd’hui (Tarabuste, 1999)
Tacite (Flammarion, 2001)
Le Corps certain (Comp’Act, 2001)
L’émotion l’émeute (Tarabuste, 2003)
Jongleur (Comp’Act, 2005)
Les horribles travailleurs, in Suspendu au récit, la question du nihilisme (Comp’Act, 2006)
Fusées et paperoles (L’Act Mem, 2008)
Jamais ne dors (Corridor bleu, 2008).
A paraître en 2009 :
Cherchant ce que je sais déjà (Editions de l’Amandier)
L’échappée belle (Wigwam)
Anthologies :
Histoires, in Le poète d’aujourd’hui par Dominique Grandmont, Maison de la Poésie Rhône-Alpes, 1994.
L’âge d’or, in Poèmes dans le métro, Le temps des cerises, 1995.
Grève argentée, in Une anthologie immédiate par Henri Deluy, Fourbis, 1996.
En point du cœur, in Cent ans passent comme un jour par Marie Etienne, Dumerchez, 1997.
Ça, in 101 poèmes contre le racisme, Le temps des cerises, 1998.
Le bel aujourd’hui (extrait), in L’anniversaire, in’hui/le cri et Jacques Darras, 1998.
L’intime formule, in Mars poetica, Editions Skud (Croatie) et Le temps des cerises, 2003.
Dans l’oubli chanté, in « Les sembles » par Gilles Jallet, La Polygraphe n°33/35, 2004.
Jongleur (extrait), in 49 poètes un collectif par Yves di Manno, Flammarion, 2004.
Parmi ses études et ses entretiens :
Henri Deluy, Un voyage considérable, in Java n°11, 1994.
Gérard Noiret, Une fresque, in La sape n°36, 1994.
Marcelin Pleynet, L’expérience de la liberté, in La Polygraphe n°9/10, 1999.
Philippe Beck, Une fulguration s’est produite, in La Polygraphe n°13/14, 2000.
Jacques Henric, L’habitation des images, in Passages à l’acte n°1/2, 2007.
22:51 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
22/04/2009
Psaumes - Paul Claudel (une lecture de Claude Minière)
Paul Claudel, Psaumes, - Traductions 1918-1953
Gallimard, 2008
NOTE DE LECTURE………
« La manière que j’ai eue de mettre un pied devant l’autre, tout de même il est temps d’y songer, et toute cette écriture que j’ai écrite avec ma langue. » (Ps. 38) La réécriture des Psaumes telle que la pratique Claudel donne une excellente occasion de « voir » sa poésie. Répétitions, variations, corrections, épuisement, nouvel élan. Un pas en arrière pour mieux sauter. Langue cultivée ou des « simples », réclamations d’enfant têtu, emphase, demande nue, pression, humilité…Claudel mobilise toutes les capacités de sa lyre. « Regardez mes doigts sans aucun bruit dans le rayon de soleil qui essaient la harpe entre mes genoux : il y a dix cordes » (Ps. 32). L’instrument est toujours le même mais les changements de clef sont abrupts, selon le jour et l’heure, entre 1918 et 53. On croit entendre un écho d’Hölderlin : « L’homme, avec tout cet honneur qui lui sied, n’a pas compris » (Ps. 48), et puis c’est Homère : « Dieu va au secours du matin avec l’aurore »(Ps. 45). Le combattant échappe à ses poursuivants : il est debout sur le verset, converti, envers et contre tout dans les revers. « Egorge-Moi la glorification ! »(Ps. 49), voilà comme Claudel se permet de faire parler Dieu. Ou bien : « la beauté de la campagne est avec Moi. ».
Claude Minière
 « Les psaumes, ça n'est pas fait pour dormir dans des vieux livres poussiéreux, ni pour être ânonné ou roucoulé sur des airs qui manquent d'air, de beauté, de culot. C'est fait pour vivre aujourd'hui, louer, crier, pleurer, prier, danser ce qui fait le fond et l'arrière-fond de notre présent avec toute la panoplie des douleurs, espoirs, tristesses, joies.
« Les psaumes, ça n'est pas fait pour dormir dans des vieux livres poussiéreux, ni pour être ânonné ou roucoulé sur des airs qui manquent d'air, de beauté, de culot. C'est fait pour vivre aujourd'hui, louer, crier, pleurer, prier, danser ce qui fait le fond et l'arrière-fond de notre présent avec toute la panoplie des douleurs, espoirs, tristesses, joies.
Plutôt que de les retraduire, Paul Claudel a voulu les répondre comme l'écho, en les recréant en toute liberté dans cette langue charnelle, baroque, bruissante qui fait son génie.
Le résultat est explosif. »
Guy Goffette (Préface)
16:51 Publié dans Claude Minière, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Paul Claudel | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
16/04/2009
Une lecture de Nathalie Riera
Mathieu Brosseau
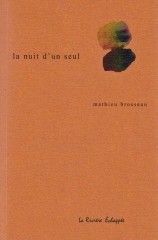
la nuit d’un seul
La Rivière Echappée, mars 2009
(IV )
Ici, disparaître. Circonscrire ce rien, cet ajout de soi, ce dérèglement du regard. Dans le sort d’être et le déroulement de la formule. Se dénouer dans l’équation. Sa valeur sacrilège dans le ventre de l’Initiale s’exécute, ici, sur le passage des mondes…, ici, by its very absence.
(p.32)
Rêve et chair cherchent alliance. Ils sont vie, sont mouvement, sont ce qui se perpétue sur le sol natal, c’est-à-dire disposés à toutes les métamorphoses.
*
En soi ne cesse de se conjuguer or et mort, prairie de l’abîme ou « mélodie du labyrinthe ». Rien de mortifère, mais seulement ici, disparaître. Ou en finir, mais en finir avec quoi précisément ? Ce temps humain tout fait de fictions. Chimères, inventions, narrations de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, et de tout ce qui nous vit, nous happe, nous possède.
Savez-vous
ce qu’il faut de
chimères
pour faire du continu… ?
*
Il n’y a pas de double de soi, mais le témoin de soi, ou témoin de votre mort, tout contre vous depuis le commencement de votre histoire, Toujours présent comme un astre jumeau. Et puis, il n’y a pas seulement ce qui avance à l’endroit, le chemin pris est toujours un retour. L’essentiel retour, comme essentiel est ce qui meurt, est ce qui ne peut périr... il nous faudra/nous mourir pour nous redevenir il nous faudra/aller en sens inverse.
Enigme et dualité de ce qui nous anime et nous divise. Tristesse et lumière. La nuit d’un seul est une invitation à ce qui est chair, sel, éther, à la parole qui ne bavarde pas, aux lèvres qui se veulent libres, ne pas se dessécher, et puis, à ce que l’on peut encore atteindre par le langage à chaque pas, un retour à soi par l’expérience poétique, sans se retourner, c’est-à-dire repartir.
Le songe de vivre et le fruit du rêve sont ce rien et ce tout, sont ce qui nous font tourment, mais pour Mathieu Brosseau il faut tristesse pour se redresser, et puis, Le feu pour sortir de l’autofiction. Le feu comme seule issue à la nuit.
*
Nous sommes ce qui cherche autre chose. Nous sommes ce qui nous lie au temps sans couleur. Nous sommes ce que nous voyons, ce qui est su et qui est inconnu de nous. Ce que je vois et ce que je suis, ce que je m’apparais et ce que je disparais totalement. Ce que j’ai aussi les yeux blancs d’un aveugle.
Ce qui nous lie nous mène à la source, hors du centre. Ce qui nous lie : volatil, aérien, coagulation.
Il y a être poète pour encore écrire, ne pas écrire, encore dire, ne pas dire. Pour être perméable comme tulle au vent (…) perméable comme gaze au soleil. Comme il y a de rêver pour son âme qu’elle retrouve l’aurore des merveilles. Comme il y a être cet enfant qui pleure de revenir au monde, et qui dit ce refus de vivre, ce cri de vie.
A la page 63 : « L’automne est notre fin, aussi. Légèreté déconcertante des feuilles, moutons de poussière volants entre les édifices, spectacle sans souffle, vision aveugle. Etouffé, le monde se tait. Cet octobre en lieu et place du linéaire, l’arrêt du cœur et de la sève montante. Tissu du continu en dehors des cycles qui ponctuent notre corps de corde. Chambrée de comètes vives, ces enfants sont nos parents, notre arrière en place des astres dormants. Ils ont le rire du fracas et la langue qui devine le dessous des pierres, ce sol, ce tapis de terre. »
*
Ce recueil, nous dit son auteur, recouvre plus de cinq années d’écriture/étude, dans le tourment et l’absorption de « la question de l’Autre insondable et la volonté de casser l’incassable relation sujet-objet ».
Où se situe la poésie de Mathieu Brosseau ? Lui-même répond, au sujet de ce recueil précisément : « combien je suis livré à interroger la parole comme instance sous-jacente au langage, comme puissance évocatrice non (encore) verbalisée. Et du mouvement qui amène cette parole à s’accoucher d’elle-même, naît une écriture non narrative, structurée comme un au-delà prescient. Là se situe ma poésie. »
A la manière d’un Jean Tardieu, Mathieu Brosseau ne se veut-il pas « désert et transparent afin de devenir un piège pour les mots » ? ou, à la manière d’un Georges-Emmanuel Clancier, se demander : « Mais qui dira si je vis ou meurs ? »
La poésie est là où le chant se courbe et se recourbe, où l’horizon s’éprouve, là où le poète marche, où lui-même est aventure éperdue. Poésie sous le signe de la chair.
Contribution publiée sur poezibao le 27 février 2009
©Nathalie Riera, Notes de lecture 2009 - Toute reproduction interdite.
Cliquez ci-dessous :
 Né en 1977 à Lannion dans les Côtes d’Armor, Mathieu Brosseau est bibliothécaire à Paris. Il a publié deux ouvrages : L’Aquatone et Surfaces : Journal perpétuel. Plus récemment et en collaboration avec Thierry Le Saëc, il a publié Dis-moi, un livre d’artiste aux éditions La Canopée/La Rivière échappée. En 2006, il fonde la revue en ligne plexus-s.net et depuis 2008 il codirige avec François Rannou la collection L’Inadvertance sur le site publie.net. Il a également publié dans de nombreuses revues : Action Resteinte, Ouste, Dock(s), Boudoir & autre, L’étrangère, etc.
Né en 1977 à Lannion dans les Côtes d’Armor, Mathieu Brosseau est bibliothécaire à Paris. Il a publié deux ouvrages : L’Aquatone et Surfaces : Journal perpétuel. Plus récemment et en collaboration avec Thierry Le Saëc, il a publié Dis-moi, un livre d’artiste aux éditions La Canopée/La Rivière échappée. En 2006, il fonde la revue en ligne plexus-s.net et depuis 2008 il codirige avec François Rannou la collection L’Inadvertance sur le site publie.net. Il a également publié dans de nombreuses revues : Action Resteinte, Ouste, Dock(s), Boudoir & autre, L’étrangère, etc.
15:41 Publié dans Mathieu Brosseau, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
09/03/2009
Sermons aux oiseaux - (Lecture de Brigitte Donat)
François Cassingena-Trévedy :
Sermons aux oiseaux
Cinquante homélies pour le temps qui demeure
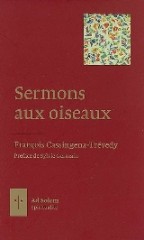 Préface de Sylvie Germain
Préface de Sylvie Germain
Ad Solem , Genève (Suisse)
Parution : décembre 2008
Nous aurions tort de devenir des oiseaux de mauvaise grâce, sourds, rétifs aux sermons. Car le sermon, plus précisément l’homélie est un genre d’expression musicale : un rondeau de la Parole qui revient sur elle-même en ouvrant un espace infini.
François Cassingena, moine bénédictin, retourne inlassablement aux Ecritures et s’abouchant à la Parole, s’en fait l’instrument. Descendant sans fin de la Montagne, elle prend son essor, se déploie, nous exhorte d’aimer et louer Dieu. Brillant exégète, l’auteur possède cependant l’art de transcender une nécessaire rhétorique au bénéfice d’une poétique. N’est-elle pas essentielle au Verbe afin qu’il s’éprenne de notre chair, pousse le lecteur à s’alléger, à s’enchanter davantage ? Séminale, subversive, elle est sœur de la foi qui opère des déplacements, étant bien entendu que le premier arbre qu’elle déracine comme la première montagne qu’elle transporte, c’est nous-même. Invité à l’habitation du désert, c'est-à-dire le dedans, nous serons amenés à découvrir que cette région de l’homme est immense. Elle délie le regard pour voir que les Trois Noms sont écrits sur toutes les fleurs des champs.
Sermon aux oiseaux rappelle que la Parole s’espace de silence. Laisse immense de Jésus en son retirement. Laisse marine. Jésus est une mer et sa laisse est l’amour.
Brigitte Donat
08:56 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
28/02/2009
Mathieu Brosseau
cliquer ici : Une lecture de Nathalie Riera sur le site Poezibao
 Né en 1977 à Lannion dans les Côtes d’Armor, Mathieu Brosseau est bibliothécaire à Paris. Il a publié deux ouvrages : L’Aquatone et Surfaces : Journal perpétuel. Plus récemment et en collaboration avec Thierry Le Saëc, il a publié Dis-moi, un livre d’artiste aux éditions La Canopée/La Rivière échappée. En 2006, il fonde la revue en ligne plexus-s.net et depuis 2008 il codirige avec François Rannou la collection L’Inadvertance sur le site publie.net. Il a également publié dans de nombreuses revues : Action Resteinte, Ouste, Dock(s), Boudoir & autre, L’étrangère, etc.
Né en 1977 à Lannion dans les Côtes d’Armor, Mathieu Brosseau est bibliothécaire à Paris. Il a publié deux ouvrages : L’Aquatone et Surfaces : Journal perpétuel. Plus récemment et en collaboration avec Thierry Le Saëc, il a publié Dis-moi, un livre d’artiste aux éditions La Canopée/La Rivière échappée. En 2006, il fonde la revue en ligne plexus-s.net et depuis 2008 il codirige avec François Rannou la collection L’Inadvertance sur le site publie.net. Il a également publié dans de nombreuses revues : Action Resteinte, Ouste, Dock(s), Boudoir & autre, L’étrangère, etc.
La Nuit d’un seul
Mars 2009 - Editions La Rivière Echappée
00:15 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
21/02/2009
L'Apparition - Yves Goulm
(LES ENCRES D’ISAAC CELNIKIER)
Editions Albiana, 2007
-Quatrième de couverture-
Jamais il n’écrivit sur Piotr dans son hebdomadaire. Il n’en fit jamais le portrait. Comment aurait-il pu ? Qui pouvait écrire sur ses Têtes ? Personne. Personne n’écrivait comme il gravait. Personne n’avait jamais écrit comme il gravait. Qui écrirait un Visage pour l’hachurer ensuite, pour le strier de suie ? Qui bâtirait le poème de la Face pour le raturer ? Qui rimerait la littérature de la Face pour la biffer avec frénésie une fois l’harmonie atteinte ? Qui parviendrait à faire apparaître une Révélation, à faire se révéler une Apparition pour l’encombrer de gribouillis, pour la charger, la surcharger ? Qui traquerait le beau en mots tissés pour mieux le rayer, le dérayer par les sillons du laid, les souillures de l’effacement ?
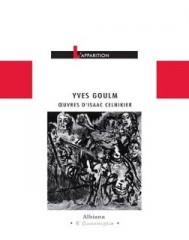 -En un mot…-
-En un mot…-
Par Nathalie Riera
Puisque peindre c’est transcender le monde avait-il dit à Edouard, alors le monde sera ma toile.
Piotr peint des têtes, rien que des têtes, mais pas n’importe quelles têtes. Trente gravures, la Tête I, la Tête II… « Trente Têtes saturées comme pièces maudites » que son ami Edouard, dont l’amitié précieuse l’aide à vivre, veut les confronter au public, lui faire rencontrer ces Têtes, et permettre en même temps au peintre de sortir de son atelier et de sa solitude. Une exposition est organisée dans une galerie, mais Edouard ne peut s’empêcher de remettre en cause ce projet qu’il considère inepte :
Comment avait-il pu insister, et insister encore, et encore, à le sortir de sa réclusion volontaire pour l’entraîner dans cette fange ? Et, surtout, pire que tout comment avait-il pu envisager par quel miracle les œuvres de Piotr supporteraient le choc d’être confrontées aux non-regards, aux regards éteints et aveugles, aux regards vides d’yeux ? Comment avait-il pu concevoir cette rencontre de têtes ?
Dès les premières pages, le ton est donné. Une situation singulière, avec un Edouard en culpabilité, un Piotr pris d’hébétude et de panique, tous deux versés au milieu d’une cacophonie, d’une masse de gens aux conversations futiles et verbeuses, si peu attentifs aux horribles créatures de Piotr : plus personne n’y prêtait attention, si tant est que quiconque en eût seulement l’intention. Ces Têtes gâchaient presque le plaisir des conviés.
(…)
Comment avait-il osé croire que ces sublimes laideurs, ces laides beautés, ces Têtes extirpées de la tribu des damnés recevraient autre chose que le dédain d’un temps où le factice et le clinquant triomphent ?
Un livre qui, pour l’éditeur des Editions Albiana, se confronte à de vraies questions.
-Extraits-
Ci-dessous : Tète 1, 1996 gravure, 1981, pointe-sèche, 11 x 11
 Ils pleurèrent un mélange d’eau et de sang, d’eau de sang, de rage et d’écoeurement, d’eau d’étang saumâtre, de mare flasque, de flaque aux eaux mortes et fangeuses où le moustique abonde, eaux de marécages, eaux dormantes où règne la touffeur. Chacun son royaume, chacun son trône et son spectre. Roi des flaques d’eau sales, roi des mares d’eaux de boue, roi des étangs d’eaux stagnantes, roi des écoulements huileux, les eaux de haut-le-cœur, roi des eaux de rage, roi des eaux de sang, suceur de sang, vampirique diktat, nécrophilique édit.
Ils pleurèrent un mélange d’eau et de sang, d’eau de sang, de rage et d’écoeurement, d’eau d’étang saumâtre, de mare flasque, de flaque aux eaux mortes et fangeuses où le moustique abonde, eaux de marécages, eaux dormantes où règne la touffeur. Chacun son royaume, chacun son trône et son spectre. Roi des flaques d’eau sales, roi des mares d’eaux de boue, roi des étangs d’eaux stagnantes, roi des écoulements huileux, les eaux de haut-le-cœur, roi des eaux de rage, roi des eaux de sang, suceur de sang, vampirique diktat, nécrophilique édit.
(p.35)
C’était un regard de désert, une terre d’yeux à l’aridité calleuse, un regard aux yeux de sécheresse, un regard de sable, un regard de tempête de sable, un regard de dunes, un regard ardent, un regard d’erg. C’était une immensité calcinée et grillée, un regard sans autre végétation que des arbustes épineux, un regard sans autre faune que lézard et scorpion, le serpent pour animal, le cactus pour végétal. C’était un regard de dard et d’épine, un regard des contrées immenses aux épouvantables chaleurs diurnes et froideurs nocturnes, un regard flou d’horizon incertain, la netteté de la ligne troublée, vaincue, distordue par les torrides torsions de la canicule, un regard dur de croûtes misérables, un regard calleux de crevasses et de gerçures. C’était un regard sans sources, sans puits, sans pluies, sans oasis, sans mirages et sans rêves, un regard sans trêve de soif, une soif que plus aucune ondée n’aurait épanchée, une soif que l’eau n’apaise plus. C’était un regard de traversée de désert sans nul but, sans boussole. C’était un regard dur d’une dureté muette.
(p.100)
Les gravures sont d’Isaac Celnikier, né à Varsovie en 1923, enfermé au ghetto de Byalystok de 1941 à 1943, et qui a reçu le Prix Mémoire de la Shoah de la Fondation Jacob Buchman en 1993.

Gladys, 1985 huile sur toile, 81 x 65
« La poésie pour réconcilier les âmes »
sur le site Paysages bretons
21:40 Publié dans 4EMES DE COUVERTURE, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Isabelle Zribi
Vient de paraître
Tous les soirs de ma vie
Ed. Verticales, février 2009
Note de lecture de Pascal Boulanger
Il est beaucoup question, dans ce très beau récit d’Isabelle Zribi, de désolation, de voix négatives et pessimistes, d’idiotie et de malchance, de nuits qui tombent en plombant l’existence…autant de scènes répétées qui révèlent, chez la narratrice, un désespoir lucide et profond. Il y a du Antoine Roquentin chez elle – rien jamais n’arrive, rien n’est nécessaire – chaque événement se voile ou bien, quand il pourrait surgir, il est déjà au bord de sa disparition nauséeuse.
Face à un réel qui ne se manifeste que par son absence ou sa défaillance, ce sont les attentes, les indécisions et les faillites qui résonnent à chaque page de ce récit. Et pourtant, des possibles autour de la fenêtre hölderlienne de l’enfermement survivent dans les lointains de l’amour. Et pourtant, Tous les soirs de ma vie est sans doute le récit le plus apaisé de Zribi car il propose aussi une rencontre et une fugue, avec une mystérieuse C., épiphanie offrant soudain un ressaisissement et une espérance. Ce livre brûle de ce qui fait obstacle à la présence. L’enjeu d’écrire consiste alors à questionner, dans un humour grinçant, une existence – la nôtre – monotone et vide. Face à la neutralité exacerbée, à la maladie de la répétition et de la tiédeur, nous ne sommes plus que des ombres muettes, plongées dans l’indifférence du monde. Plus d’immanence, encore moins de transcendance, mais le relevé froid et lucide de notre passion – notre souffrance – puisque rien ne peut excéder l’existence et sa banalité affligeante.
Flannery O’Connor, en bonne catholique, l’a exprimé : plus vive sera l’exigence de vivre plus évident risque d’apparaître le vide qu’on a sous les yeux. Zribi, triste par excès d’optimisme, traverse le négatif, y séjourne même, pour mieux déjouer nos illusions.
Pascal Boulanger
21:36 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
07/02/2009
Marco Ercolani, Lucetta Frisa - Courts-circuits
Réponses possibles à des questions imaginaires…………………………
Traduction de Sylvie Durbec
Extrait
Provoquer des courts-circuits
Quelques écrivains actuels, assez désinvoltes pour se détourner des origines et des racines de la littérature, écrivent des choses qui ont déjà été écrites des années auparavant, avec la présomption de renouveler de fond en comble l’écriture, d’être les premiers à voir la force et l’originalité d’un style, le leur. Une originalité qui se caractérise par l’amnésie, peut-être volontaire, du travail des générations précédentes. Au lieu d’être conscients de leurs choix personnels, ils se posent en prophètes de leur petite Weltanschuung sur le monde. Ils se construisent leur propre lexique dans une langue vidée à force de pauvreté, sereine par omission. Le péché originel de ces écrivains est bien leur manque de curiosité envers leurs prédécesseurs et leur absence désolante d’imagination. Se sont-ils jamais demandé si le fil rouge qui unit les générations est seulement la petite madeleine personnelle, la magique Rosebud de Welles et pas plutôt ce «fragment en forme de cube de la conscience haletante » dont parle Pasternak et qu’il recherchait dans tout livre ?
Télécharger le texte : courts circuits.pdf
13:55 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Gaston Bachelard
Lettres à Louis Guillaume
(Editions La part commune, décembre 2008)
Extrait
Un petit traité d’émerveillement
Préface de Jean-Luc Pouliquen
La correspondance de Gaston Bachelard (1884-1962) est à ce jour, dans sa plus grande partie, encore inconnue de tous ceux qui sont attentifs à son parcours exceptionnel dans la philosophie des sciences et de l’imaginaire. Avec le temps, elle remonte peu à peu à la lumière, s’échappant des tiroirs, des dossiers, des archives de ses nombreux interlocuteurs, quittant ainsi la sphère privée pour devenir accessible à tous. Tel est le processus qui se met en route après leur mort, autour des grandes figures de la création intellectuelle, littéraire et artistique ; une curiosité irrépressible pousse la collectivité à mieux connaître ce qui a entouré l’oeuvre, en constitue son soubassement.
Télécharger le document![]() Préface Lettres à Louis Guillaume.pdf
Préface Lettres à Louis Guillaume.pdf
13:53 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
02/02/2009
Philippe Sollers
Les Voyageurs du Temps
Editions Gallimard - Collection Blanche - Roman
256 pages - 17,90 €
A77977 - ISBN : 9782070779772
NOTE DE LECTURE
Claude Minière
Conditions de la critique
Il est au fond assez rare que soit dite l’expérience extatique (poétique) du temps comme surgissement. Cette expérience ne se place pas dans la continuité des affaires ordinaires mais marque un saut qualitatif, une espèce de décrochage où vous devenez rassemblé au cœur de l’intelligence et de la Bête. Quand c’est dit – et ce l’est magnifiquement dans Les voyageurs du temps – les critiques professionnels réagissent avec gêne (il serait instructif d’établir le relevé des divers contournements auxquels ils s’emploient).Les journalistes alors tatillonnent, cherchent la petite bête (« faux roman » !), ressortent les mêmes routines (« masques » !). Il faut pour eux que cette expérience ne soit que relative, à diluer au cours de tables rondes, alors qu’elle est proprement indiscutable. D’où la nécessité pour l’écrivain d’une guérilla aux méthodes semblables à celles que T.E. Lawrence définissait. Rimbaud, Hölderlin, Zhuangzi (« La Perfection »), Pound,…sont-ils passés ? Voyez Sollers.
Qu’à travers les siècles un poète ressuscite est dans « la nature des choses » (De rerum natura). Sollers cherche les lois et phénomènes de cette Nature et la forme-roman lui permet d’exposer au quotidien, sans posture idéologique, un parti-pris de l’Etre. Visiblement le style ici perturbe le ron-ron journalistique.
En librairie depuis le 8 janvier 2009
« Je viens du Centre de tir. Quelques bavures pour commencer (fatigue, souffle court), et puis précision. Je ne sais plus quel poète américain a écrit ces deux vers : "Paradis calme/Au-dessus du carnage". C'est mon état d'esprit à l'entraînement. En haut, si j'arrive à penser le moins possible, ciel bleu, calme lumineux. En bas, explosion et larmes.
Je me concentre sur le mot "mot". Je le vois là-bas, dans la ligne de mire. Il respire un peu, il grandit, c'est lui que je vise, que je veux toucher et trouer. MOT. Avec une lettre de plus, c'est MORT. En anglais, ça ferait WORD et WORLD. Je tire sur la mort, je tire sur le monde. Petite plaisanterie, mais qui fait du bien. Ma voisine de stand, Viva, me félicite d'avoir mis dans le mille. Je ne sais rien de ses activités, ni elle des miennes. On se sourit, ça suffit. » Extraits Gallimard
7 questions posées à Philippe Sollers
Qui sont ces « Voyageurs du temps » du titre ?
Quel sens donner à la formule « Le temps il ne passe pas, il surgit » ?
...
Lire l'article de Jacques Henric

14:37 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe sollers;les voyageurs du temps |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
12/01/2009
la huitième écorce - Gil Pressnitzer
Dans le cercle de l’arbre
(note de lecture)
« les éclairs se sont cachés dans l’arbre
et attendent que le tonnerre ait fini de compter
en bas dans un courant d’air les visages des hommes
ils entourent l’arbre
ils maudissent celui qui est dans l’écorce
où je vis à double tranchant… »

Cathy Garcia
« la huitième écorce »
Gil Pressnitzer
Trident neuf éditeur, 2005
Peau de l’arbre dans l’expression la plus courante, dont la transparence se perd au fil du vieillissement des cellules, rhytidome chez les botanistes pour désigner la partie morte de l’écorce… écorces à épines, fleurs, fruits, écorces papyrifées… écorces aux couleurs et aux textures multiples, dont les rôles ne nous sont pas totalement inconnus même si notre méconnaissance nous fait oublier leur fonction fondamentale, entre autre celle de nourrir protéger purifier.
Les blessures de l’écorce sont fréquentes. Dans la huitième écorce de Gil Pressnitzer, il est question de dire que nous ne vivons pas que de nos blessures mais aussi de nos échappées hors des blessures. Dire aussi ce trop de nuit pour dire nos blessures, ce pas assez de jour, des mots qui vous prennent la gorge, des mots tus qui suffoquent en moi et ne trouvent pas la sortie (…) attention s’ils ressortent sauvages ils maudiraient les herbes. Mais autant d’échappées qui consistent à nous défaire de quelle écorce ? et de combien de peaux mortes ?
L’arbre et ses écorces comme autant de pages tournées, consumées.
Chez Gil Pressnitzer il y a aussi la violence de l’Histoire : des cendres ne restent que les insomnies, et plus loin : il se love dans la peur des champs de barbelés.
je suis le témoin interne de l’arbre
j’écris son journal intime sur la huitième écorce
nul n’y lira rien
moi-même on va me crever les yeux au dernier mot
(…)
la huitième écorce
vous rentre la vie au fond de la gorge
le rouge à lèvres du sang déteint sur nos bouches
La vie avec ses écorces noirâtres, ses écorces brun-rougeâtres. Nos vies à ne pas être en dehors de l’écorce, à vouloir (ou aspirer) sortir de l’écorce. Pour quel savoir ? Pour quelle vérité ? ah sortir de l’écorce/pour enfin savoir/comment les feuilles tremblent/d’être simplement dans l’air.
Du vert chlorophylle vient se loger dans l’évidence de ce qu’il a bien fallu vivre/au nom de la parole.
j’entasse dans la huitième écorce
en plein mitan
tous les noms de mes morts
bien rangés
au frais de l’oubli à venir
l’écorce jette un cri
la haine de la nostalgie
entrer dans le cercle de l’arbre… de la première écorce à la huitième écorce… dans l’écorce où doigt et âme se laissent prendre.
Mots à la rugosité des écorces, à la fragilité de ce qui est sur le point de se détacher par plaques, écorces de mots qui s’effritent (poussière, sciure, usure) … mots des éclats de bois… mots des lichens qui envahissent les bois mort…
à vif.
Nathalie Riera
12 janvier 2009
« un jour un jour
nous serons l’un contre l’autre
dans la même goutte d’eau
(…)
un jour un jour nous vivrons ensemble dans
cette goutte d’eau
la vie vue de ce vitrail sera jeune
et fera trembler nos peaux… »
la bouche d’où sort la nuit
nous étions là avant l’histoire
toi qui t’étends sur l’arbre comme texte de mémoire
tatouage de prières sur rumeurs du jadis
moi enlisé dans tous mes noms
qui me creuse en bas dans la chair
les larmes sont souffles quand la terre se tourne
nous nous guettons chacun dans ses insomnies
nous épions le commencement de l’autre
la bouche d’où sort la nuit nous dénonce
nous pousse à faire amitié comme fougères
à devenir lien pour la complicité des tueurs d’oubli
tes conquêtes montent haut au-delà du bruit
toi la huitième écorce tu auras fait de moi une rumeur
mes écritures me rejettent jusqu’à l’absence
me frotter sang contre mousse a fait de moi ton ombre portée
tu te suffis à toi-même
avec moi enclos dans mes tremblements
depuis longtemps
nous étions là avant l’histoire
qui va céder le premier
qui va commencer l’oubli
qui va lire l’autre jusqu’au blanc
la confiance s’est perdue dans les météores
le premier qui s’endort est mort
nous partageons un seul miroir
une seule peau
vieux couple lié par la ténèbre
dans le même lieu
par le seul mot
la même patrie de ciel
à quelle distance intérieure dois-je me tenir de toi ?
rends-moi l’ombre d’où je viens
laisse-moi instant de passage
je ne veux plus être durable
meurs avant moi
22:33 Publié dans Gil Pressnitzer, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
14/11/2008
Note de lecture
Gilbert Bourson
« Congrès »
Editions Imp Act d'Ici&ailleurs
Le mystère du langage est que son rapport au monde est dérobé.
Conversions Poèmes de la Presqu’île
Michel Deguy
Brigitte Donat (note de lecture)
Gilbert Bourson avec Congrès orchestre un monde poétique à partir d’une figure aimée qui s’est retirée. Est-ce pour oblitérer le manque, conjurer la perte que la langue prolifère « congresse dans ses concavités » ?
Si le thème de l’absence à son habitude désertifie le monde, ici, bien au contraire, il entraîne à sa suite une profusion de signes dont la langue amoureuse s’empare.
La strophe seule délimite l’espace, elle crée l’ordonnance des circulations inouïes, où tout bruit, se multiplie, se détache sans fin. A l’image d’un ciel spéculaire, l’œil de verre du ciel, l’écriture reflète le grouillant mouvement des formes, les turgescences, les métamorphoses par concaténation mais aussi parfois, les ellipses lorsque l’abondance vient à buter sur la disparition.
La langue de G.Bourson exulte et dans cette exultation, elle élit le mot rare, précieux, le plus souvent déconcertant .Dans son élan, le poète réussit à réunir le disparate (archaïsmes et bestiaires s’accouplent aux néologismes) multipliant le sens.
Nos phrases, nos vues, nos viols, ce jeu de l’oie
Les égouts de l’orage au bas mot qui remugle
Un hydraulat d’écarts -, et cette exultation
Stokastique et criarde au crible indifférent.
Ce qui compte, c’est de creuser l’écart ; à l’écoute du retrait que cause le départ, se découvre l’amour du nom qui donne chair à l’absente. Pour l’amant n’existe pas la perte car sa langue est habile à parfaire les richesses de la mémoire. Rien ne meurt, ni les réminiscences livresques, Homère, Virgile, Keats, Shakespeare, Rimbaud…, ni les infimes sensations de la langue, corps amoureux.
Le poète rend compte des traces. Sensible à leurs flux, leurs courbes, leurs enchevêtrements, il épouse leurs contours dans l’oubli du sens acquis. Elles font signe et dans leurs proximités comme dans leurs éloignements, elles créent une épaisseur foisonnante, mouvante qui signent Les actes d’un congrès qui fut ici le nôtre.
La langue amoureuse s’est substituée à la perte, là voici prodigue.
Brigitte Donat
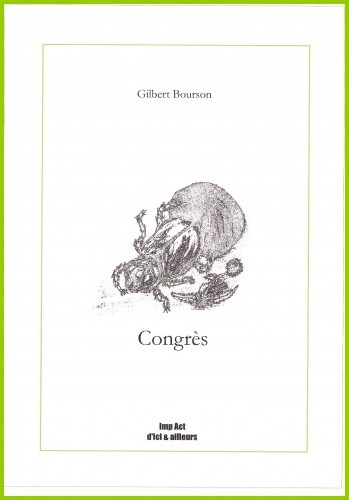
Imp Act
d'ici & ailleurs
ISBN 978-2-918088-00-4
(12€)
54, rue de Ronquerolles
95620 Parmain
01 34 73 29 75
impact.dicietailleurs@tele2.fr
13:52 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook