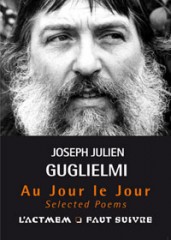03/07/2009
Joseph Julien Guglielmi chez l'Act Mem
●●●

Préfacés par Elisabeth Roudinesco, ces « Selected Poems » de Guglielmi inaugurent une nouvelle collection aux éditions L’Act Mem. Des extraits de « Aube », recueil publié par Jean Cayrol en 1968 dans sa fameuse collection « Ecrire », aux tragiques suites de vers et de monosyllabes du « Carnet de nul retour » datant de 2006, ce sont plus de trois cent pages de textes poétiques qui nous sont offerts.
Guglielmi sait que l’on n’étreint pas la réalité rugueuse avec la pensée spéculative mais dans l’attachement à la puissance du concret que seule une traversée du pire et du meilleur peut illustrer. Le poème (à condition d’inclure swing et boogie !) est un des registres d’écriture qui, en prenant appui sur la fulgurance du vers, dispose de l’horizon hasardeux du sensible. Très tôt attentif à la poésie américaine, celle de Burroughs notamment, traducteur de Jack Spicer, jouant sur les paradoxes en défendant aussi bien Apollinaire que Reverdy, Guglielmi propose un énoncé poétique qui est, avant tout, une course de vitesse, un emmêlement d’événements, une captation de l’atomisation du temps : « la datation est un vers » et un métissage de langues à l’image de Marseille où fut créée la revue à laquelle il participa dans les années soixante : « action poétique ». D’un livre à l’autre, le dispositif versifié invente et intègre des scènes de l’intime et du sexuel, du collectif et de l’histoire, jusqu’aux dissonances contrariant le « bel canto ». Guglielmi a renouvelé la métrique, en débordant les cadres admis, en déglinguant l’humanisme plat et il l’a renouvelé dans une soumission souveraine à l’urgence du vivre baroque
A travers cette anthologie, on peut différencier les étapes, les trajectoires, mesurer la radicalité d’une œuvre qui a su, sans arrogance, dépasser l’inacceptable pacte social en relançant l’aube même de la parole poétique.
Pascal Boulanger

préface
Elisabeth Roudinesco
collection
Faut Suivre
POUR PLUS D’INFOS cliquer ci-dessous :
http://www.lactmem.com/medias/livres_2009/guglielmi_selected_poems.html
09:33 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
08/06/2009
PASCAL BOULANGER
PARUTION 18 juin 2009
Quatrième de couverture
Cherchant ce que je sais déjà
Editions de l’Amandier
Collection Accents graves, Accents aigüs
Auteur de plusieurs livres de poésie et d’essais sur cette dernière, Pascal Boulanger joue ici du paradoxe, convoquant la bibliothèque et témoignant d’une traversée où les drames de l’existence côtoient les noces du ciel et de la terre.
La délivrance du mal passe par sa connaissance et si la parole poétique commence par une descente aux enfers, elle porte aussi le germe d’une renaissance.
Dans cette quête de l’amour loin des résignés, loin des naïfs et avec des yeux de chair grands ouverts, le poème interroge avec insistance -Qui me donnera un baiser de feuille d’or/ pour que l’existence ne soit plus une faute ? - et nous renvoie à nous-même, dévoilant l’obscurité et la lumière, l’opacité et la transparence, la terreur et le salut afin de nous tenir là, dans l’échec et la question et dans la beauté des choses qui ne fait pas question.
Je sais ce que je sais
Sur la double route
Dans le souffle de ma respiration
Dans le feu que le sommeil abrite
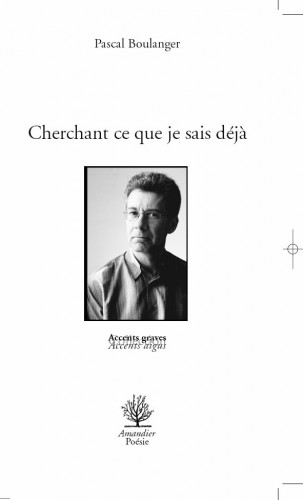
NOTE DE LECTURE
Nathalie Riera
« Il faut retirer sa foi de l’abîme. Il faut apaiser son cœur à observer de près une chose n’importe laquelle (…) Il faut surtout fermer l’abîme ».
Pierre-Jean Jouve, Proses, (p.235) Gallimard/Poésie.
« Ô Bellarmin ! qui donc peut dire qu’il se tient ferme, quand la beauté même mûrit à la rencontre de son destin, quand le divin même doit s’humilier et partager le sort des choses mortelles ! »
Hölderlin, Hypérion in Hypérion à Bellarmin (volume second, premier livre)
Etre au plus près des œuvres d’un poète, avec toute la distance qu’une telle intimité puisse exiger, c’est-à-dire sans fascination stérile. Concéder au « livre-poème » son pouvoir et sa volonté de faire musique parmi les choses. Décerner à celui qui Cherchant ce que je sais déjà une attention aussi dégagée que soutenue, comme réponse à cette évidence qu’il n’y a jamais rien à ignorer ou à renier, dans un monde où se joue sans cesse et sans concession toute la gamme des temps, dans une suite de contrastes qui font œuvre parmi les choses.
Partitions d’air et de feu, bienveillance et férocité des couleurs : là où Pascal Boulanger se tient, il n’y a pas toujours de ménagement possible. Juste se tenir dans l’extrême, c’est-à-dire là où le poète peut encore avoir désir de dire ce que les lèvres de l’homme peuvent garder d’amer, de froid, de tremblement intérieur.
La parole est aussi une forme, et cela dès lors que cette parole même est prononcée. Et ce qui se prononce dans la parole de Pascal Boulanger consiste à faire entendre que la foi, à l’égal du Verbe, dépasse d’abord la foi, au sens où P.J. Jouve préconisait que la foi soit retirée de l’abîme.* Tout grand poète nous rappelle, à sa manière, que le poète (parole jouvienne) « n’appartient qu’à sa parole ». Comme tout être n’appartient à rien d’autre qu’à sa propre histoire.
***
Au contraire de « Jamais ne dors » (Le Corridor Bleu, 2008) et ses chants amoureux, Cherchant ce que je sais déjà révèle la face douloureuse des séparations et des inquiétudes face aux proches. Est-il alors juste de penser que de la part de Pascal Boulanger ce dernier livre serait tentative de mémoire ? Mémoire dont les fils lumineux font aussi la détresse du chant. Emouvante ébauche qui fait dire : « Touchant l’étoffe qui sépare/- je ne veux plus que la mémoire humaine passe en moi ».
D’une séquence à l’autre, c’est le dénuement sans répit, ainsi la section nommée « Les ruines de la ville », qui témoigne d’une traversée en abîme, et où l’auteur lui-même se sent la proie d’un destin d’emblée verrouillé. Est-il par ailleurs besoin de préciser qu’une tentative d’anamnèse ne tient parfois qu’à un profond désir de grand silence. Quatre ans auparavant, dans Jongleur, (Comp’Act, La Polygraphe, 2005), l’auteur nous fait part de cette perspective : « Cependant, la vie que j’avais à vivre je l’avais déjà vécue/et il n’était plus question d’écrire ni de les écouter./Le tranchant du seul instant était devenu un point ».
Faut-il entendre par là un point final ? Mais à quoi ? N’y a-t-il plus de routes, plus aucun autre rendez-vous ?
Le premier cri – la buée des lèvres – le dernier souffle
la lumière et son attente
l’inexistence
le détour
le retrait
le silence
Je voisine par un abîme – je le sais – indistinct
cherchant ce que je sais déjà
***
Au cœur des drames, pas de communication possible, l’homme n’a pas vocation à trouver des réponses, mais au mieux peut-il poursuivre sa propre histoire sans cesser de faire incantation parmi les choses de la vie et les violences du monde.
Jusqu’avant les inquiétudes, le cœur a des couleurs aux ailes. Détonateur, il est ce qui nous fait partir sans nous dérober. Mais depuis longtemps déjà, il y a cette sorte de savoir, qu’il nous faut aussi vivre plusieurs autres lieux, ici ou là-bas, espérer possible ou impossible d’autres royaume, centre, espace complet… entre le vivant et le mourant. Vivre, c’est-à-dire affronter son propre exil et sa propre énigme. « Retour parmi les crimes de l’époque, les saisons de mort ». Sorte de chute qui ferme le paradis, et entraîne avec elle tous les sommeils « qui déplaçaient les montagnes ». Et à cela, comment ne pas crier, ne pas prier au sein même du grand silence :
Qui sait aimer sachant ne pas mourir ?
Je contourne les grabats du chantier
un chant glisse sur le parvis
omnia vincit amor
***
Est-ce faute d’exister ? ne devrait plus faire question, quand on sait cette autre sorte de vérité, pour ne pas dire de nouveau jour, auquel nous pouvons souscrire, même dans le plus haut déchirement, vérité conjointe à toute ruine qui ferme nos joies : éprouver et consentir que la vie nous est souveraine, indomptablement. Même au milieu des ravages elle est encore pourvue de cimes, et à jamais nous initie sa force. Ce n’est pas de la mort que naît le poème, mais de ce qu’il reste sous les décombres.
Pascal Boulanger a cet art non pas de hisser le poème mais de le faire couler, lui faire traverser tous les versants et les rives, jusqu’à ce qu’il se consume sur les sols les plus abrupts ; le sauver en quelque sorte du règne de la boue, où un grand pan de notre humanité contemporaine s’enlise. Fluidité qui assure également au poète de ne jamais cesser son invention.
Art également d’évoquer la relation de l’homme entre le clair et l’obscur, et du risque qui s’impose à notre existence :
C’est le risque du périple
- la gale démange celui qui erre dans la tourmente
- les dieux font tomber les vents
sur l’île qui se réinvente
Jamais de place pour la perdition absurde ! L’homme vit ou ne vit pas une vraie bataille.
***
Etre au plus près d’une voix qui rugit et rougit, parce qu’il y a encore espoir et toujours désespoir, le dire de tout poète est-il justement de ne plus se borner de dire, mais dire autre chose, ce qui ne veut pas dire le dire autrement.
Etre au plus près d’un désir, qui peut ressembler à ce tranchant devenu un point : dire qu’il en est assez, ou alors choisir de se rendre sourd à toutes envolées emphatiques, aux tristes chimères, aux pourrissements et autres attractions morbides, aux fausses batailles, à la vitesse qui a supplanté la contemplation, et à la nuit qui « ne ramène plus la volupté ».
Ecrire Cherchant ce que je sais déjà, comme preuve que de « se rendre au sol » n’est pas une vaine action, et que celle-ci nous rappelle que nous disposons d’un espace qui nous est à tous commun, espace clos à traverser, pour probablement un retour vers autre chose de proche, et qui touche à notre propre grandeur.
© Nathalie Riera, 30 avril 2009
NOTICE
Bio/Biblio
 Pascal Boulanger, né en 1957, vit et travaille, comme bibliothécaire, à Montreuil. Parallèlement à son travail d’écriture, il cherche depuis une trentaine d’années, à interroger autrement et à resituer historiquement le champ poétique contemporain qui, pour lui, passe aussi par la prose. Marqué par la poésie rimbaldienne et le verset claudélien, il a donné de nombreuses rubriques à des revues telles que Action poétique, Artpress, Le cahier critique de poésie, Europe, Formes poétiques contemporaines et La Polygraphe. Il a été responsable de la collection Le corps certain aux éditions Comp’Act. Il participe à des lectures, des débats et des conférences en France et à l’étranger sur la littérature et il a mené des ateliers d’écriture dans un lycée de Créteil en 2003 et 2004.
Pascal Boulanger, né en 1957, vit et travaille, comme bibliothécaire, à Montreuil. Parallèlement à son travail d’écriture, il cherche depuis une trentaine d’années, à interroger autrement et à resituer historiquement le champ poétique contemporain qui, pour lui, passe aussi par la prose. Marqué par la poésie rimbaldienne et le verset claudélien, il a donné de nombreuses rubriques à des revues telles que Action poétique, Artpress, Le cahier critique de poésie, Europe, Formes poétiques contemporaines et La Polygraphe. Il a été responsable de la collection Le corps certain aux éditions Comp’Act. Il participe à des lectures, des débats et des conférences en France et à l’étranger sur la littérature et il a mené des ateliers d’écriture dans un lycée de Créteil en 2003 et 2004.
Il a publié des textes poétiques dans les revues : Action poétique, Le Nouveau Recueil, Petite, Po&sie, Rehauts…
Parmi les études qui lui ont été consacrées, signalons celles de Gérard Noiret dans des numéros de La Quinzaine Littéraire, de Claude Adelen dans Action poétique, d’Emmanuel Laugier dans Le Matricule des anges, de Bruno Cany dans La Polygraphe, de Serge Martin dans Europe, de Nathalie Riera sur le site Les carnets d’Eucharis ainsi qu’une analyse formelle de Jean-François Puff (sur le recueil : Tacite) dans Formes poétiques contemporaines.
Certains de ses textes ont été traduits en allemand et en croate.
Livres :
Septembre, déjà (Messidor, 1991)
Martingale (Flammarion, 1995)
Une action poétique de 1950 à aujourd’hui (Flammarion, 1998)
Le Bel aujourd’hui (Tarabuste, 1999)
Tacite (Flammarion, 2001)
Le Corps certain (Comp’Act, 2001)
L’émotion l’émeute (Tarabuste, 2003)
Jongleur (Comp’Act, 2005)
Les horribles travailleurs, in Suspendu au récit, la question du nihilisme (Comp’Act, 2006)
Fusées et paperoles (L’Act Mem, 2008)
Jamais ne dors (Corridor bleu, 2008).
A paraître en 2009 :
Cherchant ce que je sais déjà (Editions de l’Amandier)
L’échappée belle (Wigwam)
Anthologies :
Histoires, in Le poète d’aujourd’hui par Dominique Grandmont, Maison de la Poésie Rhône-Alpes, 1994.
L’âge d’or, in Poèmes dans le métro, Le temps des cerises, 1995.
Grève argentée, in Une anthologie immédiate par Henri Deluy, Fourbis, 1996.
En point du cœur, in Cent ans passent comme un jour par Marie Etienne, Dumerchez, 1997.
Ça, in 101 poèmes contre le racisme, Le temps des cerises, 1998.
Le bel aujourd’hui (extrait), in L’anniversaire, in’hui/le cri et Jacques Darras, 1998.
L’intime formule, in Mars poetica, Editions Skud (Croatie) et Le temps des cerises, 2003.
Dans l’oubli chanté, in « Les sembles » par Gilles Jallet, La Polygraphe n°33/35, 2004.
Jongleur (extrait), in 49 poètes un collectif par Yves di Manno, Flammarion, 2004.
Parmi ses études et ses entretiens :
Henri Deluy, Un voyage considérable, in Java n°11, 1994.
Gérard Noiret, Une fresque, in La sape n°36, 1994.
Marcelin Pleynet, L’expérience de la liberté, in La Polygraphe n°9/10, 1999.
Philippe Beck, Une fulguration s’est produite, in La Polygraphe n°13/14, 2000.
Jacques Henric, L’habitation des images, in Passages à l’acte n°1/2, 2007.
22:51 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
21/02/2009
Isabelle Zribi
Vient de paraître
Tous les soirs de ma vie
Ed. Verticales, février 2009
Note de lecture de Pascal Boulanger
Il est beaucoup question, dans ce très beau récit d’Isabelle Zribi, de désolation, de voix négatives et pessimistes, d’idiotie et de malchance, de nuits qui tombent en plombant l’existence…autant de scènes répétées qui révèlent, chez la narratrice, un désespoir lucide et profond. Il y a du Antoine Roquentin chez elle – rien jamais n’arrive, rien n’est nécessaire – chaque événement se voile ou bien, quand il pourrait surgir, il est déjà au bord de sa disparition nauséeuse.
Face à un réel qui ne se manifeste que par son absence ou sa défaillance, ce sont les attentes, les indécisions et les faillites qui résonnent à chaque page de ce récit. Et pourtant, des possibles autour de la fenêtre hölderlienne de l’enfermement survivent dans les lointains de l’amour. Et pourtant, Tous les soirs de ma vie est sans doute le récit le plus apaisé de Zribi car il propose aussi une rencontre et une fugue, avec une mystérieuse C., épiphanie offrant soudain un ressaisissement et une espérance. Ce livre brûle de ce qui fait obstacle à la présence. L’enjeu d’écrire consiste alors à questionner, dans un humour grinçant, une existence – la nôtre – monotone et vide. Face à la neutralité exacerbée, à la maladie de la répétition et de la tiédeur, nous ne sommes plus que des ombres muettes, plongées dans l’indifférence du monde. Plus d’immanence, encore moins de transcendance, mais le relevé froid et lucide de notre passion – notre souffrance – puisque rien ne peut excéder l’existence et sa banalité affligeante.
Flannery O’Connor, en bonne catholique, l’a exprimé : plus vive sera l’exigence de vivre plus évident risque d’apparaître le vide qu’on a sous les yeux. Zribi, triste par excès d’optimisme, traverse le négatif, y séjourne même, pour mieux déjouer nos illusions.
Pascal Boulanger
21:36 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
28/01/2009
Bernard Sichère : L’Etre et le Divin
NOTE DE LECTURE
Pascal Boulanger
C’est l’histoire du divin, liée à la question de l’être et de son oubli, que nous dévoile ce volumineux essai. Convoquant notamment Heidegger et Hölderlin, Rosenzweig et Rûzbehân Baqlî Shîrâzî, Bernard Sichère prend appui sur le moment grec et les révélations monothéistes pour penser et surmonter le nihilisme triomphant. Mais plus qu’un traité de philosophie, ce livre doit être lu comme une traversée singulière du temps et de l’espace. Devant la détresse de l’homme nouveau, indécis et flou, sans mémoire et sans dette, se cache le salut, autrement dit la merveille du simple, le surgissement de l’inattendu, la grâce d’un présent qui s’offre dans sa présence. Le hors monde n’est pas, aux yeux de Sichère, la négation du monde mais sa lumière secrète que la parole poétique révèle. Le penseur qui pense en poète et le poète qui raisonne – et fait résonner – la parole sont dans la vérité du retrait d’un dieu et aussi dans l’aventure que ce retrait rend possible. Chanter – jusqu’au désenchantement – la face visible de ce dieu qui s’est caché sape en beauté la clôture individuelle et sa volonté de puissance criminelle. Pour des poètes comme Hölderlin et Rimbaud, la mort de Dieu ou des dieux est une plaisanterie. Le manque de Dieu est déjà une question plus sérieuse, mais là est le signe du divin et de l’amour, car sans ce manque, comment sentir et savoir que l’on vit et que l’on aime ? L’agapè, c’est la certitude – la foi – d’être aimé par l’amour, c’est à dire par le Verbe, celui qui s’est incarné et s’incarne à chaque fois qu’une voix se déploie dans la nuit du monde. Mais l’aversion du beau et du sublime, de l’être et du divin ne domine t’elle pas tous les discours de notre modernité nécrophile? Qu’importe, des voix intemporelles continuent de penser et de parler.
Pascal Boulanger
"L'être et le divin"
Bernard Sichère
Ed. Gallimard, novembre 2008
« Collection Infini »
23:18 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
20/12/2008
Pascal Boulanger (Fureur et Silence)
DOSSIER POЄSIE
des Carnets d'Eucharis
N°1
Télécharger (format pdf)
CLIQUEZ CI-DESSOUS :
(… les mots possèdent ce prodigieux pouvoir de rapprocher et de confronter ce qui, sans eux, resterait épars dans le temps des horloges et l’espace mesurable…)
Claude Simon, Discours de Stockholm, Fondation Nobel/Les Editions de Minuit, 1986
Fureur et Silence
Par Nathalie Riera
Si Claude Simon accordait un extrême souci au « phénomène du présent de l’écriture » (dans son Discours de Stockholm, 1986), n’est-ce pas aussi en ce lieu même de l’instant que s’opère la fabuleuse dynamique des sensations, des émotions, et où des figures inconnues se raniment en autant de paysages intérieurs auxquels certains écrivains et poètes se rattachent, mais non comme des repaires contre le monde mais plutôt comme ce que Philippe Jaccottet définit au mieux en cette phrase : « revenir à ces paysages qui sont aussi mon séjour ».
Mais des retours à quels paysages inépuisables ?
Tout d’abord, de tels retours seraient-ils seulement entendus comme des manières de se protéger du monde tout en ayant également souci de protéger ce monde, quand le travail ou le fait d’écrire (je le préfère au mot « tâche ») ne saurait se limiter ni à un détournement du réel ni au seul recours à l’imagination (au sens où l’imagination réduit l’engagement de l’être, ou ne fait que plaider des causes perdues, nous dit Gaston Bachelard).
Revenir alors à des paysages inépuisables, qui ne cessent de se modifier, de n’appartenir à aucun autre temps que celui où l’écriture le convoque, temps enfoui, et comme une manière aussi de ne jamais se démettre du chemin, mais plutôt ne jamais cesser de s’en remettre comme preuve de notre engagement d’être vivant.
« Le monde ne peut devenir absolument étranger qu’aux morts (et ce n’est même pas une certitude) » nous dit Jaccottet, lorsque pour Pascal Boulanger : « Vivante, en effet, est la pensée du cœur et plus tranchante qu’aucun glaive » (Jamais ne dors, p.66). A cette notion de vivant je ne peux m’empêcher d’associer cette phrase de Pascal Boulanger à celle du jeune Siward s’adressant à MacBeth : « (…) De mon épée je ferai la preuve du mensonge que tu profères » (Shakespeare).
Si selon O. Milosz le songe a lui aussi sa réalité, le réel c’est aussi ne jamais cesser de naître, et surtout de prendre les preuves de son être dans la volonté que nous mettons à fuir toutes formes de terreurs et de chantages fréquents, ainsi que toutes formes de mensonges et d’aveuglements qui nous empêchent de voir nos ennemis.
« La pensée du cœur » chez Pascal Boulanger n’exclut cependant pas la douce chaleur, elle en est même conservée : force et fragilité des contrastes, comme les fureurs et les silences, à participer pleinement de notre être, tout à la fois en protestation et en assentiment de dire le monde et de le taire. « Au temps tragique, tu ne donnes pas prise à la tragédie », et plus loin « Tu es triste et toujours dans la joie » (p.63). Dans la poétique de Boulanger, il convient de prendre la réalité en charge, car celle-ci n’est pas considérée comme un fardeau mais comme une immanence en extension. Le réel est aussi source d’agréments et d’enthousiasmes. D’ailleurs, les mots chez Pascal Boulanger sont des « carrefours de sens » : lorsqu’on lit, par exemple, son dernier recueil « Jamais ne dors », on ne sent pas chez ce poète un quelconque souci de cohérence univoque, et encore moins de transcendance, sa seule pertinence étant que le texte reflète une certaine symétrie et une certaine liberté aussi : « non plus exprimer mais découvrir » disait Claude Simon.
En lisant et relisant Pascal Boulanger, notamment ses recueils de poésie, je suis tentée de rapprocher sa poétique à celle de Pierre-Jean Jouve, lorsque ce dernier écrit : « Le miracle de l’amour est de n’aimer rien… D’être la flamme de n’exister en rien » (dans « Matière Céleste », Œuvre I). A la manière d’un Jouve, les mots de Pascal Boulanger ne s’écrivent pas avec une encre présomptueuse. Fermerait-il ses yeux pour s’ouvrir au monde, ce serait du moins pour faire le vœu que soit réduit l’avilissement des cœurs. Pour ce poète, aimer et penser le monde sont identiques.
Ce dossier est consacré à l’œuvre de Pascal Boulanger que je vous invite à découvrir à travers des extraits de ses recueils, essais & anthologies (depuis Septembre, déjà, 1991 à Jamais ne dors, 2008), puis également des extraits d’articles de presse, notes de lecture et critiques réservés à chacune de ses œuvres, tous ces éléments réunis par exigence et plaisir à donner un aperçu général du travail d’un poète sensible aux états et aux enjeux de la poésie contemporaine… dans une distance qui s’impose pour remettre en cause l’idée même de la poésie.
5 décembre 2008
©DOSSIER POЄSIE n°1, Les Carnets d'Eucharis
12:39 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
31/10/2008
ENTRETIEN AVEC PASCAL BOULANGER
Les entretiens
des carnets d'eucharis
avec Pascal Boulanger
Nathalie Riera : Peut-on dire, à travers l’ensemble de votre œuvre, que vous vous inscrivez dans un combat contre le nihilisme ?
Dans un monde où il y a toujours plus de menaces, partagez-vous la parole du poète Marcelin Pleynet quand il cite Hölderlin : « Toujours là où il y péril il y a ce qui sauve » ?
Pascal Boulanger : Sur cette question du nihilisme et de ses effets, permettez moi de vous renvoyer au livre collectif que j’ai publié : Suspendu au récit, la question du nihilisme (Editions Comp’Act) et à ma propre contribution qui fut d’abord lue à la Sorbonne en 2004, grâce à Pierre Brunel, sur Rimbaud et Pleynet.
Ce que je constate, avec d’autres, c’est que nous assistons aujourd’hui à une impossibilité, pour les humains, d’accéder à la liberté et au bonheur. On ne compte plus ceux qui deviennent perméables au désir de néant, au solipsisme, à la fascination pour l’anéantissement et pour la dévastation et à ce besoin illusoire de communautés et de complicités festives. Tout cela fait masse. Et masse consommatrice de « culturel » c'est-à-dire aujourd’hui de spectacle. Nos sociétés occidentales qui, par ailleurs et au nom de l’altérité, sapent les fondements judéo-chrétiens, s’installent dans un nihilisme passif qui fait miroir au nihilisme actif des nouveaux terroristes issus de l’Islam et des banlieues. Plus symptomatique encore, le spectacle de la mort - ses relais symboliques – comme d’ailleurs l’insatisfaction générale que suscitent les démocraties molles, deviennent des marchandises qui s’exposent dorénavant dans les musées subventionnés par l’Etat et dans les livres à gros tirages.
Conséquence ? La merveille du simple, le surgissement de l’inattendu et la grâce d’un présent qui s’offre dans sa présence, ne sont plus au programme. Il s’agit, à grande échelle, de se justifier, de se culpabiliser d’être né, de marchander (dans le commerce des sentiments), de produire et de consommer. Or, et vous avez raison de citer Hölderlin, la parole et le langage devraient être ce qui déterminent l’habitation poétique du monde. Et si vous souhaitez mettre un peu de lumière dans votre espace intime comme dans le monde qui vous entoure, vous êtes bien obligés de déployer une écoute et un langage qui feront face aux convulsions folles et fermées de l’Espèce. Tous les espaces et tous les temps traversés sont, en effet, en péril. Le dernier homme pour Nietzsche n’a plus comme horizon que lui-même. C’est pourtant la singularité d’une voix qui, même en prêchant dans le désert, peut rendre compte du jour spirituel d’un présent qui fête les noces du ciel et de la terre et qui tente de sauver ce qui reste d’humain dans l’homme.
Et à nos yeux grands ouverts sourira le ciel grand ouvert (Hölderlin). Mais voilà bien longtemps que les yeux de nos contemporains se sont fermés au surgissement et que le ciel, de plus en plus bas et lourd, ne donne plus signe de vie. Le ciel d’ailleurs, comme tout le reste, est à conquérir et à détruire. On s’y emploie, patience. Le ciel et Dieu sont donc morts, et n’oublions pas que c’est nous, d’après Nietzsche, qui les avons tués. La Technique (lire sur ce sujet Heidegger) et sa puissance d’arraisonnement et d’occupation qui étend son emprise sur la terre, le ciel et les océans, atteint bien entendu les consciences. L’idéologie de la mort de Dieu, c’est la croyance au progrès, au bonheur pour tous ici-bas, c’est le meurtre fraternel et la longue histoire des charniers. Dans cette affaire plus que jamais d’actualité, la poésie a un rôle de dévoilement. Nous y sommes loin, quand elle se contente de reproduire le vieux schéma idéaliste qui fait abstraction du réel ou quand elle se contente d’un jeu formel et ludique.
La question de la présence, du don gratuit et de la beauté se pose donc en décalage complet avec la propagande culturelle de notre actualité. Voilà, l’aversion du beau domine tous les discours de la modernité. La peinture, la poésie, le roman, la musique sombrent dans le nécrophile. C’est le règne de la valeur, de la psychologie et de la sociologie. Rien de grave, des voix intemporelles continuent de parler, et qu’elles parlent ou non dans le désert n’a guère d’importance.
N.R. : Chez vous, écrire répond-il d’une nécessité ? d’un souci d’éclaircissement ? Ou est-ce un exercice spirituel d’effacement, de retrait face à un monde qui cultive la « mise à nu » pathétique et outrancière, et le goût de parler de soi pour ne rien dire ?
Et quelle idée vous faites-vous de la poésie contemporaine et du rôle du poète dans notre société ?
P.B. : Nécessité, éclaircissement (je préfère d’ailleurs le mot dévoilement), exercice spirituel…c’est trop dire et c’est adopter une posture un peu trop romantique ou maudite à mon goût. Pour ma part, le moteur, c’est tout simplement l’émotion. C’est elle qui met en mouvement (motivus) et qui fait circuler la parole. Très jeune et quand j’ai du, comme chacun, faire face à la pression sociale, des questions se sont formulées ainsi : Comment ne pas être chassé de sa propre parole ? Comment rester vivant à force de paradoxes et de hasards ? Comment intégrer dans l’écrit la part obscure qui œuvre dans les liens communautaires ? Comment être dans l’approbation de l’existence tout en la sachant tragique ? Et comment faire avec la Bibliothèque qui mêle poésie et peinture, pensée et musique ? Pour moi, à travers poésie ou prose, l’enjeu de lire et d’écrire m’a permis de soutenir la pensée du néant, de proposer une série de visions décalées – traversées aussi – par rapport aux pulsions de mort qui ponctuent chaque époque et que l’on nomme Histoire. J’écoute la parole venue d’un passé lointain (mais ce passé est toujours bien présent), je passe d’une lecture à l’autre, j’interroge, je contredis, je dépasse un ordre ou l’illustre à travers mon propre réseau d’images. J’accepte aussi la venue en présence de ce qui m’entoure. La poésie alors que j’apprécie (et qui passe très souvent par la prose, celle pour ne citer que quelques contemporains de Philippe Sollers, Pascal Quignard, Claude Simon, Samuel Beckett…) cette poésie distend les enclos du temps et de l’espace, oppose une farouche résistance à l’effondrement du langage et des sensations, traque les expressions les plus insensées de la mélancolie, capture des rêves, convoque enfin un savoir qui met en jeu sa propre existence. Cette poésie nous dit qu’il y a toujours un désert à conquérir là-bas, sous des nuages lumineux, loin des idées de ruine et de ressentiment et que ce désert de pages blanches est traversé de voix (ces fameuses voix blanches qui nous appellent dans la nuit de Marcel Schwob).
J’avoue que le discours des poètes de ma génération sur les formes m’a souvent ennuyé. J’y perçois, sans doute à tort, une tentation nihiliste qui cache mal une censure sur les enjeux du sens, des multiplicités du sens à donner à des problématiques liées au réel. La rétention syntaxique, l’aphasie ou la logorrhée, les débats sur les avant ou les arrière gardes, les performances publiques… tout cela, que je respecte, ne me concerne pas vraiment. N’oublions pas que j’ai appris à lire avec Tel Quel, pas exclusivement mais enfin grâce aux œuvres issues de ce « collectif ». Celles notamment de Jacques Henric, Marcelin Pleynet, Pierre Rottenberg, Jacqueline Risset, Claude Minière et bien sûr Philippe Sollers m’ont conduit à penser que la poésie est l’essence même du langage qui rayonne, résonne et raisonne en toute langue du monde. Les travaux critiques (je pense notamment à ceux de Jean-Louis Houdebine, injustement oublié aujourd’hui : Excès de langages chez Denoël) ont été considérables. Cette histoire a été faite (par Philippe Forest) et mérite encore d’être méditée.
Aussi, je crois saisir le sens de ce propos d’Antonin Artaud : Et s’il est encore quelque chose d’infernal et de véritablement maudit dans ce temps, c’est de s’attarder artistiquement sur des formes, au lieu d’être comme des suppliciés que l’on brûle et qui font des signes sur leurs bûchers ».
Afin d’être à l’écoute de ces brûlures qui nous traversent, il y a toujours nécessité de se dégager. De se dégager de ce qui fait illusion (et y compris de la communauté poétique qui fait illusion) et de ce monde rongé par le négatif. Et c’est d’après moi en se dégageant de la sorte que la poésie, cette pensée en images, fait entendre dans une même dynamique de langue, les voix de l’inconnu et les voix du sens.
N.R. : Dans votre dernier livre, « Jamais ne dors » publié aux Editions le Corridor Bleu, ce qui fait question (je serai tentée de rajouter ce qui fait souci), c’est l’amour, au sens non pas de ce qui nous sauve mais de ce que l’amour est opposition à tout ce qui est destruction et possession. Mais à notre manière d’aimer, ne manque t-il pas une pratique de la distance ? La distance qui crée la profondeur (Noli me tangere). Et d’autre part, y aurait-il selon vous une leçon rimbaldienne ?
Jamais ne dors ne révèle t-il pas aussi une certaine proximité avec Pierre-Jean Jouve ou Gérard de Nerval pour leur attirance pour la femme disparue, perdue, l’Absente, la Sainte… ?
P.B. : Une attirance pour la femme disparue, perdue, pour l’absente et la sainte ? Vous plaisantez ? Jamais ne dors, mais toutes les lectures sont possibles et je respecte la vôtre, c’est le chant d’une rencontre et d’une grâce, pas du tout le chant d’une perte et d’une mélancolie. C’est la présence qui m’émeut et le retrait que cette présence inaugure… Ce qui surgit (ici l’amour incarné) se dévoile en se cachant. L’amour, mot désuet que Rimbaud s’évertue à réinventer, c’est la joie de nommer et d’être nommé. C’est ce qui place un être hors de soi, en brisant et la clôture individuelle et le discours social. On peut porter en soi une souffrance lancinante et discrète, se murer dans la solitude, il n’en demeure pas moins que chaque individu, dans sa valeur infinie et suprême, tend à mettre de l’idéal dans sa réalité. Mais cette espérance doit apprendre que l’on séjourne dans un proche et un lointain, dans une présence et une absence, un surgissement et une éclipse.
Dans un essai à la fois volumineux et remarquable : L’Europe et la profondeur, Pierre le Coz commente la fameuse phrase du Christ à la femme amoureuse : Noli me tangere. Autrement dit, ne cherche pas à durer et à demeurer dans cet amour, il n’est qu’un souffle qui nous visite, sans garantie ni contrat, un souffle ouvert à l’hiver écumeux et à la rumeur d’été (Rimbaud). C’est l’expérience du temps qui change avec le christianisme et avec la parole poétique, avec les prophètes bibliques. Le dévoilement de la violence primitive et la joie fondée sur le don et la grâce, jouent pour toujours. Il y a, si vous voulez, le temps du tombeau, le temps des horloges, le temps qui calcule et négocie les contrats sentimentaux. Puis, il y a le temps hors du temps, le temps infini dans lequel la présence s’affirme dans le retrait, dans le Noli me tangere, dans l’abîme que l’éloignement de Dieu ouvre. La mort de Dieu ou des dieux, pour un poète, est une blague. Le manque de Dieu déjà est une question plus sérieuse, mais là est le signe même de l’amour car sans ce manque, comment sentir et savoir que l’on aime ?
L’agapè, c’est la certitude (la Foi) d’être aimé par l’amour, c'est-à-dire, par le Verbe, celui qui s’est incarné et s’incarne à chaque fois qu’une voix se déploie dans la nuit du monde. Alors Pierre Jean Jouve bien entendu, Tout chant est substance à Dieu et même si Dieu absent… (dans Mélodrame) mais aussi Apollinaire, Seul en Europe tu n’es pas antique ô Christianisme (dans Zone), et Claudel perpétuellement en exil, qui ne cesse de quitter tous les clergés des Lettres.
Jamais ne dors qui a pu paraître aujourd’hui, dans le contexte d’aujourd’hui, que grâce à Charles-Mézence Briseul, responsable du Corridor bleu, est un dialogue amoureux sur le fil de l’abîme. C’est fait de tensions et de joie, de répétitions et d’infini, à l’image de ce que je traverse dans l’existence. Ce n’est pas une communication, un discours sur l’amour, mais une incantation, ce n’est pas du « dit » mais du « dire » (la rencontre d’un visage selon Levinas). Là aussi, c’est la guerre. Car le monde ne reconnaît Dieu, c'est-à-dire l’amour, que pour le mettre en Croix. La question que je me pose depuis plus de vingt ans est donc la suivante : comment la poésie peut-elle déjouer la mimésis sacrificielle et le masochisme ? Comment la poésie peut-elle nous déposséder puisque la dépossession de soi, dans la parole qui parle, est le plus grand bien dans un monde où posséder équivaut à détruire ?
Permettez moi enfin de conclure en vous disant que s’ouvrir à la poésie n’est pas écrire forcément…des poèmes. On ne compte plus, en effet, les recueils poétiques qui ne cessent d’illustrer les maladies du ressentiment et de la haine de soi. On me reprochera sans doute une vision bien trop « romantique » mais que voulez-vous, d’après moi, l’écrivain n’est pas le planificateur du crime qui agite nos communautés mais au contraire l’être qui se voue à la pensée et à l’art et qui aide Dieu dans la création. La liberté divine ne devrait pas apporter de mauvaise conscience car après tout, connaissez-vous d’autre grâce que celle d’être né ? Un esprit impartial la trouve complète.
©Les entretiens des carnets d’eucharis, 31 octobre 2008

Un extrait « Les horribles travailleurs »
Pascal Boulanger
in « Suspendu au récit, la question du nihilisme »
Editions Comp’Act et les auteurs, 2006
-I-
Comment lire Rimbaud, comment lire Rimbaud et Pleynet aujourd’hui, dans l’actualité d’aujourd’hui, et en quoi ces deux présences poétiques s’imposent dans notre propre présent ? J’ai découvert l’œuvre poétique de Rimbaud, et plus précisément Une saison en enfer et les Illuminations au moment même où je lisais les trois premiers livres de Marcelin Pleynet : Provisoires amants de nègres, Paysages en deux suivi de Les lignes de prose et Comme. Nous sommes alors dans les années 1977-1978. J’ai vingt ans. J’ai vingt ans et je sais déjà ce qu’il en est de la servitude ambiante, de ses aménagements et de la résistance qu’il s’agit de lui opposer. Moi aussi, je n’ai pas d’autres diplômes que ceux que je me donne en tenant compte de mes expériences quotidiennes dans les divers quartiers de Paris. Je n’ai encore rien écrit, je me contente de puiser dans la Bibliothèque. J’opère des choix, je m’attache à quelques singularités, j’intègre et je rejette, je découvre l’importance de la revue et de la collection Tel Quel, je suis sensible aux écrivains qui refusent les dérives platoniciennes et je saisis très vite que là où la poésie est dérisoire la société est une société des « amis du crime » : les hommes y vivent et y meurent ensemble en enfer.
Pleynet ne s’est jamais identifié au milieu d’où il était censé venir ni à la misère qu’il traversa en faisant ses premiers pas. A plusieurs reprises, dans ses études critiques et dans son journal, il a montré comment une œuvre, et singulièrement celle d’Arthur Rimbaud, pouvait engager l’existence de celui qui la découvre et la lit. 1949. J’avais à peine seize ans lorsque je me suis trouvé seul à Paris. Je ne connais pas d’autre éducation. Découvrir en même temps Lautréamont, Rimbaud, la porte Saint-Denis, et le quartier des halles (…) Seize ans, la rue et la bibliothèque, le musée, les muses m’ont fais ce que je suis. Et je ne ressens rien différemment aujourd’hui où l’horizon est infiniment plus large(1). Et encore ceci : Première forme de résistance, je m’étais pendant plus d’un an, employé à lire chaque soir, et à apprendre par cœur, un poème de Rimbaud. Engagé dans quelques misérables tractations familiales ou sociales, je me récitais par exemple le début des « Poètes de sept ans »(2).
Rimbaud n’était pas assimilable, Pleynet ne le sera pas plus. Dans ces œuvres croisées, pas de Mère-Patrie, pas de Mère-Parti, pas de patrouillotisme, celui qui s’empara notamment des citoyens de Charleville Mézières en 1870. Rimbaud, en 1872, a déjà traversé le Parnasse. Un siècle plus tard, Pleynet travers le naturalisme, le réalisme et les provincialismes de la littérature de notre époque.
(…)
J’ai enfin lu Rimbaud et Pleynet en tenant compte de cette remarque : La connexion de foyers d’écrits et de biographie constitue la base réelle de toute cette affaire poétique. Cette phrase de Pleynet, je l’ai associée à celle de Guy Debord : Pour savoir écrire il faut avoir lu et pour savoir lire il faut savoir vivre. C’est l’absence d’appétit, et d’appétit pour les mots, qui est proprement l’enfer. Dans ses études sur Rimbaud, et notamment dans celle publiée dans le numéro 86 de la revue L’Infini (3), Pleynet s’évertue à ne jamais réduire les lectures et la pensée de Rimbaud. Le poète des Illuminations a dépassé l’étroit cercle de la poésie parnassienne pour atteindre une langue polymorphe, traversée de tensions entre le grec, le latin, l’anglais, entre langue littéraire et langage technique, entre archaïsme et néologisme. Si bien qu’il n’y a pas, comme l’a souligné aussi Michel Murat, de caractère incontrôlé dans la composition poétique rimbaldienne.
-II-
(…)
On n’est pas poète en enfer dit Rimbaud, l’enfer, c’est le non accès à la poésie ajoutera Philippe Sollers. Et la mise en scène du négatif, durant une saison, n’est pas elle-même une adhésion au négatif puisqu’elle parvient, d’une texte à l’autre, à le traverser et à le surmonter. Il s’agit bien pour Rimbaud et d’une autre façon pour Pleynet, de se dégager des affaires de famille, de l’aménagement de la terreur sous la IIIe République, puis du fascisme, du stalinisme, de se dégager de ce monde rongé par le négatif et le nihilisme, mais aussi des modes prosodiques, du commerce des sentiments, de l’enchaînement des « passions tristes », bref, d’une vie cernée de mort. L’adieu de Rimbaud à ses propres contemporains est un adieu au ressentiment et à la misère subjective. Rien ne nous empêche, en effet, d’aller voir ailleurs, après s’être détourné de toutes illusions, et y compris de la communauté littéraire et poétique faisant illusion. Tous les possibles alors s’inventent dans cette science des couleurs et des sons, un nouveau défilé de féeries, hier comme aujourd’hui.
(pp.157-170)
NOTES
1.Marcelin Pleynet, Situation, L’Infini n°72, hiver 2000.
2.Marcelin Pleynet, Situation, L’Infini n°84, automne 2003.
3.Marcelin pleynet, Rimbaud, les chemins de la liberté,L’Infini n°86, printemps 2004.
Cet extrait est issu de la conférence de Pascal Boulanger, qui a été prononcée le 17 mai 2004 à la Sorbonne, suite à une invitation de Pierre Brunel.

Dernière parution « Jamais ne dors »
Pascal Boulanger
Editions Le corridor bleu, octobre 2008
01:49 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
19/10/2008
Dernière parution
JAMAIS NE DORS
Pascal Boulanger
Editions Le Corridor Bleu
ISBN : 2-978-2-914033-26-8 /96 p.
12 x 18,5 cm. / 13 € / port : 2 €
Règlement à l'ordre du Corridor Bleu
185, rue gaulthier de rumillly 80000 amiens

Note de lecture
Par Nathalie Riera
Dans son dernier livre, Pascal Boulanger nous reçoit et on se laisse recevoir : il n’y a plus de démarcation entre là-bas et ici, hors de soi et en soi. Désormais il y a « éclat et silence de ce qui passe et n’est plus là », en d’autres termes il y a l’amour, qui selon P.B. se définit comme « l’histoire d’une folie, d’un espace ouvert à l’insensé (…) un amour qui se multiplie en ses voyages ».
Avec « Jamais ne dors », nous sommes invités à entrer dans la vérité, à rejoindre comme dans la musicalité d’un songe exil et miracle. Le texte multiplie à sa manière ses propres échappées dans le songe d’un espace-temps sensible, traversé d’aucun ressentiment, espace où se joue l’amour, autant sa grâce que son abîme.
Le déploiement du temps semble n’avoir lieu que dans ce qui s’endort, « en plein dans le sommeil », à cet endroit de l’absence et de l’exil si nécessaires à l’amour de combler l’être malgré le manque. C’est dans la séquence qui suit que se définit au mieux l’amour comme rencontre insufflant au poète de se porter sans crainte et sans faillir vers ce qu’il nomme l’amour absolu :
C’est un amour absolu
S’il s’abaisse, je le vante. S’il se vante, je le vante davantage
Un amour qui n’a pas de lien
Qui se révèle dans la distance
Dans le corps qui est tout entier dans la voix
Un amour qui ne rêve pas de perversion
Qui se situe au-delà de toute interprétation
Qui ne met pas, contre ses yeux, la parole du destructeur.
L’amour absolu ? Avec lui qu’il apprend, avec lui qu’il peut encore s’enrouler « dans la chaleur en dessinant les contours de l’instant », avec lui qu’il est rendu, non pas esclave à l’aimée, mais avec ce qu’il lui reste de plus libre et de plus enjoué, pouvant ainsi accueillir cet absolu et l’abriter dans sa demeure silencieuse. Chez P.B. l’aimée est une évadée, qui seule connaît la sensualité du repos et du sommeil. Mais elle est aussi et surtout « une parole sans reproche qui autorise l’écriture, en souligne la beauté ».
Quand un regard vous reçoit c’est un regard qui vous soutient et vous met en demeure de vous dérober à tout ce qui est haïssable et vous éloigne du « simple fait d’exister ». Avec l’évadée se déroule ce « qui n’est que de passage » comme peuvent l’être « Le songe/L’extase/Et la tendresse ». Et c’est parce qu’il y a exil, séparation, manque et absence que d’aimer de toute éternité n’est ni vain ni insensé. Sous la plume de P.B. l’évadée est la passante, l’étrangère, celle qui ne se tient pas « à l’étroit de l’asthme ! ». Elle est faite de tous les contrastes et de tous ces verbes qui la vantent et font la force d’aimer, et qui n’est rien d’autre que de vivre délié, dénoué, élargi. L’aimée peut fuir à tout moment, c’est dans le sommeil qu’elle disparaît et c’est dans son sommeil à elle que l’aimé peut dormir.
A la question : qui est-elle ? Elle est ce qu’elle-même ne sait pas et ce qu’elle ne veut même pas savoir, répondrait Pascal Boulanger. La vérité et l’amour ne sont pas à savoir. D’ailleurs, comme tous ses livres précédents, nous retrouvons cette même volonté infaillible de ne pas défendre l’amour mais le prôner contre « la parole du marchand ». Et lorsqu’un poète est ainsi visité par la grâce et l’abîme d’aimer et d’être aimé, comment rêve et réalité peuvent-ils se prolonger dans un même espace-temps, et trouver accord contre ce qui en soi ne triomphe plus ? Très vite, nous pouvons retrouver notre position d’esclave ou de naufragé, lorsque des lèvres toutes frémissantes nous les quittons pour retourner « aux bouches tremblées d’épuisement ». Et néanmoins, toute demeure en soi est-elle en péril ou sous la menace de s’effondrer : « Il y a ce retournement inattendu de la malédiction en exultation ».
Pascal Boulanger précise que l’amour est seul au monde. Seul, mais arraché à « l’ordre fou des hommes » aux « passions tristes », à l’aversion, à l’idolâtrie, à la haine de l’amour et au « règne où le divin ressemble à un viol ».
Notre époque est-elle à cette « parole qui n’aime pas », s’il y a bien une vérité à laquelle nous pouvons souscrire : « Lutter contre le mal est lui faire trop d’honneur ». Et parce que l’amour est solitude et retrait, on ne peut ni l’épuiser ni disposer de lui, seulement se laisser envahir par sa bienveillance qui se déverse à brassées dans le sommeil du monde.
Nathalie Riera – Septembre 2008
09:41 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
17/10/2008
Note de lecture - Pascal Boulanger
Catherine Millet : Jour de souffrance
Dans l’usage du faux qui caractérise désormais notre actualité, il est réconfortant de lire un récit qui exprime la vérité d’un excès. Jour de souffrance, qui paraît aujourd’hui, sept ans après le succès de La vie sexuelle de Catherine M., propose une radiographie précise et méticuleuse du gouffre amoureux. Une femme se regarde, sans concession, et fait face à la douleur du négatif – ici la jalousie – et chaque mot sonde une traversée, chaque phrase travaillée par l’introspection, cogne contre un espace-temps mis en croix.
Tâtonnement intérieur, crise, doute, suspicion, surveillance… la jalousie opère dans le champ de l’imaginaire et quand les sensations vécues se murent dans des conflits intimes et dans la logique folle des passions tristes, quand l’hostilité envers soi-même et envers l’autre se déploie avec acharnement et à chaque instant, il y a bien enfer.
Enfer et aussi plaisir à se couler dans les stéréotypes de la femme trompée et humiliée. Une des forces de ce livre est de montrer l’enchaînement implacable d’un huis clos qui dissocie les sensations de chaque protagoniste.
Catherine Millet nous oblige, en effet, à traverser l’unité des contraires, dans leurs tensions et dans leurs douleurs, au lieu de les escamoter dans des concepts qui cachent toujours la cruauté du réel. Ce sont les détails des effets de la jalousie qui nous enseignent alors sur la vérité de l’être et de l’altérité. La grande santé dionysiaque (ce corps de femme livré à d’autres corps dans La vie sexuelle de Catherine M.) n’exclut pas la chute dans la dépression dont témoigne magistralement ce Jour de souffrance. Comme la connaissance du pire n’exclut pas le chant de l’affirmation.
L’homme qui se contredit mille fois, qui tente de nombreuses voies, qui porte divers masques et qui ne trouve en soi ni terme, ni ligne d’horizon, est-il probable que celui-là s’instruise moins au sujet de la vérité qu’un vertueux stoïcien ?
Nietzsche savait qu’un regard lucide et mobile renforce, en les assumant souverainement, toutes les libertés et toutes les contraintes humaines. Ce récit s’affronte à l’intériorité vibratoire de l’individu et investit, en les surmontant, les convulsions amoureuses. Mais celui qui subit la chute en inverse, à travers l’écriture – cette voix blanche dans la nuit du monde – le signe.
Face à un monde spectaculaire qui ignore et occulte l’abîme, Catherine Millet oppose un art de l’enquête et de la dissection. Elle déroule ici un récit clinique, écrit au scalpel, qui agit au cœur d’un trauma. Si la terreur rôde depuis toujours dans la geôle où tous nous nous enfermons, une voix, quand elle parle d’amour, chante aussi l’amen illimité d’une traversée.
Pascal Boulanger
Editions Flammarion, 2008
23:54 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
03/10/2008
Note de lecture : Fusées & Paperoles
Note de lecture
par Nathalie Riera
Un écrivain & un journal anthologique
« (…) lisant, cessant de lire, relisant et écrivant, je sors de moi-même, de l’emphase et de l’éternel reportage. Je lève et je baisse les yeux, je suis soudain très jeune ou très vieux, je suis sans regret. J’entends les mots, les phrases, j’entends autre chose. Et c’est toujours, à chaque reprise du livre, à chaque nouvelle lecture, un état neuf du langage qui se dessine, un espace de plaisir qui se crée ».
Dans « La Quinzaine Littéraire » de janvier 1996, Gérard Noiret présente Pascal Boulanger comme « lecteur de Nietzsche (…) de Joyce, de Clément Rosset, mais aussi des poètes comme Pleynet ». Par ailleurs, de Serge Martin on peut lire : « bibliothécaire, poète, lisant, faisant tel jour ceci ou cela… », et aussi, lors d’un entretien en 2005 : « solitaire intempestif en bute à bien des incompréhensions mais une force incommensurable semble tenir son aventure d’écrivain dans une tension vive entre une joie inextinguible et un prophétisme nourri de fusées ».
Fameuses fusées qui pourraient aussitôt nous interroger sur l’auteur dans sa manière de nous ouvrir sa bibliothèque en homme d’esprit, autant qu’un certain Baudelaire n’a-t-il pas écrit une partie de ses « journaux intimes » dans le recul nécessaire pour un ton le plus détaché. Car, ici, aucune place à la polémique mais plutôt à une critique qui se veut sans concessions.
Patiente traversée de « la masse des pratiques poétiques contemporaines en France » souligne Claude Minière, pour l’auteur des Fusées ξt Paperoles ce n’est pas tant de savoir si une œuvre est poésie ou prose. Dans un entretien avec Philippe Forest, pour la revue Art Press en avril 2008, Pascal Boulanger précise :
« Dans mon livre, précise t-il, j’appelle poésie les textes qui fondent l’Histoire. Tenter une fondation poétique de l’Histoire avec ses débâcles et ses joies intimes, c’est ouvrir un monde – un présent du monde – qui marque un acte de rupture radicale avec la logique meurtrière des communautés ».
L’écriture comme moyen ou mouvement de « prendre l’initiative sur le chaos du réel » est une manière de déjouer - « là où triomphe le discours des experts » - le nihilisme contemporain. Pascal Boulanger n’est pas homme à se détourner du réel, mais bel et bien « de prendre en charge ce que l’on sait de lui ». Et cette aventure – qu’elle soit un tressage de joie et de douleur, de grâce et de violence – que peut-elle être vraiment si ce n’est « ma propre connaissance du pire et mon chant du oui », ou chant de l’affirmation.
Fusées ξt Paperoles n’est-ce pas l’aventure d’un livre qui nous invite à la rencontre d’autres livres, ou plus exactement d’autres voix, et plus précisément encore de ce qui pousse en avant et non ! à ce qui nous cloue dans une complaisance victimaire à se laisser périr.
La somme de livres et leurs auteurs (plus d’une centaine) que Pascal Boulanger a choisi de chroniquer peuvent converger et diverger, s’opposer et se mêler, ce que Fusées ξt Paperoles me fait entendre, entre autre, c’est cette question déterminante et cruciale : Que signifie vivre ? et à laquelle Nietzsche répondait : « cela veut dire : rejeter sans cesse loin de soi quelque chose qui tend à mourir ». Le poète est le sage qui parle, se définissant lui-même comme « Etranger au peuple, et cependant utile au peuple » nous dit encore le philosophe prussien, mais utile dans quelle mesure ? Hors du contemporain que peut nous proposer le poème si ce n’est d’être porteur de questions. Ainsi, Fusées ξt Paperoles ne soulève t-il pas une toute autre interrogation autour de l’exercice de notre esprit critique qui, selon Nietzsche, est la preuve d’une bonne santé, « que des forces vivantes en nous sont à l’œuvre prêtes à faire éclater une écorce ». Pascal Boulanger est surtout et avant tout un écrivain en faveur de la critique. Et en tant que critique, Pascal Boulanger n’accuse pas, mais détourne son regard de toutes les vaines espérances. C’est en poète lucide que son cœur et sa raison se laissent vibrer et traverser, loin de la foule et de ses comédies barbares.
Dans L’art de l’éphémère (Figures de l’art 12), Alicja Koziej range Pascal Boulanger parmi les poètes majeurs du XXème siècle, citant Jules Supervielle, Pierre Reverdy, Saint-John Perse, Philippe Jaccottet, André du Bouchet.
« Allègre traversée de la littérature », selon les termes de O. Penot-Lacassagne, pour ma part, j’y ajouterai : vivante traversée d’un écrivain confronté à l’amer du quotidien, mais dont l’art n’est pas de donner libre carrière à l’aphasie et au vide anémiant, mais de convoquer avec joie et rage le sum, ergo cogito : cogito, ergo sum (Je vis encore, je pense encore : il me faut encore vivre, car il me faut encore penser).
©Nathalie Riera
19 Septembre 2008
(Tous droits réservés)
A propos de Fusées ξt Paperoles
Les sites qui accueillent l’auteur et son livre
Chez Alain Veinstein – France Culture – 20 juin 2008
Quelques poèmes en ligne
Extrait
Feuilles d’herbe (…) de Whitman ou le matérialisme comme poésie grandiose : Suis, pour tout dire, imprégné de matérialisme… Je crois à la chair, ses appétits,/Voir, ouïr, toucher sont des miracles, pas une particule qui ne soit miracle. Voici donc un inventaire inépuisable, qui marque une faim féroce, une présence dans son élan et sa variété. Plus question de dormir ou de s’installer dans les théologies de l’absence. Le poème de Whitman s’impatiente, se dresse, flâne, circule, défend l’Amérique et sa démocratie. C’est bien simple, il n’y a rien à jeter dans cette œuvre totale et il faut lire ces Feuilles d’herbe à ciel ouvert, en toute saison de chaque année. Dieu déteste les tièdes et ça se passe ici et maintenant, ça se situe toujours dans le « oui ».
(…)
Van Gogh en 1888, au moment où il peint ses éblouissantes Nuits étoilées, confie à sa sœur depuis Arles : As-tu déjà lu les poésies américaines de Whitman… Il voit dans l’avenir et même dans le présent, un monde de santé, d’amour charnel et franc, d’amitié, de travail avec le grand firmament étoilé, quelque chose en somme qu’on ne sait appeler que Dieu et l’éternité remis en place au-dessus de ce monde. Le drame est donc ailleurs : dans la profusion inouïe et nous ne savons où tourner la tête tant nous sommes sollicités. Whitman en France ? Mallarmé, hélas : Qui l’accomplit, l’écriture, intégralement se retranche ? Dans Feuilles d’herbe au contraire, le soleil aboie plus fort qu’un chien. On entend tous les vents, les cris effacés du silence. Le ciel surgit au cœur de Manhattan, chaque pli inonde l’horizon, chaque brin d’herbe est une chevelure à porter le feu. Voilà une vie où la mort ne compte plus, voilà un seul filament de soie et tous les possibles. On est soulevé par la musique de ce vers long, par les éclats qui surgissent. Tout accès est donné et on va partout. On est dans la marche, pas dans un laboratoire, et dans la nappe lumineuse du temps délié. Tout est là et il n’y a plus qu’à se jeter à genoux. Appétit et santé, roses brûlantes et allégresse. Simplicité lyrique et enchantement. Présence et volupté de l’instant. Quant à toi, la Mort, toi la mortalité aux bras amers, tu perds ton temps à essayer de me faire peur.
« L’amour de la langue »
(P.124)
Ouvrages publiés
Septembre, déjà - éd. Messidor, 1991
Martingale - éd. Flammarion, 1995
Une action poétique de 1950 à aujourd’hui - éd. Flammarion, 1998
Le bel aujourd’hui - éd. Tarabuste, 1999
Tacite - éd. Flammarion, 2001
Le corps certain - éd. Comp’Act, 2001
L’émotion L’émeute - éd. Tarabuste, 2003
Jongleur - éd. Comp’Act, 2005
Suspendu au récit...la question du nihilisme - éd. Comp’Act, 2006
Dernières parutions :
Fusées et paperoles - Act Mem, 2008
Jamais ne dors - Corridor bleu, 2008
Et à paraître :
Cherchant ce que je sais déjà - L’Amandier, 2009
Un ciel ouvert en toute saison – éd. D’Ici et ailleurs, 2009
19:54 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
10/09/2008
A Paraître
Gilbert Bourson
« Congrès »
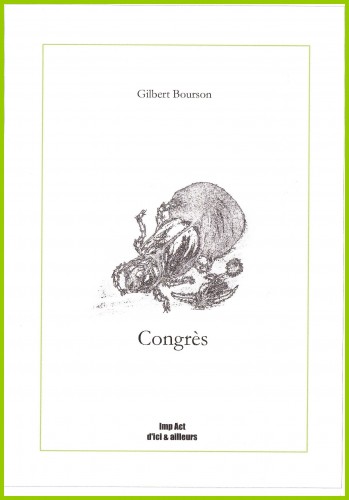
Gilbert Bourson : le lierre, la foudre…
par Pascal Boulanger
En postface
Où sommes-nous, sur quelle scène, dans quelle reprise et dans quelle outrance ? Quel univers de profusion se déploie sous nos yeux, quel Congrès, autrement dit, quelle union / désunion de la langue amoureuse, quelle rencontre possible / impossible avec le monde se lancent sur la page ?
L’écrivain comme l’amoureux, impatiente ses doigts sur l’agrafe d’une description : celle de son désir écrit Gilbert Bourson. Et en effet, à condition de surmonter le nihil du nihilisme, tout fait monde.
D’ailleurs, les vieilles coulisses du théâtre du monde peuvent bien rester les mêmes, il suffit alors de se réveiller de la comédie humaine et de son mortel ennui pour que l’existence, penchée sur le signe, ne soit plus saturée et close. Il suffit de s’arracher au destin tel qu’il s’impose et cette sortie s’inaugure à partir de l’autre – le visage de l’autre – visible et invisible sous son voile ou son masque.
L’écriture baroque de Gilbert Bourson résonne dans les profondeurs musicales des choses vues, dans leurs incessantes métamorphoses et ce qui se donne à entendre, à travers élégies et lieds, ce sont d’abord de grandes singularités qui, dans l’actualité présente, font toujours corps : Homère, Properce, Catulle, Hölderlin, Rimbaud, Mallarmé… une foule de poètes pour qui le texte, tendu et intemporel, fait bruire le lierre et la foudre.
La poésie de Bourson passe aussi par l’expérience – la suspend et l’éclaire – surtout quand elle refuse, comme ici, toute concession au langage de la tribu. Elle est la combinaison d’une forme et tout autant l’invention d’un sujet lié au monde, lié à l’assaut continuel des couleurs et des sonorités du monde. Il faut – horrible travailleur – montrer ce quelque chose qui fond sur le cœur, le comble, se retire, en passer par la main et par l’oreille pour former une cène, concrète et solennelle, où l’on se perçoit autre, comme sollicité et pensé par les événements mêmes et par le surgissement épiphanique du temps.
Le signe – Gilbert Bourson a été responsable, avec Francine Bourson, de la Compagnie théâtrale Le groupe Signes, adaptant et traduisant pour la scène de nombreux textes, ceux notamment de Sénèque, Dante, Jarry, Lautréamont, Flaubert – le signe donc s’ordonne en syntaxe, se déplie en musique, en sonnets et en sonates. Il est un antidote à l’éclipse de la pensée et de la beauté dont les volutes chatoyantes, qui sont de l’esprit et du sang, habitent la page.
Ces pages, hors-jeu et dans le secret du jeu, cet écrivain insaisissable et inapaisable, les conçoit et les travaille depuis des années. Elles excèdent les conventions poétiques et romanesques dans l’outrance du désir et la violence d’une écriture qui ne peut se satisfaire du réalisme et de ses variantes. Souveraines, elles plongent dans un ciel étoilé et on mesure enfin aujourd’hui l’éclat d’une posture rare qui, en marge du pacte social, médite le jaillissement du poème et le passage d’un monde muet et idolâtre à un monde qui parle quand le sensible prend l’oreille ou le regard (Merleau-Ponty).
Pascal Boulanger
Extraits
Dans les éboulements fleurissent les brèches
Et c'est sous la langue, arquée par dessous,
La ligne d'eau noire tire sur le fond
En humant son crochet qui s'agrège aux masses
Brèves et velues; caresses d'estuaires
Avec des nudités d'agrafe et leur escorte
D'odeurs furetées, de plans enchevêtrés
Aux semis des compas, (ceux des écartements
Font éclore cette ovation de vert tancé
D'un à-pic mortel) et le champ qui s'épand
Force au plus près de l'agraphie ce qui s'efforce
A dire le sans-toi du lieu, l'encoche nue
Avec ce parfum d'ongle qui plane; les mots
Qui arrivent à se manquer: La chair d'un nom.
(rêve d'un nom) 15/04/04
Cet écart rayonnant qui survient, ce coup
De scalpel du ciel: Et la tortue du bleu
Nous montre son faciès- (ou est-ce l'escarpin
Furtif d'une occasion qui pointe sous le plaid
Du jour ? ) – A la terrasse, la dégustation
D'un alcool fort de jambes, l'interview de rien
Qui s'étire en fumée, les journaux parcourus
Pour juste un aperçu du monde entre les coudes
Et le Schopenhauer d'un café fort qu'on boit
Sans y goûter vraiment, ce visage qui passe
Et qui n'est pas le tien, mais de ton cher fantôme
Hachurant l'éclaircie. En face le Pierrot
Du mur hypertrophique nous mime à regret
La verticalité tangente d'une idylle.
(à la terrasse d'un café)
Le barman triste songe:" Si j'étais, disons
Une partie du ciel, comme la galaxie
Au lieu de vous servir des verres, je ferais
Descendre sur les prés, les champs, une lumière
Sur les villes aussi, sur les bars aussi bien
Et même les bordels, une sacrée lumière
Qui ressemble à la neige gelée ou au sucre
En poudre que l'on met sur les gaufres qui fait
Eternuer au manège les chevaux de bois:
(C’est depuis ce temps là toujours que l'on entend
Cette- "Tranquille et triste musique des hommes")
Hé hé, voyez les gars, c'est parce que je vois
En pensée Son regard que j'ai cette idée là
D'en répandre partout… La tournée est pour moi".
(La tournée du barman)
Imp Act
d'ici & ailleurs
ISBN 978-2-918088-00-4
(12€)
54, rue de Ronquerolles
95620 Parmain
01 34 73 29 75
impact.dicietailleurs@tele2.fr
00:25 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
09/08/2008
Pascal Boulanger - Une "Action Poétique" de 1950 à aujourd'hui - L'Anthologie (à lire sans conteste)
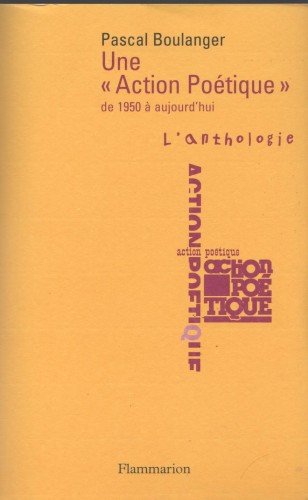
Quatrième de couverture
Emanation, à l’origine, d’un groupe fondé à Marseille en 1950, Action Poétique est sans conteste l’une des deux ou trois revues incontournables, pour qui cherche à comprendre l’évolution de la poésie contemporaine. La réflexion qui s’y développe depuis près d’un demi-siècle, les œuvres qui sont nées dans sa mouvance directe ou indirecte, la personnalité enfin de ses principaux responsables, regroupés à partir de 1958 autour d’Henri Deluy – Jacques Roubaud, Paul Louis Rossi, Franck Venaille, Lionel Ray, Emmanuel Hocquard, Liliane Giraudon, Olivier Cadiot, pour ne citer qu’eux – on en effet infléchi en profondeur les formes, les pratiques et la conception même de l’écriture poétique, dans notre pays.
Pascal Boulanger propose en ouverture le récit détaillé de cette longue aventure collective, en la replaçant dans son contexte historique et culturel. Cette partie introductive (première synthèse jamais tentée sur le sujet) représente un apport important à l’histoire littéraire récente, éclairant au passage nombre d’enjeux ignorés ou mal perçus de la création contemporaine.
Mais ce livre se présente avant tout comme une anthologie du vaste champ poétique couvert par la revue, durant sa longue existence. On y trouvera en effet les textes les plus significatifs publiés par Action Poétique, de son n°1 (1958) à son n°150 (1998).Ce parcours anthologique met nécessairement l’accent sur le cercle de ses animateurs, tout en accordant une large place aux nombreux poètes accueillis par la revue, au fil des années, dans la diversité des styles et des générations. Il illustre également l’étonnant travail de traduction et de relecture du passé poétique qui constitue l’un de ses apports majeurs – des sonnets baroques aux renga japonais, du grand chant des troubadours à celui des chamans indiens, des objectivistes américains aux futuristes russes…
Plus de 150 auteurs – français et étrangers – sont ainsi regroupés dans ce volume, dessinant la carte mentale d’un nouveau continent poétique…
©Editions Flammarion, 1998
601 pages
Une partie des animateurs de la revue « Action Poétique »
 FRANCK VENAILLE est né en 1936 à Paris. Service militaire en Algérie. 1er livre publié en 1961 : Journal de bord (1961). Collabore (Action poétique) et fonde (Chorus, Monsieur Bloom) plusieurs revues. Rencontres décisives : les peintres Klasen et Monory, les écrivains Bénezet, Daive, Veinstein, Hocquard...
FRANCK VENAILLE est né en 1936 à Paris. Service militaire en Algérie. 1er livre publié en 1961 : Journal de bord (1961). Collabore (Action poétique) et fonde (Chorus, Monsieur Bloom) plusieurs revues. Rencontres décisives : les peintres Klasen et Monory, les écrivains Bénezet, Daive, Veinstein, Hocquard...
Son œuvre : une quarantaine d’ouvrages (poésie, théâtre, essai, livret d’opéra, etc.) couronnés de nombreux prix littéraires.
photo: © Olivier Roller
 Emmanuel Hocquard photographié par Claude Royet-Journoud
Emmanuel Hocquard photographié par Claude Royet-Journoud
Henri Deluy
 Lionel Ray
Lionel Ray
Jacques Roubaud


LILIANE GIRAUDON est née en 1946 et vit à Marseille. Outre les nombreux ouvrages qu’elle a publiés, son activité est marquée par les diverses revues qu’elle a crées ou auxquelles elle a collaboré. De 1977 à 1980, elle participe au comité de rédaction d’Action Poétique. En 1980, elle fonde avec Jean-Jacques Viton Banana Split, qui se donne pour programme de mêler le « résolument contemporain » à la « redécouverte des textes anciens proposés à une lecture moderne ». Cette revue, qui cesse ce paraître en 1990 après 28 numéros, rompt avec les conventions de l’édition poétique qui prévalent alors, en donnant à la poésie un support « cheap », les numéros étant composés de photocopies simplement brochées, et vendus à bon marché. Le cadre de la page y est un espace libre ouvert à des poètes comme Dominique Fourcade, Joseph Guglielmi, Mathieu Bénezet, Christian Guez-Ricord, Olivier Cadot, Hubert Lucot, John Ashberry ou Haroldo de Campos, mais aussi à des plasticiens comme Christian Boltanski, Jean-Pierre Pincemin ou Annette Messager (la revue se contentant de photocopier le cadre dans lequel l’artiste avait écrit). A Banana Split succéderont en 1990 La Nouvelle B.S., revue orale vidéo-filmée, qui paraîtra jusqu’en 2000 et IF, co-fondée en 1992 avec Jean-Jacques Viton, Henry Deluy et Jean-Charles Depaule. Liliane Giraudon est aussi traductrice, et a créé en 2000 les Comptoirs de traduction de la nouvelle B.S...
LIRE LA SUITE :
http://cep.ens-lsh.fr/auteurs/x/giraudon.html

Pascal Boulanger
Fiche bio-bibliographique
Né en 1957, Pascal Boulanger vit et travaille à Montreuil. Parallèlement à son travail d’écriture, il cherche depuis une vingtaine d’années à interroger autrement et à resituer le champ poétique contemporain qui, pour lui, passe par la prose. Marqué par la poésie rimbaldienne et le verset claudélien, il a donné de nombreuses rubriques à des revues telles que Action Poétique, Artpress, Le Cahier critique de poésie, Europe, Formes Poétiques Contemporaines et La Polygraphe. Il a été responsable de la collection Le Corps Certain aux Editions Comp’Act. Il participe à des lectures, des débats et des conférences en France et à l’étranger.
Il a publié des poèmes dans les revues : Action Poétique, Le Nouveau Recueil, Petite, Poξsie, Rehauts…
Ouvrages publiés
Septembre, déjà (Europe-poésie, 1991)
Martingale (Flammarion, 1995)
Une « Action Poétique » de 1950 à aujourd’hui (Flammarion, 1998)
Le Bel aujourd’hui (Tarabuste, 1999)
Tacite (Flammarion, 2001)
Le Corps certain (Comp’Act, 2001)
L’Emotion l’Emeute (Tarabuste, 2002)
Jongleur (Comp’ Act, 2005)
Les horribles travailleurs, in Suspendu au récit, la question du nihilisme (Comp’Act, 2006)
Fusées & Paperoles (L’Act mem, 2008)
A paraître
Jamais ne dors (Le Corridor Bleu éditions) – parution pour l’hiver 2008
sur le site du cipM
http://www.cipmarseille.com/auteur_fiche.php?id=1063
sur le site des Chroniques de la Luxiotte
(retrouver des extraits de ses poèmes en ligne)
http://www.luxiotte.net/liseurs/auteurs/boulanger.htm
sur le site du Corridor Bleu
(retrouver un extrait « Sur l’abîme du parterre »)
http://re-pon-nou.blogspot.com/2008/04/sur-labme-du-parterre-pascal-boulanger.html
Article
de Thierry Guichard dans le Matricule des Anges
N°24-septembre/octobre 1998
http://www.lmda.net/din/tit_lmda.php?Id=269
à lire
sur le site PileFace
« L’inadmissible et son poème »
http://www.pileface.com/sollers/article.php3?id_article=547
23:02 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
30/05/2008
Pascal Boulanger (Quatrième de couverture & Extrait)
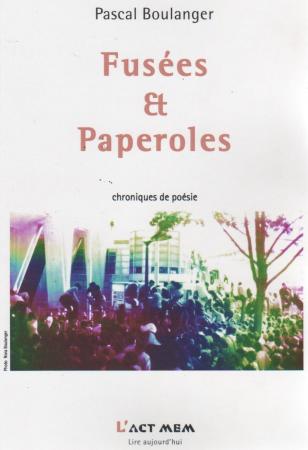 FUSÉES & PAPEROLES
FUSÉES & PAPEROLES chroniques de poésie
Pascal Boulanger
La poésie a connu au XXe siècle une mini catastrophe, mini mais aux effets dévastateurs : la puissance de sa langue et de sa pensée a émigré vers la grande prose romanesque, celle de Proust, de Joyce, de Céline… Est-ce à dire que les poètes ont tous déserté ? Mais Artaud, Pound, Ponge, quels noms leur donner ?Et s’il ne nous est plus loisible de nous déplacer dans de vastes continents poétiques, est-ce à dire que de la déflagration qui les a ravagés, et dont s’est constituée la modernité littéraire, n’ont pas subsisté, et ne subsistent pas toujours, de très étincelantes parcelles, d’autant plus lumineuses, d’autant plus douées d’une force radioactive, qu’elles sont isolées, errantes, inaptes désormais à s‘agréger entre elles, à composer une totalité. C’est à ces astéroïdes nomades, les uns doués de la vitesse des « fusées » (bonjour Baudelaire), les autres mimant les lents, discrets flottements de modestes « paperoles » (bonjour Proust), que Pascal Boulanger a consacré de déjà longues années de sa recherche. Il livre ici ses analyses et ses conclusions. Il fallait, pour mener au mieux une telle tâche, un écrivain ayant lui-même la pratique de la poésie (au sens que je tente de donner à ce mot), un homme libre d’attaches idéologiques et institutionnelles, ouvert à des expériences d’écriture parfois à l’opposé des siennes, peu respectueux des frontières entre les genres littéraires, en prise avec le réel de son époque, doué d’une mémoire historique, résistant aux oukases, aux dogmes, aux divers terrorismes et aux lancinants chants des sirènes nihilistes de son temps. Pascal Boulanger est cet écrivain et cet homme-là. Jacques Henric L’ACT MEM FUSÉES & PAPEROLES PASCAL BOULANGER
L’ACT MEM 17 € Lire aujourd’hui
Télécharger
A PROPOS DE L'AUTEUR ... En forme d'avant-propos :f&p_a_propos.pdf
EXTRAIT
« La parole poétique dit et ne dit pas, saisit et se détache, fait lien et cassure, compose et décompose la vie dans la mort et la mort dans la vie et, avant tout, elle intègre un espace-temps dans lequel une voix nomme. Elle nomme en suspendant les figures idolâtriques et en se risquant dans l’acquiescentia in se ipso (Spinoza), qui évoque la présence à soi, la joie et le pouvoir d’agir.
Les possibles sont-ils perdus ? Jamais, et il n’y a pas d’autre actualité , pour un poète, que celle consistant à refuser le moteur du ressentiment vis-à-vis du temps et de son « il était ». Rimbaud est ailleurs que dans l’ailleurs où la communauté le cherche. Il n’est pas plus dans la poésie comme posture et imposture littéraires que sur les chemins besogneux de la soif de vivre. Il témoigne, par-delà son soit-disant silence, de l’union dans la désunion et sa prétendue absence est un mythe. Ses notes nerveuses relatives à son périple final en civière et toute sa correspondance sont aussi poésie, elles ne seraient éloignées que d’une pratique de la poésie dont justement Rimbaud s’est ostensiblement éloigné (Daniel Oster, L’individu littéraire, P.U.F. coll. « Ecriture »). La poésie, comme dépassement de la métaphysique, est une manière de dire et une manière d’être, elle supporte et dépasse l’inacceptable de la vie sociale en relançant l’existence simple et forte – son noyau d’enfance – que la servilité fonctionnelle n’a pas encore détruite ».
(pp.75/76)
Lire la note de "Corridor Bleu"
http://re-pon-nou.blogspot.com/2008/04/lire.html
23:33 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
25/05/2008
L'émotion L'émeute - Pascal Boulanger
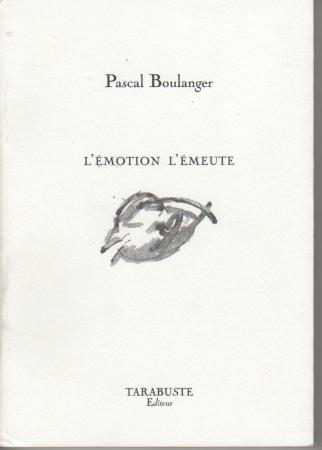 « Le monde s’occupe trop des morts »… alors ne revient-il pas au poète de se réjouir à ne pas quitter le monde, mais à se laisser quitter par lui, parce qu’à cet endroit même de ce presque invivable, de ce presque irrespirable, il y a ce lieu, à proximité, là où :
« Le monde s’occupe trop des morts »… alors ne revient-il pas au poète de se réjouir à ne pas quitter le monde, mais à se laisser quitter par lui, parce qu’à cet endroit même de ce presque invivable, de ce presque irrespirable, il y a ce lieu, à proximité, là où :
« le mauve accentué autour du tilleul
Ne rien dire
dire oui »
Parce que acquiescer « veut dire jouir », chez Pascal Boulanger acquiescer est aussi une manière cruciale de donner au poème à être « une machine critique »* contre ce monde dans lequel nous y sommes « plantés », comme nous y sommes « jetés », avec cependant cette forme de foi en la beauté, en ce que Pascal Boulanger nomme, par ailleurs, ces « Merveilles endormies », qui nous éveillent et sont notre éveil, nous donnant à vivre une sorte de gloire intérieure, ou de ce qu’il écrira plus loin « le flux interne », ainsi ces insignes « Battements lumière du cœur » contre toutes les sombres langueurs, et contre toutes les asthénies ambiantes et leurs morbidités.
Il y a chez le poète des départs, toujours plus de départs que de fuites. Vers ces lointains tout proches. Vers ces proximités vibrantes. Des départs « pensés », des départs pour que « tout cesse de peser ». Mais des départs aussi pour répondre à ce souci de l’éveil, « la clarté imprévisible et brutale de l’éveil ».
Le saut dans lequel on survole l’univers brise les frontières on monte jusqu’au plus haut des clôtures on descend vers les lacs blancs au creux des vallées tout s’élève et s’abaisse on sait où aller en quête d’un nouvel amour notre amour sonne à chaque instant dans la soudaineté du tranchant
Tranchant de la révolte, mais pas du ressentiment, c’est aussi avec cette même « soudaineté » que le poète dit « Adieu dieux de la mort terre aride où rien ne pousse on laisse tout désespoir à l’agitation des hommes… ».
De fait, peut-on dire que ces départs ressemblent à ces voyages que le poète refait « dans l’instant et rien d’autre ».
//
Les trois vocables qui semblent le plus chers au poète : vie – épiphanie – devenir.
Précieux vocables que Pascal Boulanger aura lui-même réunis dans un des articles de son dernier ouvrage « Fusées et Paperoles » publié aux Editions L’Act Mem.
Ezra Pound déclarait un jour : « J’écris pour contrecarrer l’opinion que l’Europe et la civilisation vont au diable ». De la même manière, Pascal Boulanger ne regarde t-il pas devant lui, au loin, tout en étant le plus attentif possible à son environnement présent, à ce qui est près et qui se fait entendre par la terreur, ainsi ce :
11 septembre 2001
CE QUE DESIGNE CE TERME DE NIHILISME EST UN MOUVEMENT HISTORIAL QUI REMONTE A FORT LONGTEMPS AVANT NOUS ET QUI VA PAR-DELA NOUS-MEME S’ETENDRE DANS LES LOINTAINS DE L’AVENIR.
Mais en même temps que le vœu du poète serait que le nihiliste puisse s’abolir de lui-même « dans un pur néant », il y a dans le cœur du poète ce désir d’atteindre les roses :
« C’est plein de bouquets quand il s’éloigne
Là-bas sur la route
De tous côtés vers les sources
Les éclats de lumière
Quand il atteint les roses
Les roses qui gravitent pénètrent la pensée ».
Il y a de l’amour dans le cœur de cette pensée. Dans le cœur où parfois mourir, se laisser troubler, où parfois s’enténébrer, et puis souffler.
Et puis aussi ce vertige qui ne prend pas seulement le cœur, mais les jambes. Et le poète qui vous dit, presque le dirait-il au creux de votre oreille : « crois à ce que tu voudras mais on sort toujours indemne dans le velours de l’écriture ».
Pour Pascal Boulanger, les routes ne sont jamais les mêmes, parce que lui-même change souvent de lieux, parce que lui-même « ne cède pas au désir de mourir ». Toujours ces grands départs, afin de mieux supporter « les deux visages du destin », sans irritation ni indignation contre personne.
la parole parlante
Sauvagement présente
la beauté seule
les livres par milliers
C’est beaucoup de choses
l’émotion l’émeute
le mauve accentué autour du tilleul
Ne rien dire
dire oui
©Nathalie Riera
* "Le poème de Pascal Boulanger est par là aussi une machine critique", selon Emmanuel Laugier dans le Matricule des Anges, n°44 de Mai-Juillet 2003.
D'autres textes en ligne dans les Chroniques de la Luxiotte
ICI : http://www.luxiotte.net/textes/boulanger01.htm
Pascal Boulanger, né en 1957, est bibliothécaire en région parisienne. Parallèlement à son travail d’écriture, il cherche depuis une vingtaine d’années, à interroger autrement et à resituer historiquement, le champ littéraire contemporain. Il a ainsi donné de nombreuses rubriques à des revues telles que Action poétique, Artpress, le Cahier Critique de poésie, Europe, La Polygraphe et Passage à l’acte. Il participe à des lectures, des débats et des conférences sur l’écriture en France et à l’étranger.
Livres :
• Septembre, déjà - éd. Messidor, 1991
• Martingale - éd. Flammarion, 1995
• Une action poétique de 1950 à aujourd’hui - éd. Flammarion, 1998
• Le bel aujourd’hui - éd. Tarabuste, 1999
• Tacite - éd. Flammarion, 2001
• Le corps certain - éd. Comp’Act, 2001
• L’émotion L’émeute - éd. Tarabuste, 2003
• Jongleur - éd. Comp’Act, 2005
• Suspendu au récit...la question du nihilisme - éd. Comp’Act, 2006
Dernière parution : Fusées et paperoles - éd. Tarabuste, et à paraître : Jamais ne dors - éd. Corridor bleu, en 2008.
Publications dans des anthologies :
Histoires, in Le poète d’aujourd’hui, 7 ans de poésie dans « L’Humanité » par Dominique Grandmont, Maison de la Poésie Rhône-Alpes, 1994.
L’age d’or, in Poèmes dans le métro, Le Temps des cerises, 1995.
Grève argentée, in Une anthologie immédiate par Henri Deluy, Fourbis, 1996.
En point du cœur, in Cent ans passent comme un jour, édition établie et présentée par Marie Etienne, Dumerchez, 1997.
Ça, in 101 poèmes et quelques contre le racisme, Le Temps des cerises, 1998.
Le bel aujourd’hui : chroniques, in L’anniversaire, in’hui/le cri et Jacques Darras, 1998.
L’intime formule, in Mars poetica, Skud (Croatie) et Le Temps des cerises, 2003.
Dans l’oubli chanté, in « Les sembles », La Polygraphe n°33/35, 2004.
Jongleur (extraits), in 49 poètes un collectif, réunis et présentés par Yves di Manno, Flammarion, 2004.
Etudes, entretiens sur :
Henri Deluy, Un voyage considérable, in Java n°11, 1994.
Gérard Noiret, Une fresque, in La sape n°36, 1994.
Marcelin Pleynet, L’expérience de la liberté, in La Polygraphe n°9/10, 1999.
Philippe Beck, Une fulguration s’est produite, in La Polygraphe n°13/14, 2000.
Jacques Henric, L’habitation des images, in Passages à l’acte n°1/2, 2007.
20:21 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
24/04/2008
En réponse à Pascal Boulanger
 « On n’insistera jamais assez sur le caractère sensible des effets de lecture, sur la vérité du livre à travers l’expérience physique de la voix. Il s’agit d’un exercice spirituel consistant à toucher et à entendre le texte brûlant, et ce qui surgit autour de lui, dans un espace et un temps inviolables » : mon profond accord et une certaine estime pour ces mots de Pascal Boulanger dans « Le corps certain : détails 1990-2000 ».
« On n’insistera jamais assez sur le caractère sensible des effets de lecture, sur la vérité du livre à travers l’expérience physique de la voix. Il s’agit d’un exercice spirituel consistant à toucher et à entendre le texte brûlant, et ce qui surgit autour de lui, dans un espace et un temps inviolables » : mon profond accord et une certaine estime pour ces mots de Pascal Boulanger dans « Le corps certain : détails 1990-2000 ».
Et voici plus loin ce que l’on peut lire, (et après que P.B. eut cité Kostas Axelos) : « La pensée poétique et future, déjà énoncée, passe inaperçue et demeure impensée » :
« Ecoutant Axelos on peut penser qu’une écriture nouvelle ne peut que rester inacceptable et dérangeante pour les universités, les partis, les églises qui conservent et restaurent ce qui domine, aussi bien que pour les communautés marginales qui se laissent récupérer et font partie du jeu du monde existant ».
Pascal Boulanger a, par ailleurs, raison de souligner la question de « la poésie effusion maternelle ou risque de langue ? », et en référence à Heidegger de préciser que la poésie n’est en aucune manière un simple embellissement de notre réalité quotidienne, et que le tort le plus grave serait effectivement de ne pas pouvoir prêter à la poésie cette vibration que j’oserai dire « tellurique », ou encore « magnétique », et que vaines me paraissent toutes pensées qui n’accordent à ces deux derniers vocables qu’une idée d’échappatoire, de déroute, ou de feinte mystique.
Dans ce monde prédisposé à « l’ouvert », la poésie n’a pas pour tâche d’enjoliver nos vides, mais probablement nous maintenir à un endroit de nous-même : celui le plus en marge, et par conséquent le plus formé à la sédition comme refus légitime de ce que la société et ses faussetés nous assène. Entendre par sédition, un certain soulèvement de l’être. « Et que se cache-t-il (…) derrière les images lisses et festives du monde sinon une incapacité de penser et de surmonter le nihilisme ? ». Soulèvement en rapport à cette effroyable incapacité de la société à pouvoir admettre la singularité, et lui préférant ainsi des normes imposées. Et toujours au détriment « de sa propre vérité qu’on ne peut atteindre qu’à condition de la créer ».
Dans son texte qui ouvre l'anthologie, P.B. cite, entre autres auteurs, Marcelin Pleynet, qui, parce que ce dernier se montre plutôt rétif à toute communauté, sait néanmoins vouer une vive admiration à l’égard des « esprits libres ». Et plutôt proche de la pensée de M.P., pour Pascal Boulanger : « Ne pas se laisser enfermer dans des classifications arbitraires, des mémoires restrictives. Piocher dans la diversité des registres, les collections les plus éclectiques. Ne pas appartenir à un groupe, une famille de pensée… Ne pas fonctionner par opposition. Rien de plus agréable quand on découvre qu’une écriture contredit ou déborde son propre programme.
(…)
Il ne s’agit pas ici de former communauté : pas de palmarès, pas de bilan ni de jugement. Pas d’écoles ni de courants.
(…)
Un livre ne m’intéresse qu’en regard du plaisir qu’il me procure ».
Cette anthologie (sous la direction de P.B.) est également une sorte d’hommage à ces « éditeurs de création » qui « savent faire preuve d’une rare pugnacité pour défendre leurs auteurs malgré la chute continue des tirages et des ventes, malgré les lois du marché et de la censure ».
« Nulle poésie n’achève la poésie, mais chacune déplace, approfondit, recrée toutes les autres. C’est ce mouvement que ce livre aimerait refléter ».
La Polygraphe
Poésies 1990/2000
Le corps certain N°17/19 – Editions Comp’Act, 2001 (pp.13-36)
Nathalie Riera - le 24 avril 2008
"J'appelle poésie cette intrigue de l'infini/ où je me fais auteur de ce que je vois, de ce que j'entends."
 L' Émotion l'émeute
L' Émotion l'émeute Le quatrième livre de poésie de Pascal Boulanger est, sous son titre paradoxal, une confrontation déchirée au monde tel qu'il ne va pas, pour y inventer une respiration. LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE d'Emmanuel Laugier dans Le Matricule des Anges...
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lmda.net...
15:14 Publié dans Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook