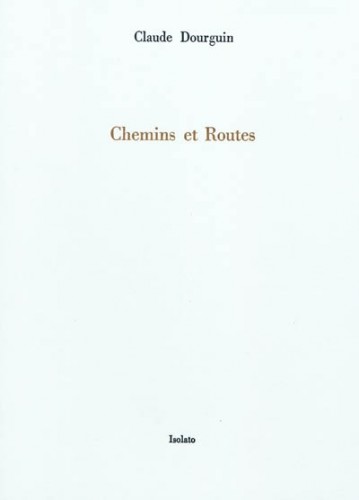Claude Dourguin, Chemins et Routes (une lecture de Tristan Hordé) (13/01/2011)
Une lecture de Tristan Hordé
©
Chemins et routes
Claude Dourguin
(Editions Isolato, 2010)
Les voyages de Claude Dourguin naissent d’une exigence, tout se passe comme s’il lui devenait impossible de continuer à rester immobile, qu’il lui fallait prendre le bâton et marcher pour savoir ce qu’est respirer, regarder, découvrir, apprendre — vivre. Cette manière de se connaître, d’éprouver le vif des choses apparaît peut-être plus dans Chemins et routes que dans ses autres livres (1), parce qu’il s’agit ici de l’expérience de multiples parcours.
La plénitude ressentie par le seul fait de quitter les habitudes, par le contact physique avec le sol, s’exprime dans les premières phrases et c’est ce bonheur d’être qui est exploré ensuite, série de variations dans une prose-poésie reconnaissable entre toutes. Se séparer donc de ce qui abrite, protège, cela se fait jour encore pas venu (« Départ dans le matin frais » est le début du livre), dans ces moments incertains, aux « adieux sans mots », pour retrouver un corps, « le réel après la trêve des songes ». Rapidement, « le pas se fait au sentier, au chemin », et c’est bientôt « la marche heureuse », « l’accord trouvé », la « continuité vive », la lumière détache les contours, le marcheur voit maintenant arbres et ruisseaux : « le monde s’ouvre, donné », vraie « terre première ».
Il n’est pas besoin d’être un marcheur pour apprécier l’exaltation de Claude Dourguin ; qui n’a pas, ne serait-ce que dans l’enfance, imaginé ce qui se trouvait au-delà de l’horizon, « ligne de promesses : là-bas, d’autres terres, d’autres champs, d’autres monts, différents, toujours renouvelés », « un monde toujours recommencé » ? C’est cette merveille (qu’y a-t-il derrière le miroir ?) que propose Chemins et routes. Avant d’atteindre l’horizon, dès qu’un village est quitté, hors du tumulte, Claude Dourguin est enveloppée dans une nature toujours accueillante, généreuse, la nature telle qu’elle apparaissait à Rousseau. Ainsi, figuiers et vignes abandonnés par la culture continuent à produire et le marcheur réinvente les gestes d’un Robinson : « Je m’arrêtais, mangeais ces fruits offerts, présents du lieu dont, ainsi, j’assimilais les vertus. » Ailleurs, c’est l’eau d’un ruisselet qui est donnée, « bonheur d’une générosité inadressée ». On verra là non pas tant une forme de panthéisme qu’un amour profond, raisonné pour cette manière de vivre, si peu de temps qu’on puisse le faire, à l’écart du tumulte, en suivant ces chemins qui gardent à qui veut les lire les traces d’une histoire séculaire : « Je les vois, tracés qui ne blessent ni ne segmentent mais relient, pas de l’homme ou de la bête et terre, cultures et demeures, cyprès riverains et ciel. Chemins religieux, en effet, si, foncièrement, on ne les éprouvait païens. »
Les chemins, bien plus que les autoroutes d’aujourd’hui, avaient une fonction de lien ; il y eut une longue période où « on allait, périple rude, surprises et peurs, mais prémunis de l’errance. Le chemin accompagnait, donnait un destin. » Claude Dourguin rappelle que les routes anciennes étaient parcourues sans cesse par les marchands, les soldats, les étudiants, les colporteurs, les ouvriers, etc., vivantes de toute une vie « bigarrée, pleine de bruits et d’odeurs ». On lit encore l’épaisseur du temps dans les noms de lieux, énumérés pour tout ce qu’ils portent du passé, ceux par exemple de l’Italie, abondants ici, ou pour le plaisir de les suivre inscrits sur la carte le long d’un sentier, « Bosch Tens, Plan Vest, Löbbia, Cadrin, Mungat, Maroz, Dent…, petites énigmes locales qui entrainent le songe dans leur récitatif mystérieux ».
Claude Dourguin vit aussi les paysages à partir de la littérature et de la peinture, évoquant les voyageurs du XIXe siècle, de Chateaubriand à George Sand ou Mérimée, Schiller, Heine…, suivant Hölderlin et Nerval, Thoreau et Montaigne, ou un personnage de Stifter. Dans un paysage de neige, l’eau sous la glace est un « jardin d’Eden, un fond de tableau de Bellini » ; ici, ce sont les campagnes des Très riches heures du duc de Berry, là des teintes pour un Douanier Rousseau, des formes admirées chez Memling ou Carpaccio, des lumières du Lorrain, "La construction d’un grand chemin" d’Horace Vernet, ou encore Poussin, Dürer, Thomas Jones…
Ce qui est esquissé dans Chemins et routes, c’est un projet rêvé dont le livre tel qu’il est, donne une idée : projet « d’un livre des chemins, catalogue et dictionnaire à la fois, qui évoquerait, recenserait sans du tout prétendre faire œuvre savante, les figures diverses des chemins, leurs histoires, leurs particularités géographiques. Ou bien un traité exact et poétique, recueil des singularités des reliefs et des terres, provinces et leurs façons de dire, de cultiver, de mener commerce, bêtes poussées devant soi […] ». De ce projet borgésien reste pour le lecteur un beau labyrinthe où il peut errer, découvrir sans cesse et des sorties et des possibilités de se perdre ; il saura aussi qu’à emprunter les chemins, « au plaisir physique d’arpenter, à la satisfaction du regard se mêle le bonheur de découvrir, d’apprendre, de comprendre, de nouer un lien intime avec une contrée et sa terre », il souhaitera peut-être avec la marche voir le monde devant lui, comme le faisait Walt Whitman cité à la fin du livre.
(1) Voir les derniers publiés, en 2008 chez le même éditeur, Les nuits vagabondes et Laponia.
12:38 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook