31/07/2014
SUSAN SONTAG dans Les Carnets d'Eucharis, 2013 (N°1)

E X T R A I T S
Les Carnets d’Eucharis, Année 2013
(HOMMAGE A SUSAN SONTAG)
■■■
[…]
Devant l’image qui montre la douleur des autres, il reste à lutter contre plusieurs attitudes : la défection morale mais aussi la naïveté de qui croit découvrir l’horreur ou le cynisme de celui qui la voit comme une représentation et rien d’autre.
En entendant les propos de Macha Makéïeff à la radio vantant « la beauté convulsive » de Fukushima, j’aurais aimé lui opposer les arguments de Susan Sontag. Pour voir de la beauté dans la catastrophe, il faut soit se sentir hors du désastre, en le regardant de loin comme un spectacle et fuir ainsi sa propre peur, ou être en mesure de la transformer en œuvre, ce qui n’empêche pas d’en mesurer la réalité. De l’horreur, de la guerre, en effet, peuvent naître des tableaux et des poèmes. Otto Dix, Apollinaire, Picasso et bien d’autres artistes pourraient être cités. Cette douleur, si nous pouvons l’éloigner bien entendu, et même la transformer, elle n’en existe pas moins. Susan Sontag évoque en ce sens le travail du photographe canadien Jeff Wall comme antidote à l’indifférence devant la guerre. Il n’est jamais allé en Afghanistan mais a conçu une immense photographie[1] en 1992 à partir d’une installation mettant en scène des soldats morts. « Antithèse du document », cette image de Jeff Wall nous donne à voir l’horreur de la guerre mieux que des images de reportage réel. Il n’est pas hasardeux que l’artiste se réfère explicitement à l’œuvre de Goya.
Susan Sontag, après avoir réfléchi sur ce qui l’éloigne en partie de sa position dans ses précédents essais sur la photographie - qu’elle qualifie de conservatrice, la diffusion des images entrainant une apathie morale - explicite son cheminement de pensée en se référant à une « défense de la réalité » contre les tenants de la représentation. II faut des images, mais vues dans un cadre élargi, dans la compréhension de ce que les hommes sont capables d’infliger à leurs semblables. Revenant sur le travail de mémoire, elle choisit une posture originale : Pour elle, la mémoire est trop souvent associée à un excès de souvenirs qui rendent impossible toute réconciliation, parce que trop facilement utilisés pour opposer les identités au nom de la souffrance particulière de telle ou telle communauté. On se souviendra, outre son origine juive, qu’elle fut aux côtés des Bosniaques à Sarajevo, ou à Jenine, aux côtés des Palestiniens.
« Faire la paix, c’est oublier », écrit-elle.
Par l’image, il s’agit de faire réfléchir, non pas à une monstruosité particulière, mais de montrer de quoi l’humanité est capable en matière de cruauté et de violence. Cette conclusion paraît d’une grande sagesse dans un contexte international dominé par les violences interethniques et communautaires. Leçon de vie, pensée souple et pragmatique, culture ouverte, le livre de Susan Sontag est tout cela et reste un bel encouragement à la vigilance et à ne pas céder à la tentation du cynisme, de l’indifférence ou, pire à ses yeux, de l’angélisme.
« Nous » – ce « nous » qui englobe quiconque n’a jamais vécu une telle expérience – ne comprenons pas. Nous ne saisissons pas la chose. Nous ne pouvons pas nous représenter ce que c’était. Nous ne pouvons imaginer à quel point la guerre peut être horrible – ni à quel point elle peut devenir normale. Nous ne pouvons ni comprendre, ni imaginer. C’est ce que chaque soldat, chaque journaliste, chaque travailleur humanitaire, chaque observateur indépendant ayant connu le feu de la guerre et eu la chance d’échapper à la mort qui frappait les autres, tout près, éprouve, obstinément, et ils ont raison»[2]. […]
_______________________
© Sylvie Durbec
Extrait de « Devant Susan Sontag, écrire ? », (p.23/24)
[…]
Il est devenu plausible que, dans des situations où le photographe a le choix entre une photo et une vie, il choisisse la photo.
Puis elle-même et la rédaction, et surtout la France la meilleure, la plus consciencieuse, perdirent trois photographes et un reporter en Algérie et deux journalistes à Suez, et là Trotta lui dit : la guerre que vous photographiez pour les autres, pour le petit-déjeuner, elle ne vous épargne donc pas non plus ! Je ne sais pas, mais je suis incapable de verser une larme sur tes amis. Quand quelqu’un se précipite dans le feu pour rapporter chez lui quelques bonnes photographie de la mort des autres, il peut bien, avec cette ambition sportive, mourir lui aussi, il n’y a là rien de particulier, ce sont les risques du métier, rien de plus ! Élisabeth avait perdu toute contenance, car tout ce qu’ils faisaient à ce moment-là, elle le considérait comme la seule attitude juste, il fallait que les gens apprennent, et de façon précise, ce qui se passait là-bas, et il fallait qu’ils voient ces photos pour « être secoués, réveillés ». Trotta dit seulement : Ah bon, le doivent-ils ? Le veulent-ils ? Réveillés, seuls le sont ceux qui peuvent imaginer ça sans vous. Penses-tu être obligée de me photographier des villages détruits et des cadavres pour que je me représente ce qu’est la guerre, ou bien ces enfants indiens pour que sache ce qu’est la faim ?
De même que l’appareil photo est une sublimation de l’arme à feu, photographier quelqu’un est une sublimation de l’assassinat : assassinat feutré qui convient à une époque triste et apeurée.
Qu’est-ce que c’est cette prétention idiote ? Et celui qui ne sait rien, il feuillette vos séries de photos bien réussies, en esthète ou simplement écoeuré, mais cela doit dépendre de la qualité des clichés, tu en parles si souvent, l’importance de la qualité, est-ce qu’on ne t’envoie pas partout parce que tes photos ont cette qualité ? Demanda-t-il avec un léger mépris.
Une photo qui informe sur la détresse qui sévit dans une zone où on ne la soupçonnait pas ne fera pas la moindre brèche dans l’opinion publique, en l’absence de sentiments et de prises de position qui lui fournissent un contexte adéquat. (…) Les photos sont incapables de créer une position morale, mais elles peuvent la renforcer (…)
[…]
_______________________
© Michaël Glück
Extrait de « Tout, dans l’univers, existe pour aboutir à une photographie », (p.33)
[…]
L’aventure de la forme a été négligée, abandonnée, au profit du témoignage infini et de ce qu’un Stéphane Mallarmé appelait si justement, et avec quel dégoût, « l’universel reportage ». Inceste, viol, pédophilie, meurtre, cancer, conflit, crise financière, magouille politique, suicidé de frais, tout est bon, aujourd’hui, pour inscrire le roman dans le fil d’une actualité dont, en fait, il ne dit pas grand-chose, la critique sociale ayant, depuis longtemps, trouvé refuge dans le « roman noir ».
Le journal entretient notre représentation du monde comme fragmentation aléatoire et déréalisation quotidienne. La seule lecture que l’on peut décemment en faire est une lecture sur le mode surréaliste. Le journalisme possède, en effet, ce talent très particulier qui consiste à rendre considérable le banal et banal le considérable. Règne de la donnée hors contexte, de l’information partielle, des « chiens écrasés », de l’obsession « people », du dernier « débat de société » à la mode ; le J.T. et Internet n’ont fait que renforcer ces travers. C’est pourquoi ce dont nous aurions le plus besoin, aujourd’hui, c’est d’auteurs débranchés, inactuels, aptes à inquiéter les routines. Pas des experts en « faits divers » abonnés aux alertes automatiques de Google. Des auteurs du « dehors », en quête de vigueurs nouvelles.
Tristan Tzara, dans le manifeste Dada de 1918 : « Une œuvre compréhensible est produit de journalisme ». Aujourd’hui, la multiplication des accès à une information devenue pléthorique, contradictoire et omniprésente aurait dû frapper les auteurs par le côté précisément inconstituable de son discours. Or, tout se passe comme si l’écrivain n’avait pas noté la profonde aphasie de notre commun présent. La littérature semble partout, face au texte inarticulable de l’actualité, dans un état de sidération servile quant au contenu et de repli conservateur quant à la forme. Son obsession du sens la réduit à n’être qu’une simple donnée parmi d’autres. Les romans industriels sont devenus aussi jetables que le journal quotidien. En en empruntant les thèmes, ils finissent par en partager le destin.
[…]
_______________________
© Gérard Larnac
Extrait de « Sontag apparamment », (p.36/37)
Susan Sontag, comme chacun d’entre nous, était un personnage « de son époque ». Plus encore, elle fut l’un des principaux interprètes de cette époque. Elle sut adopter plusieurs masques littéraires comme celui de critique d’art, d’avocat polémique des causes politiques et sociales, jusqu’à celui de romancière, de correspondant de guerre, témoignant en cela de la grande variété de sa personnalité, (on pourrait même penser disparité), ce dont elle fut toujours consciente. En écrivant au sujet de Sartre elle avait lancé l’idée que le philosophe, fidèle aux rites primitifs de l’anthropophagie, les transposait afin de « manger le monde ». Elle nommait cet élan : cosmophagie. On pourrait lui retourner le compliment, Susan Sontag a avalé, a dévoré la vie comme le monde, en jouant de nombreux rôles. Une figure de l’excès s’il en fut.
[…]
_______________________
© Béatrice Machet
Extrait de « La revanche de l’intellect », (p.39)
[…]
Remettant en question sa mentalité de « citoyenne de l’empire américain », analysant avec lucidité ses contradictions personnelles ainsi que les paradoxes auxquels elle se trouve confrontée, elle tente d’approcher au mieux et de comprendre l’état d’esprit et la culture de ceux qui l’accueillent, elle, l’Américaine, avec tant de désarmante bienveillance. Une fois surmontés le côté négatif des toutes premières impressions et le désarroi qu’elles engendrent, l’une des difficultés majeures, dans la démarche intellectuelle et humaine qui est la sienne, consiste à se dépouiller des images que la femme et la militante se sont construites au cours de sa vie ; « sarabandes d’images » qu’elle porte en elle, qui forgent ses convictions et qui façonnent sa personnalité. Car « c’est une chose d’imaginer et autre chose de découvrir la réalité », de la saisir dans son épaisseur, indépendamment du « moulage qui portait la marque de l’esprit américain ».
[…]
_______________________
© Angèle Paoli
Extrait de « Trip to Hanoi ou le récit d’une « révolution intérieure » », (p.45)
[…]
« Pour moi, voyager, c’est se remplir l’esprit. (…) je vois combien la notion de « voyageur » a infiltré, parfumé, nourri mon rêve naissant de devenir écrivain. Quand je reconnais que tout m’intéresse, que dis-je d’autre, sinon que je veux voyager partout ? »
Chez Sontag les notions de lecture et d’écriture sont aussi intimement liées à la notion de voyage. Voyager pour défendre des libertés est un engagement qui se passe de toute démagogie, et sur ce point Sontag est sans concession. Elle a non seulement voyagé sur les terres de la littérature, mais elle a aussi directement vécu, pendant un certain temps, dans des pays en guerre. Durant l’été 1993, elle se rend, pour la deuxième fois, à Sarajevo pour monter En attendant Godot de Beckett – (« il était sûrement aussi dangereux d’aller à Barcelone en 1937 qu’il l’est d’aller à Sarajevo en 1993 ») – De 1965 jusqu’au début des années 1970, elle milite contre l’agression américaine au Vietnam. Autant de luttes et de positionnements qui définissent son profil d’écrivain, c’est-à-dire ne se voulant ni crédule ni idéaliste. Pour Sontag, rien de plus lamentables que ces « intellectuels tristement dépolitisés d’aujourd’hui, avec leur cynisme toujours prêt, leur accoutumance au divertissement, leur réticence à subir de l’inconfort au nom d’une cause quelconque, leur dévotion à leur sécurité personnelle. »
« L’art se crée parmi des hommes vivants et concrets, donc imparfaits. […] Il faut que votre verbe vise à atteindre les hommes et non les théories, les hommes et non pas l’art. » écrivait Witold Gombrowicz, dans son Journal, 1954.
[…]
_______________________
© Nathalie Riera
Extrait de « Susan Sontag et le désir d’une émancipation totale », (p.58)
[…]
Si la photographie a très tôt intéressé les écrivains (Hugo, Zola, Lewis Carroll), c’est que se joue en elle, à travers elle, la question de la trace, de l’empreinte, de la Graphie. Photo-Graphie. Ecriture de la lumière. Ecriture par la lumière. La lumière par l’écriture. La preuve par la lumière qui non seulement peut se voir, mais en plus s’écrire. Et que signifie au fond écrire sur la photographie sinon chercher dans l’écriture de la lumière une réponse à l’écriture du texte, c’est à dire à la lumière de l’écriture ? De ce point de vue il faut remonter très loin pour trouver l’origine du problème; à Moise et aux tables de la Loi. Moïse voit d’abord et ensuite ça s’écrit. D’où l’alliance originelle image/texte, le texte fait image car l’image est un texte. Susan Sontag, née Rosenblatt, ne peut l’ignorer. Une langue commune aux deux medias qui fonctionne au régime de la Révélation (le fameux révélateur photographique) et de l’Impression (sur un support, papier ou autre, au moment où Sontag écrit la photo argentique est encore la norme).
[…]
_______________________
© Richard Skryzak
Extrait de « Petite diversion à propos de Sur la Photographie de Susan Sontag », (p.60)
[…]
Susan Sontag a écrit “La maladie comme métaphore” à la fin des années ’70. Trente ans et des poussières plus tard, la maladie s’est compliquée, la métaphore en est devenue plus rugueuse encore, la chape de plomb s’est faite plus dense, plus lourde, plus sournoise. La maladie appartient plus que jamais à l’industrie pharmaceutique qui boursicote, protocole, cultive les effets d’annonce, promet, laisse espérer que dans quelques années au vu des résultats obtenus sur les rats, souris, lapins, cochons et autres cobayes, les malades du futur auront, sinon le privilège de guérir, au moins celui de ne plus traîner pendant toute leur vie le boulet d’avoir été un jour “gravement” malade et d’obtenir enfin un prêt dans une banque.
Or, même si l’espoir est le dernier à mourir, ça fait quand même un bail que durent ces “quelques années” parsemées de “molécules du futur”, de “nous y sommes”, de “blouses blanches reprises devant un microscope qui va voir ce que personne n’a encore réussi à voir, là bientôt, très bientôt”. Dans ce cirque médiatique qui vend de l’espoir périmé avant même qu’il n’arrive aux intéressés, le livre de Susan Sontag devient repère, il fixe les choses et nous les rend afin que nous regardions ce que tout est devenu. Un livre rare. Qui nous montre comment la métaphore de la maladie s’est développée, s’est embellie, continue à pousser dans le terreau des conflits, des injustices, des jeux de pouvoirs économiques et politiques qui parcourent désormais la planète à la vitesse des réseaux qui sillonnent espace, terre, ciel, mers, océans et air.
“La maladie comme métaphore”, Susan Sontag l’a voulu “essai”, une forme qui valorise et valide une recherche méthodique, presque universitaire mais qui en même temps s’adresse à tous sans tomber dans le piège de la “vulgarisation”. La question est trop délicate pour être simplifiée. Alors l’auteur argumente, étoffe, montre, prend à témoin l’histoire, la littérature, écarte le malade, sciemment l’évite, par respect, presque par tendresse, comme une mère elle le cache à la vindicte dont il est le sujet-objet-raison, la cause de quelque chose qui le dépasse et dont il ne sait rien. Comment pourrait-il le savoir lui qui est confronté plus que jamais à la vie dans ces instants où quelque chose a basculé ou s’est déclaré ou s’est mis à exister, à vivre. On ne meurt pas à petit feu, on meurt un point c’est tout, c’est la vie qui veut ça, pas la maladie. La maladie ne veut rien, elle vit sa vie, suit son évolution, court à sa perte de toutes les façons, guérison ou mort sont pour elle la même chose, la fin de son aventure. La maladie n’est jamais mortelle, c’est l’homme qui est mortel. Et pas seulement l’homme. Les arbres, les animaux et même la radioactivité sont mortels, ce n’est qu’une question de temps. Un jour, la vie se transforme en d’autres vies et/ou une infinité de morts, finalement chacun choisira son credo ou ne choisira rien et se laissera aller à l’indéfinition même de ce bagage encombrant. Mais mourir n’est pas au goût du jour. Dans une société qui mise sur « l’idéal d’une santé parfaite », la mort est forcément un échec. Susan Sontag revisite les siècles, la littérature, la peste, la syphilis, la tuberculose. Et le cancer. Dont elle prépare l’entrée en scène dès le début du livre, il est là entre les lignes, sujet délicat, « maladie mortelle (ou jugée l’être), parce qu’elle est ressentie comme obscène au sens originel du terme, c’est-à-dire de mauvais augure, abominable, répugnante, offensante pour les sens. »
[…]
_______________________
© Patricia Dao
Extrait de « La maladie comme métaphore », (p.62/63)
SUSAN SONTAG
Les Carnets d’Eucharis, Année 2013
(HOMMAGE A SUSAN SONTAG)

Like some Americans and many Europeans, I would far prefer to live in a multilateral world – a world not dominated by any one country (including my own).*
Comme certains Américains et comme de nombreux Européens, je préfèrerais de loin vivre dans un monde multilatéral – un monde qui ne serait pas dominé par un seul pays (quel qu’il soit, y compris le mien) – Literature is freedom(The Friedenspreis acceptance speech of Susan Sontag)
[Susan Sontag, « La littérature est la liberté » in Garder le sens mais altérer la forme, Christian Bourgois Editeur, 2008, (p.248) Traduit de l’Américain par Anne Wicke.]

Les Carnets d’Eucharis, Année 2013
(HOMMAGE A SUSAN SONTAG)
Format : 170 x 250|206 pages| ISSN : 2116-5548
ISBN : 978-2-9543788-0-0
2013
16:06 Publié dans Les Carnets d'Eucharis, Susan Sontag | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
29/07/2014
Chris Marker, La jetée, 1962
01:39 Publié dans VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
16/07/2014
"En bref" d'Anthony Dufraisse
![]()

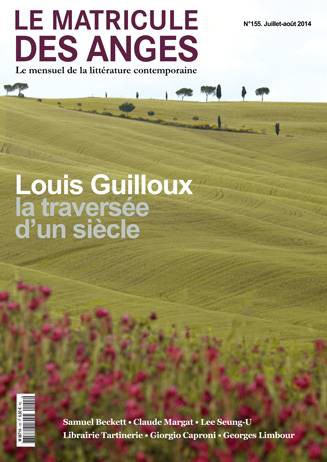
LE MATRICULE DES ANGES| N°155 (juillet / août 2014)
●●●
Site : LE MATRICULE DES ANGES
| © Cliquer ICI http://www.lmda.net/
19:35 Publié dans Les Carnets d'Eucharis | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
14/07/2014
Paul Thek

© Paul Thek
[Photo : Peter Hujar]
Robert Wilson en conversation avec Elisabeth Sussman, Whitney Museum of American Art, New York, et Theodore Bonin, Alexander and Bonin, New York
Né à Brooklyn en 1933, Paul Thek grandit à Floral Park, dans l’Etat de New York, avant de s’installer en 1951 à New York. Il se forme à l’Art Students’ League, au Pratt Institute et à Cooper Union et développe rapidement un mode de vie nomade, entre la côte Est des Etats Unis et l’Europe. Lors d’un séjour en Sicile puis à Rome en 1963, l’artiste est impressionné par les catacombes et les reliquaires. Il entreprend peu après sa très significative série des Technological Reliquaries (Reliquaires technologiques, 1964-1967), basée sur la rencontre de cires anatomiques et de matériaux industriels raffinés. « A New York à cette époque, il y avait une telle tendance au minimal, au non-émotionnel, à l’anti-émotionnel, même, que je voulais dire à nouveau quelque chose à propos de l’émotion, à propos du côté hideux des choses. Je voulais rendre à l’art les caractéristiques de la chair humaine crue », explique-t-il en 1969 dans une interview avec Emmy Huf pour De Volkskrant. Tandis qu’il fréquente la scène underground réunie à la Factory d’Andy Warhol, en particulier Jack Smith, le cinéaste de Flaming Creatures (1963), son œuvre construit une réponse critique au Minimalisme et au Pop Art. Susan Sontag, avec qui il est lié d’une forte amitié dès 1959, lui dédicace son premier livre, Against Interpretation (Contre l’interprétation, 1966), incluant notamment ses Notes on Camp. LIRE LA SUITE
19:06 Publié dans CLINS D'OEILS (arts plastiques) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Martine-Gabrielle Konorski
Je te vois pâle au loin

Martine – Gabrielle KONORSKI| © Domaine privé
Toute une vie d’éponge
derrière les oripeaux
sous les mots et les pages
et les paroles des hommes à chapeau
Au milieu du chemin
Des aubépines en fleurs.
………………………………………………………………………….… DEMAIN IL FERA BEAU
(Extrait 1)
Là
Cligne sous nos paupières
un battement impair
Temps de pierre
d’un chronomètre
tu traverses les ombres
sur la pointe des pieds
A la lisière.
……………………………………………………………………………. CANTIQUE
(Extrait 2)
La lumière s’est éteinte
Ne me dis plus un mot
Cherche sous la couleur
un chemin d’outre-routes
Silence
Contre
bouches closes
Reviens.
……………………………………………………………………………. NUIT
(Extrait 3)
Un morceau de papier
A tes pieds
Dessin d’un cabanon
Où tu pourras rêver
Et tourne et tourne
manège
Ligne de plume
Rubans aux cheveux de lumière
Cours et cours
L’horizon fermera ses paupières sur ton regard de verre.
……………………………………………………………………………. MANÈGE
(Extrait 4)
(A paraître à l’automne 2014. Lauréat du Prix Poésie Cap 2010)
●●●
Martine – Gabrielle KONORSKI
Née à Paris en 1959. Elle est de nationalité française et suisse. Après des études supérieures de Droit, d’Anglais et de Sciences Politiques, elle développe une carrière dans la Communication, depuis plus de trente ans, à des postes de responsabilités, au sein de cabinets ministériels, d’entreprises publiques et privées, en France et aux Etats-Unis ainsi que d’agences de communication américaines.
Ses activités de Directeur de la Communication se déploient principalement à l’international. Elle a toujours baigné dans une culture cosmopolite et a pratiqué la traduction en anglais et en italien.
Après quelques années d’éclipse, elle retrouve la poésie qui l’accompagne depuis toujours. « la poésie s’est imposée à moi, entre lumières et ombres, et c’est dans le brasier des mots que se construit mon chemin. C'est la musique de la voix et la danse intérieure qui tissent ensemble les mots, tel un ruban de vie ».
Elle a publié Sutures des Saisons, (Editions Caractères), ainsi que dans des revues de poésie : Incendits, autour du sculpteur G. Jeanclos, Ecrits du Nord, Les Cahiers du Sens, Levure Littéraire. D’autres textes sont à paraître dans la revue Les Carnets d’Eucharis et la revue Décharge.
Son livre de poésie, « Je te vois pâle au loin » vient de recevoir le Prix « Poésie Cap2020 » et sera publié à l’automne 2014 aux Editions Le Nouvel Athanor.
Martine Konorski est également musicienne (piano et chant). Elle est membre de l’Union des Poètes & Cie.
Elle est Chevalier dans l’ordre national du mérite.
18:30 Publié dans Martine-Gabrielle Konorski | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
13/07/2014
Tarjei Vesaas, L'incendie
●●●
Du côté de chez…
Tarjei Vesaas

© Tarjei Vesaas & Olav Vesaas
L’incendie
La Barque en coédition avec L’Oeil d’or, 2012
Postface d’Olivier Gallon.
Traduction du nynorsk (néo-norvégien) de Régis Boyer
(Site) LA BARQUE | © http://www.labarque.fr/livres01.html
Il était étendu, le visage enfoui dans les racines des herbes. Des brins d’herbe cassés lui piquaient la peau, cela faisait du bien. S’il était resté longtemps ainsi, le dessin confus que formaient les herbes écrasées au sol se fût imprimé sur son visage. Peut-être était-ce nécessaire, dans l’état où il se sentait.
Il ne bougeait pas un doigt.
Dormir.
Autour de lui, le jeu continuait. Les brins d’herbe, tout contre ses flancs, se redressaient dans l’intention de l’enfouir sous leur croissance avant l’arrivée de l’hiver. Les souffles d’air apportaient grain de poussière sur grain de poussière qui s’étalaient sur l’énorme élément que constituait son corps dans le paysage. Des coléoptères délicats sortaient de terre à cause de la double chaleur obscure qui se trouvait produite sous lui. Ils se mettaient incontinent à entreprendre un important travail. Ils habiteraient là, sous son corps, comme sous n’importe quoi d’autre qui fût tombé à terre. Il fallait tout préparer pour la vie en cet endroit. Instantanément, il était l’objet de sollicitudes et de soins, on l’utiliserait.
Il en prit conscience peu à peu. Quand on était étendu comme il l’était, on sentait maintes choses… et on s’en trouvait bien.
Ne veux pas penser.
Ne veux plus.
Je veux.
Il était étendu à plat, lourdement, se faisant de plus en plus pesant, pour ainsi dire. Mais il ne pouvait s’abstraire de la vie bruissante qu’il y avait ici. Il notait confusément qu’il était le centre d’une effervescence effrénée.
............................... (p.68/69)
●●●
Le grand but : qu’est-ce que j’ai fait de mon cœur ? de mon cerveau et de l’obscurité ? C’est cela qu’on va voir maintenant. On va le voir en haut de la prochaine côte, et on aura la paix. Du dehors, d’ombres d’un noir de poix, le cortège recevait des renforts fulgurants. Des cœurs effrayés, pleins d’attente, battaient aux chambranles des portes, attendant le cortège.
Pas de questions dans l’air ardent : qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que je dois faire ? Qu’est-ce que je veux ? Rien de tel. Le temps était trop mesuré, si l’on ne s’y joignait pas à la vitesse de l’éclair, le cortège était passé. Se jeter dans la foulée de la course, que ce fût la vie ou la mort qui attendît là-haut, au sommet de la côte. Pas de salutation. Personne qui levât les yeux. Nul qui ne surveillât quoi que ce fût d’autre que sa place. Des hommes et des femmes… Nul qui ne dît mot… et l’on eût dit maintenant que la terre cédait sous le poids.
............................... (p.147/148)
●●●
Oui, passer un pont…
Le jour venait, de tous côtés. Le pont était gris de la lumière nocturne qui se retirait, et des bouffées de brouillard venues du cours d’eau l’enveloppaient en passant. Il était long, avec des rangées de vieilles piles sombres dans l’eau. Entre elles, tranquillement, passait le cours d’eau.
Sur le moment, pas lieu de s’en soucier. Passer le pont ! Arriver de l’autre côté. Vers ce que l’on ne savait pas encore. Il n’y a pas de nom pour cela, mais le chemin pour y aller, c’est le pont. Il chante le bâtisseur du pont, sans pouvoir s’arrêter. Jon entendait ce chant, sachant qu’il n’avait pas de nom.
Il parvint sur le pont, faisant claquer ses talons sur les planches. Les pans de brouillard l’entouraient, hachant sa marche, traversée par à-coups de lueurs. Le pont était gris, ou teinté de nuit… mais il y avait ce jour neuf qui était en train de s’y établir. Tandis qu’un coup de vent nocturne prolongé se métamorphosait doucement en brise matinale.
............................... (p.170/171)
●●●
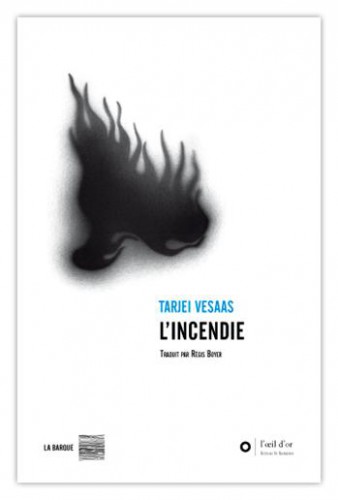
Tarjei Vesaas (1897-1970)
L’œuvre de Tarjei Vesaas est l’une des plus fortes à nous être parvenues de Norvège. De la quarantaine d’ouvrages qu’il écrivit, une partie seulement a été traduite en français, principalement ses romans de maturité : Le Germe, Les Oiseaux, Le Palais de glace, Les Ponts, La Barque le soir et... L’Incendie.
Tarjei Vesaas fut sans distinction romancier, poète, nouvelliste et, de même que Jon Fosse, l’un de ses plus illustres lecteurs, auteur de théâtre ou plus précisément de « pièces à entendre ».
Paru alors que Tarjei Vesaas était âgé de 64 ans, L’Incendie est un« roman limite » dans son œuvre.
Avec une force inégalée, l’auteur parvient à faire coexister différents pans de réalités. Jon, « l’esprit » du roman, pénètre ainsi toutes choses et nous-mêmes.
Chaque chose, chaque être, est une voix qui parle et se tait sans que se taire soit ne plus parler, cesse d’être une adresse.
●●●
Site : KULTORG
| © CLIQUER ICI
18:43 Publié dans Tarjei Vesaas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Annette von Droste-Hülshoffn Tableaux de la lande & autres poèmes
●●●
Du côté de chez…
Annette von Droste-Hülshoff

TABLEAUX DE LA LANDE et autres poèmes
La Dogana, 2013
Traduction de Patrick Suter & Bernard Böschenstein
& texte allemand
LA DOGANA | © http://www.ladogana.ch/html/nouveau.htm
I
Ainsi s’est-il en vain tourmenté,
a-t-il en vain vendu le domaine
Où sont le tilleul de son enfance
et le lit de mort de ses parents,
En vain a-t-il durant tant de jours
respiré l’air oppressant de gel,
La bride dans les mains engourdies,
quand crissent les vagues de neige –
Tant à l’aurore qu’au couchant,
Rien que pour un quignon de pain.
Le marchand sur le sol s’agenouille,
frotte les flancs brûlants du cheval,
du chevron de la poutre la lampe
fait vaciller des ombres folles ;
Dieu, il vit ! – un éclair dans ses yeux –
le cheval tremble, ses flancs frissonnent,
Puis s’étend, naseaux étirés,
ballonné dans un cri sauvage,
Et des membres tournoie la vapeur,
Lutte ultime des forces de vie.
A genoux le marchand frotte encore,
refusant d’en croire ses yeux,
Et montent dans ses paupières gonflées
les larmes amères des hommes,
il étend doucement la couverture,
sur les flancs doucement la dépose,
Fais alors glisser sa lanterne
sur les tendons étirés ;
C’en est fini, plus un souffle de vie,
Des flancs déjà s’estompe la vapeur.
Il se relève, il est debout,
homme accablé par les soucis,
Et lentement saisit son front,
l’abrite dans le creux de ses mains.
Que s’est-il passé ? et demain ?
comment pourrait-il s’en souvenir !
De la désespérance il sent
le venin couler dans son cœur,
Quoi ? que se passe t-il – i l se lève,
Un cliquetis juste à ses oreilles !
Et, adossé au poteau voisin,
soupesant impassiblement
Mors et bride du cheval mort,
un homme avec étrille et picotin,
Trapu, tel cocher qui dans la poussière
et le gel mène ses rudes membres,
Un chapeau mou dégoulinant
suspendu à sa large nuque –
Et paisibles sur le maquignon
Se posent des yeux ombrés de gris.
« Monsieur », dit-il, « vous m’inspirez pitié,
c’était là un bel animal,
Mais j’en connais un qui lui ressemble
comme deux coraux du rosaire ;
Je vous dirai le lieu, la maison,
vous l’aurez pour deux cents florins,
Je sais un patron qui pour l’avoir
donnerait la moitié de ses biens. »
Le marchand écoute et balbutie :
« Je suis un homme tout à fait ruiné. »
[…]
............................... (p.169/171)
●●●
[…]
Et ce n’est qu’entouré de sapins,
aiguilles bruissant à ses semelles,
Qu’il ralentit le pas, restant
prostré, et qu’il écoute – écoute –
Nul amant n’écoute ainsi le son
de la cloche invitant à l’amour,
Nul malade le pas du prêtre
qui l’absout avec la relique ;
Un délinquant peut écouter ainsi
La pendule sonner la dernière heure.
Sous le feu solaire sommeille
la forêt dans des vagues d’arômes,
Résine suintant des aiguilles comme
des cils du dormeur coulent les larmes ;
Le rocher s’incline, ivre de soleil,
les oiseaux rêvent de ramage,
Caressé par sa queue d’écureuil
dort enroulé sur lui-même,
Une vapeur blanche à chaque aiguille
Exhale la térébenthine.
Un rayon perce à travers les branches
jusqu’aux mèches de qui écoute,
Qui luisent de la sombre chevelure
telles flammèches de vers marins ;
Il se dresse et guette, et guette et se dresse,
n’entends-tu pas un grésillement ?
Un ruissellement, tels grains de sable
glissant dans les fentes du grenier ?
Si acéré, si pénétrant,
Comme affûtage de faux sur la pierre.
[…]
............................... (p.193)
●●●

Note de l’éditeur
Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) est considérée dans le monde germanophone comme la plus grande poétesse allemande de tous les temps. Gottfried Benn, Walter Benjamin ont dit très tôt leur admiration pour ses inventions puissantes et Johannes Bobrowski compte « Le feu des bergers » et « Dans l'herbe » parmi les dix plus beaux poèmes de la langue allemande. Paul Celan lui-même ressentait une parenté envers ce que cette écriture comporte d'âpre, de rêche, de dense et d'élémentaire. Récemment remise au goût du jour par plusieurs jeunes auteurs, Annette von Droste-Hülshoff est constamment citée en raison de la liberté audacieuse de sa prosodie et du message d'immense désolation - constamment interrompu par les souvenirs d'une vie à première vue idyllique, qu'elle transmet à travers ses étonnantes visions. Mais cette célébrité dépasse nettement le cercle des poètes et des connaisseurs : « Le garçon dans le marais » est récité depuis des générations par les élèves des écoles allemandes. De même « Le Hêtre du Juif », sa prose la plus célèbre, est souvent étudiée au collège. Enfin « La Droste », comme on l'appelle familièrement, a figuré sur des billets de banque et des timbres. Le présent recueil offre un ensemble des textes les plus denses et les plus audacieux de l'écrivain : le défi qu'ils opposent aux traducteurs en a longtemps retardé la diffusion en terre française. Ces poèmes sont tantôt marqués par des éléments d'une extrême concrétude, qui fécondent l'imagination la plus débridée, tantôt ils sont entraînés par le mouvement propre de la vie intérieur, le rêve. Dictés par une sensibilité quasi tactile au monde du vivant, ils font fréquemment appel à la botanique, à la minéralogie, à la zoologie, de même qu'ils décrivent de manière très directe les mondes rural aussi bien que préindustriel et minier, mêlant cette réalité rugueuse à des scènes spectrales volontiers situées dans la brume des marais ou dans la poix des cimetières…
●●●
16:57 Publié dans Annette von Droste-Hülshoff | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Walter Benjamin, Enfance berlinoise
●●●
Du côté de chez…
Walter Benjamin

© Walter Benjamin
Enfance berlinoise
L’Herne, 2012
Préface de Patricia Lavelle.
Traduit de l'allemand par Pierre Rusch.
L’HERNE | © http://www.editionsdelherne.com/
Combien désespéré renaissait à chaque printemps mon amour pour le prince Louis Ferdinand, aux pieds de qui poussaient les premiers crocus, les premiers narcisses ! Un cours d’eau qui me séparait d’eux me les rendait aussi inaccessibles que s’ils avaient été placés sous une cloche de verre. Telle est la froide beauté sur laquelle s’appuie toute noblesse princière, et je compris pourquoi Luise Von Landau, qui avant de mourir fréquentait le même cours que moi, avait dû habiter quai de Lützow, presque en face de cette parcelle sauvage qui confie aux eaux du canal le soin de ses fleurs. Je découvris plus tard de nouveaux coins ; j’en appris davantage sur d’autres. Mais aucune fille, aucune expérience, aucun livre ne surent rien me dire de neuf sur celui-ci. Aussi quand trente ans plus tard un connaisseur de l’endroit, un paysan de Berlin, me prit sous son aile pour, après une longue absence commune, revenir avec moi dans la ville, sa route sillonna-t-elle ce jardin en y jetant la semence du mutisme. Il me précédait sur les sentiers, suivant une pente qui pour lui était toujours descendante. Ils descendaient, sinon vers les mères de toute existence, du moins vers celles de ce jardin. Ses pas éveillaient un écho dans l’asphalte qu’il foulait. Le gaz jetait une lueur équivoque sur le pavé. Les petits escaliers, les porches soutenus par des colonnes, les frises et les architraves des villas du Tiergarten – nous les prîmes pour la première fois au mot. Mais surtout les cages d’escaliers, encore vitrées comme autrefois, même si bien des choses avaient changé à l’intérieur des appartements. Je sais encore les vers qui après l’école emplissaient les intervalles des battements de mon cœur, quand je marquais une pause en montant les escaliers. Ils surgissaient confusément de la vitre, où une femme flottant entre ciel et terre comme la Madone de la Chapelle Sixtine sortait de la niche une couronne à la main. Les pouces glissés sous les bretelles du cartable pour soulager mes épaules, je lisais : « Le travail est la parure du citoyen / La bénédiction le prix de la peine. » La porte d’entrée, en bas, se refermait avec un soupir, comme un fantôme redescend dans la tombe. Dehors, il pleuvait peut-être. Une des vitres multicolores était ouverte et c’était au rythme des gouttes que se poursuivait l’ascension. Mais parmi les cariatides et les atlantes, les putti et les pomones qui m’avaient jadis regardé, celles que je préférais à présent étaient les figures empoussiérées de la race des gardiens des seuils, qui protègent l’entrée de la vie comme celle de la maison. Car elles savaient attendre. Il leur était donc égal d’attendre un étranger, le retour des anciens dieux où l’enfant qui avec son cartable était passé à leurs pieds trente ans plus tôt. Sous leur signe, le vieil Ouest était devenu l’Ouest antique, d’où les vents viennent aux mariniers qui remontent lentement le Landwehrkanal avec leur barge chargée de pommes des Hespérides, pour accoster près du pont d’Hercule. Et, comme dans mon enfance, l’Hydre et le Lion de Némée prenaient à nouveau place dans le territoire sauvage qui entoure la Grande Etoile.
............................... (p.35/37)
●●●
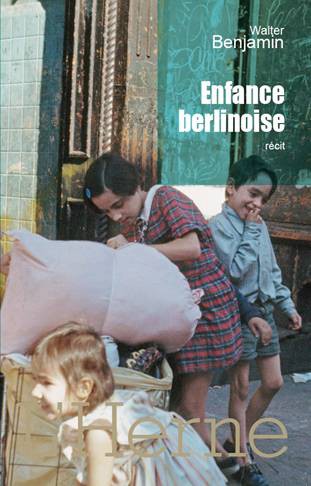
Note de l’éditeur
Enfance berlinoise est le récit des souvenirs d'enfance de l'auteur, un livre qui ouvre des perspectives nouvelles non seulement sur les mémoires d’enfance, mais également sur la compréhension de l’apport théorique de la pensée de Benjamin.
Qu’est-ce que Enfance berlinoise vers 1900 ? Ce titre, sous lequel Benjamin prévoyait de réunir un ensemble des proses courtes rédigées à partir de ses souvenirs d’enfance, ne correspond pas à une oeuvre ayant connu une édition définitive, mais plutôt à un projet de recueil que l’auteur n’a pas réussi à voir édité.
C’est la première de ces deux versions, publiée en Allemagne seulement en 2000 en dehors des écrits réunis et jusqu’à présent inédite en français, que l’excellente traduction de Pierre Rusch donne maintenant à lire au public francophone.
Préface de Patricia Lavelle.
Traduit de l'allemand par Pierre Rusch.
●●●
Walter Benjamin (1892-1940)
Écrivain et philosophe allemand, il est l’auteur d’essais historiques et esthétiques dans la ligne de l’École de Francfort. Fin connaisseur de la langue française, il traduit, entre autres, Baudelaire et Proust. En 1915, il se lie d’amitié avec G. Scholem. De leur dialogue, Walter benjamin tire une réflexion théologique qu’il applique au langage. Voyageur infatigable, il ne cesse de parcourir l’Europe de l’entre-deux-guerres. Il fut proche d’Adorno, Bertolt Brecht, Ernst Bloch et Hannah Arendt. Il est l’auteur notamment de L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (1936). En 1933, il trouve refuge à Paris et en 1940, il essaie de quitter l’Europe pour les États-Unis ; il préfère se donner la mort plutôt que de risquer d’être livré à la Gestapo.
15:16 Publié dans Walter Benjamin | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
09/07/2014
Julio Cortázar
●●●
Du côté de chez…
Julio Cortázar

© Julio Cortázar
Crépuscule d’automne
José Corti“Ibériques”, 2010
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Silvia Baron Supervielle
Les Carnets d’Eucharis | © http://lescarnetsdeucharis.hautetfort.com/
●●●
Marco Polo se souvient
Ton minuscule pays, inaccueillant et sauvage !
Là-bas des arbres nains brandissent leur ennui
pendant que les taupes perforent le chemin
et que les musaraignes remontent le ciel.
En venant à la frontière de ta terre évasive
combien de douanes vertes et des sceaux dilués !
Mes besaces recelaient médailles et mascottes
destinées à tes gardiens amateurs de menthe.
Ta langue – celle des hommes à l’affût des nuages –
s’élevait dans les chaloupes aux souffles de la nuit
et la lance du danger et l’ocelot en or
et sans répit t’attendre au-delà des sommets.
Les portes d’obsidiane s’incurvaient sous le temps
et tu étais dans le temps derrière l’obsidiane !
Avec mon nom – ce glauque gong d’ancienne grâce –
J’ai jeté sur les portes le parchemin ouvert.
Treize nuits de rouges ablutions – et d’insectes
aux pattes de cristal et de musiques aveugles – ,
ô chaleur sous le ciel, la lune dans la citerne
et toi absente, lointaine, belle comme jamais !
Tes serfs ont déchiffré les lettres de mon nom,
et j’ai vu s’entr’ouvrir les portes pour mon pas.
Par des mois et des chemins mes traces se perdirent
la caravane a rapporté des bagues de bronze.
Je me souviens de la terrasse en demi-lune,
la soie que tu m’offris et le tambour des nuits.
La caravane a rapporté des bagues de bronze –
Et moi j’ai une galère avec des voiles d’émeraude !
........................... (pp.231/232)
Je veux pleurer parce que ça me plait,
comme pleurent les enfants du dernier banc,
car je ne suis pas un poète, ni un homme, ni une feuille,
mais un pouls blessé qui tourne autour des choses de l’autre côté.
FEDERICO GARCIA LORCA,
Poème double du lac Edem
BLACKOUT
Si tu vois un chien près d’une tombe
fuis l’hélicoptère : il neige déjà
la mort délicate par trituration, assaut
du néant, les yeux crevés à cause
du cobalt, de l’hydrogène.
Petit soldat de plomb, de chocolat, court
chercher un refuge : il se peut
que le chien ne te cède pas sa niche, les chiens sont tellement sots.
Et sinon il y a la tombe :
chasse d’un coup de pied ce mort, couvre-toi
avec ce qui reste, chiffons, terre, ossements.
(N’oublie jamais le Reader’s Digest,
ça fait passer le temps, c’est instructif.)
........................... (p.305)
1950 ANNÉE DU LIBÉRATEUR, etc
Et si les larmes viennent te chercher…
(D’UN TANGO)
Et si les larmes viennent te chercher
prends-les de face, bois jusqu’au bout
l’apéritif de larmes légitimes.
Pleure, argentin, pleure enfin un pleur
véritable, face au temps
que tu escamotais avec souplesse,
pleure les malheurs que tu croyais d’autrui,
la solitude sans rémission au bord d’un fleuve,
la coulpe de la paix sans mérite,
la sieste de ventres bourrés de pains au raisin.
Pleure ton enfance avilie par le cinéma et la radio,
ton adolescence dans les rues du dégoût, la clique,
l’amour sans récompense,
pleure les échelons, le championnat, le steak saignant,
pleure ta nomination ou ton diplôme
qui t’enfermèrent dans la prospérité ou le malheur,
et qui dans la plaine la plus immense
te clouèrent dans un petit terrain duquel tu t’acquittas
par versements trimestriels.
........................... (p.324)
●●●
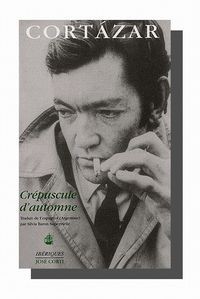
●●●
_______________
Julio Cortázar
Crépuscule d'automne, poÉsie
traduit de l'espagnol (Argentine) & préface de Silvia Baron Supervielle
José Corti, Collection « Ibériques », 2010
SITE EDITEUR :ICI
14:02 Publié dans Julio Cortazar | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
08/07/2014
AUTOPORTRAIT - Marguerite Duras
23:15 Publié dans Marguerite Duras, VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
01/07/2014
Jean-Luc Sarré, Ainsi les jours, Le Bruit du Temps - Une lecture de Tristan Hordé
●●●
UNE LECTURE DE TRISTAN HORDÉ
…
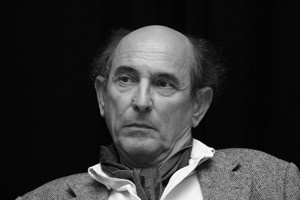
© J. Luc Sarré photographié par Jean-Marc de Samie │ http://www.franceculture.fr/
Ainsi les jours
JEAN-LUC SARRÉ
Le Bruit du Temps, 2014
______________________________________________________________
■■■Ainsi les jours, ce sont quelques poèmes et de « modestes petites proses », notes souvent brèves, dépassant rarement la douzaine de lignes, « ni sentences, ni aphorismes, ni maximes mais simples remarques » (174). On pense très vite à Jules Renard, et Sarré indique qu'il fut en effet le « principal instigateur de [s]es carnets » (99). Donc des remarques, et celles qui le concernent le décrivent avec bien peu de complaisance : « tout en moi est discordant » (22), affirme-t-il et il regrette ici et là de n'avoir rien fait d'autre qu'écrire quelques lignes ; l'âge venant, il n'apprécie guère « le visage d'un étranger » (183) qu'il voit le matin dans le miroir. Mais est-ce misanthropie de ne plus supporter au fil des ans, la bêtise (bruyante) des voisins, plus largement de ses contemporains ? Inapte à toute discipline, non pas sceptique, mais « douteur », il s'ennuie vite, constatant, désabusé, « je ne suis pas d'ici » (80). Comment vivre ? Les notes quasi quotidiennes sur les carnets sont nécessaires, écriture de minuscules moments de vie saisis et restitués : « j'écris parce qu'il me faut bien respirer » (114).
Qu'est-ce qui est retenu, hors les propos, le plus souvent acerbes, le concernant ? Sédentaire, Sarré observe les choses de son balcon du quatrième étage, et d'abord le ciel qu'il apprécie plutôt nuageux — quand le soleil s'installe, on entend « l'odieux chant des cigales ». Il peste contre le bruit des engins de terrassement et le bavardage au téléphone portable qui l'oblige à fermer la fenêtre. Il suit des yeux l'enfant qui, sur son petit vélo, pédale et se dirige vers le bout du monde... Il suit également le mouvement des oiseaux, d'un arbre devant son logement aux graines de tournesol qu'il leur prépare. Il vérifie que le poisson rouge a eu sa ration journalière. Les notations sur la nature, ou plutôt sur la relation que l'on peut entretenir avec elle, sont nombreuses ; se définissant piètre cavalier, il s'attendrit de savoir sa fille être plus à l'aise qu'il l'avait été et il se désole, un cheval s'avançant vers lui, de n'avoir pas toujours un sucre dans sa poche. Il est attentif aux pies qui construisent un nid au sommet d'un arbre et comment ne pas l'approuver quand il note que « le cri de l'effraie légitime l'insomnie » (137) ?
Ce sont toutes les choses du monde qui requièrent son attention et vouloir relever ce qui le retient conduirait (presque) à citer tout le livre. Il recopie un jour une petite annonce concernant la vente d'un cor de chasse, il s'amuse de la laideur des genoux — trop gros — de jeunes femmes en mini-jupe, il écoute une conversation dans un bus à propos des tatouages et des piercings ( "qui habillent"), il relate un fait-divers, il constate la disparition accélérée des petits magasins, il apprécie à Genève des maisons « aux couleurs audacieuses », il s'irrite qu'une place de parking puisse susciter une violente querelle, il suit des yeux le rouge-gorge qui mange les baies de la vigne vierge. La multiplication des motifs est compensée, d'abord, par le fait que certains sont développés ; ainsi, plusieurs pages sont consacrées à Barcelone, toujours sous la forme de remarques. Un motif en entraîne parfois d'autres ; évoquant Breton, par qui il découvrit la poésie, Sarré rappelle les insupportables ukases du poète et, de là, cite Cioran qui fustigeait le « ton prophétique ». À partir du rire « étranglé » (130) d'une petite fille qui semble rejetée d'un groupe, un récit s'esquisse. S'indignant de la morgue des « coquins » de l'ENA, il passe des urnes électorales aux urnes funéraires — les seules dignes — et termine avec une citation de Reverdy sur le spectacle des manifestations politiques (111-112).
Une autre manière d'introduire des variations consiste à rapporter ses visites d'expositions, signalant au passage que l'abandon de son activité de peintre a été « un bon choix dans la vie », à commenter aussi, brièvement, les disques écoutés, de Schubert à Charlie Parker, de Brahms à Kathleen Ferrier — celle-ci point de départ d'une minuscule digression. En relation ou non avec une remarque viennent aussi des citations, de moralistes qu'il affectionne — Chamfort, Joubert —, d'écrivains qu'il fréquente : Flaubert, Kafka, Jules Renard, Thomas Bernhard, Eudora Welty, Limbour, Perros, Faulkner... Enfin, ennemi de la "merdonité", il n'hésite pas à marquer sa distance vis-à-vis des goûts et activités dominants. Il rejette les pratiques empruntées aux États-Unis des ateliers d'écriture et de la lecture publique, relevant une note de Leopardi pour qui il y avait un « vice qui consiste à lire et à réciter aux autres ses propres productions » ; sont alors sur le même plan "l'atelier cuisine" et "l'atelier poésie"... À propos des colonnes de Buren, Sarré constate qu'elle « continuent de saloper la cour d'honneur du Palais Royal, d'en altérer l'harmonie » (84).
Lire Ainsi les jours, c'est comme reprendre une conversation passionnée, interrompue pour une mauvaise raison. J'y retrouve une sobriété dans l'écriture propre aux moralistes, un regard sans illusion sur le monde et sur lui-même, une vraie tendresse aussi pour les choses de la nature. Ce sont là de bonnes raisons de le lire et relire.
Tristan Hordé, juin 2014 © Les Carnets d’Eucharis

SITE À CONSULTER
Sur le site : Le Bruit du Temps | © Cliquer ICI
23:33 Publié dans Jean-Luc Sarré, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
































































