26/02/2011
Henri Cole, Terre médiane (à paraître)
Terre médiane
Henri Cole

© Star Black
Occupé à nettoyer les géraniums, je me vois
comme je suis, presque nu dans la chaleur,
essayant de faire vivre un microcosme
de tons roses noircis, fanés par le soleil et la pluie,
qui ploient et frémissent sous mes sécateurs
tandis que je sépare les fleurs pourries des vivantes,
comme un homme seul emplit un vide de paroles,
non pour consoler ou indiquer où est le bien,
mais pour dire quelque chose de vrai qui a du corps,
parce que c’est la preuve qu’il existe.
21:57 Publié dans Henri Cole, Le Bruit du Temps | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
James Sacré, Mobile de camions couleurs (par Tristan Hordé)
Une lecture de Tristan Hordé
MOBILE DE CAMIONS COULEURS
Photographie de Michel Butor
James Sacré
(Editions Virgile, 2011)
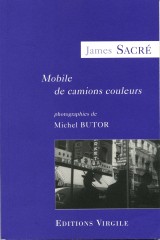 Les camions étaient présents dans un livre récent de James Sacré, America solitudes1, ils occupent toute la place dans ce livre de poèmes, accompagné de 9 photographies. Le titre rappelle sans ambiguïté le Mobile (Gallimard, 1962) de Michel Butor, construit à partir de ses séjours aux Etats-Unis où il enseignait la littérature ; les images remontent à la même époque (une dixième, Michel Butor à sa table de travail, est plus récente). Mais le titre évoque aussi le mouvement sans cesse changeant des camions et, en même temps, leur déplacement les uns par rapport aux autres comme s’ils étaient les énormes pièces d’une sculpture de Calder liées par les invisibles fils des routes. Enfin, comme le livre de Butor, Mobile de camions couleurs, est une construction complexe « où divers éléments de prosodie et de figurations bougent en lents mouvements de l’ensemble ».
Les camions étaient présents dans un livre récent de James Sacré, America solitudes1, ils occupent toute la place dans ce livre de poèmes, accompagné de 9 photographies. Le titre rappelle sans ambiguïté le Mobile (Gallimard, 1962) de Michel Butor, construit à partir de ses séjours aux Etats-Unis où il enseignait la littérature ; les images remontent à la même époque (une dixième, Michel Butor à sa table de travail, est plus récente). Mais le titre évoque aussi le mouvement sans cesse changeant des camions et, en même temps, leur déplacement les uns par rapport aux autres comme s’ils étaient les énormes pièces d’une sculpture de Calder liées par les invisibles fils des routes. Enfin, comme le livre de Butor, Mobile de camions couleurs, est une construction complexe « où divers éléments de prosodie et de figurations bougent en lents mouvements de l’ensemble ».
Les camions sont liés à l’histoire des Etats-Unis et leurs formes, leurs couleurs ont évolué, les machines anciennes abandonnées ou reléguées dans les régions les plus pauvres. Seul l’écrit garde trace (pour combien de temps ?) des temps enfouis de cet aspect de l’industrialisation de l’Amérique, « la voilà maintenant qui s’en va dans le souvenir qu’en garde ce livre [Mobile] de Michel Butor / Avec son histoire, un peu grandiloquente et vaguement ridicule ; / Pays qui oublie, qui oublie longtemps souvent ». Ce motif de l’oubli et, lié, celui des jours qui se ressemblent à se confondre, sont récurrents ; les camions passent sans cesse, comme à la fraîcheur du matin succède la chaleur du jour, comme « demain est un autre jour, le même ». Nous vivons dans un monde de la répétition, du même — avec des machines identiques à Kayenta, en Arizona, et à Cougou, en Vendée.
Ces camions très divers ressemblent à des êtres vivant hybrides, mi-ferrailles mi-animaux, chevaux de fer ou monstres bruyants mais bonasses d’une mythologie contemporaine, l’un « carré sous le coupe-vent bombé et les deux oreilles dégagées », l’autre « le museau jaune (barres rouges des pièces métalliques) comme pris dans un harnais ». Ce caractère subsiste quand ils sont immobiles, « au repos » dans des parkings « derrière un grillage haut », tout comme les bêtes d’un zoo. Ils paraissent parcourir le pays de manière autonome, tant les conducteurs sont invisibles dans leurs cabines. En outre, on ne sait pas vraiment, à les regarder passer ou quand on les croise, vers quel lieu ils se dirigent dans l’ « immense toile de parcours routiers », et peut-être roulent-ils sans fin, dans leur « vigueur aveugle », « pour que tiennent ensemble les villes du pays ».
Comment restituer quelque chose du mouvement incessant, de la profusion de formes et de couleurs ? James Sacré alterne une amorce de description des camions à l’arrêt, qu’il photographie (immobiles alors à jamais), et la saisie de leur extrême variété quand il les voit sur la route. Sur le parking, c’est surtout l’animalité, parfois un peu inquiétante, qui est mise en valeur ; la phrase alors peut s’étendre sur plusieurs vers (« Soit le long museau […], soit / Le groin carré […] / Quand […] / Où […] », ce qui est exclu quand il s’agit d’écrire à propos du passage des camions. Plus de verbes, de clausules, pas d’autres qualifications que celles relatives à la forme ou à la couleur :
Camions gris à double caisse blanche — rouge terne à caisse blanche — noir, caisse bleu clair — noir renfrogné, la caisse blanche — jaune cru à caisse blanche — blanc à caisse blanche — gris-vert à caisse blanche et lettres vert clair — noir à caisse blanche —gris-bleu costaud, caisse blanche — bleu-vert, caisse blanche ligne et lettres rouges — bleu clair, la caisse blanche et des lettres rouges — rouge à caisse blanche, lettres rouges —blanc à caisse blanche — etc.
Une autre alternance est lisible. Parmi les pages consacrées aux camions s’insèrent des poèmes autour de la vie quotidienne du narrateur, ou des chauffeurs : ces derniers non pas comme conducteurs des machines mais « comme autant d’artisans ou de pêcheurs du dimanche », parfois sans plus de lien avec leur travail, comme celui-ci endormi sur une pelouse. C’est aussi le monde du travail qui apparaît, avec la figure de l’Indien qui pourrait être contraint de quitter sa terre pour devenir routier, ou avec un lieu, Gallup, « Où le commerce et la misère, et le simple travail quotidien / Font se rencontrer […] toutes sortes de gens. » Ce qui est également visibles sur la caisse des camions, ce sont les noms des compagnies qui les possèdent ; c’est là une autre variation notée, « une troisième ligne rythmique » à côté de celle des couleurs et du mouvement bruyant. Un autre rythme encore est donné par le silence et la quasi immobilité du paysage.
Une nouvelle pièce du mobile oppose la course des camions aux États-Unis, dont on ne sait trop jusqu’où ils vont — à l’instar des pionniers du XIXe siècle construisant continûment une nouvelle frontière — à celle de camions de taille plus modeste, « gros jouets propres », sur une autoroute en France, qui font « le tour d’un petit pays ». La dernière pièce, à mes yeux, de ces constructions de rythmes est le jeu entre les photographies de Michel Butor et les poèmes : deux d’entre elles (l’entrée d’un parking souterrain, un homme endormi sur une pelouse) peuvent être associés aux camions, les autres sont relatives à la vie citadine quotidienne : la proportion est inversée dans le texte. Il est sans doute d’autres à lire ; il est certain que l’on ne quitte pas volontiers ce "mobile", singulier non par certains motifs récurrents dans l’œuvre mais par sa construction.
Tristan Hordé
(pour les Carnets d’eucharis)
21:54 Publié dans James Sacré, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
19/02/2011
Charles Olson, Les Poèmes de Maximus

je vivais à Washington la
capitale de cette grande pauvre Nation
j’avais du temps avant – les Muses ? où étaient les Muses ? – sont-elles, les
Muses toujours sous le déguisement d’
oiseaux sur la terre,
là un rossignol, ici un rossignol, à Cressy-plage un rossignol
oh des rossignols, ici ?
dans l’air de la nuit je suis seul
pas les perdrix qui flaquent des ailes en s’envolant, elles roucoulent et ne parlent pas, ici ?
en tous cas de toute façon toujours je n’ai jamais cherché qu’au son
des seuls rossignols, dans ces Etats-Unis d’ici (cette portion d’Amérique
- & c’est du fond des puits que vient notre parole
nous parlons avec l’eau
sur nos langues lorsque
la Terre
nous a rendus au Monde, nous Poètes, & que les Airs qui appartiennent aux Oiseaux ont
conduit nos vies à être ces choses-là au lieu de Rois
(Extrait Les Poèmes de Maximus, Volume trois, éditions La Nerthe, p.510)
La migration en fait (qui est sans doute une
constante de l’histoire, chose courante : la migration
est la recherche par les animaux, les plantes & les hommes d’un
environnement – et par les Dieux aussi – qui leur soit convenable
& préférable ; elle mène toujours vers un centre nouveau. Et pour dire
le vrai je parlerais ici du bi-pôle Ases-Vanes, car là
est l’impetus (la fureur qui s’ajoute à
l’Animus : ainsi l’Ame, la Volonté toujours
avec succès s’oppose au temps d’Avant & l’investit, Et là
est la rose est la rose est la rose du Monde
lundi 8 août, dans la nuit
(Ibid., p.565)
00:10 Publié dans Charles Olson, La Nerthe | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
18/02/2011
Eric Bourret, Dans la montagne de Lure (par François Bazzoli)

Au Prieuré de Salagon (juillet-novembre 2010)
Dans la montagne de Lure
D’abord, il y a la montagne de Lure, masse rocheuse à l’intersection des Alpes et de la Provence, située, comme on peut s’en douter, au sud-ouest des Alpes-de-Haute-Provence, et qui culmine à 1 826 mètres. Ce n’est qu’une montagne parmi toutes celles qu’Éric Bourret a parcouru, non pour les figer définitivement mais, au contraire, pour les mettre en mouvement. Le contraire du truisme photographique, en somme. C’est sans doute pour cela qu’il affirme faire de l’art, contemporain si possible, avant que de faire de la photographie. Affirmation paradoxale puisque son travail ne peut exister que par le médium photographique, sa vision borgne, ses imperfections, la chimie de son tirage.
Son travail de décalage de l’image, de superpositions, de recherche pédestre du point de vue comme objet unique, n’est sans doute pas la photographie. Peut-être seulement une photographie qui serait toujours complexe, aux confins de plusieurs zones, de plusieurs idées, et de certaines facultés de comportement ou de création. Pour entrer dans le vif du sujet, quelle donc est cette démarche proche de l'art contemporain et totalement ancrée dans la photo, qu'on pourrait définir comme (à cause de ses côtés ludiques, manipulatoires et surtout analytiques) l'antichambre de la perception ? Cette démarche où se superposent une image première lisible a priori et une image seconde suffisamment surprenante et énigmatique pour obliger le spectateur à analyser la proposition qui lui est faite et à en chercher les sources et les aboutissants.
On pourrait imaginer cette photographie comme un immense memento mori, un lacis inextricable de traces fragiles vouées à l'oubli, un massif de mémoires tremblantes, de lignes bougées, un cénotaphe vide consacré à l'infime durée des choses de ce monde. En auquel cas, toute photographie (et surtout celles d’Éric Bourret) serait une vanité, cette horreur de l'éphémère, le point de basculement entre l'existence et l'effacement, presque la frontière métaphysique de toutes choses. Pouvoir saisir l'apparence de l'objet réel, sa peau seule, son enveloppe matérielle, aurait été l'offre d'un démon nommé Daguerre à l'humanité inconsciente. Il n’était plus besoin de la lenteur du dessin et du recouvrement laborieux de la peinture pour fixer tout ce qui est digne de rester, à l'aune de l'individu et non de l'histoire. Un simple clic et le tour est joué. Car il s'agit bien d'un tour, de magie ou de passe-passe. L'intangible prend corps, l'anodin devient image. Cette vision aurait des liens serrés et quasi généalogiques avec l'art éphémère de l’extrême fin du XXe siècle et du début encor vagissant du suivant, une causalité sans faille avec le presque rien et le je-ne-sais-quoi. Dans cette proposition, l’œuvre d’Éric Bourret aurait une place de choix, ses liens avec la concrétion, l’effacement programmé, mais aussi avec le monument tumulaire, tutélaire, étant très fortement marqués, insistants même. Avec la capacité de transformer l’image lisible en son contraire, de faire du paysage une œuvre de Land Art transformable à sa volonté. Et cela en redoublant le clic initial afin qu’une partie de l’image se désintègre sur la pellicule avant de se concrétiser.
On pourrait également imaginer la photographie telle que la pratique Éric Bourret comme la somme totale de toutes les mémoires de l’œil, car il ne peut exister de mémoires sans oubli. Une plaque sensible sans limites, qui serait le réceptacle de chaque couche de forme et de sens. Une superposition sans fin de toutes les réalités pour parvenir à une seule image. Peut-être serait-elle blanche, peut-être serait-elle noire, c'est selon. Elle entretiendrait avec les superposeurs de tout acabit, avec les voileurs de pellicules et les bougeurs de caméras, les photographes sans appareil et les bricoleurs de chambres, des relations troubles et attirantes qui sonneraient le glas des formes réelles, des contours identifiables et des masses reconnaissables. Un feuilletage de la réalité imagée qui tiendrait peu de place et pourrait se glisser dans la mince couche de gélatine de la photographie. Or les images d’Éric Bourret sont toutes remplies de ces superpositions infimes, semblables à un brouillage mais nourrissant abondamment le regard de leur complexité. Une complexité de construction qui n’exclut pas une grande simplicité de lecture, où l’émotion affleure comme un souvenir qui peine à réapparaître tout en laissant deviner qu’il est là, latent, prêt à émerger. Mais cette superposition ne doit rien au hasard ou au bougé, elle s’engendre par la mise en place d’une procédure qui peut se répéter d’image en image, qui se réédite de procédure en procédure afin de comprendre (pour le spectateur comme pour l’artiste) ce qu’il peut advenir de différent au sein du même. Il n’est pas besoin de chercher bien loin dans l’histoire de la photographie pour retrouver des images de montagnes. Elles font même partie d’un genre extrêmement prisé au XIXe siècle. Parce qu’elles sont une sorte de climax du paysage romantique. Ce n’est pas la préoccupation d’Éric Bourret, pas plus que celle d’un Richard Long ou d’un Hamish Fulton, par exemple. La montagne est là pour sa morphologie plus que pour sa symbolique, pour la raréfaction (de présences, de formes, de nuances) qu’elle entraîne plus que pour sa photogénie. On remarquera d’ailleurs que dans la série ici présentée, quelques présences humaines identifiables apparaissent en petit nombre, en contradiction légère avec les règles tacites édictées il y a longtemps.

Lure 2010 (142.3) - 110 x 130 cm
On nous dit depuis déjà longtemps que la photographie n'est plus fiable, en tant que technique et en tant que représentation. Loin de l'inébranlable des solutions chimiques du XIXe siècle, les procédés commerciaux de notre temps s'effaceraient, s'effaceront, en dix ans, en trois ans, voire moins en ce qui concerne le Polaroïd ou l’imprimante de salon (bien que nous arrivent des processus faramineux et des durées d’un siècle à tout le moins). La boulimie d'images des amateurs et des professionnels est comme remise en cause avant que la photo ne soit faite. Cette précarité inscrite comme un destin inéluctable donne à la prise de réalité photographique une instabilité tragique. Un destin la marque qui est celui de la révélation. L'instant d'avant, il n'y avait rien, l'instant d'après ne reste que la marque brûlante d'un fait dont on ne jurerait pas de l'existence. C'est aussi ce qui entache de fragilité la photo de reportage et le scoop. Ne jamais savoir si cela représente le bon moment, celui que décrit le texte et que le photogramme tente de cerner tant que faire ce peut, sans jamais indiquer si le point culminant est celui qui se lit. Chez Éric Bourret, ce tragique est à l’œuvre mais dans une autre figuration. Dans son obstination à construire du transitoire, du peu ou du presque, à relier les gestes qui sont ceux du bricoleur (mais au sens où le développe Claude Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, celui de l’invention et de la survie, celui du faire avec l’entourage immédiat pour trouver une solution viable) à ceux du sculpteur, les gestes de l’artisan d’autrefois à ceux de l’artiste d’aujourd’hui. Ce tragique-là gît dans la profondeur de l’image obtenue, nourrie de ses contradictions et de sa polyvalence. Si une représentation est polysémique, c’est bien celle-là, qui ne se laisse pas réduire à son sujet. D’ailleurs qui sait si le sujet est la montagne de Lure ou le redoublement de l’image ?
On a assez dit, jusqu’à en faire un stéréotype, que l’objectif photographique était un piège à image. L’immatérialité de l’image est aussi rattrapée, ici, par l’immatérialité des choses de la cosmologie et de la météorologie, le vent, les nuages, le brouillard, les reflets, le mutable. Par la présence, et l’interaction sur l’image, de plusieurs clichés identiques légèrement décalés, même la roche peut devenir liquide, comme l’eau peut se durcir et se fossiliser. Quelles manœuvres de coercition, quelles tactiques d’approche doivent-elles êtres développées devant tant d’insaisissable ? Les procédures mises en jeu par ces pérégrinations argentiques permettent de voir le contraire de ce qui se montre en même temps que celui-ci. Certains photographes, comme Georges Rousse, se disent essentiellement peintres, et d’autres pourraient prétendre à la fonction de sculpteurs. Dans le travail d’Éric Bourret, chaque œuvre superpose, en même temps que des prises de vue, le photographe, le peintre et le sculpteur, sans que l’un soit plus présent que ses alter ego : si un jour l’un se met à prédominer, il n’y aura plus d’image.
Sans entrer dans le monde infini des paradoxes, le parcours d’Éric Bourret se veut une « démarche ». Mais comprise entre ce qui se fait intentionnellement et toutes les barbes du temps et de l’à-peu-près. Entre ce qui construit l’image et ce qui s’insinue en elle sans que l’appareil y prenne garde. Entre la conscience du photographe et l’inconscient de la photographie. Alors, autant que d’une démarche, qui le situe d’autorité dans le camp des plasticiens, il pourrait bien s’agir aussi de l’élaboration d’une méthode, si l’on en croit le Petit Larousse : « Méthode n. f. (latin Methodus) manière de dire, de faire, d’enseigner une chose, suivant certains principes et avec un certain ordre : procéder avec méthode. // Démarche ordonnée, raisonnée ; technique employée pour obtenir un résultat : procéder avec méthode, une méthode de lecture. // Ouvrage groupant logiquement les éléments d’une science, d’un enseignement. // Philos. Ensemble des règles et des procédés permettant de parvenir à la vérité. Méthode expérimentale, procédure qui consiste à observer les phénomènes, à en tirer des hypothèses et à vérifier les conséquences de ces hypothèses dans une expérimentation scientifique. » Une vérité scientifique malaxée par le hasard, l’instant fatidique et la poésie.
La citation est un peu longue, mais éclaire comment et pourquoi une méthode en art ou en photographie, et aussi comment y parvenir. Les sentiers qu’emprunte notre photographe sont en effet méthodiques, obsessionnels, prudents mais inventifs. Quelque chose du dernier moment possible pour saisir un réel en dilution oblige aux grands moyens : employer autant de rigueur que de souplesse, autant de « méthode » que de « démarche ».
Ayant défini l’œuvre et la méthode comme se démarquant volontairement de celles qui sont admises par le genre et le médium, il est difficile de dresser un arbre généalogique construit, logique et évident. Comme pour ses sources ou ses matériaux, le cadre de ses pères ou de ses pairs est composite et multiple. Non pas qu’il s’agisse d’autant d’objets trouvés que dans les autres domaines édifiant son œuvre, mais il n’est pas possible de ranger Éric Bourret dans un groupe cohérent qui le définirait autant qu’il en ferait partie. Sa position est trop flottante, son comportement trop sensible, son parcours trop individualisé pour le nommer d’une seule étiquette, d’une seule définition. Le fait que l’époque soit au refus, dans les faits plutôt que dans les mots, des mouvements revendiqués, surligne cette position. Sans doute par peur de sombrer dans la masse des conformismes, les avant-gardes (les historiques comme celles des années 1960) et les archipels de groupes qui en étaient issus, avaient tablé sur une lisibilité faite de déclarations, de manifestations et de proclamations écrites. Depuis vingt ans, il n’est plus question de regroupements idéologiques ou formalistes. Chaque œuvre est une aventure qui ne tente pas de surpasser ou de défaire les aventures qui précèdent ou coexistent. On n’inscrira donc pas Éric Bourret dans un arbre, serait-il généalogique. Mais sa proximité avec les artistes nomades de tout profil qui se sont mis en quête de l’immensité du monde ses dernières années n’est sans doute pas pour lui déplaire.
Pour en finir, il y a encore la montagne de Lure. C’est là qu’il voit pour la première fois ses semblables dans son viseur. C’est là que les valeurs de ses images s’inversent. Lourdes, noires et minérales, elles deviennent blanches, légères et gazeuses. Elles succèdent à des formats panoramiques, elles seront donc rectangulaires. Leur poids venait de leurs représentations, c’est dans le cadre que, maintenant, il se niche. Elles n’hésitent plus à se confronter à elles-mêmes, elles peuvent être grandes et petites en même temps. Et leur exposition peut réserver des surprises qu’on ne dévoilera pas. Sacrée montagne de Lure.
François Bazzoli, printemps 2010

PHOTOGRAPHIES & MARCHES
Eric Bourret est né à Paris le 10 mars 1964.
Il vit à Marseille, la Ciotat, dans les Alpes, en Himalaya.
19:26 Publié dans Eric Bourret, PHOTOGRAPHES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
15/02/2011
REVUE GPU n°6 - Février 2011 - (au sommaire)
A l’occasion de la sortie de GPU #6, jeudi 17 février 2011 à 19H00, à l’AtelieRnaTional : La présentation de la revue sera suivie d’une lecture par Brian Mura Affiches et livres à découvrir

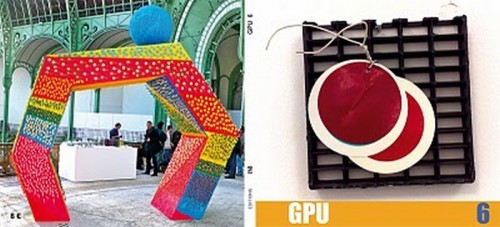
SOMMAIRE N°6
STEPHEN HITCHINS
MARTINE LE CORNEC-DRUCKER
JEAN-YVES BOSSEUR
FRANÇOIS POIVRET
RICHARD SKRYZAK
JEAN-LUC POIVRET
NATHALIE RIERA
PIERRE PETIT
JEAN-LUC STEINMETZ
ARNO CALLEJA
HELMUT STALLAERTS
LOUIS SCUTENAIRE
MATHIAS PÉREZ
AURELIE NEMOURS
DIDIER CAHEN
PAUL-ARMAND GETTE
HUBERT LUCOT
Avec les contributions de Veerle Van Durme, Eric Harasym, la bibliothèque de l'Ecole Supérieure d'Art du Nord-pas-de-Calais, Tourcoing, la collection CNAP, Paris.
Pourquoi une revue ?
Parce que le livre n’est pas un produit comme les autres, parce qu’une revue n’est pas un livre comme les autres(…)Fondée en 2005 la revue GPU a publié, dans un format pas tout à fait carré sur un papier bien net, des oeuvres inédites et originales d’une centaine d’artistes et auteurs tels que : Valérie Favre, John Giorno, Norbert Hillaire, Paul-Armand Gette, Nathalie Riera, Louis Jou, Jacques Villeglé, Charles Bukowski, Jean-Luc Steinmetz, Fabrice Gigy et Pierre Petit.
Avec le concours du Centre National du Livre le n°6 vient de paraître. Le directeur de publication est Brian Mura avec Jean-Luc Poivret comme conseiller à la rédaction.
Parallèlement en 2010 naissait Courtesy, une extension éditoriale de la revue avec à ce jour deux titres disponibles (Mnémosyne et Sans Titre).
La page de l’évènement sur Facebook
AtelieRnaTional - Patricia BOUCHARLAT, Vincent DELAROQUE, Franck LESBROS, Brian MURA, yujeong PYEON, Jean-François RAGARU, Jean-François ROUX, Marta RUEDA, Ran SERI
21:18 Publié dans Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
14/02/2011
Quadratures, Dominique Buisset - (par Tristan Hordé)
Une lecture de Tristan Hordé
QUADRATURES
Postface de Jacques Roubaud
Dominique Buisset
(Editions NOUS, 2010)
 Il faut répéter que la poésie n’est pas une, que « La poésie naît de ce qui, sans elle, demeurerait à jamais sans nom. »1 Elle peut donc encore être en vers comptés et rimés aujourd’hui, sauf à éliminer des œuvres aussi différentes que celles de Jacques Réda et Christian Prigent. Comme eux, Dominique Buisset choisit des formes dites traditionnelles et prouve avec une allégresse communicative qu’elles n’ont pas fini d’être explorées. Rien de contourné dans ces poèmes courts, écrits dans des mètres (7, 8, 9, 10, 11 syllabes) et des formes (septain, huitain, neuvain, dizain, onzain) classiques. Cependant, une fois que le lecteur a reconnu le cadre, il comprend vite que l’auteur en joue en tous sens : développant un art d’écrire — une poétique — et, dans le même temps, revisitant les motifs du lyrisme — le temps, la mort, l’oubli —, Dominique Buisset parcourt tous les schémas de rime, multiplie les combinaisons phoniques et fait partager le plaisir de manipuler des structures numériques.
Il faut répéter que la poésie n’est pas une, que « La poésie naît de ce qui, sans elle, demeurerait à jamais sans nom. »1 Elle peut donc encore être en vers comptés et rimés aujourd’hui, sauf à éliminer des œuvres aussi différentes que celles de Jacques Réda et Christian Prigent. Comme eux, Dominique Buisset choisit des formes dites traditionnelles et prouve avec une allégresse communicative qu’elles n’ont pas fini d’être explorées. Rien de contourné dans ces poèmes courts, écrits dans des mètres (7, 8, 9, 10, 11 syllabes) et des formes (septain, huitain, neuvain, dizain, onzain) classiques. Cependant, une fois que le lecteur a reconnu le cadre, il comprend vite que l’auteur en joue en tous sens : développant un art d’écrire — une poétique — et, dans le même temps, revisitant les motifs du lyrisme — le temps, la mort, l’oubli —, Dominique Buisset parcourt tous les schémas de rime, multiplie les combinaisons phoniques et fait partager le plaisir de manipuler des structures numériques.
Comment débuter un livre ? En disant qu’il commence et qu’il vient après d’autres. Le premier vers du livre, « Il est temps de reprendre le chant », ouvre un huitain mais, comme s’il fallait s’échauffer, le système de rimes est défaillant (a b c d e e e a) — ensuite, quand un poème ne sera pas régulièrement rimé, le lecteur inclinera à en chercher la raison. Quel parti est pris ? « la parole a besoin d’ordre », et cet ordre s’établit, par exemple, par le retour du même — nombre de vers égal au nombre de syllabes, rimes ; par extension, c’est le réel qui perd quelque peu son opacité :
[…] le poème est un rêve du nombre,
dans le désordre qui met la césure,
nomme et compte et divise le réel
pour éviter qu’il soit un chaos sombre
Sans doute ne prête-t-on pas attention à cette mise en ordre de la langue, du réel, « poussée des pages s’amoncelle / dans tous les sens apparemment ». Apparemment : bien des indices ralentissent ou interrompent le lecteur, notamment les rimes. Ici, un dizain à rime unique (an, en), là des rimes riches (consentement / contentement ; l’éclosion des mots / les cloisons d’émaux ; etc.), qui couvrent tout un hémistiche : et nous par le dedans / et nous parle de dents ; néant toussa / nez en tout ça ; rêve d’une ombre / rêve d’une ombre ; etc. L’attention se porte sur tous les jeux avec les sons et les repère ailleurs que dans les rimes : « le vent violent voyeur à l’œil / violet » ; adieu mers vaches merveilles ; apeurés tels des lapereaux ; etc. Comme le montrent des exemples ci-dessus, Dominique Buisset utilise pour les transformations phoniques un procédé cher à Raymond Roussel, jusqu’à agir sur un vers entier : dans un dizain, au vers 1 « Tout doit disparaître ! En mille, en cent ans… » répond le dernier vers, « tout dix doit paraître, cela s’entend. »
Jacques Roubaud relève dans la postface que « Quadratures suppose des tonnes de lecture, des années de travail ». Il est bon d’y insister : aucune poésie n’existe sans travail dans la langue : « Le faux n’est pas rien, l’imaginaire / est une vieille astuce et la ruse /du réel, en quoi rien ne se crée /mais tout se produit. Et la matière / est première » (souligné par moi). On le voit dans la variété des schémas de rimes, dans la reprise de rimes de la Délie de Scève (hommage annoncé par l’auteur) ou d’un thème né à la même époque (la "belle matineuse"), avec son vocabulaire. La mise en ordre, toujours rigoureuse, n’est pas à tout coup exhibée. Dans la première partie du livre (qui en compte six), 21 poèmes sont organisés en deux groupes de 10, le onzième poème, onzain de 11 syllabes, sert de pivot et suggère la règle choisie. En effet, il n’est pas rimé mais deux fins de vers (le rend / rends-le), la construction du vers 9 (nous, et sa piqûre dont s’ourlent de nous) (souligné par moi), la relation entre les premier et dernier vers (Universelle maison de l’équivoque / dans l’équivoque biais de l’universel) orientent vers une structure en palindrome. En effet, aux dix premiers poèmes (8-7-8-7-8-9-8-10-9-10) répondent en miroir les dix après le onzième (10-9-10-8-9-8-7-8-7-8) ; on peut d’ailleurs voir que la construction est plus complexe. Pour le bonheur du lecteur, la règle d’organisation peut être dite ; la quatrième partie est titrée "Six cents syllabes à circonscrire Une ballade pour rire" et propose la suite 3 dizains (300 syllabes) - une ballade - 3 dizains (à nouveau 300 syllabes). Le lecteur découvre d’autres règles de construction non explicitées et peut établir des liens avec, notamment, les poètes désignés (souvent péjorativement) par "Grands Rhétoriqueurs" et ceux de la Renaissance.2
Mais à quoi bon cette vertigineuse mise en ordre ? Dominique Buisset répond à sa manière :
Couronnant le vide souverain
Le poème est le mètre de rien
De son compte il enchante les leurres
Du silence sans fin qu’il emplit
En son lieu il arpente le champ
Des lois propres de sa gravité
Il est de nature sans objet
Car sa course exactement réglée
N’a ni sens ni centre ni sujet.
Ce qui est dit ici, on n’en sera pas surpris, est inscrit dans la forme : l’absence de rimes des vers 3, 4 et 5 attirent l’attention (a a b c d e f e f), comme les rimes souverain / rien, gravité / réglée, objet/ sujet. Forme et fond inséparables. Cependant, on laisserait beaucoup de côté si l’on ne s’attachait qu’à la très savante virtuosité, qu’à la connaissance approfondie de la poésie du passé — ce qui ne serait pas si mal ! Mais ce serait dire aussi que les "quadratures" ne sont que des ornements. Il faut relire Dominique Buisset sur ces points et réfléchir à une affirmation sur ce qu’est le poème : « l’inutile est là / seul qui donne au temps la tenue / sans laquelle il n’a pas de cesse ». Organiser strictement le flux des mots, construire un ensemble de poèmes (et non pas les juxtaposer), c’est refuser la "fuite" du temps, ou plutôt inscrire quelque chose qui peut résister un peu dans le temps, laisser une empreinte — sans l’illusion d’une fausse éternité :
envolés drames, comédies, renoms,
iambe ou trochée, poésie trépassée !
Satire, épopée, travaux de Romains,
œuvres, formes, tout a suivi les mains…
tout repose au fond du temps, in pace.
Il y a aussi dans Quadratures le sentiment fort de la solitude de chacun (De personne rien ne nous délivre / Sinon mourir) et du vide des jours, quoi qu’on fasse, sans autre perspective que la mort (Quelle mort parle en nous plus haut /que le désir). Ces motifs sont des lieux communs du lyrisme, certes. La poésie de Dominique Buisset, cependant, leur donne de la fraicheur grâce au travail minutieux et savant sur la forme : l’élégie existe, mais l’auteur introduit une distance vis-à-vis du discours, ne serait-ce que pour rappeler que le temps, la mort ne sont pas que des mots :
Non il n’y a rien à dire
L’écriture c’est la règle
Elle fait taire le pire
À coup d’arbitraire espiègle.
© Tristan Hordé, Carnets d’eucharis (février 2011)
■ AUTRES SITES A CONSULTER :
Recension d’Angèle Paoli
Extraits de Quadrature
Fiche de l’auteur sur le site CipMarseille
13:49 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Erich Fried
Erich FRIED
Ecrivain et poète de langue allemande
(1921 - 1988)
L A P A U S E P O E S I E

© Photo : internet
Biographie
Né à Vienne en 1921 de parents juifs, Erich Fried quitte l’Autriche après l’Anschluss en 1938 et s’exile à Londres, collaborant notamment au service allemand de la BBC. Profondément marqué par le spectre du nazisme et la condition juive – son père est mort lors d’un interrogatoire par la Gestapo – Fried incarne en Allemagne, à partir des années 1950, la figure de l’écrivain engagé, au service d’une conscience politique toujours tenue en éveil (guerre du Vietmam, Israël).
Aux côtés d’écrivains comme Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll, Peter Weiss, Martin Walser ou Paul Celan, il a fait partie du Groupe 47, initié par Hans Werner Richter en 1947 dans le but de nettoyer la langue allemande des séquelles du nazisme, en prônant une écriture dépouillée.
L’oeuvre d’Erich Fried porte la marque claire de cette démarche et se caractérise par la dimension ludique du travail d’écriture. Il est l’auteur de quelques romans (Les Enfants et les Fous, Le Soldat et la Fille) mais surtout d’un nombre considérable de recueils de poèmes. Ce sont eux qui lui ont assuré une grande popularité en Allemagne, notamment Cent poèmes sans frontière, lauréat du Prix International des Éditeurs en 1977, et plus encore ses Liebesgedichte (Poèmes d’amour) en 1979. Certains poèmes comme Was es ist (Ce que c’est) sont devenus des "classiques" de la littérature allemande des années 1980. Erich Fried est aussi un grand traducteur de l’anglais, en particulier de Shakespeare, Dylan Thomas, T.S Eliot, Sylvia Plath.
Le prix Georg Büchner lui a été décerné pour l’ensemble de son oeuvre en 1987, un an avant sa mort à Baden-Baden.
Bibliographie en français
Le Soldat et la fille, traduit par Robert Rovoni, Gallimard, 1962 (réédition, 1992).
Les Enfants et les fous, traduit par Jean-Claude Schneider, Gallimard, 1968.
Cent poèmes sans frontière, traduit par Dagmar et Georges Daillant, Christian Bourgois, 1978.
La Démesure de toutes choses, traduit par Pierre Furlan, Actes Sud, 1984.
Bibliographie sélective en allemand
1944, Deutschland.
1945, Österreich
1960, Ein Soldat und ein Mädchen
1965, Kinder und Narren
1966, und Vietnam und
1967, Anfechtungen
1968, Zeitfragen
1972, Die Freiheit den Mund aufzumachen
1974, Höre, Israel !
1978, 100 Gedichte ohne Vaterland
1979, Liebesgedichte
1981, Zur Zeit und zur Unzeit
1982, Das Unmaß aller Dinge
1983, Es ist was es ist
1985, Von Bis nach Seit
1987, Gegen das Vergessen
1988, Unverwundenes
D’autres sites :
10:11 Publié dans ALLEMAGNE/AUTRICHE, Chantal Tanet, Erich Fried, TRADUCTEURS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Erich Fried -I- (traduction Chantal Tanet & Michael Hohmann)
Liebe ?
in memoriam Hans Arp
Sackhüpfen
im verschlagenen Wind
ohne Segel
Strohsack- und Plumpsackvögel
im eigenen Hosensack
Hodensackhüpfen
Schwalbenhodensackhüpfen
Schwalbenhodensarglüpfen
Schwalbenhodenhosensargnestelknüpfen
Schwalbennestelknüpfen
Aus dem Nest fallen:
Lustrestlinge
Hineinschlüpfen
Wo hinein?
Sich festkrallen
Gefallene Nestlinge
zu klein
Vögel sein wollen
noch ein zweimal flattern
sterben
Amour ?
in memoriam Hans Arp
Sautiller en sac
dans le vent malin
sans voile
Oiseaux sacs de paille et sacs grossiers
en poche-sac de pantalon
Sautiller en sacs à testicules
Sautiller en sacs à testicules d’hirondelles
Soulever tombeau de testicules d’hirondelles
Nouer rubans de tombeau de pantalon de testicules d’hirondelles
Nouer rubans d’hirondelles
Tomber du nid :
Rescapés du plaisir
Glisser
Où donc ?
Se cramponner
Occupants du nid tombés
trop petits
Vouloir être oiseaux
encore une deux fois battre des ailes
mourir
09:44 Publié dans ALLEMAGNE/AUTRICHE, Chantal Tanet, Erich Fried, TRADUCTEURS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Erich Fried -II- (traduction Chantal Tanet & Michael Hohmann)
Par la pensée
Te penser
et penser à toi
et penser à toi toute entière et
penser au te-boire
et penser au t’aimer
et penser à l’espérer
et espérer et encore
et toujours plus espérer
le te-revoir-toujours
Ne pas te voir
et par la pensée
non seulement te penser
mais aussi déjà te boire
et déjà t’aimer
Et alors seulement ouvrir les yeux
et par la pensée
d’abord te voir
et puis te penser
et puis de nouveau t’aimer
et de nouveau te boire
et puis
te voir de plus en plus belle
et puis te voir penser
et penser
que je te vois
Et voir que je peux te penser
et sentir ta présence
quand bien même
je ne peux te voir avant longtemps
Mais alors
La vie
serait
peut-être plus simple
si je ne t’avais
pas du tout rencontrée
Moins de tristesse
chaque fois
que nous devons nous séparer
moins d’appréhension
de la prochaine séparation
et de la suivante
Et pas non plus
quand tu n’es pas là
tant de ce vain désir
qui ne réclame que l’impossible
et l’immédiat
dans l’instant même
et qui ensuite
parce qu’il ne peut s’accomplir
en est troublé
et respire avec peine
La vie
serait peut-être
plus simple
si je ne t’avais
pas rencontrée
Mais alors
elle ne serait pas ma vie
Quoi ?
Qu’es-tu pour moi ?
Que sont pour moi tes doigts
et tes lèvres ?
Qu’est pour moi le son de ta voix ?
Qu’est pour moi ton odeur
avant l’étreinte
et ton parfum
pendant l’étreinte
et après ?
Qu’es-tu pour moi ?
Que suis-je pour toi ?
Que suis-je ?
Nuit à Londres
Garder les mains
devant le visage
et laisser clos
les yeux
ne voir qu’un paysage
montagnes et torrent
et dans la prairie deux animaux
bruns sur le versant vert clair
qui monte jusqu’à la forêt plus sombre
Et commencer à sentir
l’herbe fauchée
et tout en haut au-dessus des pins
en cercles lents un oiseau
petit et noir
sur le bleu du ciel
Et tout
absolument paisible
et si beau
que l’on sait
que cette vie vaut la peine
parce que l’on peut croire
que tout ça existe
Poèmes extraits du recueil Es ist was es ist (1983)
Traduits de l’allemand par Chantal Tanet et Michael Hohmann
Télécharger version allemande  E. Fried, version allemande.pdf
E. Fried, version allemande.pdf
09:32 Publié dans ALLEMAGNE/AUTRICHE, Chantal Tanet, Erich Fried, TRADUCTEURS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
13/02/2011
Angye Gaona, poète colombienne emprisonnée
Signez, faites circuler rapidement et si vous avez un site, relayez cet appel en urgence.

"Toma este pan, "Prends ce pain
toma esta vida, prends cette vie
toma la Tierra prends la Terre
que es tuya." qui est à toi"
Angye Gaona
La poète et journaliste Angye Gaona a été arrêtée. L'État colombien veut la faire taire pour maintenir l'obscurité sur un génocide. Angye Gaona, poètete et témoin, arrêtée pour penser, en Colombie, le pays dans lequel l'état a converti le fait de penser en un crime. Angye Gaona est une femme créatrice et compromise socialement, toujours active et très engagée dans le développement de la culture; elle fait partie du comité organisant le Festival International de Poésie de Medellín, dont la qualité témoigne d'un travail et des rêves tissés entre les peuples.
Urgente est la mobilisation internationale pour sa libération et pour dénoncer que l'état colombien maintient emprisonnées plus de 7.500 personnes pour "délit d'opinion" : nous sommes devant une vraie dictature camouflée.
C'est une situation insupportable : chaque jour ils arrêtent, assassinent ou font disparaitre un adversaire politique, étudiant, syndicaliste, un sociologue, un paysan... La répression exercée par l'État colombien contre le peuple pour apaiser ses revendications sociales est d'une brutalité sans précédent.
Il est urgent que le monde bouge par solidarité!
Libérons Angye Gaona!
Signatures à adresser à:
Aurora Tumanischwili
10:23 | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
11/02/2011
26ème bulletin des carnets d'eucharis - Janvier & Février 2011

Jean-Marc PLANCHON Peintre
DU CÔTÉ DE…
Mohammed Khaïr-Eddine
FRANCO FORTINI Une fois pour toutes
RICHARD SKRYZAK Résonances d’un souvenir florentin
AUPASDULAVOIR
MARIELLE ANSELMO Jardins & autres textes inédits
ANDRE CHENET Au cœur du cri
Dylan Thomas
ESPRITSNOMADES
Alejandra Pizarnik Toute la nuit écrite sur le mur écaillé de la vie sur le site de GIL PRESSNITZER
NOTES DE LECTURE
James Sacré America Solitudes par Sylvie Durbec
Stanislas Brzozowski Histoire d’une intelligence par Nathalie Riera
■ LES CARNETS D’EUCHARIS N°26
CALAMEO http://www.calameo.com/read/0000370712b6d82f93f00
TELECHARGEMENT PDF Carnets d'eucharis n°26_Janvier Février 2011.pdf
http://lescarnetsdeucharis.hautetfort.com/media/01/01/3037147880.pdf
15:45 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Menaces sur La Pensée de midi, revue méditerranéenne
Partenaire de Rue89, La Pensée de midi, une revue basée à Marseille et consacrée aux idées et aux débats dans l'espace méditerranéen, vient de perdre le soutien financier de la région PACA, qui était indispensable à son équilibre économique. Nous nous associons aux appels à la région, présidée par le socialiste Michel Vauzelle, pour qu'elle revienne sur sa décision au moment où l'espace méditerranéen vit les mouvements historiques que l'on sait, nécessitant plus d'écoute et d'attention encore au mouvement des idées, plus d'échange. Voici le communiqué de La Pensée du Midi. P.H.
A l'heure où Marseille Provence 2013, qui a choisi Albert Camus comme figure de référence, s'apprête à devenir capitale européenne de la culture, on apprend que la Région PACA a décidé de retirer son soutien à la revue La pensée de midi, qui doit son nom et son inspiration à Albert Camus.
Ce désengagement voue La pensée de midi à une disparition imminente. Lieu de pensée collective, cette revue littéraire et de débats d'idées, publiée depuis 10 ans chez Actes Sud, a été à l'origine de nombreuses découvertes dont celle de l'immense écrivain Alaa al-Aswani (l'auteur de L'immeuble Yacoubian) dans un numéro entièrement consacré à la littérature égyptienne (2004).
Au fil de ses dix ans et de 31 numéros, La pensée de midi a abordé la plupart des phénomènes culturels, artistiques, politiques et de société qui traversent le monde méditerranéen, annonçant et analysant, en filigrane, les événements qui agitent notre actualité.
A l'heure où la Méditerranée est en pleine effervescence politique et culturelle, il est pour le moins surprenant, choquant et incohérent de faire disparaître une revue telle que La pensée de midi.
La Région PACA, qui se dit volontiers attachée aux valeurs de la pensée et de la Méditerranée, peut-elle être sciemment responsable de la dissolution de ce laboratoire d'idées, d'écriture et de création ? Une telle décision, si elle se confirmait, paraîtrait incompréhensible, à la fois arbitraire et indigne.
Indignons-nous !
Le comité de rédaction
En partenariat avec :

A lire aussi sur Rue89 et sur Eco89
► Quand Averroes rapproche l'Occident et l'islam, par Thierry Fabre, La pensée de midi
Ailleurs sur le Web
14:25 Publié dans La Pensée de Midi | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
03/02/2011
Villa-Lobos
VILLA-LOBOS Bachianas Brasileiras n°5
Aria Cantilena
Soprano : Amal Brahim Djelloul
22:52 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
































































