28/12/2011
Les carnets d'eucharis (N° spécial fin 2011)
■■■
Les carnets d’eucharis n°HORS-SERIE
Fin d’année 2011

ROI JAMES
SZILARD HUSZANK
MARIE HERCBERG
Christophe Charbonnel ■■■Jacqueline Devreux
DU CÔTÉ DE…
Alain Le Saux Crucifiction
Valérie Canat de Chizy Pieuvre
Olivier Hobé Le journal d’un haricot
Umar Timol Point Barre (revue)
Nicolas Grenier (Choix de poèmes)
■■■OSSIP MANDELSTAM
Nouveaux poèmes 1930-1934 ■■■
Zbigniew Herbert
DES LECTURES
Alda Merini, « Delirio amoroso» Oxybia Editions
■■■
Au format PDF

21:36 Publié dans LES CARNETS D'EUCHARIS (pdf & calaméo), Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
18/12/2011
Andreï Tarkovski - Zerkalo/Le Miroir - 1975
14:10 Publié dans Andreï Tarkovski, RUSSIE, VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
09/12/2011
Alda Merini - Delirio amoroso/Délire amoureux (par Nathalie Riera)

Lecture Nathalie Riera
Alda Merini,
Délire amoureux/Delirio amoroso
Collection « Debout poète, debout »
Oxybia Editions, 2011
Traduction Patricia Dao/ Préface deFlaviano Pisanelli
Quatrième de couvertureAndré Chenet
Alda Merini, « de sa fièvre amoureuse »
____________________________________________________________________________
■■■ Pour avoir été très lié à la poète Alda Merini, Angelo Guarnieri, psychiatre de la réforme Basaglia contre l’asile totalitaire soumis à une législation italienne des plus arriérées d’Europe [1], assurait la préface du recueil « Après tout même toi/Dopo tutto anche tu » [2] , dans une écriture portée par « une amitié authentique et profonde, résistante à l’usure et à l’ennui de notre temps ».[3] Il y a ceux comme Guarnieri qui auront eu la chance de rencontrer Alda Merini et de l’entendre lire ses poèmes, et il y a ceux qui s’en tiendront à cette chance de pouvoir la lire en France, deux ans après sa disparition. Si rien dans la poésie de Merini ne laisse entendre un quelconque dégoût pour la folie (« Je crois que la folie est un profond lien d’amour »), il ne peut s’agir non plus d’une idéologie de la folie, et comme l’écrit l’ami psychiatre à son propos : « Alda Merini est devenue un ruminant, qui régurgite la douleur et la reboit ».[4] Quel est donc chez elle ce rapport poésie/folie ? :
parce que le jour du poète,
si semblable à la folie,
ne trouvera pas
sa mesure
dans l’éthique moderne.
[p. 21]
Chez Merini, il y a surtout « l’enfer/des sens/qu’est la vie », « les enfers de la grande pensée », mais sans que ceux-ci ne viennent supplanter son profond humour et la gravité de sa fantaisie. Et que dire du sens de la poésie chez un être frappé par ces enfers irrémissibles ? Dans sa « Lettre à Angelo G. » [5] : « La poésie n’est-elle pas une sorte de méchanceté adressée à soi-même ou une sorte de bénédiction ? ».[6]
« La folie est un artisanat ».
[p. 71]
Et à la question sur la « loi Basaglia », Alda Merini répond [7] : « Voyez-vous, l’hôpital psychiatrique n’a pas pour moi la même fonction que pour les autres, pour moi ce fut… je ne sais pas, je n’en ferais pas un cas national… je l’ai bien vécu ; mais j’aurais bien vécu n’importe quoi, la guerre… la poésie aussi… est un traumatisme, vous le savez vous aussi. C’est une espèce d’asile psychiatrique personnel… ».
Deux ans après Dopo tutto anche tu, Les éditions Oxybia poursuivent un hommage à la poète milanaise avec l’édition bilingue de Délire amoureux/Delirio amoroso, lumineusement traduit par Patricia Dao, passionnément préfacé par Flaviano Pisanelli, ce bel ensemble rejoint par une quatrième de couverture du poète et passeur André Chenet.
Comme le précise F. Pisanelli, à chaque recueil de Merini, la notion même de « folie » « ne se limite à aucune définition conventionnelle ni médicale ».[8] C’est dans l’Italie du Sud (Milan, Taranto) que Merini fera l’expérience de l’incarcération psychiatrique :
« Elle ne cesse de vouloir comprendre les raisons de l’univers déshumanisé et déshumanisant de l’asile psychiatrique. Cette attitude de révolte et de résistance amène l’écrivain à défendre son rôle d’individu et de femme : elle continue à vivre sa condition d’épouse et de mère, en essayant de ne jamais perdre le contact avec la réalité qui semble toutefois s’arrêter au-delà des barreaux des fenêtres de sa chambre et de son lit de contention, des électrochocs et de la stérilisation qu’elle subit et qui privent l’individu de son identité et de sa dignité ».
[p. 14]
« Dans Délire amoureux… la folie s’exprime tout d’abord comme une force ‘dissidente’ ».
[p. 16]
Mais comment est-il possible d’écrire dans l’enfer de l’internement ? Patricia Dao me confiera qu’il fut impossible pour Alda Merini d’écrire « dans ce lieu tourmenté et infâme qu’est l’asile psychiatrique ».[9] Ce ne sont pas les fous qui font l’asile psychiatrique. Dans « La neo-mediocrità », Patrick Faugeras relate :
C’est en 1988, dix ans plus tôt donc, qu’avait éclaté le scandale concernant la ville d’Agrigente, lorsqu’un parlementaire, Franco Corleone, avait poussé, de façon impromptue, les portes de l’asile, et avait découvert avec stupeur une situation catastrophique : « … des malades errants, nus, glissant sur un sol inondé d’urine, demandant l’aumône aux visiteurs, mangeant avec les mains… dormant nus dans des draps tachés de jaune, de marron, de pus, rongés par les rats… des malades enfermés dans des cellules, d’autres ne pouvant franchir l’enceinte de l’hôpital… » Ces faits, rapportés par le journal L’Espresso, soulevèrent en Italie une indignation générale. L’opinion publique, les politiques se mobilisèrent. Le 3 octobre 1991, un malade est retrouvé mort au pied du mur d’enceinte de l’hôpital, le visage dévoré par les rats et par les chiens. L’enquête s’élargissant, seize médecins et administrateurs sont accusés d’« abandon aggravé de personnes en difficulté », d’« homicide par imprudence », d’« incurie par imprudence ». Il faut préciser qu’entre 1977 et 1988, cent quatre-vingt-dix personnes ont trouvé la mort, la moitié de ces décès étant dus à une épidémie de tuberculose non enrayée, non soignée. [10]
« Je fus déchargée à l’entrée de l’hôpital psychiatrique Paolo Pini, mais je ne comprenais pas encore. Les âmes bénies ne croient pas qu’il puisse y avoir de la violence dans le monde ».
[p. 31]
La psychiatrie de Taranto ne cesse d’être une insulte : « Incroyables sont les malversations, les intrigues, les compromis auxquels recourt le personnel des Centres Psychiatriques pour piéger le malade qui parle, discute, dénonce. Le malade est coupable : tout ça pour eux est savoir psychiatrique. Tout ça pour moi est crime».[11]
Alors reconnue par les critiques et les plus grands poètes du XXème siècle (Montale, Pasolini…), le premier internement d’Alda Merini aura lieu dans la jeunesse de ses 16 ans, suivi d’un autre internement, de plusieurs années (de 1955 à 1972), et c’est en 1979 qu’elle recommencera à écrire.
« Je suis devenue poète peut-être parce que la poésie m’importait guère. Même si j’ai dévoré les livres, même si en moi était le chant (mais c’était le chant de la vie, et ça ils ne l’ont pas compris)
[…]
J’ai vécu ma première société poétique Via del Torchio. Par société, je veux dire que j’étais sur le divan coude-à-coude avec les grands de la poésie, avec la classe du renouveau littéraire. J’étais trop petite pour comprendre ce que faisaient ces grands hommes.
Erba, toujours joyeux et éparpillé. Pasolini, taciturne et plein de résistance physique. Turoldo, à la voix tonnante et belle qui semblait la réincarnation de la « scapigliatura » affranchie.
Nous étions pauvres, mais pleins de patience et avec une grande capacité d’absorption. Plus qu’un écrivain, j’étais leur mascotte : jeune, taciturne, peut-être belle, avec deux flancs dont j’avais honte et que j’essayais de cacher.
Manganelli était un brave homme. Il lançait des miettes dans mon décolleté en riant, mais il avait aussi un sourire tendre. Erba semblait toujours à la recherche d’un cerf-volant qui lui échappait des mains ».[12]
Dans cette vie constellée de malédictions, Alda Merini parle souvent de la peur, la peur est au centre de sa vie, de sa chair, comme elle évoque souvent ces deux années d’isolement total, chaque jour marqué par « un douloureux calvaire de solitude », sans « aucune solution de mémoire ni de chant ».[13] Et même si « la psychiatrie et la littérature n’ont rien en commun » : « Avec ‘Delirio amoroso’ Alda Merini décrit précisément cette ‘folie d’amour’ qui lui valut de sortir des ornières de la pensée admise. Un chant halluciné remontant des grandes profondeurs de l’être sous-tend ce récit d’une tragédie qui se dénoue, comme une prière muette, dans la divinité de l’amour universel ».[14] ■■■
Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Nathalie Riera

Régis Daubin - 12, rue des Roumègons – 06520 MAGAGNOSC
Tél. : 09 53 61 72 31 ou 06 76 96 96 67
Extraits
____________________________________________________________________________
J’ai été trahie : je ne sais pas par qui. Un jour, un nuage gris tomba sur mon existence. Un nuage sans couleur. Difficile que les hommes puissent remuer le ciel, mais parfois ils se servent des devins pour cela. Par le biais de chaudrons, de serpents et de sorcières je fus envoyée loin de ma vieille patrie, où je ne connus plus rien. Je fus enterrée en psychiatrie. Pour l’honneur, par le pouvoir. Le « diario » fut mon passeport pour une folie dense d’amour et de pauvreté. Je suis pauvre, seule l’obole de mes amis me permet de vivre. Il y a en cela un certain romantisme, mais je reste fondamentalement pauvre, alors que je voudrais avoir mon domaine secret. Si on me trahit, je me cache dans l’enchevêtrement des mots et les mots sont des haies vertes et hautes où se tapissent de nobles faons.
L’homme est un cannibale qui veut à tout prix manger ses semblables, après quoi il exhibe avec clameur ses appareils électroniques, ses machines à laver dernier cri, les ordinateurs et tout ce qu’il appelle progrès (et que j’appelle carnage).
[p. 42/43]
Ça fait maintenant deux ans que je suis malade, exactement deux ans, et c’est moi qui l’ait voulu. Encore une fois j’ai fermé le lourd temple de ma vie. J’ai reculé en me plongeant dans un indéchiffrable inconscient. L’inconscient est riche comme le fond des mers, plein de coraux et d’éponges, de sirènes et de personnages de rêves. Plein de fleurs carnivores. J’habite ici depuis deux ans comme quand j’étais à l’asile psychiatrique. L’asile psychiatrique est une grande caisse de résonance où le délire devient écho. J’ai vécu en asile psychiatrique parfois volontairement. D’autres fois sans le savoir.
[p. 83]
[1] Lire l’article de Patrick Faugeras « La neo-mediocrità » - Sud/Nord 1/2004 (no 19), p. 31-39.
[8] Le feu de la folie : Délire amoureux d’Alda Merini (Préface de Flaviano Pisanelli), Délire amoureux/Delirio amoroso, Oxybia Editions, 2011, p. 13
22:04 Publié dans Alda Merini, ITALIE, Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Zbigniew Herbert, Corde de lumière
Zbigniew Herbert Corde de lumière
(Œuvres poétiques complètes I)
Editions Le Bruit du Temps, 2011
LECTURE : (Nathalie Riera)
« … un poème qui sonne comme un disque de vieux tango ne m’attire pas », [1] mais ce n’est pas pour autant que le grand poète polonais Zbigniew Herbert(1924-1998) soumettra sa passion de penser à « ce malheureux intellectualisme de la poésie contemporaine », refusant pour cela l’épithète de « poète intellectuel ». Pour Herbert, entre le poète et son lecteur, la complicité est plus que jamais primordiale : « Je fais confiance à mon lecteur pour être mon complice, travailler avec moi. Ceux qui dispensent une distraction facile méprisent leur public. Moi, je le traite comme un partenaire, en respectant sa différence, sa capacité de juger et de critiquer ».[2]
« Une flamme qui pense », en titre d’un article de Claude Mouchard dans La Quinzaine Littéraire,[3] le poème chez Herbert n’est pas un moyen d’expression mais le moment d’une expérience intérieure, le lieu d’une autre connaissance. Pour faire un parallèle avec le réalisateur russe Andreï Tarkovski : « … mes films ne sont pas une expression personnelle mais une prière. Quand je fais un film, c’est comme un jour de fête. Comme si je posais devant une icône une bougie allumée ou un bouquet de fleurs. Le spectateur finit toujours par comprendre lorsqu’on lui parle avec sincérité (…) Le manque d’honnêteté détruirait le dialogue ». [4]
Que peut offrir la poésie dans un monde trahi ? La poésie, antithèse du concept et de la puissance négatrice, chaque poème est une ligne du cœur sans mélodie artificielle, la volonté d’une union du rêve et de la mémoire. « (…) les poètes n’ont pas de pouvoir sur le monde. La langue est leur unique royaume. Ce n’est que dans ce domaine qu’ils peuvent gouverner et légiférer ».[5]
Corde de lumière est le premier volume des Œuvres poétiques complètes, publié aux éditions Le Bruit du Temps, et traduit du polonais par Brigitte Gautier.
(Les carnets d’eucharis, Nathalie Riera, décembre 2011)
EXTRAITS
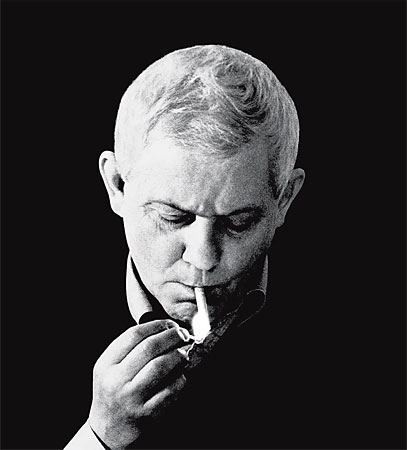
La forêt d’Ardenne
Joins les mains pour puiser du rêve
comme on puise eau ou graine
et apparaît une forêt : nuée verte
et un tronc de bouleau comme une corde de lumière
et mille paupières vont battre
une langue feuillue oubliée
tu te remémoreras alors le matin blanc
où tu attendais que les portes s’ouvrent
tu sais l’oiseau entrouvre cette contrée
il dort dans l’arbre et l’arbre dans la terre
source ici de nouvelles questions
sous les pas les courants des mauvaises racines
vois le dessin de l’écorce où
s’imprime une corde de musique
le luthiste tournant les chevilles
afin que résonne ce qui se tait
écarte les feuilles : des fraises des bois
la rosée d’une feuille l’arête d’une herbe
plus loin l’aile d’une libellule jaune
une fourmi enterre sa sœur
plus haut au-dessus de la belladone traîtresse
mûrit doucement un poirier sauvage
sans attendre de meilleure récompense
assieds-toi sous l’arbre
joins les mains pour puiser de la mémoire
des morts les prénoms la graine flétrie
une autre forêt : nuée calcinée
le font marqué d’une lumière noire
et mille paupières serrées
fort sur des globes immobiles
l’arbre et l’air brisés
la foi trahie des abris vides
et cette forêt-là est pour nous pour vous
les morts réclament aussi des fables
une poignée d’herbes l’eau des souvenirs
alors sur les aiguilles de pin sur les murmures
et des odeurs les fils fragiles
peu importe que la branche t’arrête
que l’ombre te mène par des chemins sinueux
car tu retrouveras et tu entrouvriras
notre forêt d’Ardenne
(p.85/87)
Le sel de la terre
Une femme passe
son foulard tacheté comme un champ
elle serre contre sa poitrine
un petit sac en papier
cela se passe
en plein midi
au plus bel endroit de la ville
c’est ici qu’on montre aux excursions
le parc et son cygne
les villas dans les jardins
la perspective et la rose
Une femme avance
avec la bosse d’un baluchon
- que serrez-vous donc ainsi grand-mère
elle vient de trébucher
et du sac
sont tombés des cristaux de sucre
la femme se penche
et son expression
n’est rendue
par aucun peintre de cruches brisées
elle ramasse de sa main sombre
sa richesse dissipée
et remet dans le sac
les gouttes claires et la poussière
Elle
reste
si
longtemps
à genoux
comme si elle voulait ramasser
la douceur de la terre
jusqu’au dernier grain
(p.144/145)
01:52 Publié dans Nathalie Riera, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Zbigniew Herbert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Jude Stéfan, Ménippées (P(r)o(so)ésies)
Lecture Tristan Hordé
Jude Stéfan, Ménippées (P(r)o(so)ésies)
Editions Argol, 2011
■■■Le titre et le sous-titre apparaissent, comme la plupart du temps chez Jude Stéfan comme un programme. Ménippées ne s’inscrit pas dans la tradition de la Staire Ménippée, texte essentiellement satirique, mais, ce que suggère le pluriel, évoque sans doute possible les Ménippées de Varron, c’est-à-dire des écrits qui mêlent vers et proses et abordent tous les sujets sans établir de hiérarchie entre eux, passant de remarques sur la vie quotidienne à des considérations sur la philosophie ou la littérature. C’est bien de cela qu’il s’agit dans les cinq ensembles, datés de 2006 à 2010 du livre de Stéfan ; s’y succèdent les fragments d’un journal, des "litanies du Muséomane" (parallèles aux Litanies d’un scribe), des ajouts à Pandectes (Pandectes (ou le neveu de Bayle), 2008), la traduction d’un poème de Rubén Darío, des poèmes, des remarques sur la littérature, d’autres sur une lecture, des propos entendus au café, des citations (parfois non traduites), des idées de titres, des notations de rêves, des jeux phoniques à partir du grec et du latin ; etc. Le sous-titre, P(r)o(so)ésies, qui, littéralement, ne peut être lu, dit autrement le refus de distinguer entre des genres, de séparer prose et vers. C’est là une constante dans l’œuvre de Stéfan, affirmée dès le premier livre (Cyprès (poèmes de prose), 1968) et régulièrement répétée dans les textes critiques, dans des titres, par exemple La Muse Province (ou 76 proses en poèmes), et dans les poèmes : le sous-titre apparaît dans Épodes (1999), ouvrant le premier ensemble, "Des vers" :
78 : Arthur affiché sur les portes d'acier
aux Transformateurs
la poésie en la prose
la poésie en le PO M
ou la prose en prosoésies les
proêmes en prosies proésies
le poèmenprose en la prosenpoème
[etc. ; p. 11]
La radicalité de ce choix déconcerte certains lecteurs pour qui les genres existent toujours, partage ancré par les habitudes de lecture scolaire figées. Si la plupart des lecteurs admet qu’un coucher de soleil ou une déclaration d’amour ne sont pas "poétiques" par nature ( ?), il faut encore redire que la poésie ne se définit pas plus par la présence du vers — le passage à la ligne — que par le sens dénoté : « En lisant Zanzotto (Phosphènes) ; enfin des textes dépourvus de sens, du sens appris de lecture scolaire ou conformiste, enfin pouvoir lire les mots tels quels en leur indépendance syntaxique. » (p. 80) Le sens n’est pas absent, certes, ou l’émotion, la présence du sujet, mais rien du « ça veut dire », ni dans Zanzotto ni dans des œuvres en cours fort différentes comme celles de Philippe Beck, Caroline Sagot-Duvauroux ou Jean-Louis Giovannoni.
Dans Ménippées, les lignes de force de l’œuvre sont bien présentes si l’on met en valeur celles qui organisent presque tous les livres : l’amour, le temps, la mort. Non pour classer des éléments du texte mais, ici et là, sous diverses formes. Ainsi le motif du temps clôt le premier ensemble daté (I, 2006) avec l’évocation d’une maison dont les éléments progressivement se défont, allant vers la ruine
Anti-poème
à l’arrière-cour
fenêtre murée
verrous, gouttières, auvents
barreaux, grille rouillée
rideaux pendants
en muet abandon
tenons et chenil
dans une aire sans accent
que des cadenas
Ainsi le motif de la mort se lit dans un rappel des noms perdus ou dans la proposition d’un récit où reviendrait à intervalles réguliers la phrase : « X… est mort ». Quant au motif de l’amour, c’est un solide fil conducteur, au début du livre avec le souvenir d’un film d’amour « bouleversant », ensuite avec le récit d’anecdotes — un adieu dans une gare —, la notation d’un « cri de Fille », de conseils pour séduire une femme, d’affirmations lapidaires (« Amour. Le moins aimé souffre le plus ») ou, pour conclure un rêve, avec une équivalence, « L’amour : inquiétude/apaisement ».
Le lecteur retrouve les formules qui se veulent sans réplique (« Il n’est de plaisir pur que dans l’égoïsme »), les remarques sur la difficulté à vivre la solitude et, nombreuses, les assertions provocatrices : à l’ouverture de Ménippées, la lumière et la naissance (la venue au jour) sont associées à la défécation (la disparition) : « Confession d’Optimiste. Il s’avèrera moins lugubre d’allumer, dans les lieux d’aisances, afin d’honorer ce rite quotidien, en remerciant d’être né. ». À la page suivante, c’est l’art d’être grand-père qui est parodié : « Lorsque l’enfant paraît traînant son pot [etc.] » ; ajoutons un éloge du port de la burka et de la masturbation en public (puisqu’elle est « naturelle »…), et le rejet de Mozart, Beethoven et quelques autres, seulement capables de « flatter l’oreille », « art mélodique […] qui longtemps retarda la Musique ».
Ce regard peu amène sur ses contemporains et leurs choix n’est pas nouveau mais, parallèlement, Stéfan considère avec peu de complaisance son personnage. Le commentaire de l’exposition qui lui était consacrée en 2010 — « Une vie d’ombre, une œuvre de non-vie » — est symboliquement noté le 1/7, jour de la naissance de qui signe de ce nom ; le thème de la "non-vie", comme celui du "vide", est récurrent dans l'œuvre. Symboliquement encore, Ménippées s'achève sur une sortie avec une note du 31/12 : « Excipit. Le dégoût d’avoir écrit l’emporte sur le plaisir d’écrire », qui répond au dernier vers de Que ne suis-je Catulle (2010), « Ne Plus Écrire ». ■■■
Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Tristan Hordé
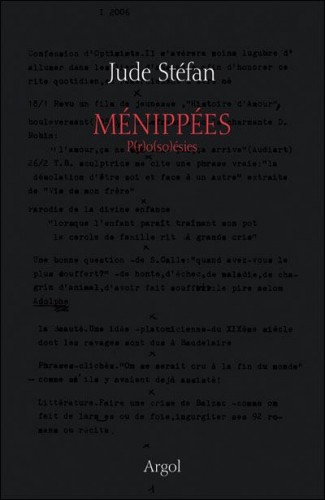
01:36 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Claude Royet-Journoud et Alain Cressan (une lecture de Tristan Hordé)
Lecture Tristan Hordé
TABOURET
Claude Royet-Journoud et Alain Cressan
Editions Lnk, 2011
■■■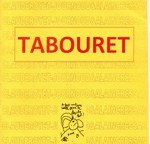 Il faudrait un jour écrire l'histoire de ces éditeurs qui, depuis des années, travaillent en marge, diffusant leurs livres vaille que vaille, grâce au bouche à oreille, sans souci premier d'être "rentables". Pascal Quignard a évoqué, dans une lettre à Bénédicte Gorillot qui ouvre Inter (Argol, 2010) comment Emmanuel Hocquard, l'hiver 1978, tirait « à la main sur la presse d'Orange Export Ltd » ses livres, « dans l'atelier de Raquel, à Malakoff, sur un plancher de bois exhaussé, le chien hurlant de ne pouvoir monter les échelons ». Quelques passionnés, sans beaucoup plus de moyens, poursuivent cette tâche patiente, obscure, donnant à lire quelques titres chaque année — je cite, au hasard des livres sur la table, L'arrière-pays (Josette Ségura et Éric Dazzan), Poliphile (François Lallier et Géraldine Toutain), Ficelles (Vincent Rougier), Contrat Main (Pascal Poyet et Françoise Goria).
Il faudrait un jour écrire l'histoire de ces éditeurs qui, depuis des années, travaillent en marge, diffusant leurs livres vaille que vaille, grâce au bouche à oreille, sans souci premier d'être "rentables". Pascal Quignard a évoqué, dans une lettre à Bénédicte Gorillot qui ouvre Inter (Argol, 2010) comment Emmanuel Hocquard, l'hiver 1978, tirait « à la main sur la presse d'Orange Export Ltd » ses livres, « dans l'atelier de Raquel, à Malakoff, sur un plancher de bois exhaussé, le chien hurlant de ne pouvoir monter les échelons ». Quelques passionnés, sans beaucoup plus de moyens, poursuivent cette tâche patiente, obscure, donnant à lire quelques titres chaque année — je cite, au hasard des livres sur la table, L'arrière-pays (Josette Ségura et Éric Dazzan), Poliphile (François Lallier et Géraldine Toutain), Ficelles (Vincent Rougier), Contrat Main (Pascal Poyet et Françoise Goria).
Je n'oublie pas les livres fabriqués "à la maison" avec un ordinateur, un scanner et une imprimante, mais qui n'entrent pas dans le circuit commercial ; les textes sont publiés autour d'une centaine d'exemplaires et distribués à des amis. Ce type d'édition, confidentiel, propose poèmes et dessins que leur éditeur, ici Alain Cressan, a sollicités auprès d'écrivains et d'artistes qu'il apprécie, sans souci de la notoriété des uns et des autres — pas seulement français : la part des travaux venus des États-Unis est importante (Peter Gizzi, Rosmarie Waldrop, Jill Magi, etc.). L'un des deniers titres, Tabouret, donne à voir des "peintures numériques" de Claude Royet-Journoud accompagnées en légende d'un récit d'Alain Cressan. La première page pose deux éléments à partir desquels se construit l'histoire : un personnage, Igor, et un tabouret, liés par une phrase écrite avec maladresse (comme celle d'un enfant qui apprend ses lettres)1, « Igor dessine son tabouret et il se couche tout content » ; le récit double partiellement ce dispositif : « Igor pense à un tabouret. Le dessine. Dort. Action faite. »
Seront introduits au fil des pages des éléments variés ; quelques-uns appartiennent à la vie d'aujourd'hui (le plan d'un appartement et ses W.C., un écran de cinéma, une porte où s'inscrit "DRH" quand « Igor cherche un travail »), certains sont rêvés ( une plante dans un pot, un âne), d'autres évoquent le loisir ou la sortie dans l'imaginaire (un livre, une bibliothèque, la mer, des bateaux, la nuit). Igor, absent une seule fois (remplacé par le plan de son appartement), devient double ou sextuple, une autre fois quatre Igor « regardent les bateaux », plus loin trois « observent le ciel ». De manière analogue, les tabourets se multiplient — il suffit de les dessiner —, et les livres, et le récit se développe à partir de jeux sur les nombres et de la répétition de l'absence (motifs privilégiés de conte) : c'est un tabouret, ou un livre, qui a disparu, c'est une tête perdue, une plante rêvée, une hypothétique « île aux tabourets » qu'il faut chercher, et même le travail manque.
 Le personnage d'Igor, malléable, change sans cesse de vêtements : pantalon jaune rayé, bleu, rose, rouge, grenat, gris, blanc, jaune, et le fond de l'image varie en même temps. Les dessins se veulent naïfs pour la mise en scène de cette figure toujours souriante, d'une naïveté très contrôlée cependant : Igor, pour une fois sur une chaise, lit de la poésie..., et sur la dernière image abandonne le tabouret pour un fauteuil ; c'est qu'alors, comme "l'Étranger" de Baudelaire (« J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages ! »), il « observe les formes des nuages à travers les fenêtres, voit des formes d'idées. Quelles idées ? » Oui, quelles idées dans ces insaisissables mouvements ? ■■■
Le personnage d'Igor, malléable, change sans cesse de vêtements : pantalon jaune rayé, bleu, rose, rouge, grenat, gris, blanc, jaune, et le fond de l'image varie en même temps. Les dessins se veulent naïfs pour la mise en scène de cette figure toujours souriante, d'une naïveté très contrôlée cependant : Igor, pour une fois sur une chaise, lit de la poésie..., et sur la dernière image abandonne le tabouret pour un fauteuil ; c'est qu'alors, comme "l'Étranger" de Baudelaire (« J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages ! »), il « observe les formes des nuages à travers les fenêtres, voit des formes d'idées. Quelles idées ? » Oui, quelles idées dans ces insaisissables mouvements ? ■■■
Décembre 2011 © Les carnets d'eucharis, Tristan Hordé
01:14 Publié dans Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Arséni Tarkovski

Enfant, je fus malade
De faim comme d’effroi. J’ôte la peau des lèvres,
Les lèvres, je les lèche ; et je me rappelais
Cette fraîche saveur à peine un peu salée.
Arseni Tarkovski
00:38 Publié dans Arséni Tarkovski, RUSSIE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook

































































