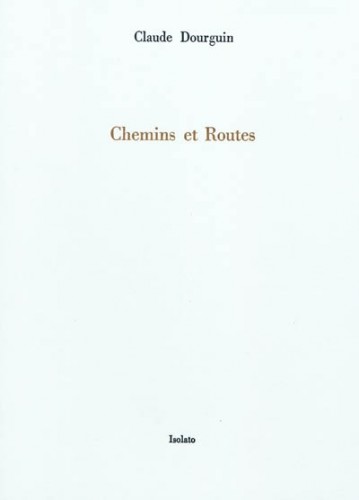04/04/2011
Marie Etienne, Haute Lice (une lecture de Tristan Hordé)
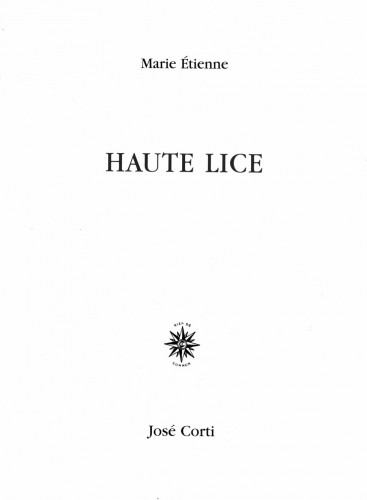
Marie Étienne, Haute Lice, éditons José Corti, 2011, 18 €.
Une lecture de Tristan Hordé
Rien de plus efficace que l’exergue tiré de Rimbaud, « Moi, j’ai toujours été stupéfait ! Quoi savoir ? » ("Remembrances du vieillard idiot") pour lire ce livre singulier ; c’est dire d’entrée de jeu que le lecteur aura à construire quelque chose — donc à lire ; « Faut-il tout dire afin qu’un jour il ne reste plus rien que la lucidité ? » (p. 124) : certes non. Haute Lice est partagé en sept ensembles de courtes séquences et se ferme sur une postface bien en relation avec l’exergue, sorte de "mode d’emploi" où l’auteur esquisse une poétique : « À proprement parler, le sens ne compte pas vraiment, ou bien ni plus, ni moins, que la sonorité, le rythme et le suspens, c’est ainsi que les choses se passent. » (p. 171) De quoi s’agit-il pour que le lecteur n’ait pas à se préoccuper du sens ?
Les ensembles sont liés grâce à la présence du début à la fin d’un personnage, Ava, c’est-à-dire Ève, narratrice des brefs récits dans lesquels elle a un rôle ; ajoutons qu’elle-même devient à l’occasion auteur : « Pour vaincre la tristesse, je m’inventais des fables troubles, dont j’ignorais la signification. » (p.20) Autrement dit, dans cet emboîtement les histoires ne se distinguent pas les unes des autres. Elles mettent en scène Ava, de l’enfance à l’âge adulte, et de nombreux personnages qui n’apparaissent qu’une fois, comme Joachim l’Italien ou Seringa le chimpanzé, ou reviennent à intervalles réguliers, comme Stone (mari d’Ava) ou Nel. Tous font n’importe quoi, le n’importe quoi ne pouvant être toujours défini, et leur apparence même n’est pas fixe. Ainsi, Ava, dans un récit est exhibée au bout d’une laisse, serait-ce dans un cirque ?, et le lecteur retrouve cette laisse bien plus loin, cette fois Ava peut-être sous une forme animale : « La laisse de ma mère, de mauvaise qualité, va céder sous mes crocs. » (p. 117)
Tout peut arriver : les oiseaux ont des dents, des fillettes sont dans des cages suspendues pour le plaisir des curieux, Ava perd sa mère dans un train ou reçoit devant sa porte « face cachée, nuque exposée, une tête sans corps » (p. 94). On multiplierait les exemples, mais ce serait recopier Haute Lice…Si une partie du livre évoque un lieu désigné par Lajenès (à lire "la jeunesse", en créole haïtien), la narratrice se trouve aussi à Paris, monte dans un étrange autobus aux vitres aveugles qui l’emporte nulle part, « dans le milieu d’une étendue d’eau grise, crêtée de loin en loin par une touffe d’herbe. » (p.166) Le lecteur renonce vite à la tentation d’organiser le tourbillon des changements d’apparence, de chercher quelque équilibre dans des récits qui, si minuscules soient-ils, le conduisent dans l’inexploré. On verrait aisément un monde à la Lewis Carroll, une Alice dans Ava, et l’auteur semblerait nous engager dans cette voie, mais il l’exclut immédiatement :
Petite sœur me conduit au miroir.
—Passe derrière, me dit-elle.
—Eh, quoi, ne me conduiras-tu ?
Elle rit, fleur goyave. (p. 124)
Le monde de Lewis Carroll a ses lois, qui relèvent somme toute d’une certaine logique, celui de Marie Étienne, qu’on pourrait lire comme relevant uniquement du rêve, est pour beaucoup un univers de mots, j’y reviendrai.
Cependant Le monde de Lewis Carroll a ses lois, qui relèvent somme toute d’une certaine logique, celui de Marie Étienne, qu’on pourrait lire comme relevant uniquement du rêve, est pour beaucoup un univers de mots, j’y reviendrai.
Cet univers n’est pas totalement coupé de l’Histoire ; on y croise par exemple un maçon « admonesté et sous-payé comme c’était la coutume » (p. 39), et les femmes, qui savent distinguer la satisfaction du désir sexuel et l’amour, peuvent surtout être elles-mêmes par le rêve ou l’écriture ; « Je commençais d’écrire c’est-à-dire de migrer vers mes terres intérieures « (p. 75) indique Ava. Mais quand elle entend bien refuser d’être dans le temps (« Je refuse de survivre à l’instant annulé en m’accrochant avide aux basques du suivant »), sa sœur se moque d’elle : « Allons, allons, tu racontes des histoires ! » L’Histoire est présente aussi par les allusions littéraires ; par exemple, "La Ravaudeuse" évoque Margot la Ravaudeuse de Fougeret de Monbron et "Nel" peut-être un personnage de Fin de partie de Beckett, "Marigda" est sans doute une allusion au livre de Viviane Forrester Le corps entier de Marigda, etc. Quant au premier récit, "La dictée", dans lequel Ava se laisse aller à uriner en classe au point que le liquide forme une grande mare, sans d’ailleurs que l’institutrice s’étonne outre mesure, il renvoie directement à "Remembrances du vieillard idiot" et donc à l’exergue :
[…] Quand ma petite sœur, au retour de la classe,
[…] Pissait, et regardait s’échapper de sa lèvre
D’en bas, serrée et rose, un fil d’urine mièvre… !
La postface introduit un jeu entre lice et lisse, d’où les termes techniques de peausserie lisser et chagriner ; dans les deux cas, le travail de l’artisan — la tapisserie, montage complexe de fils, la préparation des peaux — permet de passer d’une apparence à une autre : impossible de reconnaître dans l’œuvre achevée les matériaux travaillés. Et c’est heureux. De même, les mots sont associés non pas comme dans une fatrasie mais pour construire des ensembles pas encore vus, pas encore imaginés, pas du tout impossibles … puisqu’ils sont décrits. Voici par exemple le début d’une scène dans la loge d’une maison d’Ava :
« La femme est belle, moi je sucre, elle a les doigts qu’il faut, on lui en mangerait son cratère de plaisir, d’autant qu’elle sait ce qui convient : détecter en dansant mais sans colle ni buée les écrans de fumée qui séparent du bleu, et lire dans les yeux le tintamarre des culs. » (p. 97)
Le seul changement de position des mots (qui entraine modification du statut grammatical) produit des effets, ainsi dans ce passage : « or voilà que la terre se bombe, or voilà que les bombes se terrent » (p. 30) ; on notera les nombreux jeux avec les sons, minuscules (« je suis en pantalons, pantoise ») ou non : Ava aime une femme qu’elle nomme "Missive" ou "Mélisse" ou "Réglisse", noms qui portent le sens « de délice (ou supplice ?) », et il n’est pas surprenant que la rivale de cette femme ait pour nom "Céline" — la finale ne peut entrer dans la série….Au jeu des sons s’allie le rythme ; on prendra plaisir à entendre le mouvement de la voix dans ce passage :
« Musique en fête, en tête, en crête, en kiosque, en dents calquées sur les montagnes, en tournevis, en tour de roue, musique saoule sur les terrains poudreux, éclatée à dessein, flûtes en verve. Musique verte. (p. 80)
Il y a dans Haute Lice un amour de la langue (comment dire autrement ?) que l’on voudrait plus répandu, une jubilation que l’on partage sans peine, un humour constant — et une manière malicieuse de l’auteur d’être présente : "Marie" et "Ava/Ève" sont deux origines culturelles, et ne reconnaît-on pas "Marie" dans les noms de personnages "Mariquido" et "Marigdar" ?
© Tristan Hordé, avril 2011
■ Sur le site TERRES DE FEMMES
Dans le chagrin ouvragé de la page (une lecture d’Angèle Paoli)
18:10 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
26/02/2011
James Sacré, Mobile de camions couleurs (par Tristan Hordé)
Une lecture de Tristan Hordé
MOBILE DE CAMIONS COULEURS
Photographie de Michel Butor
James Sacré
(Editions Virgile, 2011)
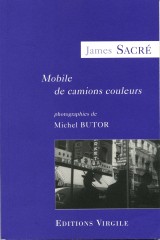 Les camions étaient présents dans un livre récent de James Sacré, America solitudes1, ils occupent toute la place dans ce livre de poèmes, accompagné de 9 photographies. Le titre rappelle sans ambiguïté le Mobile (Gallimard, 1962) de Michel Butor, construit à partir de ses séjours aux Etats-Unis où il enseignait la littérature ; les images remontent à la même époque (une dixième, Michel Butor à sa table de travail, est plus récente). Mais le titre évoque aussi le mouvement sans cesse changeant des camions et, en même temps, leur déplacement les uns par rapport aux autres comme s’ils étaient les énormes pièces d’une sculpture de Calder liées par les invisibles fils des routes. Enfin, comme le livre de Butor, Mobile de camions couleurs, est une construction complexe « où divers éléments de prosodie et de figurations bougent en lents mouvements de l’ensemble ».
Les camions étaient présents dans un livre récent de James Sacré, America solitudes1, ils occupent toute la place dans ce livre de poèmes, accompagné de 9 photographies. Le titre rappelle sans ambiguïté le Mobile (Gallimard, 1962) de Michel Butor, construit à partir de ses séjours aux Etats-Unis où il enseignait la littérature ; les images remontent à la même époque (une dixième, Michel Butor à sa table de travail, est plus récente). Mais le titre évoque aussi le mouvement sans cesse changeant des camions et, en même temps, leur déplacement les uns par rapport aux autres comme s’ils étaient les énormes pièces d’une sculpture de Calder liées par les invisibles fils des routes. Enfin, comme le livre de Butor, Mobile de camions couleurs, est une construction complexe « où divers éléments de prosodie et de figurations bougent en lents mouvements de l’ensemble ».
Les camions sont liés à l’histoire des Etats-Unis et leurs formes, leurs couleurs ont évolué, les machines anciennes abandonnées ou reléguées dans les régions les plus pauvres. Seul l’écrit garde trace (pour combien de temps ?) des temps enfouis de cet aspect de l’industrialisation de l’Amérique, « la voilà maintenant qui s’en va dans le souvenir qu’en garde ce livre [Mobile] de Michel Butor / Avec son histoire, un peu grandiloquente et vaguement ridicule ; / Pays qui oublie, qui oublie longtemps souvent ». Ce motif de l’oubli et, lié, celui des jours qui se ressemblent à se confondre, sont récurrents ; les camions passent sans cesse, comme à la fraîcheur du matin succède la chaleur du jour, comme « demain est un autre jour, le même ». Nous vivons dans un monde de la répétition, du même — avec des machines identiques à Kayenta, en Arizona, et à Cougou, en Vendée.
Ces camions très divers ressemblent à des êtres vivant hybrides, mi-ferrailles mi-animaux, chevaux de fer ou monstres bruyants mais bonasses d’une mythologie contemporaine, l’un « carré sous le coupe-vent bombé et les deux oreilles dégagées », l’autre « le museau jaune (barres rouges des pièces métalliques) comme pris dans un harnais ». Ce caractère subsiste quand ils sont immobiles, « au repos » dans des parkings « derrière un grillage haut », tout comme les bêtes d’un zoo. Ils paraissent parcourir le pays de manière autonome, tant les conducteurs sont invisibles dans leurs cabines. En outre, on ne sait pas vraiment, à les regarder passer ou quand on les croise, vers quel lieu ils se dirigent dans l’ « immense toile de parcours routiers », et peut-être roulent-ils sans fin, dans leur « vigueur aveugle », « pour que tiennent ensemble les villes du pays ».
Comment restituer quelque chose du mouvement incessant, de la profusion de formes et de couleurs ? James Sacré alterne une amorce de description des camions à l’arrêt, qu’il photographie (immobiles alors à jamais), et la saisie de leur extrême variété quand il les voit sur la route. Sur le parking, c’est surtout l’animalité, parfois un peu inquiétante, qui est mise en valeur ; la phrase alors peut s’étendre sur plusieurs vers (« Soit le long museau […], soit / Le groin carré […] / Quand […] / Où […] », ce qui est exclu quand il s’agit d’écrire à propos du passage des camions. Plus de verbes, de clausules, pas d’autres qualifications que celles relatives à la forme ou à la couleur :
Camions gris à double caisse blanche — rouge terne à caisse blanche — noir, caisse bleu clair — noir renfrogné, la caisse blanche — jaune cru à caisse blanche — blanc à caisse blanche — gris-vert à caisse blanche et lettres vert clair — noir à caisse blanche —gris-bleu costaud, caisse blanche — bleu-vert, caisse blanche ligne et lettres rouges — bleu clair, la caisse blanche et des lettres rouges — rouge à caisse blanche, lettres rouges —blanc à caisse blanche — etc.
Une autre alternance est lisible. Parmi les pages consacrées aux camions s’insèrent des poèmes autour de la vie quotidienne du narrateur, ou des chauffeurs : ces derniers non pas comme conducteurs des machines mais « comme autant d’artisans ou de pêcheurs du dimanche », parfois sans plus de lien avec leur travail, comme celui-ci endormi sur une pelouse. C’est aussi le monde du travail qui apparaît, avec la figure de l’Indien qui pourrait être contraint de quitter sa terre pour devenir routier, ou avec un lieu, Gallup, « Où le commerce et la misère, et le simple travail quotidien / Font se rencontrer […] toutes sortes de gens. » Ce qui est également visibles sur la caisse des camions, ce sont les noms des compagnies qui les possèdent ; c’est là une autre variation notée, « une troisième ligne rythmique » à côté de celle des couleurs et du mouvement bruyant. Un autre rythme encore est donné par le silence et la quasi immobilité du paysage.
Une nouvelle pièce du mobile oppose la course des camions aux États-Unis, dont on ne sait trop jusqu’où ils vont — à l’instar des pionniers du XIXe siècle construisant continûment une nouvelle frontière — à celle de camions de taille plus modeste, « gros jouets propres », sur une autoroute en France, qui font « le tour d’un petit pays ». La dernière pièce, à mes yeux, de ces constructions de rythmes est le jeu entre les photographies de Michel Butor et les poèmes : deux d’entre elles (l’entrée d’un parking souterrain, un homme endormi sur une pelouse) peuvent être associés aux camions, les autres sont relatives à la vie citadine quotidienne : la proportion est inversée dans le texte. Il est sans doute d’autres à lire ; il est certain que l’on ne quitte pas volontiers ce "mobile", singulier non par certains motifs récurrents dans l’œuvre mais par sa construction.
Tristan Hordé
(pour les Carnets d’eucharis)
21:54 Publié dans James Sacré, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
14/02/2011
Quadratures, Dominique Buisset - (par Tristan Hordé)
Une lecture de Tristan Hordé
QUADRATURES
Postface de Jacques Roubaud
Dominique Buisset
(Editions NOUS, 2010)
 Il faut répéter que la poésie n’est pas une, que « La poésie naît de ce qui, sans elle, demeurerait à jamais sans nom. »1 Elle peut donc encore être en vers comptés et rimés aujourd’hui, sauf à éliminer des œuvres aussi différentes que celles de Jacques Réda et Christian Prigent. Comme eux, Dominique Buisset choisit des formes dites traditionnelles et prouve avec une allégresse communicative qu’elles n’ont pas fini d’être explorées. Rien de contourné dans ces poèmes courts, écrits dans des mètres (7, 8, 9, 10, 11 syllabes) et des formes (septain, huitain, neuvain, dizain, onzain) classiques. Cependant, une fois que le lecteur a reconnu le cadre, il comprend vite que l’auteur en joue en tous sens : développant un art d’écrire — une poétique — et, dans le même temps, revisitant les motifs du lyrisme — le temps, la mort, l’oubli —, Dominique Buisset parcourt tous les schémas de rime, multiplie les combinaisons phoniques et fait partager le plaisir de manipuler des structures numériques.
Il faut répéter que la poésie n’est pas une, que « La poésie naît de ce qui, sans elle, demeurerait à jamais sans nom. »1 Elle peut donc encore être en vers comptés et rimés aujourd’hui, sauf à éliminer des œuvres aussi différentes que celles de Jacques Réda et Christian Prigent. Comme eux, Dominique Buisset choisit des formes dites traditionnelles et prouve avec une allégresse communicative qu’elles n’ont pas fini d’être explorées. Rien de contourné dans ces poèmes courts, écrits dans des mètres (7, 8, 9, 10, 11 syllabes) et des formes (septain, huitain, neuvain, dizain, onzain) classiques. Cependant, une fois que le lecteur a reconnu le cadre, il comprend vite que l’auteur en joue en tous sens : développant un art d’écrire — une poétique — et, dans le même temps, revisitant les motifs du lyrisme — le temps, la mort, l’oubli —, Dominique Buisset parcourt tous les schémas de rime, multiplie les combinaisons phoniques et fait partager le plaisir de manipuler des structures numériques.
Comment débuter un livre ? En disant qu’il commence et qu’il vient après d’autres. Le premier vers du livre, « Il est temps de reprendre le chant », ouvre un huitain mais, comme s’il fallait s’échauffer, le système de rimes est défaillant (a b c d e e e a) — ensuite, quand un poème ne sera pas régulièrement rimé, le lecteur inclinera à en chercher la raison. Quel parti est pris ? « la parole a besoin d’ordre », et cet ordre s’établit, par exemple, par le retour du même — nombre de vers égal au nombre de syllabes, rimes ; par extension, c’est le réel qui perd quelque peu son opacité :
[…] le poème est un rêve du nombre,
dans le désordre qui met la césure,
nomme et compte et divise le réel
pour éviter qu’il soit un chaos sombre
Sans doute ne prête-t-on pas attention à cette mise en ordre de la langue, du réel, « poussée des pages s’amoncelle / dans tous les sens apparemment ». Apparemment : bien des indices ralentissent ou interrompent le lecteur, notamment les rimes. Ici, un dizain à rime unique (an, en), là des rimes riches (consentement / contentement ; l’éclosion des mots / les cloisons d’émaux ; etc.), qui couvrent tout un hémistiche : et nous par le dedans / et nous parle de dents ; néant toussa / nez en tout ça ; rêve d’une ombre / rêve d’une ombre ; etc. L’attention se porte sur tous les jeux avec les sons et les repère ailleurs que dans les rimes : « le vent violent voyeur à l’œil / violet » ; adieu mers vaches merveilles ; apeurés tels des lapereaux ; etc. Comme le montrent des exemples ci-dessus, Dominique Buisset utilise pour les transformations phoniques un procédé cher à Raymond Roussel, jusqu’à agir sur un vers entier : dans un dizain, au vers 1 « Tout doit disparaître ! En mille, en cent ans… » répond le dernier vers, « tout dix doit paraître, cela s’entend. »
Jacques Roubaud relève dans la postface que « Quadratures suppose des tonnes de lecture, des années de travail ». Il est bon d’y insister : aucune poésie n’existe sans travail dans la langue : « Le faux n’est pas rien, l’imaginaire / est une vieille astuce et la ruse /du réel, en quoi rien ne se crée /mais tout se produit. Et la matière / est première » (souligné par moi). On le voit dans la variété des schémas de rimes, dans la reprise de rimes de la Délie de Scève (hommage annoncé par l’auteur) ou d’un thème né à la même époque (la "belle matineuse"), avec son vocabulaire. La mise en ordre, toujours rigoureuse, n’est pas à tout coup exhibée. Dans la première partie du livre (qui en compte six), 21 poèmes sont organisés en deux groupes de 10, le onzième poème, onzain de 11 syllabes, sert de pivot et suggère la règle choisie. En effet, il n’est pas rimé mais deux fins de vers (le rend / rends-le), la construction du vers 9 (nous, et sa piqûre dont s’ourlent de nous) (souligné par moi), la relation entre les premier et dernier vers (Universelle maison de l’équivoque / dans l’équivoque biais de l’universel) orientent vers une structure en palindrome. En effet, aux dix premiers poèmes (8-7-8-7-8-9-8-10-9-10) répondent en miroir les dix après le onzième (10-9-10-8-9-8-7-8-7-8) ; on peut d’ailleurs voir que la construction est plus complexe. Pour le bonheur du lecteur, la règle d’organisation peut être dite ; la quatrième partie est titrée "Six cents syllabes à circonscrire Une ballade pour rire" et propose la suite 3 dizains (300 syllabes) - une ballade - 3 dizains (à nouveau 300 syllabes). Le lecteur découvre d’autres règles de construction non explicitées et peut établir des liens avec, notamment, les poètes désignés (souvent péjorativement) par "Grands Rhétoriqueurs" et ceux de la Renaissance.2
Mais à quoi bon cette vertigineuse mise en ordre ? Dominique Buisset répond à sa manière :
Couronnant le vide souverain
Le poème est le mètre de rien
De son compte il enchante les leurres
Du silence sans fin qu’il emplit
En son lieu il arpente le champ
Des lois propres de sa gravité
Il est de nature sans objet
Car sa course exactement réglée
N’a ni sens ni centre ni sujet.
Ce qui est dit ici, on n’en sera pas surpris, est inscrit dans la forme : l’absence de rimes des vers 3, 4 et 5 attirent l’attention (a a b c d e f e f), comme les rimes souverain / rien, gravité / réglée, objet/ sujet. Forme et fond inséparables. Cependant, on laisserait beaucoup de côté si l’on ne s’attachait qu’à la très savante virtuosité, qu’à la connaissance approfondie de la poésie du passé — ce qui ne serait pas si mal ! Mais ce serait dire aussi que les "quadratures" ne sont que des ornements. Il faut relire Dominique Buisset sur ces points et réfléchir à une affirmation sur ce qu’est le poème : « l’inutile est là / seul qui donne au temps la tenue / sans laquelle il n’a pas de cesse ». Organiser strictement le flux des mots, construire un ensemble de poèmes (et non pas les juxtaposer), c’est refuser la "fuite" du temps, ou plutôt inscrire quelque chose qui peut résister un peu dans le temps, laisser une empreinte — sans l’illusion d’une fausse éternité :
envolés drames, comédies, renoms,
iambe ou trochée, poésie trépassée !
Satire, épopée, travaux de Romains,
œuvres, formes, tout a suivi les mains…
tout repose au fond du temps, in pace.
Il y a aussi dans Quadratures le sentiment fort de la solitude de chacun (De personne rien ne nous délivre / Sinon mourir) et du vide des jours, quoi qu’on fasse, sans autre perspective que la mort (Quelle mort parle en nous plus haut /que le désir). Ces motifs sont des lieux communs du lyrisme, certes. La poésie de Dominique Buisset, cependant, leur donne de la fraicheur grâce au travail minutieux et savant sur la forme : l’élégie existe, mais l’auteur introduit une distance vis-à-vis du discours, ne serait-ce que pour rappeler que le temps, la mort ne sont pas que des mots :
Non il n’y a rien à dire
L’écriture c’est la règle
Elle fait taire le pire
À coup d’arbitraire espiègle.
© Tristan Hordé, Carnets d’eucharis (février 2011)
■ AUTRES SITES A CONSULTER :
Recension d’Angèle Paoli
Extraits de Quadrature
Fiche de l’auteur sur le site CipMarseille
13:49 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
13/01/2011
Claude Dourguin, Chemins et Routes (une lecture de Tristan Hordé)
Une lecture de Tristan Hordé
©
Chemins et routes
Claude Dourguin
(Editions Isolato, 2010)
Les voyages de Claude Dourguin naissent d’une exigence, tout se passe comme s’il lui devenait impossible de continuer à rester immobile, qu’il lui fallait prendre le bâton et marcher pour savoir ce qu’est respirer, regarder, découvrir, apprendre — vivre. Cette manière de se connaître, d’éprouver le vif des choses apparaît peut-être plus dans Chemins et routes que dans ses autres livres (1), parce qu’il s’agit ici de l’expérience de multiples parcours.
La plénitude ressentie par le seul fait de quitter les habitudes, par le contact physique avec le sol, s’exprime dans les premières phrases et c’est ce bonheur d’être qui est exploré ensuite, série de variations dans une prose-poésie reconnaissable entre toutes. Se séparer donc de ce qui abrite, protège, cela se fait jour encore pas venu (« Départ dans le matin frais » est le début du livre), dans ces moments incertains, aux « adieux sans mots », pour retrouver un corps, « le réel après la trêve des songes ». Rapidement, « le pas se fait au sentier, au chemin », et c’est bientôt « la marche heureuse », « l’accord trouvé », la « continuité vive », la lumière détache les contours, le marcheur voit maintenant arbres et ruisseaux : « le monde s’ouvre, donné », vraie « terre première ».
Il n’est pas besoin d’être un marcheur pour apprécier l’exaltation de Claude Dourguin ; qui n’a pas, ne serait-ce que dans l’enfance, imaginé ce qui se trouvait au-delà de l’horizon, « ligne de promesses : là-bas, d’autres terres, d’autres champs, d’autres monts, différents, toujours renouvelés », « un monde toujours recommencé » ? C’est cette merveille (qu’y a-t-il derrière le miroir ?) que propose Chemins et routes. Avant d’atteindre l’horizon, dès qu’un village est quitté, hors du tumulte, Claude Dourguin est enveloppée dans une nature toujours accueillante, généreuse, la nature telle qu’elle apparaissait à Rousseau. Ainsi, figuiers et vignes abandonnés par la culture continuent à produire et le marcheur réinvente les gestes d’un Robinson : « Je m’arrêtais, mangeais ces fruits offerts, présents du lieu dont, ainsi, j’assimilais les vertus. » Ailleurs, c’est l’eau d’un ruisselet qui est donnée, « bonheur d’une générosité inadressée ». On verra là non pas tant une forme de panthéisme qu’un amour profond, raisonné pour cette manière de vivre, si peu de temps qu’on puisse le faire, à l’écart du tumulte, en suivant ces chemins qui gardent à qui veut les lire les traces d’une histoire séculaire : « Je les vois, tracés qui ne blessent ni ne segmentent mais relient, pas de l’homme ou de la bête et terre, cultures et demeures, cyprès riverains et ciel. Chemins religieux, en effet, si, foncièrement, on ne les éprouvait païens. »
Les chemins, bien plus que les autoroutes d’aujourd’hui, avaient une fonction de lien ; il y eut une longue période où « on allait, périple rude, surprises et peurs, mais prémunis de l’errance. Le chemin accompagnait, donnait un destin. » Claude Dourguin rappelle que les routes anciennes étaient parcourues sans cesse par les marchands, les soldats, les étudiants, les colporteurs, les ouvriers, etc., vivantes de toute une vie « bigarrée, pleine de bruits et d’odeurs ». On lit encore l’épaisseur du temps dans les noms de lieux, énumérés pour tout ce qu’ils portent du passé, ceux par exemple de l’Italie, abondants ici, ou pour le plaisir de les suivre inscrits sur la carte le long d’un sentier, « Bosch Tens, Plan Vest, Löbbia, Cadrin, Mungat, Maroz, Dent…, petites énigmes locales qui entrainent le songe dans leur récitatif mystérieux ».
Claude Dourguin vit aussi les paysages à partir de la littérature et de la peinture, évoquant les voyageurs du XIXe siècle, de Chateaubriand à George Sand ou Mérimée, Schiller, Heine…, suivant Hölderlin et Nerval, Thoreau et Montaigne, ou un personnage de Stifter. Dans un paysage de neige, l’eau sous la glace est un « jardin d’Eden, un fond de tableau de Bellini » ; ici, ce sont les campagnes des Très riches heures du duc de Berry, là des teintes pour un Douanier Rousseau, des formes admirées chez Memling ou Carpaccio, des lumières du Lorrain, "La construction d’un grand chemin" d’Horace Vernet, ou encore Poussin, Dürer, Thomas Jones…
Ce qui est esquissé dans Chemins et routes, c’est un projet rêvé dont le livre tel qu’il est, donne une idée : projet « d’un livre des chemins, catalogue et dictionnaire à la fois, qui évoquerait, recenserait sans du tout prétendre faire œuvre savante, les figures diverses des chemins, leurs histoires, leurs particularités géographiques. Ou bien un traité exact et poétique, recueil des singularités des reliefs et des terres, provinces et leurs façons de dire, de cultiver, de mener commerce, bêtes poussées devant soi […] ». De ce projet borgésien reste pour le lecteur un beau labyrinthe où il peut errer, découvrir sans cesse et des sorties et des possibilités de se perdre ; il saura aussi qu’à emprunter les chemins, « au plaisir physique d’arpenter, à la satisfaction du regard se mêle le bonheur de découvrir, d’apprendre, de comprendre, de nouer un lien intime avec une contrée et sa terre », il souhaitera peut-être avec la marche voir le monde devant lui, comme le faisait Walt Whitman cité à la fin du livre.
(1) Voir les derniers publiés, en 2008 chez le même éditeur, Les nuits vagabondes et Laponia.
12:38 Publié dans NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
02/01/2011
Cole Swensen "L'âge de verre" : une lecture critique de Tristan Hordé
Une lecture de Tristan Hordé
©
L’AGE DE VERRE – Cole Swensen
(Editions José Corti, 2010)
Maïtryi et Nicolas Pesquès ont déjà traduit en 2007, pour le même éditeur, Si riche heure, construit à partir d'un livre de piété, les Très Riches Heures du duc de Berry. Cette fois, L'Âge de verre a pour point de départ des tableaux de Pierre Bonnard et, plus particulièrement, ceux où apparaît une fenêtre. Le livre de Cole Swensen introduit, à la suite de données informatives sur le peintre (« Pierre Bonnard, 1867-1947, [...] » ou d'une amorce d'analyse (« L'œuvre de Bonnard demande implicitement ce que c'est que voir et ce que c'est que voir à travers. Nous songeons aux disputes [...] », des éléments d'un tout autre ordre, des vers coupés [1] et, ici et là, des pronoms (je, tu, nous, et les possessifs correspondants) qui modifient le propos. Ce qui s'annonçait comme une méditation poétique à propos des fenêtres dans la peinture de Bonnard, avec des digressions notamment sur Vuillard, Caillebotte et des écrivains, est un ensemble de variations autour du verre, de la transparence, du regard et de la réflexion.
D'emblée le nom de Bonnard renvoie à des tableaux que l'on peut regarder, quelques titres sont d'ailleurs donnés, mais en même temps est évoqué le temps du narrateur : « Comme beaucoup, Bonnard repeignait / alors / ma fenêtre ». Parallèlement, interviennent de minuscules débuts de récits, de scènes dans lesquels les fenêtres, les vitres, les glaces jouent un rôle ; fragments d'histoires, points de vue sur les choses du monde, analogues au "elle" apparu l'espace d'une page qui « révèle / un si multiple / visage dans la glace ». À partir d'un tableau des figures naissent qui débordent, comme s'il offrait réellement une vue sur les choses, « un chien dans la cour, et quelqu'un qui s'en va ou qui vient », comme « dans un seul grain tient une plante ». Par ailleurs, par le seul changement d'un temps verbal dans la phrase, Cole Swensen passe de la description "objective" d'un tableau ("Nu dans un intérieur", c. 1935) à l'imaginaire, la toile étant à l'origine d'un récit qui pourrait être continué, les deux points (:) marquant la frontière entre le texte sur la représentation du réel et celui qui en dérive, dans « Elle se penche pour toucher quelque chose : et puis elle se redressera pour regarder dehors, [...] ».
Que voit-on depuis la fenêtre ? Dans un tableau de Caillebotte, un homme regarde la rue — voyeur —, alors que personne n'est présent devant les fenêtres chez Bonnard ; qui regarde ? Question de la subjectivité : ici un corps qui l'incarne, là une fenêtre « devient une partie du corps, sans suture avec la continuité du monde ». Les vitres anciennes contenaient un autre monde, minuscules scories dans la fabrication qui pouvaient issues du corps, « parfois une larme, parfois une petite bulle d'air », perçues seulement quand l'œil oubliait ce qui est derrière la vitre alors limite du regard ; monde disparu au profit, au-delà du seuil, du paysage ou de la rue.
L'ouverture vers l'extérieur est une échappée dans un imaginaire maritime, « La fenêtre, entrouverte, soudain s'offre à la brise et tu vois son visage qui vogue au loin. » Dans un autre poème, l'allusion à la mer est plus claire et s'opère une métamorphose ; ce ne sont plus un paysage, les gens de la rue qui sont visibles, mais la totalité de ce que le regard pourrait embrasser jusqu'à perdre tout contour :
mais tel un rivage
la fenêtre est infinie, son périmètre
augmentant sans cesse sans jamais dépasser son cadre
n'est rien d'autre que la vue s'outrepassant.
Cette relation de la fenêtre et de la mer, de l'eau, est récurrente dans L'Âge de verre et contribue à unifier souterrainement l'ensemble. Analysant, par exemple, la composition des tableaux de Bonnard après avoir évoqué la vogue du "Monde Flottant" japonais à la fin du XIXe siècle, Cole Swensen note que chez lui le monde est comme « un plan d'eau sur lequel glisse, apothicaire-vite, le regard ». Ou encore : le Palais de Cristal, à l'exposition de 1851, était d'une telle étendue que ses visiteurs avaient l'illusion de « se croire sous les flots de quelques fabuleuse rivière ». Dans "Les fenêtres" de Mallarmé, est relevé « galères d'or, belles comme des cygnes ». Etc.
La fenêtre éclairée, vue de l'extérieur, se transforme en pièce d'un théâtre d'ombres, les personnes se meuvent sans épaisseur, passant et repassant comme s'ils étaient peints sur une plaque, devenant alors les personnages d'une histoire qui se dissipera quand les lumières seront éteintes. La fenêtre permet ainsi de réinventer la lanterne magique — « Le premier film fut une fenêtre » ; dans le premier film des frères Lumière, rappelle Cole Swensen, le spectateur voit une femme « le visage collé à la vitre, immobile », qui le regarde.
Cole Swensen mêle les espaces et les temps, le réel et sa représentation, construisant ainsi ce qui n'appartient qu'à l'écriture. Les lecteurs sont convoqués ("vous") pour voir Bonnard qui, la nuit, « regarde l'intérieur d'une pièce jaune, se demandant ce qui est dû à la lumière et ce qui est dû à la peinture ». La suite : c'est Marthe (l'épouse et le modèle de Bonnard) cette fois qui, le lendemain, regarde à l'intérieur, elle « vient s'appuyer à la fenêtre et t'appelle // toi qui regardes le tableau dans un musée ». Mondes mêlés par la grâce des mots, et qui le resteront ; ce n'est pas hasard si le livre s'achève sur « Ce qu'il y a de mieux dans les musées ce sont les fenêtres » — dit-il [Bonnard] en regardant la Seine depuis le Louvre, juin 1946.
[1] J’emprunte le terme à Nicolas Pesquès qui, en 4ème de couverture, définit avec concision l’entrelacement des propos dans L'Âge de verre.
© Tristan Hordé, Carnets d’eucharis n°25 (Spécial fin d’année 2010)
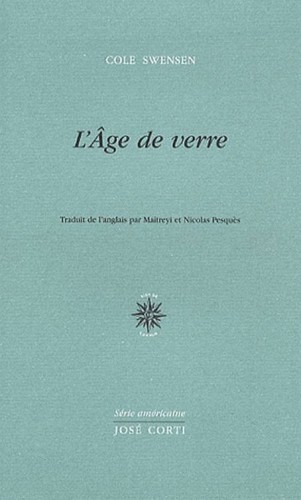
Traduit de l'anglais par Maïtreyi et Nicolas Pesquès
Série américaine
José Corti, 2010
■ Site des Editions José Corti : http://www.jose-corti.fr/titresetrangers/Agedeverre.html
16:17 Publié dans Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
09/10/2010
Angèle Paoli, Carnets de Marche (une lecture de Tristan Hordé)
NOTE DE LECTURE
(Tristan Hordé)
Carnets de Marche
ANGÈLE PAOLI
La marche solitaire me semble être une activité complète : elle est un bienfait pour le corps certes, mais elle offre aussi petits et grands bonheurs par les découvertes de la faune et de la flore, on y réinvente à chaque fois les paysages et l'on ne cesse d'y examiner ses jours, ses rêves, ses craintes, d'analyser ce qu'il en est des relations avec ses proches ; on finit par s'arrêter pour lire, regarder le ciel, un arbre, les mouvements des animaux... Dans les Carnets de marche d'Angèle Paoli, tout cela est précieusement noté.
L'espace et le temps du récit sont apparemment homogènes, il s'agit des sentiers et routes empruntés à partir d'un point fixe, une maison dans un hameau du Cap Corse, pendant plusieurs saisons, et chaque séquence du récit correspond le plus souvent à une marche. Cependant, sont introduits ici et là des souvenirs de la vie passée, et ces évocations d'autres temps et d'autres lieux menacent alors l'équilibre présent : le hameau n'apparaît plus comme un havre mais comme un lieu d'exil. La boucle de la marche ne suffit plus à assurer l'ordre du récit ; il est rétabli par la présence constante d'un élément, le vent qui, outre qu'il s'accorde par son mouvement avec l'agitation intérieure de la narratrice, soude les séquences. On commence : « Tu écoutes la chevauchée du vent dans les chênes » ; avançons : « Des vents à couper le souffle», « Le vent sarcle la montagne jusqu'à l'os » ; lisons la dernière phrase du livre : « Le silence vent du matin qui gifle et qui grince plein fouet ».
C'est encore le vent qui transporte les odeurs, celle des cochons comme celle des arbres — ainsi l'odeur « de chêne mouillé, mélange subtil de terre, d'eau, de feuilles » —, découvertes au cours de la marche comme mille et une manifestations de la vie dans le maquis et la forêt, les « minuscules enchantements du jour » : chèvres qu'appelle le berger, oiseaux dont on ne connaît la présence que par le cri, lézards vite enfuis, marcassin qui passe rapidement devant vous. La narratrice voudrait tout retenir et emporte d'ailleurs dans son sac ce qui peut l'être, des rondins de bois abandonnés, un nid de mousse, un rameau d'arbouses...
Il y a très fortement un désir de fusion avec la nature qu'elle arpente ; une des belles séquences des Carnets, par exemple, est consacrée au désir de devenir végétal : « Je suis arbre [...] Mon corps s'enracine [...] Je me coule dans l'arbre, me fonds à son corps de silence et de vent. » On rapprochera ce fantasme d'une disparition heureuse à un autre moment du livre où s'exprime le « désir de retour au ventre des origines » ; pourtant bien que la mère soit présente dans les Carnets, c'est par une relation particulière à la terre que passe ce désir : « c'est par le sexe qu'il t'est donné de le vivre à nouveau. Tu caresses les forages de la roche fissurée, lèvres et ourlets de chair minérale [...] La chair se fend sous l'insistance de tes doigts [etc.] »
Bonheur, donc, de se retrouver, d'être soi-même dans une nature sensuelle et accueillante ? Ce serait trop vite oublier une partie des Carnets. Parfois, le chemin suivi se perd dans des broussailles impénétrables, le but est impossible à atteindre et il faut revenir en arrière, modifier son itinéraire. L'incident suscite de sombres réflexions chez la narratrice, « le sentier introuvable » devient la « métaphore de sa vie ». Chaque fois qu'elle cesse d'observer ce qui l'éloigne de sa difficulté à vivre, alors « elle oublie qu'elle marche. Peut-être ira-t-elle à oublier qui elle est. » Cet oubli, le lecteur le suit sans peine dans la relation qu'elle fait de cauchemars qui disent la dissolution « dans les interstices du sol », la chute dans un trou avec la sensation d'une « béance sans visage ».
En même temps qu'un bonheur rousseauiste, les Carnets relatent la rupture d'avec une femme aimée, d'autant plus pénible à supporter qu'elle s'effectue progressivement, sans être exprimée. C'est la raréfaction des courriers, leur laconisme qui font comprendre à la narratrice que "tout est fini". Amour perdu qui, à certains moments, désoriente à un tel point que le corps semble ne plus avoir de lieu, et alors « Être ici, cela renvoie à tout ce que tu as perdu ».
Cette intégration difficile de la perte de l'Autre provoque une quasi impossibilité à prendre en charge le récit. La narratrice, c'est d'abord et dans une grande partie des Carnets, "elle", que l'on ne distingue pas toujours dans certains passages du "elle" désignant la femme aimée. D'un paragraphe à l'autre, ce "elle" narratrice devient un "tu", mais le dédoublement évite encore le "je", qui obligerait peut-être à répondre à la question « Qui fuit-elle ? » Cet emploi complexe des pronoms est explicité : « Cette distanciation [par le "elle"], toujours, qui l'empêche d'assumer son "moi". Elle, elle hésite. Le "je" qui se met sans cesse en avant, ça la contrarie. Elle le trouve trop exclusif, trop égocentré. Elle lui préfèrerait le "tu", qui ouvre le dialogue avec cette autre part d'elle-même, instaure le va-et-vient entre une forme de regard et une autre, un angle de vue et un autre. »
Le "je" n'est pas absent, mais Angèle Paoli use soit des ressources de la ponctuation pour signifier la distance dans l'écriture (c'est alors "je," ou "mon,"), soit supprime toute démarcation entre les éléments du discours, ce qui donne l'impression d'un flux de pensées qui n'auraient pas besoin d'être hiérarchisées. On pourrait dire qu'alors cette absence de distance marque la fin du deuil de l'Autre — le "elle" ambigu n'est plus nécessaire —, la possibilité par la narratrice d'être ce qu'elle est, sans (se) dissimuler. Ce n'est pas le moindre intérêt de ces Carnets de marche.
© Tristan Hordé, octobre 2010
Editions du Petit Pois, Béziers, 2010
■ LIEN : http://cordesse.typepad.com/leseditionsdupetitpois/auteurs/

+ d’infos
20:58 Publié dans Angèle Paoli, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS, Tristan Hordé | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook