30/03/2020
Gérard Cartier - L'Oca Nera (une lecture de Nathalie Riera)
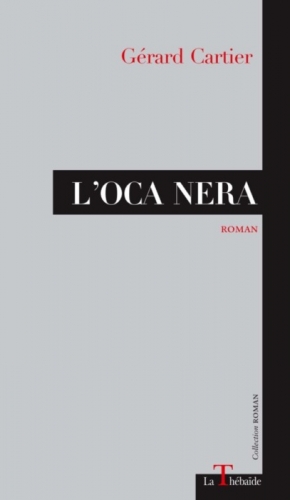
ǀ L’Oca Nera, Éditions La Thébaïde, 2019

Gérard Cartier
GERARD CARTIER
[L'OCA NERA]
L’Oca Nera est le premier roman de Gérard Cartier, avec sa structure de 62 chapitres pour répondre au traditionnel Jeu de l’Oie et ses 62 cases aux figurines diverses, toutes en référence à la mythologie, dont certaines présentent un nombre de risques ou d’accidents, autant de cases fastes que néfastes – non sans quelque lien avec la vie humaine et ses vicissitudes. Jeu de hasard pur, qui n’implique ni réflexion ni calcul, où l’aléa règne en maître, le Jeu de l’Oie est marqué du double sceau de la simplicité et du mystère. D’origine italienne, probablement Florence, la première édition remonterait à 1580. Au Musée du Jeu de l’Oie, à Rambouillet, le narrateur nous avise : « Quatre siècles sont représentés là, depuis les premiers jeux, de simples gravures à l’encre bistre, jusqu’aux planches richement enluminées du début du siècle ».
Le narrateur sait l’enracinement dès son enfance du culte de l’image, « comme tous ceux de mon âge, j’ai appris le monde dans les livres d’images », une fascination que rien ne peut éradiquer, et c’est en protagoniste ocaludophile qu’il nous entraîne dans les ruines du passé, parmi celles de la tragédie du Vercors et son foyer de la Résistance française anéanti dans un bain de sang lors de l’attaque des Allemands le 21 juillet 1944. Puis, dans un temps moins reculé, du temps où le protagoniste – comme l’écrivain Gérard Cartier – menait une carrière d’ingénieur sur des projets d’infrastructures, il y aura cette autre guerre, jugée plus protéiforme, l’attaque du chantier La Maddalena et ses manifestations NO TAV dans le Val de Suse (27 juin 2012), simulacre de « jeunes gens révoltés qui (…) jouent, comme disent les journaux, à la guerre ». La lutte de ce mouvement populaire de protestation contre la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin dure depuis le milieu des années 1990. On se souvient des chefs d’accusation retenus contre l’écrivain Erri De Luca, pour instigation au sabotage et vandalisme et aussi de son acquittement le 19 octobre 2015 par le TPP (Tribunal Permanent des Peuples) de Turin.

Le regard profond de Gérard Cartier sur l’Histoire répond à sa hantise de la guerre, celle précisément « qui nous a engendrés, dans l’ombre de laquelle mon esprit s’est formé », écrit le narrateur. Le passé remonte par bouffées, rien ne peut rompre les fils qui nous y rattachent.
Tout au long de ces 62 séquences sans chronologie dans le temps, le lecteur avance chapitre après chapitre, presque à l’aveugle, parfois tout aussi perdu que le narrateur qui veut bien croire que nous ne sommes pas seulement « un pion poussé au gré des nombres », mais plutôt croire « que nous sommes volonté et raison », au même titre qu’au jeu de hasard raisonné, à même de nous permettre d’opérer des choix pour tirer le meilleur parti du résultat des dés.
Le roman de Gérard Cartier est on ne peut plus troublant, intriguant, dans sa substance même, où le temps, qu’il soit présent ou passé, est à jamais vecteur de nostalgie : « Que devient ce qu’on possède dans l’instant, dans la pure dilapidation du désir », en même temps que ce paradoxe de vouloir y remédier avec juste ce qu’il faut d’ « un peu d’invention et même beaucoup (…) pour rendre vie au passé ».
Le premier jeu de l’oie du protagoniste remonte du temps de l’après-guerre, du temps de la ferme de Carrue, en décembre 1964, où il entendra pour la première fois le nom énigmatique de Graz, nom étroitement lié à la vie de son père, brancardier pendant la guerre, nom « tout à coup surgi des ténèbres du siècle ». Graz désigne Wolfsberg, une petite ville en Autriche, au sud-ouest de la frontière slovène que notre protagoniste aura le souci de sillonner, à la recherche « des baraquements couverts de toile goudronnée où des milliers de juifs ont langui avant d’être wagonnés vers Auschwitz ». Mais aucune trace ne subsiste. Aucune mémoire. Une usine de filtres automobiles remplace le camp mortifère. « Quant à mon père, j’en sais trop peu pour lui rendre un passé, trop peu même pour l’inventer, quand bien même, le suivant à distance, j’ai sillonné Wolfsberg et la Styrie et traversé l’Italie en regardant le monde avec ses yeux ».
C’est au retour de Graz que son père va retrouver « sous le lit de son enfance (…) la boîte de carton du jeu de l’oie qui l’attendait dans la poussière, et que le soir même, encore crasseux du long voyage en train à travers l’Autriche, l’Italie et la Savoie, à peine apaisée la faim dévorante qui l’avait presque réduit aux nerfs, il avait ouvert la planche colorée sur la grande table de la ferme et, le doigt errant de case en case, qu’il avait relaté son aventure à la famille réunie pour l’occasion. (…) Là, au milieu des miettes du repas, devant un verre encore à demi rempli de piquette, mon père avait entrepris de raconter la drôle de guerre et la défaite, cherchant ses mots, amenant à lui pour se donner une contenance le jeu de l’oie abandonné sur le buffet (…) ».
Une autre hantise de l’écrivain Gérard Cartier, rattachée à la tragédie du Vercors, celle du nom emblématique de Mireille Provence, hantise qui occupe une grande partie de L’Oca Nera. Mireille Provence, de son vrai nom Simone Waro, n’est pas sans lien dans l’histoire familiale de l’écrivain puisqu’elle serait impliquée dans la disparition de son oncle Marcel. Une double photo anthropométrique nous est donnée page 295. Mireille Provence dite l’espionne du Vercors, ou encore, l’égérie de la milice… Condamnée à mort à la Libération, De Gaulle la gracie, alors qu’elle a envoyé à la mort une quarantaine de maquisards. Que sait-on aujourd’hui du dossier du procès de Mireille Provence ? Après consultation aux archives de Grenoble dans l’espoir d’accéder au dossier de la condamnée, puis aux archives de Fontainebleau pour tenter d’élucider la disparition des dossiers de demande de grâce, la renégate n’est plus que fantôme, et pour l’écrivain parti sur ses traces, obnubilé « à sonder les bibliothèques et à dépouiller les vieux annuaires du Dauphiné et de la Provence », mais aussi pour les victimes et leurs familles, rien de plus abject que d’apprendre que la levée du secret n’aura pas lieu avant la fin de ce siècle : « la vérité est ensevelie dans les archives de la Cour de Justice de Grenoble », le dossier mis sous scellé « pour encore quatre-vingts ans » ! – Après une enquête toute personnelle, l’écrivain lui-même apprend que Mireille Provence a finalement écopé de seulement huit années de prison, ce qui paraît si faible au regard de l’assassinat d’environ 40 maquisards ! Mireille Provence « avait disparu des annales, après son procès, avalée par le siècle avec les Fredy Howard de Luz et les Hélène Coudreuse. Mais si j’avais su la retrouver, le sens était perdu. Mon sujet était autre : mesurer l’ombre que jette en nous l’Histoire (…) ».

« (…) l’Histoire (…) la Littérature, lesquelles ne font jamais bon ménage, l’une nette et sévère, tracée à la pointe sèche, constellée de dates et de noms, certifiée par mille preuves inscrites sur les cartes et les stèles, l’autre vague et fluctuante, humide, ambigüe, plus propre à émouvoir qu’à enseigner, témoignage équivoque des anciens égarements, longue ombre portée sur la postérité. »
Tout comme le père – si peu disert quand le fils l’interroge sur cette époque sinistre de l’Histoire –, qui en passe par le jeu de l’oie afin de pouvoir faire récit, de pouvoir raconter, la passion (ou l’obsession) du fils pour le jeu de l’oie ne répond-elle pas au besoin de perpétuer la mémoire ? Et en passer par la littérature mémorielle, comme une manière de vaincre le temps ? Soustraire le passé de son propre néant, revisiter le passé pour mieux le redécouvrir, dans les moindres détails.
Le narrateur de L’Oca Nera s’est constitué une ocathèque avec plusieurs centaines de planches. Peut-on penser que cette fièvre de la collection recèlerait comme une nostalgie des origines, « l’émotion du révolu » pour reprendre une expression de Jean Starobinski au sujet de l’écrivain Claude Simon et ses Photographies. Chez le narrateur, nostalgie et vertige de la possession ne sont peut-être pas si éloignés, et l’acte de collectionner ne répond-il pas d’ « une sorte d’exercice d’hygiène mentale », de son aveu même.
Même si le lecteur peut parfois douter quand il s’agit de différencier la fiction de l’autobiographie, il lui reste de jouer le jeu, d’avancer de case en case, d’accompagner le narrateur dans son aventure peu commune, quitte à se perdre, revenir en arrière ou rebrousser chemin, jusqu’à parcourir toutes les cases de L’Oie Noire.
Mars 2020
:- :- :- :- :- :
© Nathalie Riera
22:31 Publié dans Gérard Cartier, Les Carnets d'Eucharis, Nathalie Riera | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
20/03/2020
FRIEDERIKE MAYRÖCKER

FRIEDERIKE MAYRÖCKER
[DES ALOUETTES FOLLES QUI …]
chèvrefeuille et acajou dans l’aurore, la
rosace de tigre sur l’un des murs de la chambre qui s’effeuille,
moucheture à la fenêtre, rouge, dardant sa langue
dans l’indigo qui s’ouvre en dessous, bouffant
toupet de fleurs : calendrier coriandre.
dans un épuisement, larguée dans l’herbe, au visage
la trompette de l’ange, et comme le poing
de son propre cœur s’ouvre et se referme sur l’écran.
tourbillon saturnien et cuisine jaune, vibrants
les accessoires de la linotte.
Traduit de l’allemand (Autriche) par Jean-René Lassalle
……………………………………………………………………………………………………….
●●● [Extrait de Notizen auf einem Kamel – Suhrkamp, 1996]
15:53 Publié dans Friederike Mayröcker | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Compagnia delle Poete - LA MAISON DEHORS / LA CASA FUORI
Compagnia delle poete
___________
LA MAISON DEHORS/LA CASA FUORI
…………………………………………………………………………………………..
●●● Traduction Jean-Charles Vegliante
………………………………………………………………………………………….
pour LIRE le texte :

CLIQUER ICI

-----------------------------
[BIO-BIBLIOGRAPHIE]
La Compagnia delle poete [www.compagniadellepoete.com] est née en été 2009 à l’initiative de Mia Lecomte. Elle se compose de femmes poètes étrangères unies par la commune italophonie – Prisca Agustoni, Cristina Ali Farah, Anna Belozorovitch, Livia Bazu, Laure Cambau, Adriana Langtry, Mia Lecomte, Sarah Zuhra Lukanic, Vera Lucia de Oliveira, Helene Paraskeva, Brenda Porster, Begonya Pozo, Barbara Pumhösel, Francisca Paz Rojas, Candelaria Romero, Barbara Serdakowski, Jacqueline Spaccini, Eva Taylor – chacune avec une histoire individuelle particulière de migration, accompagnée d'autres artistes ayant travaillé dans un cadre international avec des expériences différentes. L'idée est celle d'une sorte d'"orchestre" harmonisant la poésie de chaque poète : elle s'imprègne de l'influence des diverses traditions linguistiques et culturelles à l'intérieur de spectacles où la parole est soutenue et développée par la multiplicité des langages artistiques. Étape après étape, et suivant une structure "modulaire", la formule de base sur laquelle est bâti tout spectacle de la Compagnie, se modifie et s'adapte vis-à-vis des diverses situations de performance ainsi que des différentes poètes sur le plateau. Le but est de ramener la poésie vers le grand public, en lui restituant sa fonction primitive d'oralité partagée ; mais c'est aussi donner la voix à l'écriture transnationale, la vraie avant-garde littéraire de ce siècle. La Compagnie, objet d’études et de thèses universitaires, est souvent invitée à participer à des séminaires et à des colloques académiques et littéraires, en Italie et à l'Étranger, autour de transferts plurilingues entre les littératures. Elle s'occupe également de projets collectifs de traduction de poésie contemporaine, tels que la rubrique du magazine du festival Babel Specimen*.
* http://www.specimen.press/articles/compagnia-delle-poete-translates-antonella-anedda/.
14:33 Publié dans Compagnia delle Poete | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
































































