01/10/2023
GUSTAVE ROUD - Campagne perdue - Editions Fario
Gustave ROUD
Campagne perdue
[extrait]

■ Gustave Roud (1897-1976)
■■■
---------------------------
Extrait
Postface et notes de Stéphane Pétermann
Éditions Fario, 2020.
Sursis.
La neige ne nous touche pas encore.
Un instant, sur l’épaule de la plus haute colline. Lèpre tout de suite fondue sous le doigt de pluie hors d’un nuage. On peut reprendre haleine après ce pincement au cœur — mais pour peu de temps. Quelques jours encore, et pour des mois il faudra marcher plus haut que terre, tasser du talon une poudre éblouissante, vivre au cœur d’un miroitement bleu-argent, le nez plissé, le regard mince comme une aiguille.
C’est un sursis. Tellement inespéré qu’il fait à la fois plaisir et gêne, et que le pays lui-même hésite à revivre. Trois nuits d’averses et de rafales l’ont lassé. Il voudrait dormir et il lui faut s’éveiller sous une haute lumière inexorable qui le fouille jusqu’aux glaciers extrêmes de l’horizon. Saveur de cet instant à surprendre, où le monde perd contenance. L’œil saute de l’un à l’autre de ses éléments posés devant lui en désordre. Plus de plans, une confusion de valeurs, l’absence de hiérarchie propre au désarroi. L’herbe sous vos pieds à l’inconsistance de la cendre, mais l’angle d’une forêt sur le ciel est aigu comme un coup de couteau. Un caillou va s’écraser, fruit mûr. Un buisson de fer. Plus de ressemblances pour l’esprit : des méprises. Est-ce un sombre feu qui brûle ou une touffe d’osiers ? Une lessive étendue au verger proche ou les façades d’un village au-delà de deux vallées ? Et l’épervier sur un morceau de branchages au bord de la route déploie sans hâte à notre approche sa paire d’ailes fauves, n’ayant plus crainte de l’homme dans ce monde renversé.
[…]
[Extrait : pp.36-38]
Visite du dragon
Étrange calendrier d’extrême-hiver où nichée au creux du temps, comme la perce-neige dans l’herbe morte et les feuilles pourrissantes, une journée fleurit soudain si pure qu’on ose à peine la cueillir, ivre d’un tel miracle, avec ce cœur qui recommence à battre et la sombre sève du sang sous l’écorce des tempes, aux rameaux des doigts fiévreux ! Mais la chambre de l’absolu quittée, ses poésies, ses poussières, ses pipes éternelles, on se heurte sur le seuil, tête contre tête, au jeune soleil qui allait entrer, qui vous bourre en pleine poitrine du feu de ses poings roses, les pose à vos épaules et vous souffle un éblouissant : Qu’attendais-tu ?
Voici la belle étoile des routes, le carrefour de l’amitié. Laquelle prendre ? Celle du nord vers les dragons de Chesalles et de Villarzel, le chemin d’ouest vers ceux de Chapelle ou de Saint-Cierges, l’asphalte au sud jusqu’à Forel, jusqu’au petit lac solitaire où les cimes de Savoie baignent leurs neiges entre les roseaux secs et les barques abandonnées ? J’ai choisi celle de l’est, puisqu’elle affrontait le soleil et me délivrait ainsi de mon ombre que les autres m’eussent fait piétiner sans cesse ou donnée à droite, à gauche, comme un noir double inséparable, percé de branches, déchiré par l’épine des buissons… Et parce qu’elle semblait douce au pas, humide encore des neiges d’hier, paresseuse à plaisir parmi le poil de lièvre des prairies. Et parce qu’en la suivant une couple d’heures (je le savais) jusqu’à cette corne bleue d’une sapinaie, là-bas sous le dos des montagnes en laine blanche comme des brebis de bergerie, André, je toucherais votre maison.
Mais à chaque forêt, cette route innocente sous le soleil plongeait en pleine tuerie d’arbres. Et cela je ne le savais point. Les marchands seront revenus, les poches gonflées, la bouche pleine de prix vertigineux, et derrière eux les haches de nouveau se lèvent et s’abattent, les scies recommencent à mordre, les fûts immenses à frémir, à s’effondrer en sifflant dans le fracas des branches brisées. Il faudrait s’endurcir le cœur ou détourner les yeux de ces grands corps couchés qu’on a retranchés de la vie au seuil même du renouveau, qu’on écorce, qu’on écorche, mise à nu leur chair cachée couleur de rose, couleur d’orange ou lisse et pâle comme un beurre d’hiver fraîchement battu. Il faudrait se guérir en froissant une feuille de lierre, en étendant les mains sur le sol jusqu’à les sentir becquetées au creux des paumes par la plus fine pointe des plantes perce-terre… Mon guérisseur, c’est un rameau de bois-gentil que j’ai pu rompre, avec ses fleurs de cire rose à peine ouvertes et son parfum, ce miel faux et frais où s’englue lentement la pensée. Je le tiens comme un talisman, je le hausse vers la lumière : toute la vallée devient un lac d’odeur.
[…]
[Extrait : pp.79-81]

■ © Éditions FARIO
17:23 Publié dans Fario, Gustave Roud | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
07/04/2012
Gustave Roud "... attaché à la même seule échappée" - Par Nathalie Riera
Hommage à Gustave Roud
(1897-1976)

© Photo : Fonds photographique Gustave Roud – Vucherens, 1935
(Fonds photographique Gustave Roud)
■ http://www.unil.ch/unimedia/page53151.html
« (…) cette vie menée si purement, si fidèlement, vraie vie de berger des mots, toujours dans le même champ, le regard attaché à la même seule échappée (…) »

Détail d’une photographie de Gustave Roud,
«Fernand aiguise sa faux au crépuscule».
« … attaché à la même seule échappée »
Par Nathalie Riera
________________________________________________________
■■■Les Ecrits de Gustave Roud ?
En retrait des agitations, le lecteur avance tout au long de pages qui sont autant de sentiers parcourus avec le poète qui avance lui-même en promeneur solitaire, – à l’époque, privilège qu’on eût pu lui envier ou lui reprocher et qui aujourd’hui encore ne serait pas plus acceptable – en souci de maintenir une parole qui jamais ne fait rage, alors que se poursuit la toujours plus sombre réalité que nous vivons des heures maudites de mensonges et de lâchetés, dans un monde toujours plus peuplé d’images haïssables et moribondes, et que toute poésie digne de ce nom en est que plus malmenée.
En 1985, le poète libanais Salah Stétié écrit dans son « Archer aveugle » : « Mais pourquoi la poésie intéresserait-elle ? Elle ne capte, comme eau pure une main, rien qui vaille d’être retenu si l’on n’est pas organisé intérieurement pour ce type de captage froid et brûlant.»[2] Langage égaré des poètes, selon encore Stétié, ou « langage privilégié du mal-être », avec Gustave Roud comment ensemble ne pas se jeter dans le paysage comme on plonge au plein d’une rivière, avec le désir de m’abandonner, de me laisser perdre et porter je ne sais où par une force déchaînée qui jouerait aveuglément avec mon abandon ».[3]
Dans le Journal de Vitalie Rimbaud, la sœur du poète, juillet 1873, on peut lire : « Mon frère Arthur ne partageait point nos travaux agricoles ; la plume trouvait auprès de lui une occupation assez sérieuse pour qu’elle ne lui permît pas de se mêler de travaux manuels. » Gustave Roud se rendait attentif à la vie paysanne et aux travaux des hommes dans les champs, pour avoir vécu toute sa vie à Carrouge, dans le Jorat, dans la ferme du grand-père maternel.
Bien que poésie dans sa musique agreste, poésie qui se fait conteuse de l’absolu de la solitude, marcher aux côtés de Gustave Roud, c’est écarter du ciel de l’imaginaire tout azur trop bleu, et s’écarter ainsi de toute baliverne champêtre.
« … et je vécus, étincelle d’or de la lumière nature. »[4], écrit Rimbaud, alors que chez Roud, c’est la couleur fauve de la vie et de la nature qui domine, sans leur prêter une quelconque supposition ou présomptueuse idée de Paradis ou de Terre Promise. Y voir plutôt comme un simple regard qui s’affûte sous les effets d’une certaine nostalgie, cette « nostalgie de la distance » selon Philippe Jaccottet.
Résistance d’une poésie et d’un poète qui ne se tient pas à l’écart, contrairement à ce que peut supposer toute existence contemplative, mais plutôt en souci de ne pas rompre ce lien avec l’éphémère et l’éternel. ■■■
Avril 2012 © Nathalie Riera (Les carnets d’eucharis)
-------------------------
Ecrits I
[…] Un corps nouveau, un cœur nouveau…
(Par lambeaux soudain devant ma mémoire presque abolie, le temps où ma vie tâtonnait encore parmi les hommes tout pareils à des anthologies : un corps et une table des matières. Temps des « langues mortes » - et des « langues vivantes » plus mortes que les autres. Un désert où le squelette de la poésie luisait sous le soleil des dictionnaires. L’Integer vitae chanté sur un air de choral par le vieux maître hernoute, l’avocasserie d’Euripide, Aristophane et ses danseurs agitant comme un fouet leur membre de cuir rougi, Lucrèce, fou furieux pour avoir respiré dans les fourrés de l’Hélicon l’arbre à la fleur-qui-tue… - mais déjà le veilleur d’Eschyle, le museau dans les étoiles comme un chien, me rendait d’un coup la présence du ciel nocturne, et l’Andromaque de Virgile se faisait un paradis de la tristesse. Les plus lointains, les plus vagues pressentiments réapparaissent : quand au-delà des vitres de la sombre salle où nos sept têtes sous le sifflement du gaz versaient leur ombre sur les syllabes mortes, un jet de soleil en trompe-l’œil sur de la neige tirait tout près de moi du cœur de l’hiver un faucheur de seigles, la tête dans le ciel, sa dure épaule nue huilée de lumière. Autour de lui déjà le monde s’ordonnait selon le rythme de son souffle ; la colline fléchit, remonte, quand s’abaisse et se relève tour à tour la lisse poitrine noire et dorée. Toute la ville abattue comme un château de cartes, si le jeune paysan traverse la rue, un épi de froment à son chapeau.
[extrait de « Nuit » in Essai pour un paradis, ECRITS I – p.223/224]
-------------------------
BAIN
Ta chair nue ou sous la toile toujours liée au soleil, je sais bien ce sourd désir d’eau qui jamais ne l’abandonne ! Ni la cruche en plein ciel renversée, son jet de glace au fond de ta gorge (car c’est la soif des lèvres et de la langue qu’elle apaise), ni le vent qui t’épouse comme l’ombre et meurt, sa fraîche plume fondue à ta poitrine avec le frisson du plaisir, - ni le sommeil même ne pourront rendre le calme au corps brûlé. Et pourtant qui osait braver là-haut le sommeil et son empire ? Suspendu à cette seule note aiguë qui de cent mille cris d’insectes à l’unisson célèbre le soleil, l’univers dormait. Les villages blêmes au fond de l’air bercés par le courant qui tord les routes comme des algues, le noir battement des cloches, ce peuple de cadavres dans les vergers (tu riais de l’homme aux mains mortes, Aimé, vaincu par la goutte de lumière à sa joue) – tous les sortilèges de la torpeur, de quel bond tu les brises ! Tu traverses en courant les seigles, la pente commence, et tout de suite l’ombre à ton épaule ! Le ravin s’ouvre et se referme sur le ciel. Tu descends, battu de feuilles et d’odeurs ; tes pieds aveugles tâtent le sentier sous les branches, le tuf craque, les prêles lient tes genoux. Ivresse du végétal corps à corps, espèce de cri qui sourd de ta chair heureuse, quand le soleil d’en bas brille tout à coup sous les feuilles, et que ce morceau de ciel qui est de l’eau lui chante son rassasiement et sa joie !
[…]
[extrait de « Bain » in Essai pour un paradis, ECRITS I – p.247/248]
-------------------------
Ecrits II
EPAULE
Fleurs des talus sans rosée, pitoyables au voyageur, qui le saluez une à une, douces à son ombre, douces à cette tête sans pensée qu’il appuie en tremblant contre nos visages, signes, timide appel, caresse à l’homme qui ne sait plus rien des hommes sinon ce murmure d’une voix sans lèvres et le frôlement des suppliantes ombres, vous tout autour de l’année comme une couronne de présences, la petite étoile du faux fraisier sous sa frange de neige noircie (un papillon nu s’est trompé de soleil et vacille comme une feuille morte), l’épi du sainfoin rose, la scabieuse de laine, bleue comme le regard de mon ami perdu, la sauge, la sauge de novembre refleurie et la brunelle, vous que je nomme et vous que je ne sais plus nommer, ô toi parfum du pâle œillet charitable, changeur de rêves, dénoueur des plus sombres sommeils, vous d’aujourd’hui, de cette minute même sous mon regard, campanules haletantes, humiliées, compagnes de mon ombre solitaire, consolatrices, voyez, cette ombre sur vous n’est plus seule, accueillez mon bonheur d’une heure, ne riez pas de mon bonheur ! Un visage près de mon visage, une épaule nue à mon épaule ; la fauve croupe des chevaux qui tirent, le pas des chevaux parmi les pierres, et derrière nous jusqu’aux nuages, pesante et solennelle, fleurie d’une toute petite fille, la craquante charge de froment !
Non, laisse le fouet pris au collier. Les taons suffisent, et ce soir fourmillement de mouches que je tisonne en vain d’une tige de coudre avec toutes ses feuilles. Doucement, la route est longue. Calme ce cheval fier qui est à toi et que j’aime, avec son chiffre à l’encolure (l’année où tu es devenu dragon), ses jarrets au bord de la danse et du bond ployés sans cesse, ses naseaux traversés soudain par le soleil comme une sombre rose de sang. La route est lente. A gauche, à droite, ne vois-tu pas le pays qui se penche et nous salue, debout dans sa vêture d’or ? Tout le pays debout au long de notre marche comme la foule au flanc d’un cortège, la forêt voleuse de javelles, l’auberge endormie, le chant pur des pavots de soie ! Et ces chênes maintenant qui te lancent tour à tour le même filet d’ombre aux mailles de feu.
[…]
[extrait de « Epaule » in Pour un moissonneur, ECRITS II – p.44/46]
-------------------------
[…]
J’ai relu vos phrases : La guerre crée un présent que nous n’avons pas choisi. En dehors des obligations civiques et de charité qu’il nous impose, il nous laisse tout loisir pour fuir dans la poésie ; la guerre qui menace notre vie menace ce que nous aimons le plus dans la vie : la poésie. Les poètes reprennent ainsi une singulière actualité, car jamais nous ne les aurons lus avec plus de ferveur. Voilà qui est net, et juste. Mais vous parlez de la poésie qu’on lit, donc d’une poésie qui est déjà faite, et moi, je ne puis songer qu’à celle qui va naître, et je tremble. La poésie (la vraie) m’a toujours paru être (…) une quête de signes menée au cœur d’un monde qui ne demande qu’à répondre, interrogé, il est vrai, selon telle ou telle inflexion de voix. La guerre, par ce doute atroce qu’elle installe en nous sur nous-mêmes et l’univers, ne peut que paralyser l’entretien du poète et du monde fondé sur un réciproque abandon. Que l’on se batte ou que l’on « monte la garde » seulement, la guerre nous est perpétuelle présence, et si l’on tente de l’oublier comme je l’ai fait tout à l’heure, parvenu sur le bord même de l’échange poétique, tout s’écroule soudain, sournoisement miné par cette présence niée qui se venge. L’herbe éternelle est rendue à la faux, les feuillages éternels à l’hiver, ce paysan éternel qui est mon ami redevient le soldat revenu l’autre jour en congé, qui portait encore sur sa profonde poitrine la petite plaque d’os poli où l’on peut lire :
Dragon
Fernand Cherpillod
Escadron 4
et, demain peut-être, repartira.
Je vous le jure, il ne s’agit pas de mirages ; c’est la nue et stricte vérité.
[…]
[extrait de « Lettre à Henry-Louis Mermod » in Air de la solitude, ECRITS II – p.99/101]
-------------------------
Ecrits III
CAMPAGNE PERDUE
[…]
La marche errante du vagabond sans but paraît tout de suite coupable aux yeux des hommes d’ici repris par quelque grand travail d’été comme les foins. Est-il permis, pensent-ils, de traverser les mains oisives ces prairies dont nous sommes, plus encore que les maîtres, les prisonniers ? Ils jalousent la liberté de cet homme et s’en irritent, au moment même où ils redeviennent esclaves, et les pires esclaves : ceux de l’incertain, leur moindre geste dicté par le vent ou le nuage. S’ils savaient !
[…]
[extrait de Campagne perdue, ECRITS III – p.94/95]
-------------------------
La route noire, mate ou luisante, laquée par la pluie ou liquéfiant le paysage sous le soleil comme un sombre fer brûlant, n’est plus celle de jadis où boitaient, buvant la poussière d’une lèvre sèche, les rôdeurs aux sourcils, à la moustache feutrés de farine comme des meuniers. Les fleurs d’août restent fraîches, l’herbe riveraine est pure. Mais le voyageur poursuit sur cette nappe insensible une course malaisée. Quelque chose l’isole du monde, qui ne fait plus corps avec lui. Le bleu d’acier, le violet vulgaire, le noir sans richesse que sa semelle touche sont morts. Pour toujours a disparu cette chose frémissante où posait son regard sans pensée : la route ancienne sous le gel comme une dalle de marbre où le matin versait brutalement un flots d’ombres éclatantes ; la route après l’averse, grêlée comme une peau ; la route sous l’orage de mai où l’on enjambe des flaques de pétales, neige et rouille ; la route de novembre, quand le talon crève avec un cri rauque la creuse glace des ornières ; la route qui vivait.
[…]
[extrait de Campagne perdue, ECRITS III – p.179/180]
-------------------------
Aux trois tomes des Ecrits de Gustave Roud s’ajoutent des textes publiés en revue, des traductions et la riche « Correspondance » Jaccottet & Gustave Roud 1942-1976, publiée en 2002 dans les Cahiers de la NRF.
Ecrits I, II, III
Bibliothèque des Arts, 1978
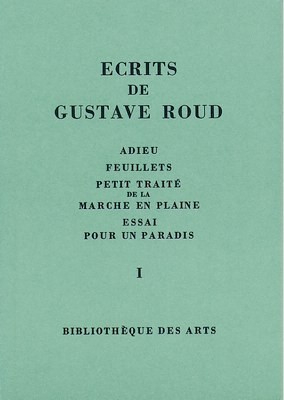
■Site Bibliothèque des Arts/http://www.bibliotheque-des-arts.com/index.php?page=Fiche&ID=12
Autres sites à consulter

Bulletin N°2, 2011
■Site L’association des amis de Gustave Roud/http://www.gustave-roud.ch/Documents_files/La%20plaine_bulletin%202.pdf
IMPRIMER

23:20 Publié dans Gustave Roud | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
































































