08/05/2021
Nicolas Bouvier - Du coin de l'oeil
Nicolas Bouvier
Du coin de l’œil
Écrits sur la photographie
[extrait]

■■■
---------------------------
Extrait
de Nicolas Bouvier, Du coin de l’œil,
in « Un voyageur qui écrit et non un écrivain qui voyage »
Éditions Héros-Limite, 2019.
« […] Lorsque je me mets en route, je n’ai aucune spécialité, je suis dilettante en tout ; j’aime la musique sans être véritablement musicologue, je fais des photographies sans être photographe, et j’écris de temps en temps sans être véritablement écrivain. Je crois que si je devais me prévaloir d’une spécialité, j’opterais pour celle de voyageur. Être l’œil ou l’esprit qui se promène, observe, compare et ensuite relate, une sorte de témoin.
Pour moi, l’écriture, c’est avant tout une façon de rendre compte de l’extraordinaire richesse que la réalité du voyage vous propose, réalité humaine, géographique. Le voyage favorise également l’introspection. Grâce à cette vie errante, on sent les changements qui s’opèrent en soi-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt, c’est le voyage qui vous fait ou vous défait. Écrire après un voyage, au sujet d’un voyage, c’est une façon de payer une dette. C’est une opération très exigeante de bonne foi et de précision.
Je réfléchis seulement quand j’écris, c’est ma méthode de pensée. L’écriture étant une occasion de réflexion totale, c’est un exercice périlleux. En écrivant, on se trouve confronté, d’une part avec la magnificence, la misère, le côté profondément comique et sarcastique de la réalité que l’on veut décrire et, d’autre part, avec l’insuffisance de ses propres instruments, l’immense océan de sa propre niaiserie, de sa propre indigence mentale. C’est donc une confrontation extrêmement humiliante, extrêmement ardue, qui fait de l’écriture un exercice que je redoute parfois, et devant lequel je jette l’éponge, je baisse les bras, je trouve des prétextes pour m’occuper ailleurs. […] » [pp.42-43]
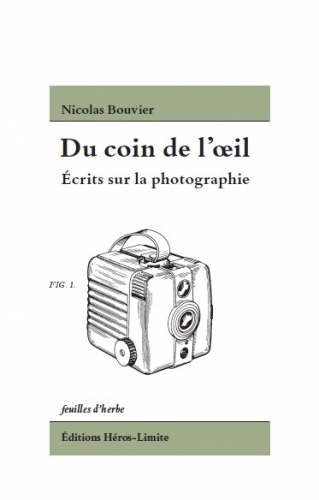
■ © Éditions HÉROS-LIMITE
21:37 Publié dans Héros-Limite, Nicolas Bouvier | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
"Ella Maillart ou la vie immédiate" par Nicolas Bouvier
Ella Maillart
Vue par Nicolas Bouvier
[extrait de « Ella Maillart ou la vie immédiate »]

■■■
---------------------------
Extrait
de Nicolas Bouvier, Du coin de l’œil, Éditions Héros-Limite, 2019.
« Depuis ses premiers exploits de « marin d’eau douce » et la lecture consternante des livres de Barbusse ou de Georges Duhamel sur l’imbécillité et la cruauté de la Première Guerre mondiale, Ella Maillart a cherché partout un peuple « vierge » que l’Occident n’aurait pas encore infecté.
L’a-t-elle trouvé au Gilgit ou au Hunza en 1935, au terme de sa longue équipée chinoise ?
L’a-t-elle trouvé bien plus tard au Népal ?
Je ne connais pas l’Inde Himalayenne, mais les photos qu’elle en a rapportées pourraient bien répondre « oui » à sa place. Ce sont surtout les visages : beaucoup expriment une chose qu’on ne trouve pas souvent en Inde : l’espièglerie, une sorte d’optimisme amusé qui suggérerait que les menaces des Dieux ne sont pas à prendre aussi au sérieux que dans le dur Tibet, ou la brûlante Inde du sud. Des effigies – le démon Râvana à dix têtes – qui devraient faire trembler ont un air bonasse et repu, avec leurs moustaches en croc qui évoquent, plutôt qu’un puissant destructeur, un coiffeur niçois ou le boucher d’une pièce de Marcel Aymé. Je trouve dans l’art népalais un côté plaisantin et rasta qui semble me dire « allons, tous ces karmas… ce n’est finalement pas si grave. »
Cet apparent manque de sérieux n’empêche d’ailleurs pas du tout les Népalais d’être de grands professionnels : de l’avis unanime des Occidentaux, leurs « sherpas » sont les meilleurs porteurs du monde, et leurs « gurkhas », malgré leur mine affable, les seuls guerriers de métier à avoir donné des cauchemars à la redoutable infanterie japonaise. Pendant la campagne de Birmanie, ils se dissimulaient la nuit, avec leur carabine de précision, dans la plus haute fourche des arbres et sifflaient. Chaque sifflement était menace et source de mort. Les Japonais en étaient malades. Pourtant les « gurkhas » ne sont ni cruels, ni sanguinaires, ils sont joviaux et d’excellente compagnie. Ils font extrêmement bien le travail qu’on leur confie ; en l’occurrence : monter dans un arbre et tirer les Japonais comme des grives.
Au Népal, Henri Michaux, cet angoissé de la précision et de la justesse, a trouvé les sourires les plus « justes » d’Asie, ni trop, ni trop peu, pas à la ronde, très précisément destinés à une seule personne. Qui dit mieux ? »
■ © Éditions HÉROS-LIMITE
21:30 Publié dans Ella Maillart, Héros-Limite, Nicolas Bouvier | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
02/05/2021
Sarah Kirsch
SARAH KIRSCH
amour de terre/erdenliebe
[Extraits]

[1935-2013]
■■■
---------------------------
Extraits
[Sarah Kirsch, amour de terre
(édition bilingue)
Atelier des livres, 2020]
Amour de terre est une anthologie qui rassemble quelques textes en prose et quelques poèmes de Sarah Kirsch, une grande voix poétique d'Allemagne, d'Est en Ouest, et de la planète en chute, née Ingrid Bernstein en 1935 dans le Harz. Les textes présentés et traduits par Marga Wolf-Gentile sont issus des recueils Étoile errante (Irrstern) et Sol mouvant (Schwingrasen). « Poète des deux Allemagnes », peut-on lire en introduction du recueil, Sarah Kirsch se définit comme « réfractaire à toute récupération et fuyant la médiatisation » : « se trouvant, après son passage à l’Ouest, au centre de l’attention sur le plan littéraire, comme public, Sarah Kirsch a montré sobriété et retenue – de la méfiance presque face à un monde qui ne lui était pas familier. Monde multiple, commercialisé, médiatisé, pressé qu’elle peut ressentir comme aliénant ».
Concernant l’édition en français de l’œuvre de la poète, on retient les publications suivantes : Terre / Erdreich, poèmes traduits et présentés par Jean-Paul Barbe, éd. Le Dé bleu, 1988. Chaleur de la neige / Schneewärme, poèmes traduits et présentés par Jean-Paul Barbe, éd. Le Dé bleu, 1993. Choix de poèmes et de prose poétique traduits et présentés par Marga Wolf-Gentile dans diverses revues littéraires dont PO&SIE (n°54, 90, 126, 165-166), Revue Alsacienne de Littérature (n°90), Les Carnets d’Eucharis (2019), Recours au Poème, Terres de femmes.
[VOYAGE II]
1
Mais je préfère aller en chemin de fer
à travers mon petit pays réchauffant
en toute saison : l’hiver me lance
des traces de lièvres des plantations de choux oubliées
par la fenêtre, je vois les ourlets des arbres nus
fin contour du branchage ils approchent
se tournent et s’éloignent de moi
2
En printemps je vois marcher le faisan
ses plumes de dent-de-lion dorées
le rendent précieux je crains pour lui
le voilà déjà disparu, terre éventrée
exhibée, obscène sur le remblai et puis
près de la maisonnette du garde-barrière, lissée
par des pensées pivoines en touffes des violettes
je vois déjà venir l’été, alors
la roue ailée sera peinte en rouge
le garde-barrière composera en pierres
de bons souhaits pour les voyageurs
3
Pauvre terre noire de suie et farineuse
belle couleur contrastée des iris qui bleus
et avec des pétales de soie veinées
se dressent au dernier soleil, cela passe
d’autres images tournent le train est si lent
que je peux désigner les plantes par leurs noms
des robiniers ici du blanc et vert vaporeux
ou est-ce sur les feuilles-monnaie posée la poussière de l’usine à chaux
4
Le voyage s’accélère vers le bord de mon pays
je vais à la rencontre de la mer des montagnes ou
que d’un fil de fer blessant qui traverse la forêt, là-derrière
les gens parlent bien ma langue, connaissent
les complaintes de Gryphius comme moi
ont les mêmes images dans leur télévision
mais les mots
qu’ils entendent, qu’ils lisent, les mêmes images
seront à l’encontre des miens, je ne sais ni vois
de chemin qui puisse mener mon train haletant
à travers le fil de fer
tout devant bleue la locomotive Diesel
---------------------------
[UNE PRUNELLE DANS LA BOUCHE JE PASSE PAR LE CHAMP]
Une prunelle dans la bouche je passe par le champ
Elle roule sur la langue bute contre les dents quand je marche
Ma tête un grelot résonne et fait
Une triste bouche
la mienne avec une prunelle
La tienne sable déjà et galet
Moi dessus toi dessous
Grains de sorbier sur le chemin, rouge sang rouge velours
Mangez les grives mangez
Faites de la graisse tout le long de l’automne
2/9/66
---------------------------
[FUMETERRE]
Et à certains moments il arrive
Que très heureux de
Quelque chose une nouvelle
Le nouvel amant l’enfant
Nous déambulons prenant alors plaisir
Au travail le plus monotone nous cuisinons
Des plats merveilleux nettoyons les fenêtres
En chantant embrassons la fleur
Qui vient juste d’éclore
Sur le buisson devant notre porte parlons
À des inconnus de l’autre côté de la rue
Sans nous occuper du soleil
De la neige légère qui danse
Tout est connu et familier
Ce sera toujours ainsi croyons-nous
Et même les affreuses images
Dans les postes de télévision nous confirment
Qu’ici au moins ça restera toujours ainsi nous entassons
Les journaux qui nous laissent dormir tranquilles
Soigneusement jusqu’à ce qu’on vienne les prendre
Nous sommes tous vivants sautons et dansons
Dans les demeures meublées de la mort.*
* Allusion à un titre du recueil de Nelly Sachs In den Wohnungen des Todes (Dans les demeures de la mort) apparu en 1947 en souvenir et hommage à ses congénères exterminés.
17:54 Publié dans Marga Wolf-Gentile, Sarah Kirsch | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Sophie Brassart
Ardentes patiences
[Extraits]

■■■
---------------------------
Extraits
[Sophie Brassart, Ardentes patiences
Éditions du Cygne, 2021]
Chant circulaire de la tourterelle
Pareil à ce rire
jeté de femme en femme
Maintenu à la frondaison du lavoir
Suspendu à sa propre nudité
Calme de l’haleine
Au milieu du temps immobile
Sur les dalles de la voie romaine
Sur les herbes et cailloux aveuglants
Que faisons-nous
---------------------------
Ceci je veux le partager :
Gorge
Vierge dans la chaleur des mûres
Velue la patte de l’insecte
Doigt d’une genèse invisible
Percée du ciel en crêtes de fer,
fifres noirs
Voici que la montagne se couvre d’ombre
Couvre notre existence
d’une aura sans finir
---------------------------
Un bosquet s’élance – à même l’ombre
Le bleu immense – depuis quelque temps
J’écoute le revers des feuilles
C’est maintenant que je connais l’indicible
Un bosquet s’élance et tresse
les liens du corps avec l’esprit
& nous saluons le vin
Pour éluder la mélancolie nouvelle
---------------------------
Je me suis assoupie, comme gorge tremblée
Le lilas de ma naissance, toute trace
Majestueuse par la zébrure du fleuve
Est-ce le rêve qui enseigne l’ombre
Mon regard se découd :
Libre de l’air et des insectes,
Venus pour qu’il devienne
air, insectes
------------------------------
| BIO-BIBLIOGRAPHIE : Sophie Brassart, poète et plasticienne, vit à Montreuil. Elle a publié un premier recueil en 2018, Combe, aux éditions Tarmac, puis en 2019, Je vais, à la mesure du ciel, aux éditions du Cygne. Elle a réalisé une fresque regroupant vingt visages de poètes contemporains exposée de manière pérenne à l’Université de Caen.
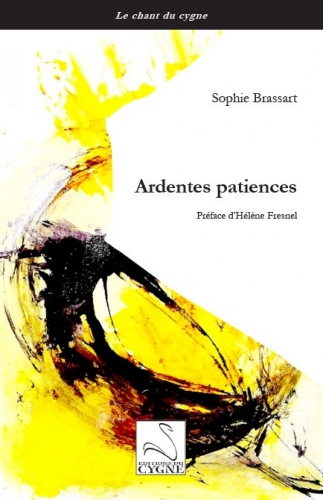
■ © Éditions du Cygne
14:40 Publié dans du Cygne, Sophie Brassart | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
01/05/2021
Julien Gracq
JULIEN GRACQ
Carnets du grand chemin
[Extraits]

[1910-2007]
■■■
---------------------------
Extraits
[Julien Gracq,
Carnets du grand chemin
José Corti, 1992]
« Route de Sallertaine à Soullans, bordée, le long de ses fossés, d’un liseré continu de saules et de tamaris au léger et tremblant plumage. Un frais et fort coup de vent de mer les met en émoi, fouaille et fait écumer la masse mobile, verte, rose et argenté ; c’est l’heure de la marée haute sur la côte toute proche, il est six heures du soir ; un soleil neuf, dans le ciel décapé par le coup de vent, étincelle sur les charrauds, les bourrines blanches et vertes, le feutrage fauve du marais rissolé : tout est lumière et mouvement, limpidité saline, entrain rustaud, bousculade allègre, crinières secouées à plein poing et retroussis de linges. C’est canonnade de fête tout le long de la côte, et toute la campagne, rubans au vent et feuilles à l’envers, l’accompagne à cœur joie de ses danses pataudes, et jette son bonnet par-dessus les moulins.
Je me sens toujours animé d’une espèce d’allégresse, quand je me trouve sur la route à la fin d’un de ces grands coups de vent d’ouest criblés de soleil qui marquent de leur signe sur toute une province la journée époumonée, et auxquels chaque canton, chaque paysage, imprime son timbre et son orchestration singulière, fastueuse ou modeste : on traverse ces jours-là la campagne comme on traverse les villages un jour de quatorze juillet. » [pp.24-25]
---------------------------
« Le parc de Saint-Cloud, veuf de son château, avec ses avenues convergeant vers le vide, sa perspective étagée qui cascade avec ampleur de palier en palier jusqu’à la balustrade suspendue au-dessus de la Seine, rameute à lui seul dans mon imagination toutes les étoiles de routes désaffectées qui, toujours, m’ont parlé dans la langue même des Sirènes. Routes qui ne mènent nulle part, perspectives inhabitées qui ne donnent sur rien, comment ne pas voir qu’elles sont sœurs de ces pièces vides, pleines de gestes fantômes et de regards que nul ne renvoie, dont la vacuité centrale a trouvé place malgré moi presque dans chacun de mes livres ? Il peut se rencontrer pourtant une singularité paysagiste plus rare encore. Dans le site peu connu de la Folie Siffait, proche de la Loire et du petit village du Cellier, site que Stendhal, et, je crois bien, George Sand ont visité au siècle dernier, partout des escaliers en impasse, des échauguettes, des belvédères sans panorama, des pans de courtine isolés, des soutènements pour jardins suspendus, des contreforts qui semblent épauler au-dessus du vide le mur de fond d’un théâtre antique, renvoient, sous l’invasion des arbres, à l’image d’un château non pas ruiné, mais éclaté dans la forêt qu’il peuple partout de ses fragments : si jamais l’architecture s’est manifestée sous la forme convulsive, c’est bien ici. Pourtant, tant de préméditation dans l’étrange rebute un peu : il manque, dans cette matérialisation coûteuse et un peu frigide — sur plans et sur devis — de la lubie d’un riche propriétaire désaxé, la pression du désir et la nécessité du rêve qui nous émeuvent dans le palais du facteur Cheval. Ce qui me ramène quelquefois sous les ombrages aujourd’hui très ensauvagés de la Folie-Siffait, c’est plutôt une projection imaginative terminale : j’y vois le prolongement en pointillé et comme le point ultime de la courbe que dessine, depuis la fin du Moyen Âge, l’alliance de plus en plus étroite nouée avec la pelouse, le bosquet, l’étang et l’arbre, par l’art de bâtir : j’y déchiffre comme le mythe de l’Architecture enfin livrée en pâture au Paysage. » [pp.58-59]
---------------------------
« […] L’arbre… Il n’apparaissait d’abord qu’au fond des vallées, dans les files de peupliers qui pacageaient leurs prairies molles, ou bien par intervalles, dans le lointain du plateau, un bouquet de noyers appuyant leurs branches basses sur les clôtures de pierres sèches d’une cour de métairie. Maintenant — comme une foule sortie on ne sait d’où qui s’agglomère en grappes — d’abord posté de loin en loin en sentinelle, il accourt de partout vers la route que vient reborder peu à peu de chaque côté une fourrure luxuriante d’herbe verte. Non plus le noyer grêle aux feuilles claires, mais le châtaignier vert sombre, piqué de rosettes d’un vert plus jaune, dont l’ombrage est si lourd, et le massif de feuillage si compact. Et, de toutes parts, gardés par ces hautes tours vertes, s’étalent non plus les chaumes secs et les éteules roussies du Poitou, mais de profonds étangs d’herbe, enclos entre les berges des haies, chambres de verdure secrètes qui s’imbriquent et s’entr’rouvrent indéfiniment l’une sur l’autre, pelucheuses, moelleuses, encourtinées, et d’où l’haleine des plantes confinées déferle sur la route aussi intime et entêtante que la touffeur d’une alcôve. Ce n’est pas la forêt, clairement délimitée, avec l’aplomb de sa muraille nette et l’avalement brutal, en coup de vent, de la route par sa haute tranchée noire — ce n’est pas le bocage aux haies de ronciers plus épaisses et plus maigres — c’est un enfièvrement congestif du monde des plantes, qui monte, gonfle et s’amasse peu à peu des deux côtés de la route comme un orage vert. Les branches s’avancent au-dessus de la chaussée et y dégorgent lentement, goutte à goutte, l’eau lourde de la dernière averse : au-dessous d’elles, le long des bas-côtés où s’épaissit l’herbe vorace, les paravents des haies ferment toute issue au regard ; le bourrelet tremblant des fougères vient onduler jusqu’à l’asphalte. On se laisse couler comme au cœur d’une eau verte et lustrale dans l’énorme respiration calme : nulle forêt noire, dans sa plantation ligneuse, son odeur de cave et de fagot, ne se referme sur le promeneur aussi voluptueusement que ce bain de plantes fermé comme une voûte, duveteux comme une mousse, qui comble et étanche en nous quelque chose de plus ancien que la soif. Très loin au-delà de cette déflagration de verdure qui monte sur la terre et gonfle ses ombrelles vertes, il y a une grande ville, mais son existence même s’embrume, et ce n’est pas vers elle qu’on marche : on monte, on voudrait continuer à monter interminablement vers ce haut pays de la verdure arborescente, à travers laquelle filtrent maintenant les barreaux horizontaux du soleil, où rien ne frappe plus l’oreille que le craquement solennel des branches chauffées, et où on croit entendre quelquefois l’arbre respirer. […] » [pp.67-69]
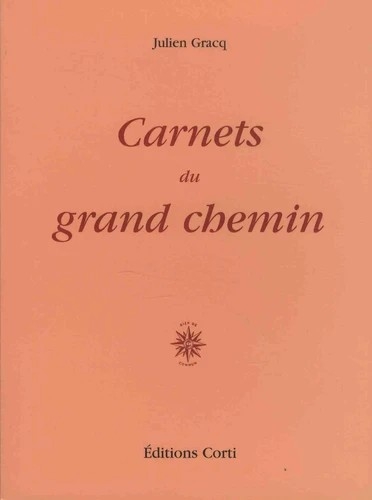
■ © José Corti
18:48 Publié dans José Corti, Julien Gracq | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Pascal Boulanger
L’intime dense
[Extraits]

■■■
---------------------------
Extraits
[Pascal Boulanger, L’intime dense
Éditions du Cygne, 2021]
Le savoir où l’on meurt
mais la ferveur qui vaut de l’or ?
& la rivière sur le chemin du soleil ?
& l’esprit d’enfance dans la chevelure forêt ?
Le promeneur qui marche sur la baie
tient la main de l’aimée
même absente.
---------------------------
Proche
insaisissable
en épiphanies qui brûlent.
La présence d’un ciel
dans l’éclat de ces yeux
fera-t-elle retour ?
Dans l’attente parmi
les oiseaux bavards de l’aube
qui signe & veille
sur les montagnes du temps
chose nouvelle ; amour ?
---------------------------
Comment se vivre autrement
au soleil couchant
quand l’écart assaille.
Sans sommeil
l’effrayant désir
entre l’herbe & le ciel
vers les yeux
commence à voir
& glisse
jupe cambrée
à la courbe,
une fenêtre, l’univers
dans la main.
---------------------------
Franchissement plein amour
qui fait présence ne manque
aux roses qui se tiennent nues.
Au toucher doux rêche
la chair des fruits ruisselle
sur une table.
Désir présume comme
un enfant joue seul
sans souci de rien
& goûte à la volupté
nouvelle du monde.
------------------------------
| BIO-BIBLIOGRAPHIE : Pascal Boulanger, né en 1957, a été bibliothécaire en banlieue parisienne. Il vit en Bretagne, près du Mont Saint Michel, depuis mars 2019. Il a publié des articles et des chroniques dans de nombreuses revues littéraires. Parmi ses derniers livres – recueils ou essais – Guerre perdue (Passage d’encre), Mourir ne me suffit pas (Corlevour), Jusqu’à présent je suis en chemin, carnets 2016-2018 (Tituli), Trame : anthologie 1991-2018 suivie de L’amour là (Tinbad).
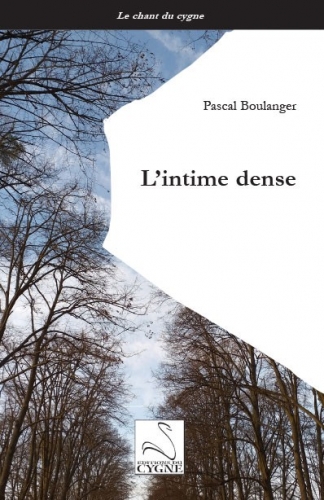
■ © Éditions du Cygne
17:26 Publié dans du Cygne, Pascal Boulanger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
ANNE-EMMANUELLE FOURNIER
La part d’errance
avec six gravures de l'artiste Régis Rizzo

■■■
---------------------------
Extrait
[Préface de Jean-Yves Masson]
Dans une célèbre conférence sur la poésie, Hofmannsthal compare le poète à un sismographe. Ce texte de 1907 s’intitule « Le poète et l’époque présente » et j’y ai songé en lisant La part d’errance d’Anne-Emmanuelle Fournier, où s’exprime avec une sensibilité vibratoire l’inquiétude de notre temps face à la coupure de plus en plus prononcée entre l’homme moderne et la nature, en même temps que s’y donne à lire une quête pour retrouver les chemins perdus de la transhumance vécue comme expérience spirituelle, ce ressourcement périodique au sein des forces naturelles.
■■■
---------------------------
Extrait
[Anne-Emmanuelle Fournier, La part d’errance
Éditions Unicité, 2021]
Regarde
regarde encore dans le visage du cheval
entends venir l’orage de très loin
et retrouve
ce consentement sans réserve à la loi du monde
de celui qui n’a pas mangé le fruit anguleux
de la connaissance
De celui qui n’a pas déserté les liens
ne s’est pas contemplé nu
dans une mortalité que plus rien ne rachète
Si les étoiles refusent de répondre
si Dieu même est béance
dans les eaux renversées du ciel
Comment croire à ce sol où nous tentons de planter
un chemin ?
Il faudrait bien oser une sorte de foi…
Quelque chose comme l’espérance des chats
qui attendent postés sur les seuils
dans l’ascèse de l’aurore
Et la voix pleine des vivants
où réchauffer nos mains.
Ceux qui mènent les chevaux boire
comme à une très ancienne offrande
en surplomb de ces tours
— qui sont pour les oiseaux
ce que sont pour nous les cités d’insectes
excavées dans les flancs de la terre —
Ceux-là qui se tiennent même cernés de béton et d’acier
tout contre la pulsation des troupeaux
sont-ils encore porteurs de la promesse
d’une alliance possible
avec tout ce qui naît puis s’érode
dans l’entropie des particules ?

■ © Éditions Unicité
16:12 Publié dans Anne-Emmanuelle Fournier, Unicité | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
































































