23/02/2023
DE SON VIVANT - Un film d'Emmanuelle Bercot
11:56 Publié dans VIDEOS, ANIMATIONS, DOCUMENTAIRES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
18/02/2023
Ç’AURAIT ÉTÉ MIEUX SI J’ETAIS RESTÉE EN HONGRIE - par Nathalie Riera
Hommage à Agota kristof
— texte composé en vers libres
© Nathalie Riera, février 2023

23 octobre 1956 : Budapest se soulève au nom de la liberté
Ce sera la première insurrection armée contre un régime communiste
Le peuple refuse la tutelle soviétique
Une statue de Staline est renversée
Le 4 novembre 1956 : plus de 1500 chars frappés de l’étoile rouge déferlent sur la capitale
La ville est sous le feu de l’artillerie et de l’infanterie
« Des chars, du sang, la liberté confisquée » !
Les civils se battent pied à pied
Et malgré que les obus tombent et que le pays s’enflamme
Les occidentaux vont rester l’arme aux pieds !
Il faut dire que Français et Britanniques se trouvent, au même moment, empêtrés dans une opération militaire sur le Canal de Suez
L’ancien Premier Ministre János Kádár est placé au pouvoir
La répression fait plus de 20 000 morts tandis que 200 000 hongrois se réfugient en Europe de l’ouest.
Agota Kristof a 21 ans en cinquante-six
quand l’exil la conduit jusqu’en territoire francophone.
S’enfuir de la petite cité médiévale de Köszeg
– qui se trouve à quelques pas de la frontière autrichienne.
Fuir à travers bois, la nuit, avec mari et nourrisson,
passer les gardes-frontières occupées par des Russes,
avant de poser pied à Neuchâtel, en Suisse romande.
Perdre un pays et tout ce qui pouvait l’y rattacher ;
parmi les autres pertes, ses manuscrits écrits en hongrois :
des poèmes de jeunesse – elle écrit depuis ses 13 ans.
Les aléas de l’Histoire lui font adopter le français,
mais plus que de l’adopter, le français sera pour elle :
affronter une langue qui est en train de tuer sa langue maternelle.
Agota Kristof parle le français mais ne le lit pas.
Ses premiers textes écrits en français sont des pièces de théâtre.
5 ans après son arrivée en Suisse elle affirmera
être « redevenue une analphabète »… L’analphabète
est un récit autobiographique paru en 2004.
Sur ce roman Agota est sans complaisance aucune ;
elle dit regretter d’avoir publié L’analphabète : (14)
« C’est pas de la littérature, c’est du mauvais journalisme ».
La ville de Köszeg est au centre de ses trois romans :
Le Grand Cahier, La Preuve et Le Troisième Mensonge.
L’écriture ne pouvant assurer ni vivre ni couvert,
Agota travaille dans une manufacture horlogère,
toute la journée chez Ebauches SA à Peseux,
et le soir elle écrit des poèmes en hongrois et français.
Si l’exil provoque un besoin compulsif d’écrire,
pour Agota : « Il faut du courage pour écrire certaines choses ».
Aussi survivre aux douleurs multiples du déracinement.
Mais comment traduire l’exil avec la langue de Voltaire,
cette « langue ennemie » qui deviendra pourtant langue d’écriture ?
Agota Kristof abhorre les sensibleries littéraires.
Pour elle, pas de place aux mensonges des sentiments et des mots.
S’en tenir aux faits. Aller à l’essentiel. Seulement ça.
Elle « regarde souvent les cartes postales de Köszeg »[1],
elle n’aurait jamais dû quitter la Hongrie. « Si j’avais su
que je resterais toujours, je ne serais pas partie. Oui,
je regrette ce choix. » « Hier tout était plus beau… ». Oui.
« … la musique dans les arbres
le vent dans mes cheveux
et dans tes mains tendues
le soleil »[2].
Agota Kristof arrête d’écrire en 2005.
Sa machine à écrire, son dictionnaire bilingue hongrois-français,
puis ses manuscrits de romans et d’œuvres théâtrales
seront vendus aux Archives littéraires suisses, à Berne.
Elle meurt le 27 juillet 2011 à Neuchâtel.

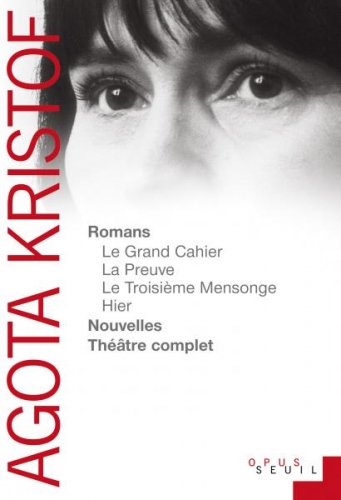
[1] Claire Devarrieux, Libération, 5 septembre 1991.
[2] Agota Kristof, Hier, in Opus Seuil, 2011.
19:42 Publié dans Agota Kristof, Nathalie Riera, SUISSE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
12/02/2023
Guennadi AÏGUI
Guennadi AÏGUI
Sommeil Poésie Poèmes
[extraits]
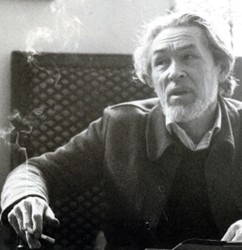
Guennadi AÏGUI
■■■
---------------------------
Extraits
ÉDITIONS SEGHERS/AUTOUR DU MONDE – 1984.
Traduit du russe par Léon Robel
« il était comme une clairière le pays
le monde – comme une clairière
et il y avait des bouleaux-fleurs
et un cœur-enfant
et comme ces bouleaux-fleurs étaient par le vent de ce monde soufflés
et des roses-neiges
entouraient comme d’anges-mendiants le soupir
des sans-parole villageois !... et avec leur Lumo-Pitié
ensemble
illuminaient
/ ici – lieu d’un silence
aussi long
que l’infini de leur vie /
nous nous appelions – de Cette Lueur maints
chacun renforçant
la vivante luminescence
secondement dans la douleur
/ ici aussi
même
silence /
et étions écoutant : que dira la pureté d’un mot unique ?
sans cesser
rayonnait :
le monde-pureté »
1975
Extrait de « O OUI : PATRIE » – p.9.
***
à M. Roguinski
« Un champ parsemé de journaux ; le vent les emmêle (il n’y a ni début ni fin). J’erre tout le jour, examine avec attention : le titre est partout le même (et même l’oubli : j’oublie et j’examine – le temps passe : impossible de me souvenir) ; avec le même portrait partout (et de nouveau, l’oubli). Où suis-je ? où dois-je revenir ? Vent ; absence de routes ; froissement de papiers ; la Terre entière n’est que ce champ ; ténèbres ; solitude. »
1979
Extrait de « GOUACHE » – p.101.
***
« et quelque part
se tient jusqu’à ce jour
une petite femme
et quelqu’un transporte – en ses yeux indifférents – comme des cercles de soleil
le scintillement mauve de sa robe
et entre ses épaules et les miennes entre son cou et le mien
entre mes manches et ses manches
il y a l’herbe poussiéreuse les rails chauffés à blanc
et les rochers brûlants
des villes et des monts
mais à part moi nul ne sait
comme sont chauds ses coudes là-bas dans la manche
et quelle particulière
vulnérabilité de la démarche se dissimule
en cette station
frêle-penchée
– et il n’y a rien de plus audible que le silence
de plus fidèle que la douleur de plus clair que l’angoisse !
et longtemps encore le séjour longtemps
dans le monde le séjour longtemps / rien ne parvient jusqu’au sens « depuis longtemps » /
et vivante sur la terre
elle n’a pas encore quitté les hommes
quelque part elle se tient à présent aussi
la petite femme vêtue d’une robe rouge
– et il n’est rien de plus infini que la fin
et les buissons mauves de l’euphorbe
s’agitent la salissant de poussière du chemin
jusqu’à la ceinture
et ils deviennent plus hauts et plus larges
et plus éclatants que sa robe »
1958
Extrait de « PROLONGEMENT DU DEPART » – pp.133-134.
***
[…] Ce qu’écrit Aïgui ne ressemble à rien de connu en Russe. C’est une sorte de synthèse organique entre trois traditions très différentes : l’avant-garde russe poétique et picturale du XXe siècle (Malevitch est pour Aïgui une référence privilégiée), la poésie française moderne et la culture populaire tchouvache. La syntaxe en est souvent désarticulée, de manière à offrir plusieurs possibilités d’interprétation simultanées et à dire en même temps les difficultés de la communication en notre temps. Les images souvent surgissent des tréfonds de la mémoire. La ponctuation très personnelle permet par les trait d’union des coagulations ou cristallisations de sens (plusieurs mots se fondent en un seul) tandis que les tirets, les point d’exclamation marquent des brisures et des envols du rythme. Des néologismes parfois apparaissent comme de nouvelles évidences de la pensée ; des rimes ou des mètres réguliers enfouis ou démontés et reconstruits sont des indices de l’immense travail sur le système de versification accompli par Aïgui. Ce qui est à l’œuvre ici c’est véritablement une « pensée rythmique » qui, par son mouvement même, nous porte vers la saisie de son objet. Ce qui fait que le mouvement rythmique est inventé pour chaque poème. […]
Extrait de « DU TRADUCTEUR AU LECTEUR… » par Léon Robel – p.157.
■ À CONSULTER:
En attendant Nadeau : Aïgui le simple par Odile Hunoult : CLIQUER ICI
Les éditions Mesures : CLIQUER ICI
Les éditions Circé : CLIQUER ICI
L’anthologie permanente de Poezibao : CLIQUER ICI
17:12 Publié dans Guennadi Aïgui, RUSSIE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
Anne-Emmanuelle Fournier
Une lecture de Gaël de Kerret
___________________________________
Anne-Emmanuelle Fournier
L’OFFRANDE AUX FANTôMES
SUIVI DE
Il y a longtemps que je t’AIME
[Editions Unicité, 2022]

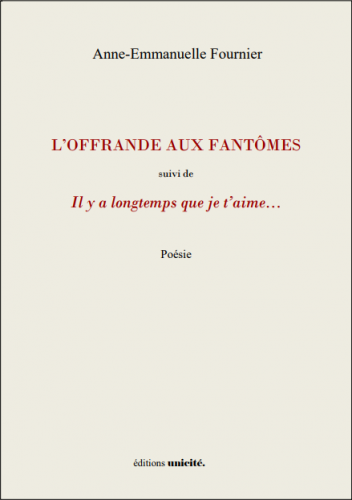
■ © Anne-Emmanuelle Fournier
Commençons, peut-être, par interroger ce double titre. La seconde partie est-elle vraiment un ajout ou une suite ? En réalité, j’ai ressenti cet ouvrage comme un chiasme, dont l’inclusion centrale est un poème isolé qui a pour rôle de transformer toute l’aspiration de la première partie en Réalisation finale.
Il est aisé de rentrer dans la première partie : ces « carrés » de prose nous placent dans une géographie par le mot. Le mot fait l’espace. Le lecteur s’y rend comme si c’était aussi un peu le sien. Les phrases sont courtes, prévenant toute tentation discursive. Ne reste que le primat de la sensation, comme un envol de l’initiation de l’auteure vers la science des vivants.
Le mot, disais-je, détaille la géographie, mais il détaille aussi les bruits quotidiens, non comme une lassitude potentielle, mais comme le sentiment d’un trésor qui est encore questionnement. Ces bruits sont entendus sans tout-à-fait être dans l’Entendement, en cohérence avec la conscience d’un sujet encore enfant au début de ce livre.
Le lecteur reste alors bouche bée devant ce que l’auteure/jeune fille appelle pudiquement « le vieil homme » qui lui enseigne tout, mais « ne reparaîtra plus ». Cet homme vieux de deux millions d’années – comme l’écrivait Carl Gustav Jung – parle la langue des oiseaux, car les Anciens transmettent non ce qu’ils disent, mais ce qu’ils sont. Puis vient l’impressionnisme de l’été. Tourisme nostalgique maintes fois réitéré en littérature ? Sauf que des mots tels que « la piscine municipale » nous empêchent résolument de fuir vers le faux et enterrent tout embourgeoisement du discours. Et l’on se demande si l’exactitude des mots ne cache pas une aspiration qui ne peut encore se dire.
Cependant, la petite fille grandit et veut prendre sa place dans ce monde. L’état de tension entre le bruit banal et l’homme vieux de mille ans ne cache plus qu’un sens de vie est en train de se constituer. Cette question du Sens est prégnante dans ce livre. Depuis que Copernic nous a dit que la terre n’était plus au centre de l’univers, l’homme baroque, avec Caravage, est devenu ombre et lumière se posant la question du sens de sa présence dans l’univers. Alors, dans la nuit qui est forcément nuit éveillée, l’adolescente cherche à découvrir la lumière qui habite les ténèbres. Même la pluie qui affole les 'raisonnables' est pour elle l’expression de la liberté « qui ruisselle par tous les pores de la nuit ». D’autres nuits, il y a même des étoiles dans cette marche que jonchent tant d’obstacles. Ces étoiles sont la métaphore du chemin « vers une source ». Elle sait la source, mais elle ne la connaît pas. Ce sera dans le quotidien du mot que se recueillera le sens : « Une pliure du multivers où tu réponds au téléphone, sarcles tes parterres ». On trouve en ce processus les trois acceptions du mot sens en français : sensation, direction, signification ».[1] Pour François Cheng, on glisse alors subtilement vers le Yi puis le Yi King comme « accord, entente communion ». Pour l’auteure en quête d’initiation, c’est là le plus important. Elle voit l’agitation des touristes, mais « rien de tout cela ne parvient jusqu’au ventre de pénombre de la maison, où la grand-mère attend. »
Puis la femme advient dans son statut d’adolescente, qui parvient à s’aimer par le tissu enveloppant son corps, donnant au « rêve de soi » la beauté exemplaire. À cet âge, parce qu’elle a pris l’univers comme amant, elle sait ce que veut dire : « partager un plat odorant à l’ombre d’un platane », avec les « valides et les fracturés ».
Fracturés ? Quand il lui est donné de voir les morts malgré tout, les rôles sont étrangement renversés : ce sont les vivants les crucifiés. Preuve en est : son lieu de visions, d’odeur et d’intangible, son topos de la Lumière spirituelle est dorénavant une pancarte : À vendre. Oui, les choses passent, mais la Lumière n’est pas à vendre. Les armoires, les lits sont médusés face à ce qui va être leur drame absolu, mais l’enfant d’autrefois s’approche du piano pour un dialogue avec les morts car elle sait « qu’ils rêvent ». Soudain monte en elle l’exigence d’une décision. La méditation doit faire place à la résolution, sous peine de rejoindre ces morts.
Cette résolution est le Kaïros du livre : ce poème adressé directement à l’homme de sa vie avec qui elle va pouvoir exercer chez elle, pour elle, toutes les visions recueillies de l’enfance. À cause de cette métanoïa du chiasme, il fallait changer d’écriture. Ce sera donc de la poésie (librement) versifiée, dans laquelle le mot isolé est roi de prophétie, parce que l’auteure sait que la poésie est création au sens du poïein grec. En 1951, le philosophe Martin Heidegger commente ainsi ce que devrait être la poésie :
« Poétiquement habite l’homme sur cette terre. Dans quelle mesure l’homme habite-t-il poétiquement ? S’il habite ainsi, c’est qu’il parle... que pouvons-nous faire pour sauver le Poème de son manque de pays ?
Libérer la poésie de la littérature, c’est une chose.
Il faut sauvegarder la terre dans son intouchable source à partir du Haut-jeu entre les divins et les mortels, pour ce jeu même. » [2]
C’est ainsi que je définirais la poésie d’Anne-Emmanuelle Fournier : mots rendant sacré le quotidien, sacrés les changements de statut de l’enfant né à la vie, mots qui donnent la verticalité du « Haut-jeu entre les divins et les mortels ». C’est un quotidien semblable à l’épi de blé surgissant de terre, porteur de tant d’archétypes immémoriaux. Renversement ici encore : dans cette partie placée sous le signe de la chanson traditionnelle À la claire fontaine, c’est l’enfant qui enseigne : « cet amour est plus grand, plus ancien que tout ce que je crois être ». Il enseigne par le « désir de parole », écrit l’auteure, et non par la « langue domestiquée ». En archê ên o logos : à l’origine était la parole, écrit le Prologue de Saint Jean. Et du côté de la fin, les rêves montrent que l’âme continue son travail, que la Lumière continue son travail malgré l’extinction de la forme, ce que l’auteure dit par ces mots : « Lorsque le temps aura dissout mon nom sur mes propres lèvres ».
Chacun des poèmes de ce dernier temps du recueil commence par « Je pourrais vivre ». Cette anaphore m’a rappelé la structure du poème « Liberté » de Paul Éluard, extrait de Poésie et Vérité et par exemple fiévreusement mis en musique par Francis Poulenc dans Figure humaine. L’apostrophe d’Éluard résonne : j’écris ton nom, j’écris ton nom, j’écris ton nom : liberté ! On peut penser qu’Anne-Emmanuelle Fournier, qui témoigne en réalité d’une double mise au monde, pourrait faire sienne cette déclinaison : mon enfant-liberté, j’écris ton nom.
[1] François Cheng, Cinq méditations sur la beauté, Albin Michel, 2006, p.35
[2] Revue Obsidiane, « Heidegger » 1982, p. 145. Cette prise de parole prend place lors d’une lecture de poèmes à Bühlerhöhe, ville d’Allemagne près de Baden-Baden.
12:51 Publié dans Anne-Emmanuelle Fournier, FRANCE, NOTES DE LECTURES/RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook
































































