Nicolas Bouvier, Oeuvres (une lecture de Nathalie Riera) (16/04/2014)
Hommage àNicolas Bouvier
(1929-1998)

© Photo : Nicolas Bouvier dans les années 1950 (Keystone)


(SUR LE SITE DE THIERRY VERNET)
■http://www.thierry-vernet.org/
« (…) Nous avons tous une boussole dans la tête, plus précieuse que l’or des Incas. » Nicolas Bouvier [1]
« Un voyage, fût-il de mille lieues, commence sous votre chaussure. »Confucius
« Incantation de l’espace, décantation du texte
ou être un miroir promené le long d’une grande route »
[[2]]
Par Nathalie Riera
________________________________________________________

« Le déplacement dans l’espace peut être un sésame pour certains… »
■■■
Voyager c’est avoir une certaine passion. Chez Bouvier, c’est avoir « la passion des points cardinaux », et parmi les 4 points, sa première direction sera le Nord, en lien avec ses premières lectures d’enfant. Un premier départ, durant l’été 1948, pour la Finlande, Helsinki… jusqu’en Laponie. Il survole le pays des 60 000 lacs. Le Nord lui fait signe de bonne heure ! : « … à sept ans je dessinais de l’ongle sur le beurre de ma tartine le cours de la Volga ou celui du Haut-Orkon, je savais fendre au couteau les naseaux d’un cheval pour qu’il galope encore dans l’air raréfié par le blizzard, et claquais de la langue pour stimuler les onze chiens de mon traîneau. » ([3])
Faut-il croire que voyager c’est retrouver un chez-soi ? De la Laponie à Paris : « Helsinki, Turku, Abo, c’est des endroits où je me sentais chez moi, encore plus en Laponie parce qu’il n’y avait personne, ici je me sens rudement « chez les autres » et il y a trop d’autres. » Une vie de voyages ne peut que répondre à un projet personnel. Nicolas Bouvier rendra compte du monde, de son usage du monde. Mais la disposition, autant physique que mentale, du « vivre ailleurs », et le goût à une vie itinérante, ont aussi leur genèse dans la constellation familiale. Le père, polyglotte « grand érudit et sourcier des grimoires », est directeur de la Bibliothèque universitaire de Genève, et il n’est pas inutile de préciser que la complicité père-fils jamais démentie s’avère comme un puissant pilier pour le « gamin bouffeur de livres à la chandelle clandestine ».
« … j’avais eu mes éblouissements : London, Rimbaud, Melville, Michaux, mais le véritable goût des mots m’est venu lorsqu’il a fallu les choisir, durs, lourds dans la main, polis comme des galets pour enluminer mes modestes icônes avec l’or, le rouge, le bleu qui convenaient, et pour tenter de faire du spectacle de la route un de ces Thesaurus Pauperum à majuscules ornées d’églantines et de licornes… » ([4])
Faire l’apprentissage de l’état nomade, regagner les vastes champs magnétiques, accéder à d’autres lieux « où les choses les plus humbles retrouvent leur existence plénière et souveraine », né le 6 mars 1929 au Grand Lancy, près de Genève, Nicolas Bouvier souligne, contrairement aux idées reçues, la manie de l’expatriement chez les Helvètes :
« Prenez au XVIème siècle le médecin Paracelse ou l’helléniste humaniste Thomas Platter, marcheurs infatigables franchissant les cols alpestres, de la neige jusqu’aux hanches, pour passer de Kiev à Salamanque, de Lübeck à Tunis et enrichir ou transmettre leur savoir, leur imago mundi. […] Plus près de nous : les voyages transsibériens de Cendrars, les enquêtes amérindiennes de Métraux, les randonnées verticales d’Auguste Piccard dans la stratosphère ou sous-marines dans la fosse des îles Tonga, les vadrouilles érudites d’un Charles-Albert Cingria entre vergers à pommes acides et bibliothèques à antiphonaires. » ([5])
Le voyage pour une lecture non monodique mais polyphonique du monde, ce sera alors voyager avec les mains et les yeux d’un écrivain et d’un photographe-chercheur d’images : « ce métier aussi répandu que celui de charmeur de rats ou de chien truffier… ». Et la formation à l’image, comme contrepoint à la littérature, c’est au Japon que l’écrivain en fera un exercice professionnel :
« Je suis devenu photographe par désespoir et portraitiste par accident. A Tokyo en 1955 (…) Mes premiers clients ont été les commerçants du petit quartier de banlieue où j’habitais, et mes premiers sujets, des portraits (…) J’étais payé en nature : six œufs frais, une petite pieuvre, trois chemises blanchies et amidonnées, une séance chez le masseur. Seules les prostituées du ravissant quartier réservé, qui jouxtait le nôtre, et qui sont toujours en fonds, payaient cash ; cela permettait d’acheter la pellicule et d’envoyer du courrier en Europe. […] Comment j’ai pu passer de cette humble clientèle à celle plus exigeante des magazines photographiques japonais reste un mystère que je m’explique mal. Mais cet apprentissage, parce qu’il était humain, cocasse et chaleureux, m’a donné pour toujours le goût des visages. » ([6])
Au métier de photographe s’ajoute celui d’iconographe, traqueur d’images, et que Nicolas Bouvier définit comme :
« l’héritier direct de ces colporteurs d’almanachs ou d’estampes qui faisaient autrefois les foires, leur baluchon sur le dos, et offraient pour un batz ou un sou des planches naïvement coloriées qui figuraient la grande peste de Marseille, le « bon sauvage » du Sépik ou le ballon de M. de Montgolfier et illustraient la chronique du moment. » ([7])
Voyager conduit l’écrivain « à murmurer des histoires », et la parole naît « d’une géographie concrète patiemment investie et subie ». ([8])De l’Asie, que Bouvier ressent comme la mère de l’Europe, « Asie, mère courbée » (Lorenzo Pestelli), cette Asie conquise par l’Occident, dans les universités de la fin des années 40, le jeune étudiant se confronte au « blanc de la carte » :
«… je suis donc allé chercher comme Gorki « mes universités sur les routes » et ce que j’ai pu percevoir de l’immense et merveilleux passé asiatique m’est venu sans manuels ni leçons, mais par la plante des pieds. » ([9])
La destination de l’Asie c’est le chemin vers la transparence, mais c’est aussi, d’une certaine manière, reconquérir la légèreté, ne pas se laisser aller à l’opacité, « se débarrasser par érosion du superflu ». Voyager c’est tout un jeu d’équilibre à trouver :
« Et si l’on souhaite raconter ce qu’on a vu, être, dans la définition stendhalienne « un miroir promené le long d’une grande route », il faudra que le langage subisse la même épreuve, chaque mot passé au feu, et comme alchimiquement « éprouvé », tout ce qui sonne juste étant le fruit de combustions ou de distillations successives qui s’opèrent souvent à notre insu. » ([10])
Les livres sont des routes interminables, sont aussi la promesse de prodiges, des pages et des pages de « manuscrits, grimoires, vélins, incunables, traités de botanique, d’alchimie ou de navigations… »([11]) Dans les contrées de la littérature vagabonde, Bouvier connaît d’autres éblouissements avec Ella Maillart (…et la Chine centrale), Maurice Chappaz (La Tentation de l’Orient), Patrick Leigh Fermor pour Le temps des offrandes, qu’il considère comme « le plus beau journal de marche, avec « Pantagonie » de Bruce Chatwin et « Chemin faisant » de Jacques Lacarrière. Un des chefs-d’œuvre de l’humanisme nomade. » ([12])Sur sa lecture d’Henry Miller, et notamment de son fameux Printemps noir :
« … je vis un satori de lecture qui me guérit pour un bon mois de quelques infirmités et questions (…) Chaque fois que je rencontre, et c’est souvent, un de mes frères humains en déroute, je lui donne ce petit livre. Chaque fois que pour moi le ciel se couvre, que la route que j’ai choisie semble ne mener nulle part, je l’ouvre à la page 81 et j’y puise immanquablement dérision, courage et espoir. » ([13])
Voyager c’est vivre plusieurs mois de routes qui vous privent de lectures. Mais vivre le monde dans un « vagabondage planétaire » peut aussi vous assurer quelques enchantements inattendus : « à mesure qu’on chemine on s’allège. » L’état nomade, nous rappelle Bouvier, est aussi accès à un monde poétique.


Afghanistan / La route de Kaboul
Si de 1800 à 1922, l’accès à l’est et au sud de l’Afghanistan était rendu impossible par l’armée anglaise des Indes, du temps de Bouvier et de Vernet tact et patience pouvaient suffire.
A Kandahar, réduit à l’apathie par une fièvre anarchique, Nicolas Bouvier souffre d’une malaria vivax. Et pendant la maladie, c’est aussi l’horrible expérience de la mouche d’Asie, en rien comparable à celle d’Europe, à vous tourmenter les nerfs : « Au moindre instant de repos, elle vous prend pour un cheval crevé, elle attaque ses morceaux favoris : commissures des lèvres, conjonctives, tympan. »([14])
De Kandahar à Kaboul, quelques routes de terre battue sous un ciel d’altitude, il faut rejoindre Kaboul, entre l’Hindoustan et le Khorassan, un pays marqué par les « Mémoires » de l’empereur Zahir-al-din-Babur (le Tigre), fondateur de la dynastie moghole de l’Inde : « C‘est un brevet pour une ville d’envoûter ainsi un homme de cette qualité. » ([15]) Contemporain de François Ier, le grand padichah se révèle pour l’écrivain-nomade un « personnage merveilleux (…) dont la connaissance me paraît profitable à toute personne engagée dans la découverte de l’Inde. »([16])
Le conquérant, mort à l’âge de 47 ans, aura trouvé le temps de rédiger ses « Mémoires ». Le Journal connait deux traductions, l’une en persan et l’autre en türk tchaghataï, la langue maternelle de Babour. Dans « Journal de Genève » du 14 juin 1986, Nicolas Bouvier lui consacre un article : « Découvrez Babour le Magnifique ».
« Comme Babour, j’avais aimé Kaboul à la passion » [[17]]

Zahir-al-din-Babur
(1483-1530)
Traverser le massif de L’Hindou Kouch, au nord de Kaboul, à 4000 m d’altitude pour regagner le Turkménistan. Gravir le col du Shibar en camion, et après les gorges et les abîmes, les accidents et les pannes, les duretés du climat, atteindre Kunduz, puis cheminer à pied jusqu’au Château des Païens fréquenté par les archéologues en mission de la Délégation archéologique française du professeur Daniel Schlumberger. Une réflexion sur l’écriture et l’archéologie s’impose, car autant sur le besoin de fouiller la mémoire que de fouiller la terre, écriture et archéologie ne sont pas sans avoir quelques points communs. Six années après son séjour au Château des Païens, Bouvier s’interroge :
« Mais le sens de cette fouille ? après tout : ces étrangers qui passent des années (…) à vivre en pionniers dans un coin de steppe solitaire pour ressusciter des Mages ou des dynastes morts depuis dix-huit siècles (…) Et puis pourquoi s’obstiner à parler de ce voyage ? quel rapport avec ma vie présente ? aucun, je n’ai plus de présent (…) creuser la terrifiante épaisseur de terre (…) (Voilà aussi de l’archéologie ! chacun ses tessons et ses ruines, mais c’est toujours le même désastre quand du passé se perd). Forer à travers cette indifférence qui abolit, qui défigure, qui tue, et retrouver l’entrain d’alors, les mouvements de l’esprit, la souplesse, les nuances, les moirures de la vie (…) Au lieu de quoi : ce lieu désert qu’est devenue ma tête, la silencieuse corrosion de la mémoire (…) »([18])

© Nicolas Bouvier, Thierry Vernet et sa femme Floristella Stephani à Ceylan, en 1955.
La « descente de l’Inde » / décembre 1954 – mars 1955 : le lyrisme de la route indienne
Lahore, deuxième ville du Pakistan, « une ville très personnelle qui vous saisit du premier coup… » ; Pendjab, la première ville de l’Inde ; Ambala, « une ville admirable sous un ciel qui était un ciel de véritable joaillerie » ; l’ancienne cité commerciale de Mathura sur l’axe Delhi-Bombay ; puis Gwalior où trouver réconfort, dans l'État indien du Madhya Pradesh : un nom qui tinte comme un bijou, vieille ville « jolie, menue, avec quelques chemins de poussière en velours… », aux odeurs « de girofle, de pâtisserie et de pneu surchauffé ». La « descente de l’Inde » est une descente en sauts de puce de quatre mois et demie, avant d’atteindre Ceylan. Il y a aussi l’incontournable Bombay, si snobée par les Européens, de par son côté très hybride :
« Bombay est, un peu comme l’Alexandrie d’avant-guerre, une ville qui héberge, qui habite un très grand nombre de communautés différentes : vous avez le milieu des Marathes, vous avez dans les affaires le milieu des Parsis, vous avez le milieu des cotonniers musulmans du Hyderabad qui travaillent sur le marché de Bombay, une colonie européenne importante et intéressante car ce sont des gens qui sont très épris du pays, enfin vous avez, parmi d’autres milieux, le milieu des Russes blancs et celui des Goanais. Et j’en oublie certainement. C’est donc une sorte de Babel très cosmopolite, dans laquelle une sorte de dialogue est-ouest, celui que Kipling jugeait impossible, peut parfaitement s’instaurer. » ([19])
The Grand Trunk Road relie Peshawar à Calcutta, sur plus de 3000 kilomètres. C’est là que Nicolas Bouvier dit avoir fait « la connaissance avec une seconde dimension de l’Inde, que j’appellerai le lyrisme de l’espace ». ([20])
Je traverse les récits de voyages de Nicolas Bouvier en un parcours ponctué de cahotements, de trépidations, qui donnent à ma lecture itinérante un certain tempo, comme un accès à des territoires hybrides de la pensée. Je mesure ce que l’espace, en termes de voyage, ou de déplacement sur une surface donnée, peut avoir de lyrique : le phrasé de son rythme cardiaque, le souffle de son alphabet, l’haleine de sa poésie.
Lire ces récits donne des couleurs à l’esprit : je me sens comme habitée du grand mystère du monde, et je ressens comme une amplitude à penser le voyage telle une opposition contre tout ce qui ne relève plus de l’incantation. Chaque voyage restitué par la mémoire, cette mémoire que l’on qualifie toujours de fragile, à la lisière du mensonge ou de l’amnésie, je me sens un être de chair et d’os dans la géomancie du monde. Je vibre de ma propre survivance. Le secret du monde est d’être un secret, et comme tout secret il ne peut que promettre un long voyage de vivre. Et au cœur du « vivre », les étincelles, les poussières, les scories.
Les voyages de Nicolas Bouvier sont des huiles aux couleurs primaires, des dessins à l’encre noire, des photographies de l’Ailleurs et Autrement. Ils esquissent une mémoire de reliefs, de perspectives, et par l’écriture empreinte de cet espace lyrique Nicolas Bouvier nous a restitué tous les grands spectacles de la route dont il fut un formidable observateur et témoin.
Au-dessus de la table où j’écris est accrochée une petite boussole d’acier bruni qui date de la guerre de 1914. Elle indique encore le Nord d’une aiguille qui tremble un peu ; le jour où elle cessera de le montrer, je mourrai. ([21])
Avril 2014 © Nathalie Riera (Les carnets d’eucharis)
L’usage du monde
AUTOUR DU « SAKI BAR »
[…] Sans l’odeur j’aurais pu oublier la journée. Mais malgré le savon, la douche, une chemise propre, je puais l’ordure. A chaque respiration, je revoyais cette plaine fumante et noire libérer par bouffées ses dernières molécules instables pour rejoindre enfin l’inertie élémentaire et le repos ; cette matière au bout de ses peines, au terme de ses réincarnations, dont cent ans d’ondée et de soleil n’auraient plus tiré un brin d’herbe. Les vautours qui picoraient ce néant ne manquaient pas de nerf ; la succulence de la charogne avait depuis longtemps déserté leur mémoire. La couleur, le goût, la forme même, fruits d’associations délicieuses, mais fugaces, n’étaient pas souvent au menu. Négligeant ces efflorescences passagères, perchés en pleine permanence, en pleine torpeur, ils digéraient la dure affirmation de Démocrite : ni le doux ni l’amer n’existent, mais seulement les atomes et le vide entre les atomes.[…]
[Extrait de « L’usage du monde » in Nicolas Bouvier, ŒUVRES– p.334]
-------------------------
Chronique japonaise
I – LE CAHIER GRIS
[…] le froid, le poids du froid, son importance dans la vie ici : il entre du grelottement dans la musique japonaise, quant aux arbres ! ces branchures tordues anguleuses, comme s’ils avaient des crampes, comme si le froid s’en était mêlé. Et toutes ces attitudes du corps qui frappent dans le théâtre ou dans l’estampe : gestes étriqués, ramenés à soi, qui ont pour seul but d’empêcher la chaleur du corps de s’enfuir […]
[Extrait de « Chronique japonaise » in Nicolas Bouvier, ŒUVRES– p.499/500]
-------------------------
Le poisson-scorpion
[…] Travaillé tout l’après-midi au récit de la bataille de Kadesh (1286 av. J.-C.). J’aime les Hittites, cette civilisation rustique et si clémente qui dort sous trois mille ans d’humus de feuilles de saules anatoliens. C’est pour moi ici un contrepoids de fraîcheur, et le moment de fixer des images encore nettes dans mon esprit. J’ai bon espoir aussi de vendre cet article. J’aime les Hittites parce qu’ils détestaient les chicanes. Tout ce que je connais d’eux n’est qu’une inlassable exhortation au bon sens. S’il fallait vraiment faire la guerre, alors ils la gagnaient, grâce à une charioterie incomparable et une tactique pleine d’astuces de derrière les fagots. Ramsès II a eu tort de leur chercher querelle. Malgré ses bas-reliefs triomphalistes, il s’est bel et bien fait rosser. J’ai revu cette empoignade sur l’Oronte comme si j’y étais : la poussière soulevée par les chars, les tiares, les cris d’agonie, les contingents grecs et philistins engagés contre l’Egypte, les bijoux sonores des putains qui suivaient les deux armées. J’avais la tête claire ; les mots qui me venaient pesaient comme un caillou dans la poche, calibré pour la fronde de David.
[Extrait de « Poisson-Scorpion » in Nicolas Bouvier, OEUVRES – p.767/768]
-------------------------
D’UN PLUS PETIT QUE SOI…
Va voir la fourmi, paresseux, et inspire-toi de ses œuvres.
Proverbes, VI, 6.
[…] De tous mes pensionnaires, le cancrelat est le plus inoffensif et le plus irritant. Le cancrelat est un vaurien. Il n’a aucune tenue dans ce monde ni dans l’autre. Plutôt qu’une créature c’est un brouillon. Depuis le pliocène il n’a rien fait pour s’améliorer. Ne parlons pas de sa couleur tabac chiqué pour laquelle la nature ne s’était vraiment pas mise en frais. Mais ces évolutions erratiques, sans aucun projet décelable ! ce port de casque subalterne et furtif, cette couardise au moment du trépas ! Voilà pourquoi longtemps que je ne les écrase plus, à cause des fossoyeurs de toutes sortes, autrement dangereux, que ces dépouilles m’amènent. J’en reconnais même quelques uns, parmi les plus sales et les plus négligés – un léger clopinement, une aile rongée – auxquels j’ai donné des sobriquets affectueux mais dérisoires. Leur étourderie, souvent mortelle, me fait même sourire aujourd’hui. Leurs trajets sur ma table ou autour de ma chaise sont marqués par un affolement tel qu’il les fait parfois culbuter. D’un cancrelat sur le dos, autant dire qu’il est perdu et qu’il le sait. Il faut voir alors cet abdomen palpitant offert à la vigilance de tous les dards, pinces, mandibules, appétits qui mettent tant d’animation dans ce logis ; le battement des pattes qui télégraphient de mélancoliques adieux, la panique convulsive des antennes alertées par le frôlement d’un rôdeur qui s’approche ou par le vol irrité de la guêpe ichneumon qui cherche justement un garde-manger pour y pondre ses œufs. Il y a plus de monde qu’on ne l’imagine dans cette chambre où je me sens pourtant si seul et le cancrelat – Dieu soit loué – n’y compte pas que des amis. La vie des insectes ressemble en ceci à la nôtre on n’y a pas plutôt fait connaissance qu’il y a déjà un vainqueur et un vaincu.
[Extrait de « Poisson-Scorpion » in Nicolas Bouvier, OEUVRES – p.779/780]
-------------------------
Tribulations d’un iconographe
BIBLIOTHÈQUES
[…] je n’ai pas oublié le jour où, ouvrant le traité d’anatomie de Rivière, publié par Estienne (1545), volume quasiment neuf légué à la bibliothèque en 1715, et jamais consulté parce que déjà caduc ou jugé libertin à cause des superbes femmes à chignon élégamment éviscérées, j’en avais décollé les pages avec un léger chuintement, l’encre, quatre siècles après l’édition, n’étant pas sèche. Journées entières de cette lanterne magique qui allait du XVe au XXe siècle, dans le silence et la lumière tamisée de cette petite officine et dans un « passé-présent » qui me montait à la tête. Heures vécues avec les images de Mantegna, de Dürer, de Calcar ou de Callot, et de tant d’autres, vivant dans un temps autre et sortant de ma petite « cagna » tout ébloui par le soleil de fin d’après-midi sur les pelouses de l’université, garnies d’odalisques-étudiantes en mini-jupes, et me disant, avec mes cinquante kilos de matériel sur le dos, et considéré par toutes comme un portefaix ou un Aliboron, que la « petite échelle fort officieuse » serait tout à fait de saison.
[Extrait de « Tribulations d’un iconographe » in Nicolas Bouvier, ŒUVRES– p.1096/1097]
-------------------------
■■■
Les livres de Nicolas Bouvier :
L'Usage du monde, 1963, Payot poche, 1992
Japon, éditions Rencontre - L'Atlas des Voyages, Lausanne, 1967
Chronique japonaise, 1975, éditions Payot, 1989
Le Poisson-scorpion, 1982, éditions Gallimard, Folio, 1996
Les Boissonas, une dynastie de photographes, éditions Payot, Lausanne, 1983
Journal d'Aran et d'autres lieux, éditions Payot, 1990
L'Art populaire en Suisse, éditions Zoé 1991
Le Hibou et la baleine, éditions Zoé, Genève, 1993
Les Chemins du Halla-San, éditions Zoé, Genève, 1994
Comment va l'écriture ce matin ?, éditions Slatkine, Genève, 1996
Routes et déroutes, entretiens avec Irène Liechtenstein-Fall, Éditions Métropolis, 1997
La Chambre rouge et autres textes, éditions Métropolis, 1998
Le Dehors et le dedans, éditions Zoé, Genève, 1998
Entre errance et éternité, éditions Zoé, Genève, 1998
Une orchidée qu'on appela vanille, éditions Métropolis, Genève, 1998
Dans la vapeur blanche du soleil : les photographies de Nicolas Bouvier ; Nicolas Bouvier; Thierry Vernet; Pierre Starobinski; Éditeur : Genève : Zoe, 1999
La Guerre à huit ans, éditions Mini Zoé, Genève, 1999
L'Échappée belle, éloge de quelques pérégrins, éditions Métropolis, Genève, 2000
Histoires d'une image, éditions Zoé, Genève, 2001
L'Œil du voyageur, éditions Hoëbeke, 2001
Le Japon de Nicolas Bouvier, éditions Hoëbeke, 2002 (réédition de Japon, éditions Rencontre - L'atlas des Voyages)
Le Vide et le plein (Carnets du Japon, 1964-1970), éditions Hoëbeke 2004
Œuvres, Gallimard, 2004 (1428 pp, sous la direction d'Éliane Bouvier, préface de Christine Jordis). Contient : Premiers écrits ; L'Usage du monde ; La Descente de l'Inde ; Chronique japonaise ; Le Poisson-scorprion ; Le Dehors et le dedans ; Voyage dans les Lowlands ; Journal d'Aran et d'autres lieux ; L'Art populaire en Suisse (extraits) ; Histoires d'une image ; Le Hibou et la baleine ; La Chambre rouge ; La Guerre à huit ans ; Routes et déroutes + photographies, cartes, documents, biographie.
Charles-Albert Cingria en roue libre, éditions Zoé, Genève, 2005
Poussières et musiques du monde, CD Enregistrement de Zagreb à Tokyo
Correspondance des routes croisées 1945-1964, texte établi, annoté et présenté par Daniel Maggetti et Stéphane Pétermann, Éd. Zoé, Genève, 2010, 1650 pages.
Il faudra repartir, Voyages inédits, éditions Payot, 2012, textes réunis et présentés par François Laut, édition établie en collaboration avec Mario Pasa.
-------------------------
Nicolas Bouvier, S’arracher, s’attacher
de Doris Jakubec et Marlyse Pietri, Nicolas Bouvier (photographies) (Louis Vuitton, « Collection VOYAGER AVEC… – 2013)
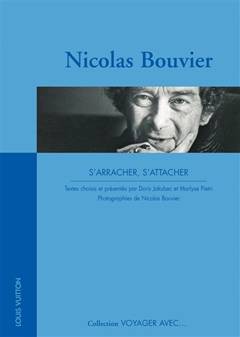
■Site Louis Vuitton http://www.louisvuitton.fr/front/#/fra_FR/Collections/Femme/Livres--ecriture
Doris Jakubec a dirigé pendant 23 ans le Centre de recherches sur les lettres romandes de l'Université de Lausanne et se consacre au rayonnement de la littérature romande par des conférences et des publications.
De Nicolas Bouvier, elle a préfacé Le Dehors et le Dedans dans l’édition Points Seuil et édité le livre posthume, Charles Albert Cingria en roue libre.
Marlyse Pietri est la fondatrice des Editions Zoé qu’elle a dirigées jusqu’en 2011.
Elle a publié de nombreux ouvrages de Nicolas Bouvier dont sa correspondance avec Thierry Vernet, la Correspondance des routes croisées.
Nicolas Bouvier, Oeuvres
Édition publiée sous la direction d'Eliane Bouvier avec la collaboration de Pierre Starobinski. Préface de Christine Jordis
(Quarto Gallimard – 2009)
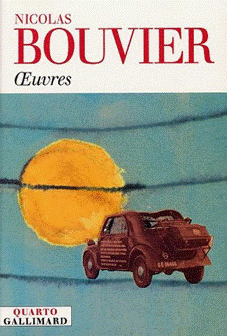
■Site Gallimard http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Quarto/OEuvres11
À quel envoûtement obéit un jeune Suisse bien né, sur le berceau duquel les fées se sont penchées, pour «prendre la route» à 24 ans, ses diplômes en poche, en Fiat Topolino, mais sans un sou vaillant et pour un aller simple ? Il est décidé à en découdre. Avec lui-même, avec la vie et avec l'écriture. De la Yougoslavie au Japon, c'est dur, mais c'est cette dureté qu'il recherche : la descente en soi qui peut être illumination ou descente aux enfers, l'intensité de l'instant et l'ennui qu'il faut meubler avec des riens. Le pittoresque, l'observation ne sont que des supports à la quête de soi et à la douleur de l'écriture, mais ils nous valent des portraits truculents, des récits merveilleux car ce conteur est un enchanteur. Il fait son miel avec les surprises de la route qui ne sont pas ce que l'on croit. Ainsi ce corps encombrant qui réclame chaque jour sa pitance et que frappe un cortège de malarias, de jaunisses à répétitions, sans parler des dents qui prennent la poudre d'escampette. On s'en va «pour que la route vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées par les lessives qu'on vous tend avec un éclat de savon dans les bordels... Sans ce détachement et cette transparence, comment espérer faire voir ce qu'on a vu ?». Mission accomplie. Nicolas Bouvier a payé sa livre de chair et bien au-delà, et son écriture de l'extrême exigence, de l'économie du mot, fait de nous des visionnaires par procuration auxquels il arrache «des râles de plaisir».
Il faudra repartir
Voyages inédits
(Payot – 2012)
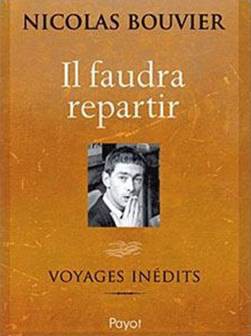
■Site Payot
http://www.agendaculturel.com/Livre_Carnets_de_route
Des textes inédits rédigés en des pays sur lesquels le célèbre voyageur n'a rien publié de son vivant : telles sont les pépites de ses archives sur près d'un demi-siècle, du jeune homme de dix-huit ans qui, en 1948, écrit son premier récit de voyage entre Genève et Copenhague, rempli d'illusions qu'il veut 'rendre réelles', à l'écrivain reconnu qui, en 1992, sillonne les routes néo-zélandaises, à la fois fourbu et émerveillé. Tout le talent de Nicolas Bouvier apparaît dans ces carnets : portraitiste et observateur hors pair, mais également reporter, historien, ethnographe, conférencier, photographe, poète.
[1]Nicolas Bouvier, « Le Hibou et la Baleine », Zoé, 1993 – publié à l’occasion du film de Patricia Plattner, « Nicolas Bouvier, le hibou et la baleine ».
[2]« Réflexions sur l’espace et l’écriture » (p.1054) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009
[3] « Ces rêves venus du froid » (p.1099) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009
[4]Ibid., (p.1054)
[5]Ibid., (p.1057)
[6] « Notes en vrac sur le visage » (p.703/704) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009
[7] « Tribulations d’un iconographe » (p.1087) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009
[8] « Réflexions sur l’espace et l’écriture » (p.1054) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009
[9]Ibid., (p.1059)
[10]Ibid., (p.1062)
[11]Ibid., (p.1088)
[12](p.1077)
[13] (p.1085)
[14] « L’usage du monde » (p.344) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009
[15]Ibid., (p.353)
[16] « La descente de l’Inde » (p.460) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009
[17]Ibid., (p.463)
[18] « L’usage du monde » (p.379) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009
[19] « La descente de l’Inde » (p.464) in Nicolas Bouvier Œuvres, Quarto Gallimard, 2009
[20]Ibid., (p.444)
[21] Nicolas Bouvier, (Le Nord) Le hibou et la baleine
22:18 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |
Imprimer | | ![]() Facebook
Facebook